 home page
home page
 pagina iniziale
pagina iniziale
|

|
by
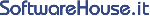
|


|
Ebook in formato Kindle (mobi) - Kindle File Ebook (mobi)
Formato per Iphone, Ipad e Ebook (epub) - Ipad, Iphone and Ebook reader format (epub)
Versione ebook di Readme.it powered by Softwarehouse.itStendhal
(Henri Beyle)
LA CHARTREUSE DE PARME
AVERTISSEMENT
C'est dans l'hiver de 1830 et à trois cents lieues de Paris que cette nouvelle fut écrite ; ainsi aucune allusion aux choses de 1839.
Bien des années avant 1830dans le temps où nos armées parcouraient l'Europele hasard me donna un billet de logement pour la maison d'un chanoine : c'était à Padouecharmante ville d'Italie ; le séjour s'étant prolongénous devînmes amis.
Repassant à Padoue vers la fin de 1830je courus à la maison du bon chanoine : il n'était plusje le savaismais je voulais revoir le salon où nous avions passé tant de soirées aimablesetdepuissi souvent regrettées. Je trouvai le neveu du chanoine et la femme de ce neveu qui me reçurent comme un vieil ami. Quelques personnes survinrentet l'on ne se sépara que fort tard ; le neveu fit venir du café Pedroti un excellent zambajon. Ce qui nous fit veiller surtoutce fut l'histoire de la duchesse Sanseverina à laquelle quelqu'un fit allusionet que le neveu voulut bien raconter tout entièreen mon honneur.
-- Dans le pays où je vaisdis-je à mes amisje ne trouverai guère de soirées comme celle-ciet pour passer les longues heures du soir je ferai une nouvelle de votre histoire.
-- En ce casdit le neveuje vais vous donner les annales de mon onclequià l'article Parmementionne quelques-unes des intrigues de cette courdu temps que la duchesse y faisait la pluie et le beau temps ; maisprenez garde ! cette histoire n'est rien moins que moraleet maintenant que vous vous piquez de pureté évangélique en Franceelle peut vous procurer le renom d'assassin.
Je publie cette nouvelle sans rien changer au manuscrit de 1830ce qui peut avoir deux inconvénients :
Le premier pour le lecteur : les personnages étant italiens l'intéresseront peut-être moinsles coeurs de ce pays-là diffèrent assez des coeurs français : les Italiens sont sincèresbonnes gensetnon effarouchésdisent ce qu'ils pensent ; ce n'est que par accès qu'ils ont de la vanité ; alors elle devient passionet prend le nom de puntiglio. Enfin la pauvreté n'est pas un ridicule parmi eux.
Le second inconvénient est relatif à l'auteur.
J'avouerai que j'ai eu la hardiesse de laisser aux personnages les aspérités de leurs caractères ; maisen revancheje le déclare hautementje déverse le blâme le plus moral sur beaucoup de leurs actions. A quoi bon leur donner la haute moralité et les grâces des caractères françaislesquels aiment l'argent par-dessus tout et ne font guère de péchés par haine ou par amour ? Les Italiens de cette nouvelle sont à peu près le contraire. D'ailleurs il me semble que toutes les fois qu'on s'avance de deux cents lieues du midi au nordil y a lieu à un nouveau paysage comme à un nouveau roman. L'aimable nièce du chanoine avait connu et même beaucoup aimé la duchesse Sanseverinaet me prie de ne rien changer à ses aventureslesquelles sont blâmables.
23 janvier 1839.
Livre Premier
Chapitre Premier.
MILAN EN 1796.
Le 15 mai 1796le général Bonaparte fit son entrée dans Milan à la tête de cette jeune armée qui venait de passer le pont de Lodiet d'apprendre au monde qu'après tant de siècles César et Alexandre avaient un successeur. Les miracles de bravoure et de génie dont l'Italie fut témoin en quelques mois réveillèrent un peuple endormi; huit jours encore avant l'arrivée des Françaisles Milanais ne voyaient en eux qu'un ramassis de brigandshabitués à fuir toujours devant les troupes de Sa Majesté Impériale et Royale: c'était du moins ce que leur répétait trois fois la semaine un petit journal grand comme la mainimprimé sur du papier sale.
Au moyen âgeles Lombards républicains avaient fait preuve d'une bravoure égale à celle des Françaiset ils méritèrent de voir leur ville entièrement rasée par les empereurs d'Allemagne. Depuis qu'ils étaient devenus de fidèles sujetsleur grande affaire était d'imprimer des sonnets sur de petits mouchoirs de taffetas rose quand arrivait le mariage d'une jeune fille appartenant à quelque famille noble ou riche. Deux ou trois ans après cette grande époque de sa viecette jeune fille prenait un cavalier servant: quelquefois le nom du sigisbée choisi par la famille du mari occupait une place honorable dans le contrat de mariage. Il y avait loin de ces moeurs efféminées aux émotions profondes que donna l'arrivée imprévue de l'armée française. Bientôt surgirent des moeurs nouvelles et passionnées. Un peuple tout entier s'aperçutle 15 mai 1796que tout ce qu'il avait respecté jusque-là était souverainement ridicule et quelquefois odieux. Le départ du dernier régiment de l'Autriche marqua la chute des idées anciennes: exposer sa vie devint à la mode; on vit que pour être heureux après des siècles de sensations affadissantesil fallait aimer la patrie d'un amour réel et chercher les actions héroïques. On était plongé dans une nuit profonde par la continuation du despotisme jaloux de Charles Quint et de Philippe II; on renversa leurs statueset tout à coup l'on se trouva inondé de lumière. Depuis une cinquantaine d'annéeset à mesure que l'Encyclopédie et Voltaire éclataient en Franceles moines criaient au bon peuple de Milanqu'apprendre à lire ou quelque chose au monde était une peine fort inutileet qu'en payant bien exactement la dîme à son curéet lui racontant fidèlement tous ses petits péchéson était à peu près sûr d'avoir une belle place en paradis. Pour achever d'énerver ce peuple autrefois si terrible et si raisonneurl'Autriche lui avait vendu à bon marché le privilège de ne point fournir de recrues à son armée.
En 1796l'armée milanaise se composait de vingt-quatre faquins habillés de rougelesquels gardaient la ville de concert avec quatre magnifiques régiments de grenadiers hongrois. La liberté des moeurs était extrêmemais la passion fort rare; d'ailleursoutre le désagrément de devoir tout raconter au curésous peine de ruine même en ce mondele bon peuple de Milan était encore soumis à certaines petites entraves monarchiques qui ne laissaient pas que d'être vexantes. Par exemple l'archiducqui résidait à Milan et gouvernait au nom de l'Empereurson cousinavait eu l'idée lucrative de faire le commerce des blés. En conséquencedéfense aux paysans de vendre leurs grains jusqu'à ce que Son Altesse eût rempli ses magasins.
En mai 1796trois jours après l'entrée des Françaisun jeune peintre en miniatureun peu founommé Groscélèbre depuiset qui était venu avec l'arméeentendant raconter au grand café des Servi (à la mode alors) les exploits de l'archiducqui de plus était énormeprit la liste des glaces imprimée en placard sur une feuille de vilain papier jaune. Sur le revers de la feuille il dessina le gros archiduc; un soldat français lui donnait un coup de baïonnette dans le ventreetau lieu de sangil en sortait une quantité de blé incroyable. La chose nommée plaisanterie ou caricature n'était pas connue en ce pays de despotisme cauteleux. Le dessin laissé par Gros sur la table du café des Servi parut un miracle descendu du ciel; il fut gravé dans la nuitet le lendemain on en vendit vingt mille exemplaires.
Le même jouron affichait l'avis d'une contribution de guerre de six millionsfrappée pour les besoins de l'armée françaiselaquellevenant de gagner six batailles et de conquérir vingt provincesmanquait seulement de souliersde pantalonsd'habits et de chapeaux.
La masse de bonheur et de plaisir qui fit irruption en Lombardie avec ces Français si pauvres fut telle que les prêtres seuls et quelques nobles s'aperçurent de la lourdeur de cette contribution de six millionsquibientôtfut suivie de beaucoup d'autres. Ces soldats français riaient et chantaient toute la journée; ils avaient moins de vingt-cinq anset leur général en chefqui en avait vingt-septpassait pour l'homme le plus âgé de son armée. Cette gaietécette jeunessecette insouciancerépondaient d'une façon plaisante aux prédications furibondes des moines quidepuis six moisannonçaient du haut de la chaire sacrée que les Français étaient des monstresobligéssous peine de mortà tout brûler et à couper la tête à tout le monde. A cet effetchaque régiment marchait avec la guillotine en tête.
Dans les campagnes l'on voyait sur la porte des chaumières le soldat français occupé à bercer le petit enfant de la maîtresse du logiset presque chaque soir quelque tambourjouant du violonimprovisait un bal. Les contredanses se trouvant beaucoup trop savantes et compliquées pour que les soldatsqui d'ailleurs ne les savaient guèrepussent les apprendre aux femmes du paysc'étaient celles-ci qui montraient aux jeunes Français la Monférinela Sauteuse et autres danses italiennes.
Les officiers avaient été logésautant que possiblechez les gens riches; ils avaient bon besoin de se refaire. Par exempleun lieutenant nommé Robert eut un billet de logement pour le palais de la marquise del Dongo. Cet officierjeune réquisitionnaire assez lestepossédait pour tout bienen entrant dans ce palaisun écu de six francs qu'il venait de recevoir à Plaisance. Après le passage du pont de Lodiil prit à un bel officier autrichien tué par un boulet un magnifique pantalon de nankin tout neufet jamais vêtement ne vint plus à propos. Ses épaulettes d'officier étaient en laineet le drap de son habit était cousu à la doublure des manches pour que les morceaux tinssent ensemble; mais il y avait une circonstance plus triste: les semelles de ses souliers étaient en morceaux de chapeau également pris sur le champ de batailleau-delà du pont de Lodi. Ces semelles improvisées tenaient au-dessus des souliers par des ficelles fort visiblesde façon que lorsque le majordome de la maison se présenta dans la chambre du lieutenant Robert pour l'inviter à dîner avec madame la marquisecelui-ci fut plongé dans un mortel embarras. Son voltigeur et lui passèrent les deux heures qui les séparaient de ce fatal dîner à tâcher de recoudre un peu l'habit et à teindre en noir avec de l'encre les malheureuses ficelles des souliers. Enfin le moment terrible arriva. «De la vie je ne fus plus mal à mon aiseme disait le lieutenant Robert; ces dames pensaient que j'allais leur faire peuret moi j'étais plus tremblant qu'elles. Je regardais mes souliers et ne savais comment marcher avec grâce. La marquise del Dongoajoutait-ilétait alors dans tout l'éclat de sa beauté: vous l'avez connue avec ses yeux si beaux et d'une douceur angélique et ses jolis cheveux d'un blond foncé qui dessinaient si bien l'ovale de cette figure charmante. J'avais dans ma chambre une Hérodiade de Léonard de Vinci qui semblait son portrait. Dieu voulut que je fusse tellement saisi de cette beauté surnaturelle que j'en oubliai mon costume. Depuis deux ans je ne voyais que des choses laides et misérables dans les montagnes du pays de Gênes: j'osai lui adresser quelques mots sur mon ravissement.
«Mais j'avais trop de sens pour m'arrêter longtemps dans le genre complimenteur. Tout en tournant mes phrasesje voyaisdans une salle à manger toute de marbredouze laquais et des valets de chambre vêtus avec ce qui me semblait alors le comble de la magnificence. Figurez-vous que ces coquins-là avaient non seulement de bons souliersmais encore des boucles d'argent. Je voyais du coin de l'oeil tous ces regards stupides fixés sur mon habitet peut-être aussi sur mes souliersce qui me perçait le coeur. J'aurais pu d'un mot faire peur à tous ces gens; mais comment les mettre à leur place sans courir le risque d'effaroucher les dames? car la marquise pour se donner un peu de couragecomme elle me l'a dit cent fois depuisavait envoyé prendre au couvent où elle était pensionnaire en ce temps-làGina del Dongosoeur de son mariqui fut depuis cette charmante comtesse Pietranera: personne dans la prospérité ne la surpassa par la gaieté et l'esprit aimablecomme personne ne la surpassa par le courage et la sérénité d'âme dans la fortune contraire.
«Ginaqui pouvait avoir alors treize ansmais qui en paraissait dix-huitvive et franchecomme vous savezavait tant de peur d'éclater de rire en présence de mon costumequ'elle n'osait pas manger; la marquiseau contrairem'accablait de politesses contraintes; elle voyait fort bien dans mes yeux des mouvements d'impatience. En un motje faisais une sotte figureje mâchais le méprischose qu'on dit impossible à un Français. Enfin une idée descendue du ciel vint m'illuminer: je me mis à raconter à ces dames ma misèreet ce que nous avions souffert depuis deux ans dans les montagnes du pays de Gênes où nous retenaient de vieux généraux imbéciles. Làdisais-jeon nous donnait des assignats qui n'avaient pas cours dans le payset trois onces de pain par jour. Je n'avais pas parlé deux minutesque la bonne marquise avait les larmes aux yeuxet la Gina était devenue sérieuse.
-- Quoimonsieur le lieutenantme disait celle-citrois onces de pain!
-- Ouimademoiselle; mais en revanche la distribution manquait trois fois la semaine et comme les paysans chez lesquels nous logions étaient encore plus misérables que nousnous leur donnions un peu de notre pain.
«En sortant de tablej'offris mon bras à la marquise jusqu'à la porte du salonpuisrevenant rapidement sur mes pasje donnai au domestique qui m'avait servi à table cet unique écu de six francs sur l'emploi duquel j'avais fait tant de châteaux en Espagne.
«Huit jours aprèscontinuait Robertquand il fut bien avéré que les Français ne guillotinaient personnele marquis del Dongo revint de son château de Griantasur le lac de Cômeoù bravement il s'était réfugié à l'approche de l'arméeabandonnant aux hasards de la guerre sa jeune femme si belle et sa soeur. La haine que ce marquis avait pour nous était égale à sa peurc'est-à-dire incommensurable: sa grosse figure pâle et dévote était amusante à voir quand il me faisait des politesses. Le lendemain de son retour à Milanje reçus trois aunes de drap et deux cents francs sur la contribution des six millions: je me remplumaiet devins le chevalier de ces damescar les bals commencèrent. »
L'histoire du lieutenant Robert fut à peu près celle de tous les Français; au lieu de se moquer de la misère de ces braves soldatson en eut pitiéet on les aima.
Cette époque de bonheur imprévu et d'ivresse ne dura que deux petites années; la folie avait été si excessive et si généralequ'il me serait impossible d'en donner une idéesi ce n'est par cette réflexion historique et profonde: ce peuple s'ennuyait depuis cent ans.
La volupté naturelle aux pays méridionaux avait régné jadis à la cour des Visconti et des Sforceces fameux ducs de Milan. Mais depuis l'an 1635que les Espagnols s'étaient emparés du Milanaiset emparés en maîtres taciturnessoupçonneuxorgueilleuxet craignant toujours la révoltela gaieté s'était enfuie. Les peuplesprenant les moeurs de leurs maîtres songeaient plutôt à se venger de la moindre insulte par un coup de poignard qu'à jouir du moment présent.
La joie follela gaietéla voluptél'oubli de tous les sentiments tristesou seulement raisonnablesfurent poussés à un tel pointdepuis le 15 mai 1796que les Français entrèrent à Milanjusqu'en avril 1799qu'ils en furent chassés à la suite de la bataille de Cassano que l'on a pu citer de vieux marchands millionnairesde vieux usuriersde vieux notaires quipendant cet intervalleavaient oublié d'être moroses et de gagner de l'argent.
Tout au plus eût-il été possible de compter quelques familles appartenant à la haute noblessequi s'étaient retirées dans leurs palais à la campagnecomme pour bouder contre l'allégresse générale et l'épanouissement de tous les coeurs. Il est véritable aussi que ces familles nobles et riches avaient été distinguées d'une manière fâcheuse dans la répartition des contributions de guerre demandées pour l'armée française.
Le marquis del Dongocontrarié de voir tant de gaietéavait été un des premiers à regagner son magnifique château de Griantaau-delà de Cômeoù les dames menèrent le lieutenant Robert. Ce châteausitué dans une position peut-être unique au mondesur un plateau de cent cinquante pieds au-dessus de ce lac sublime dont il domine une grande partieavait été une place forte. La famille del Dongo le fit construire au quinzième sièclecomme le témoignaient de toutes parts les marbres chargés de ses armes; on y voyait encore des ponts-levis et des fossés profondsà la vérité privés d'eau; mais avec ces murs de quatre-vingts pieds de haut et de six pieds d'épaisseurce château était à l'abri d'un coup de main; et c'est pour cela qu'il était cher au soupçonneux marquis. Entouré de vingt-cinq ou trente domestiques qu'il supposait dévouésapparemment parce qu'il ne leur parlait jamais que l'injure à la boucheil était moins tourmenté par la peur qu'à Milan.
Cette peur n'était pas tout à fait gratuite: il correspondait fort activement avec un espion placé par l'Autriche sur la frontière suisse à trois lieues de Griantapour faire évader les prisonniers faits sur le champ de bataillece qui aurait pu être pris au sérieux par les généraux français.
Le marquis avait laissé sa jeune femme à Milan: elle y dirigeait les affaires de la familleelle était chargée de faire face aux contributions imposées à la casa del Dongocomme on dit dans le pays; elle cherchait à les faire diminuerce qui l'obligeait à voir ceux des nobles qui avaient accepté des fonctions publiqueset même quelques non nobles fort influents. Il survint un grand événement dans cette famille. Le marquis avait arrangé le mariage de sa jeune soeur Gina avec un personnage fort riche et de la plus haute naissance; mais il portait de la poudre: à ce titreGina le recevait avec des éclats de rireet bientôt elle fit la folie d'épouser le comte Pietranera. C'était à la vérité un fort bon gentilhommetrès bien fait de sa personnemais ruiné de père en filsetpour comble de disgrâcepartisan fougueux des idées nouvelles. Pietranera était sous-lieutenant dans la légion italiennesurcroît de désespoir pour le marquis.
Après ces deux années de folie et de bonheurle Directoire de Parisse donnant des airs de souverain bien établimontra une haine mortelle pour tout ce qui n'était pas médiocre. Les généraux ineptes qu'il donna à l'armée d'Italie perdirent une suite de batailles dans ces mêmes plaines de Véronetémoins deux ans auparavant des prodiges d'Arcole et de Lonato. Les Autrichiens se rapprochèrent de Milan; le lieutenant Robertdevenu chef de bataillon et blessé à la bataille de Cassanovint loger pour la dernière fois chez son amie la marquise del Dongo. Les adieux furent tristes; Robert partit avec le comte Pietranera qui suivait les Français dans leur retraite sur Novi. La jeune comtesseà laquelle son frère refusa de payer sa légitimesuivit l'armée montée sur une charrette.
Alors commença cette époque de réaction et de retour aux idées anciennesque les Milanais appellent i tredici mesi (les treize mois)parce qu'en effet leur bonheur voulut que ce retour à la sottise ne durât que treize moisjusqu'à Marengo. Tout ce qui était vieuxdévotmorosereparut à la tête des affaireset reprit la direction de la société: bientôt les gens restés fidèles aux bonnes doctrines publièrent dans les villages que Napoléon avait été pendu par les Mameluks en Egyptecomme il le méritait à tant de titres.
Parmi ces hommes qui étaient allés bouder dans leurs terres et qui revenaient altérés de vengeancele marquis del Dongo se distinguait par sa fureur; son exagération le porta naturellement à la tête du parti. Ces messieursfort honnêtes gens quand ils n'avaient pas peurmais qui tremblaient toujoursparvinrent à circonvenir le général autrichien: assez bon homme il se laissa persuader que la sévérité était de la haute politiqueet fit arrêter cent cinquante patriotes: c'était bien alors ce qu'il y avait de mieux en Italie.
Bientôt on les déporta aux bouches de Cattaroet jetés dans des grottes souterrainesl'humidité et surtout le manque de pain firent bonne et prompte justice de tous ces coquins.
Le marquis del Dongo eut une grande placeetcomme il joignait une avarice sordide à une foule d'autres belles qualitésil se vanta publiquement de ne pas envoyer un écu à sa soeurla comtesse Pietranera: toujours folle d'amourelle ne voulait pas quitter son mariet mourait de faim en France avec lui. La bonne marquise était désespérée; enfin elle réussit à dérober quelques petits diamants dans son écrinque son mari lui reprenait tous les soirs pour l'enfermer sous son lit dans une caisse de fer: la marquise avait apporté huit cent mille francs de dot à son mariet recevait quatre-vingts francs par mois pour ses dépenses personnelles. Pendant les treize mois que les Français passèrent hors de Milancette femme si timide trouva des prétextes et ne quitta pas le noir.
Nous avouerons quesuivant l'exemple de beaucoup de graves auteursnous avons commencé l'histoire de notre héros une année avant sa naissance. Ce personnage essentiel n'est autreen effetque Fabrice Valserramarchesino del Dongocomme on dit à Milan. [ On prononce markésine. Dans les usages du paysempruntés à l'Allemagnece titre se donne à tous les fils de marquiscontine à tous les fils de comtecontessina à toutes les filles de comteetc. ] Il venait justement de se donner la peine de naître lorsque les Français furent chasséset se trouvaitpar le hasard de la naissancele second fils de ce marquis del Dongo si grand seigneuret dont vous connaissez déjà le gros visage blêmele sourire faux et la haine sans bornes pour les idées nouvelles. Toute la fortune de la maison était substituée au fils aîné Ascanio del Dongole digne portrait de son père. Il avait huit anset Fabrice deuxlorsque tout à coup ce général Bonaparteque tous les gens bien nés croyaient pendu depuis longtempsdescendit du mont Saint-Bernard. Il entra dans Milan: ce moment est encore unique dans l'histoire; figurez-vous tout un peuple amoureux fou. Peu de jours aprèsNapoléon gagna la bataille de Marengo. Le reste est inutile à dire. L'ivresse des Milanais fut au comble; maiscette foiselle était mélangée d'idées de vengeance: on avait appris la haine à ce bon peuple. Bientôt l'on vit arriver ce qui restait des patriotes déportés aux bouches de Cattaro; leur retour fut célébré par une fête nationale. Leurs figures pâlesleurs grands yeux étonnésleurs membres amaigrisfaisaient un étrange contraste avec la joie qui éclatait de toutes parts. Leur arrivée fut le signal du départ pour les familles les plus compromises. Le marquis del Dongo fut des premiers à s'enfuir à son château de Grianta. Les chefs des grandes familles étaient remplis de haine et de peur; mais leurs femmesleurs fillesse rappelaient les joies du premier séjour des Françaiset regrettaient Milan et les bals si gaisqui aussitôt après Marengo s'organisèrent à la Casa Tanzi. Peu de jours après la victoirele général françaischargé de maintenir la tranquillité dans la Lombardies'aperçut que tous les fermiers des noblesque toutes les vieilles femmes de la campagnebien loin de songer encore à cette étonnante victoire de Marengo qui avait changé les destinées de l'Italieet reconquis treize places fortes en un journ'avaient l'âme occupée que d'une prophétie de saint Giovitale premier patron de Brescia. Suivant cette parole sacréeles prospérités des Français et de Napoléon devaient cesser treize semaines juste après Marengo. Ce qui excuse un peu le marquis del Dongo et tous les nobles boudeurs des campagnesc'est que réellement et sans comédie ils croyaient à la prophétie. Tous ces gens-là n'avaient pas lu quatre volumes en leur vie; ils faisaient ouvertement leurs préparatifs pour rentrer à Milan au bout des treize semainesmais le tempsen s'écoulantmarquait de nouveaux succès pour la cause de la France. De retour à ParisNapoléonpar de sages décretssauvait la révolution à l'intérieurcomme il l'avait sauvée à Marengo contre les étrangers. Alors les nobles lombardsréfugiés dans leurs châteauxdécouvrirent que d'abord ils avaient mal compris la prédiction du saint patron de Brescia: il ne s'agissait pas de treize semainesmais bien de treize mois. Les treize mois s'écoulèrentet la prospérité de la France semblait s'augmenter tous les jours.
Nous glissons sur dix années de progrès et de bonheurde 1800 à 1810; Fabrice passa les premières au château de Griantadonnant et recevant force coups de poing au milieu des petits paysans du villageet n'apprenant rienpas même à lire. Plus tardon l'envoya au collège des jésuites à Milan. Le marquis son père exigea qu'on lui montrât le latinnon point d'après ces vieux auteurs qui parlent toujours des républiquesmais sur un magnifique volume orné de plus de cent gravureschef-d'oeuvre des artistes du XVlIe siècle; c'était la généalogie latine des Valserramarquis del Dongopubliée en 1650 par Fabrice del Dongoarchevêque de Parme. La fortune des Valserra étant surtout militaireles gravures représentaient force batailleset toujours on voyait quelque héros de ce nom donnant de grands coups d'épée. Ce livre plaisait fort au jeune Fabrice. Sa mèrequi l'adoraitobtenait de temps en temps la permission de venir le voir à Milan; mais son mari ne lui offrant jamais d'argent pour ces voyagesc'était sa belle-soeurl'aimable comtesse Pietraneraqui lui en prêtait. Après le retour des Françaisla comtesse était devenue l'une des femmes les plus brillantes de la cour du prince Eugènevice-roi d'Italie.
Lorsque Fabrice eut fait sa première communionelle obtint du marquistoujours exilé volontairela permission de le faire sortir quelquefois de son collège. Elle le trouva singulierspirituelfort sérieuxmais joli garçonet ne déparant point trop le salon d'une femme à la mode; du resteignorant à plaisiret sachant à peine écrire. La comtessequi portait en toutes choses son caractère enthousiastepromit sa protection au chef de l'établissementsi son neveu Fabrice faisait des progrès étonnantset à la fin de l'année avait beaucoup de prix. Pour lui donner les moyens de les mériterelle l'envoyait chercher tous les samedis soiret souvent ne le rendait à ses maîtres que le mercredi ou le jeudi. Les jésuitesquoique tendrement chéris par le prince vice-roi étaient repoussés d'Italie par les lois du royaumeet le supérieur du collègehomme habilesentit tout le parti qu'il pourrait tirer de ses relations avec une femme toute-puissante à la cour. Il n'eut garde de se plaindre des absences de Fabricequiplus ignorant que jamaisà la fin de l'année obtint cinq premiers prix. A cette conditionla brillante comtesse Pietranerasuivie de son marigénéral commandant une des divisions de la gardeet de cinq ou six des plus grands personnages de la cour du vice-roivint assister à la distribution des prix chez les jésuites. Le supérieur fut complimenté par ses chefs.
La comtesse conduisait son neveu à toutes ces fêtes brillantes qui marquèrent le règne trop court de l'aimable prince Eugène. Elle l'avait créé de son autorité officier de hussardset Fabriceâgé de douze ansportait cet uniforme. Un jourla comtesseenchantée de sa jolie tournuredemanda pour lui au prince une place de pagece qui voulait dire que la famille del Dongo se ralliait. Le lendemainelle eut besoin de tout son crédit pour obtenir que le vice-roi voulût bien ne pas se souvenir de cette demandeà laquelle rien ne manquait que le consentement du père du futur pageet ce consentement eût été refusé avec éclat. A la suite de cette foliequi fit frémir le marquis boudeuril trouva un prétexte pour rappeler à Grianta le jeune Fabrice. La comtesse méprisait souverainement son frère; elle le regardait comme un sot tristeet qui serait méchant si jamais il en avait le pouvoir. Mais elle était folle de Fabriceetaprès dix ans de silenceelle écrivit au marquis pour réclamer son neveu: sa lettre fut laissée sans réponse.
A son retour dans ce palais formidablebâti par le plus belliqueux de ses ancêtresFabrice ne savait rien au monde que faire l'exercice et monter à cheval. Souvent le comte Pietraneraaussi fou de cet enfant que sa femmele faisait monter à chevalet le menait avec lui à la parade.
En arrivant au château de GriantaFabriceles yeux encore bien rouges des larmes répandues en quittant les beaux salons de sa tantene trouva que les caresses passionnées de sa mère et de ses soeurs. Le marquis était enfermé dans son cabinet avec son fils aînéle marchesino Ascanio. Ils y fabriquaient des lettres chiffrées qui avaient l'honneur d'être envoyées à Vienne; le père et le fils ne paraissaient qu'aux heures des repas. Le marquis répétait avec affectation qu'il apprenait à son successeur naturel à teniren partie doublele compte des produits de chacune de ses terres. Dans le faitle marquis était trop jaloux de son pouvoir pour parler de ces choses-là à un filshéritier nécessaire de toutes ces terres substituées. Il l'employait à chiffrer des dépêches de quinze ou vingt pages que deux ou trois fois la semaine il faisait passer en Suissed'où on les acheminait à Vienne. Le marquis prétendait faire connaître à ses souverains légitimes l'état intérieur du royaume d'Italie qu'il ne connaissait pas lui-mêmeet toutefois ses lettres avaient beaucoup de succès; voici comment. Le marquis faisait compter sur la grande routepar quelque agent sûrle nombre des soldats de tel régiment français ou italien qui changeait de garnisoneten rendant compte du fait à la cour de Vienneil avait soin de diminuer d'un grand quart le nombre des soldats présents. Ces lettresd'ailleurs ridiculesavaient le mérite d'en démentir d'autres plus véridiqueset elles plaisaient. Aussipeu de temps avant l'arrivée de Fabrice au châteaule marquis avait-il reçu la plaque d'un ordre renommé: c'était la cinquième qui ornait son habit de chambellan. A la véritéil avait le chagrin de ne pas oser arborer cet habit hors de son cabinet; mais il ne se permettait jamais de dicter une dépêche sans avoir revêtu le costume brodégarni de tous ses ordres. Il eût cru manquer de respect d'en agir autrement.
La marquise fut émerveillée des grâces de son fils. Mais elle avait conservé l'habitude d'écrire deux ou trois fois par an au général comte d'A***; c'était le nom actuel du lieutenant Robert. La marquise avait horreur de mentir aux gens qu'elle aimait; elle interrogea son fils et fut épouvantée de son ignorance.
S'il me semble peu instruitse disait-elleà moi qui ne sais rienRobertqui est si savanttrouverait son éducation absolument manquée; or maintenant il faut du mérite. Une autre particularité qui l'étonna presque autantc'est que Fabrice avait pris au sérieux toutes les choses religieuses qu'on lui avait enseignées chez les jésuites. Quoique fort pieuse elle-mêmele fanatisme de cet enfant la fit frémir; si le marquis a l'esprit de deviner ce moyen d'influenceil va m'enlever l'amour de mon fils. Elle pleura beaucoupet sa passion pour Fabrice s'en augmenta.
La vie de ce châteaupeuplé de trente ou quarante domestiquesétait fort triste; aussi Fabrice passait-il toutes ses journées à la chasse ou à courir le lac sur une barque. Bientôt il fut étroitement lié avec les cochers et les hommes des écuries; tous étaient partisans fous des Français et se moquaient ouvertement des valets de chambre dévotsattachés à la personne du marquis ou à celle de son fils aîné. Le grand sujet de plaisanterie contre ces personnages gravesc'est qu'ils portaient de la poudre à l'instar de leurs maîtres.
Livre Premier
Chapitre II.
... Alors que Vesper vint embrunir nos yeuxTout épris d'avenirje contemple les cieuxEn qui Dieu nous escritpar notes non obscuresLes sorts et les destins de toutes créatures. Car luidu fond des cieux regardant un humainParfois mû de pitiélui montre le chemin; Par les astres du ciel qui sont ses caractèresLes choses nous prédit et bonnes et contraires; Mais les hommeschargés de terre et de trépasMéprisent tel écritet ne le lisent pas.
RONSARD
Le marquis professait une haine vigoureuse pour les lumières: ce sont les idéesdisait-ilqui ont perdu l'Italie; il ne savait trop comment concilier cette sainte horreur de l'instructionavec le désir de voir son fils Fabrice perfectionner l'éducation si brillamment commencée chez les jésuites. Pour courir le moins de risques possibleil chargea le bon abbé Blanèscuré de Griantade faire continuer à Fabrice ses études en latin. Il eût fallu que le curé lui-même sût cette langue; or elle était l'objet de ses mépris; ses connaissances en ce genre se bornaient à réciterpar coeurles prières de son misseldont il pouvait rendre à peu près le sens à ses ouailles. Mais ce curé n'en était pas moins fort respecté et même redouté dans le canton; il avait toujours dit que ce n'était point en treize semaines ni même en treize moisque l'on verrait s'accomplir la célèbre prophétie de saint Giovitale patron de Brescia. Il ajoutaitquand il parlait à des amis sûrsque ce nombre treize devait être interprété d'une façon qui étonnerait bien du mondes'il était permis de tout dire (1813).
Le fait est que l'abbé Blanèspersonnage d'une honnêteté et d'une vertu primitiveset de plus homme d'espritpassait toutes les nuits au haut de son clocher; il était fou d'astrologie. Après avoir usé ses journées à calculer des conjonctions et des positions d'étoilesil employait la meilleure part de ses nuits à les suivre dans le ciel. Par suite de sa pauvretéil n'avait d'autre instrument qu'une longue lunette à tuyau de carton. On peut juger du mépris qu'avait pour l'étude des langues un homme qui passait sa vie à découvrir l'époque précise de la chute des empires et des révolutions qui changent la face du monde. Que sais-je de plus sur un chevaldisait-il à Fabricedepuis qu'on m'a appris qu'en latin il s'appelle equus ?
Les paysans redoutaient l'abbé Blanès comme un grand magicien: pour luià l'aide de la peur qu'inspiraient ses stations dans le clocheril les empêchait de voler. Ses confrères les curés des environsfort jaloux de son influencele détestaient; le marquis del Dongo le méprisait tout simplement parce qu'il raisonnait trop pour un homme de si bas étage. Fabrice l'adorait: pour lui plaire il passait quelquefois des soirées entières à faire des additions ou des multiplications énormes. Puis il montait au clocher: c'était une grande faveur et que l'abbé Blanès n'avait jamais accordée à personne; mais il aimait cet enfant pour sa naïveté. Si tu ne deviens pas hypocritelui disait-ilpeut-être tu seras un homme.
Deux ou trois fois par anFabriceintrépide et passionné dans ses plaisirsétait sur le point de se noyer dans le lac. Il était le chef de toutes les grandes expéditions des petits paysans de Grianta et de la Cadenabia. Ces enfants s'étaient procuré quelques petites clefset quand la nuit était bien noireils essayaient d'ouvrir les cadenas de ces chaînes qui attachent les bateaux à quelque grosse pierre ou à quelque arbre voisin du rivage. Il faut savoir que sur le lac de Côme l'industrie des pêcheurs place des lignes dormantes à une grande distance des bords. L'extrémité supérieure de la corde est attachée à une planchette doublée de liègeet une branche de coudrier très flexiblefichée sur cette planchettesoutient une petite sonnette qui tinte lorsque le poissonpris à la lignedonne des secousses à la corde.
Le grand objet de ces expéditions nocturnesque Fabrice commandait en chefétait d'aller visiter les lignes dormantesavant que les pêcheurs eussent entendu l'avertissement donné par les petites clochettes. On choisissait les temps d'orage; etpour ces parties hasardeuseson s'embarquait le matinune heure avant l'aube. En montant dans la barqueces enfants croyaient se précipiter dans les plus grands dangersc'était là le beau côté de leur action; etsuivant l'exemple de leurs pèresils récitaient dévotement un Ave Maria. Oril arrivait souvent qu'au moment du départet à l'instant qui suivait l'Ave MariaFabrice était frappé d'un présage. C'était là le fruit qu'il avait retiré des études astrologiques de son ami l'abbé Blanèsaux prédictions duquel il ne croyait point. Suivant sa jeune imaginationce présage lui annonçait avec certitude le bon ou le mauvais succès; et comme il avait plus de résolution qu'aucun de ses camaradespeu à peu toute la troupe prit tellement l'habitude des présagesque siau moment de s'embarqueron apercevait sur la côte un prêtreou si l'on voyait un corbeau s'envoler à main gaucheon se hâtait de remettre le cadenas à la chaîne du bateauet chacun allait se recoucher. Ainsi l'abbé Blanès n'avait pas communiqué sa science assez difficile à Fabrice; mais à son insuil lui avait inoculé une confiance illimitée dans les signes qui peuvent prédire l'avenir.
Le marquis sentait qu'un accident arrivé à sa correspondance chiffrée pouvait le mettre à la merci de sa soeur; aussi tous les ansà l'époque de la Sainte-Angelafête de la comtesse PietraneraFabrice obtenait la permission d'aller passer huit jours à Milan. Il vivait toute l'année dans l'espérance ou le regret de ces huit jours. En cette grande occasionpour accomplir ce voyage politiquele marquis remettait à son fils quatre écusetsuivant l'usagene donnait rien à sa femmequi le menait. Mais un des cuisinierssix laquais et un cocher avec deux chevauxpartaient pour Cômela veille du voyageet chaque jourà Milanla marquise trouvait une voiture à ses ordreset un dîner de douze couverts.
Le genre de vie boudeur que menait le marquis del Dongo était assurément fort peu divertissant; mais il avait cet avantage qu'il enrichissait à jamais les familles qui avaient la bonté de s'y livrer. Le marquisqui avait plus de deux cent mille livres de renten'en dépensait pas le quart; il vivait d'espérances. Pendant les treize années de 1800 à 1813il crut constamment et fermement que Napoléon serait renversé avant six mois. Qu'on juge de son ravissement quandau commencement de 1813il apprit les désastres de la Bérésina! La prise de Paris et la chute de Napoléon faillirent lui faire perdre la tête; il se permit alors les propos les plus outrageants envers sa femme et sa soeur. Enfinaprès quatorze années d'attenteil eut cette joie inexprimable de voir les troupes autrichiennes rentrer dans Milan. D'après les ordres venus de Viennele général autrichien reçut le marquis del Dongo avec une considération voisine du respect; on se hâta de lui offrir une des premières places dans le gouvernementet il l'accepta comme le paiement d'une dette. Son fils aîné eut une lieutenance dans l'un des plus beaux régiments de la monarchie; mais le second ne voulut jamais accepter une place de cadet qui lui était offerte. Ce triomphedont le marquis jouissait avec une insolence rarene dura que quelques moiset fut suivi d'un revers humiliant. Jamais il n'avait eu le talent des affaireset quatorze années passées à la campagneentre ses valetsson notaire et son médecin jointes à la mauvaise humeur de la vieillesse qui était survenueen avaient fait un homme tout à fait incapable. Or il n'est pas possibleen pays autrichiende conserver une place importante sans avoir le genre de talent que réclame l'administration lente et compliquéemais fort raisonnablede cette vieille monarchie. Les bévues du marquis del Dongo scandalisaient les employés et même arrêtaient la marche des affaires. Ses propos ultra-monarchiques irritaient les populations qu'on voulait plonger dans le sommeil et l'incurie. Un beau jouril apprit que Sa Majesté avait daigné accepter gracieusement la démission qu'il donnait de son emploi dans l'administrationet en même temps lui conférait la place de second grand majordome major du royaume lombardo-vénitien. Le marquis fut indigné de l'injustice atroce dont il était victime; il fit imprimer une lettre à un amilui qui exécrait tellement la liberté de la presse. Enfin il écrivit à l'Empereur que ses ministres le trahissaientet n'étaient que des jacobins. Ces choses faitesil revint tristement à son château de Grianta. Il eut une consolation. Après la chute de Napoléoncertains personnages puissants à Milan firent assommer dans les rues le comte Prinaancien ministre du roi d'Italieet homme du premier mérite. Le comte Pietranera exposa sa vie pour sauver celle du ministrequi fut tué à coups de parapluieet dont le supplice dura cinq heures. Un prêtreconfesseur du marquis del Dongoeût pu sauver Prina en lui ouvrant la grille de l'église de San Giovannidevant laquelle on traînait le malheureux ministrequi même un instant fut abandonné dans le ruisseauau milieu de la rue mais il refusa d'ouvrir sa grille avec dérisionetsix mois aprèsle marquis eut le bonheur de lui faire obtenir un bel avancement.
Il exécrait le comte Pietranerason beau-frèrelequeln'ayant pas cinquante louis de renteosait être assez contents'avisait de se montrer fidèle à ce qu'il avait aimé toute sa vieet avait l'insolence de prôner cet esprit de justice sans acception de personnesque le marquis appelait un jacobinisme infâme. Le comte avait refusé de prendre du service en Autricheon fit valoir ce refusetquelques mois après la mort de Prinales mêmes personnages qui avaient payé les assassins obtinrent que le général Pietranera serait jeté en prison. Sur quoi la comtessesa femmeprit un passeport et demanda des chevaux de poste pour aller à Vienne dire la vérité à l'Empereur. Les assassins de Prina eurent peuret l'un d'euxcousin de madame Pietraneravint lui apporter à minuitune heure avant son départ pour Viennel'ordre de mettre en liberté son mari. Le lendemainle général autrichien fit appeler le comte Pietranerale reçut avec toute la distinction possibleet l'assura que sa pension de retraite ne tarderait pas à être liquidée sur le pied le plus avantageux. Le brave général Bubnahomme d'esprit et de coeuravait l'air tout honteux de l'assassinat de Prina et de la prison du comte.
Après cette bourrasqueconjurée par le caractère ferme de la comtesseles deux époux vécurenttant bien que malavec la pension de retraitequigrâce à la recommandation du général Bubnane se fit pas attendre.
Par bonheuril se trouva quedepuis cinq ou six ansla comtesse avait beaucoup d'amitié pour un jeune homme fort richelequel était aussi ami intime du comteet ne manquait pas de mettre à leur disposition le plus bel attelage de chevaux anglais qui fût alors à Milansa loge au théâtre de la Scalaet son château à la campagne. Mais le comte avait la conscience de sa bravoureson âme était généreuseil s'emportait facilementet alors se permettait d'étranges propos. Un jour qu'il était à la chasse avec des jeunes gensl'un d'euxqui avait servi sous d'autres drapeaux que luise mit à faire des plaisanteries sur la bravoure des soldats de la république cisalpine; le comte lui donna un souffletl'on se battit aussitôtet le comtequi était seul de son bordau milieu de tous ces jeunes gensfut tué. On parla beaucoup de cette espèce de duelet les personnes qui s'y étaient trouvées prirent le parti d'aller voyager en Suisse.
Ce courage ridicule qu'on appelle résignationle courage d'un sot qui se laisse prendre sans mot dire n'était point à l'usage de la comtesse. Furieuse de la mort de son marielle aurait voulu que Limercatice jeune homme richeson ami intimeprît aussi la fantaisie de voyager en Suisseet de donner un coup de carabine ou un soufflet au meurtrier du comte Pietranera.
Limercati trouva ce projet d'un ridicule achevé et la comtesse s'aperçut que chez elle le mépris avait tué l'amour. Elle redoubla d'attention pour Limercati; elle voulait réveiller son amouret ensuite le planter là et le mettre au désespoir. Pour rendre ce plan de vengeance intelligible en Franceje dirai qu'à Milanpays fort éloigné du nôtreon est encore au désespoir par amour. La comtessequidans ses habits de deuil éclipsait de bien loin toutes ses rivalesfit des coquetteries aux jeunes gens qui tenaient le haut du pavéet l'un d'euxle comte N...quide tout tempsavait dit qu'il trouvait le mérite de Limercati un peu lourdun peu empesé pour une femme d'autant d'esprit devint amoureux fou de la comtesse. Elle écrivit à Limercati:
«Voulez-vous agir une fois en homme d'esprit?
«Figurez-vous que vous ne m'avez jamais connue.
«Je suisavec un peu de mépris peut-êtrevotre très humble servante
«GINA PIETRANERA »
A la lecture de ce billetLimercati partit pour un de ses châteaux; son amour s'exaltail devint fouet parla de se brûler la cervellechose inusitée dans les pays à enfer. Dès le lendemain de son arrivée à la campagneil avait écrit à la comtesse pour lui offrir sa main et ses deux cent mille livres de rente. Elle lui renvoya sa lettre non décachetée par le groom du comte N... Sur quoi Limercati a passé trois ans dans ses terresrevenant tous les deux mois à Milanmais sans avoir jamais le courage d'y resteret ennuyant tous ses amis de son amour passionné pour la comtesseet du récit circonstancié des bontés que jadis elle avait pour lui. Dans les commencementsil ajoutait qu'avec le comte N... elle se perdaitet qu'une telle liaison la déshonorait.
Le fait est que la comtesse n'avait aucune sorte d'amour pour le comte N...et c'est ce qu'elle lui déclara quand elle fut tout à fait sûre du désespoir de Limercati. Le comtequi avait de l'usagela pria de ne point divulguer la triste vérité dont elle lui faisait confidence: -- Si vous avez l'extrême indulgenceajouta-t-ilde continuer à me recevoir avec toutes les distinctions extérieures accordées à l'amant régnantje trouverai peut-être une place convenable.
Après cette déclaration héroïque la comtesse ne voulut plus des chevaux ni de la loge du comte N... Mais depuis quinze ans elle était accoutumée à la vie la plus élégante: elle eut à résoudre ce problème difficile ou pour mieux dire impossible: vivre à Milan avec une pension de quinze cents francs. Elle quitta son palaisloua deux chambres à un cinquième étagerenvoya tous ses gens et jusqu'à sa femme de chambre remplacée par une pauvre vieille faisant des ménages. Ce sacrifice était dans le fait moins héroïque et moins pénible qu'il ne nous semble; à Milan la pauvreté n'est pas un ridiculeet partant ne se montre pas aux âmes effrayées comme le pire des maux. Après quelques mois de cette pauvreté nobleassiégée par les lettres continuelles de Limercatiet même du comte N... qui lui aussi voulait épouseril arriva que le marquis del Dongoordinairement d'une avarice exécrablevint à penser que ses ennemis pourraient bien triompher de la misère de sa soeur. Quoi! une del Dongo être réduite à vivre avec la pension que la cour de Viennedont il avait tant à se plaindreaccorde aux veuves de ses généraux!
Il lui écrivit qu'un appartement et un traitement dignes de sa soeur l'attendaient au château de Grianta. L'âme mobile de la comtesse embrassa avec enthousiasme l'idée de ce nouveau genre de vie; il y avait vingt ans qu'elle n'avait pas habité ce château vénérable s'élevant majestueusement au milieu des vieux châtaigniers plantés du temps des Sforce. Làse disait-elleje trouverai le reposetà mon âgen'est-ce pas le bonheur? (Comme elle avait trente et un ans elle se croyait arrivée au moment de la retraite.) Sur ce lac sublime où je suis néem'attend enfin une vie heureuse et paisible.
Je ne sais si elle se trompaitmais ce qu'il y a de sûr c'est que cette âme passionnéequi venait de refuser si lestement l'offre de deux immenses fortunesapporta le bonheur au château de Grianta. Ses deux nièces étaient folles de joie.-- Tu m'as rendu les beaux jours de la jeunesselui disait la marquise en l'embrassant; la veille de ton arrivéej'avais cent ans. La comtesse se mit à revoiravec Fabricetous ces lieux enchanteurs voisins de Griantaet si célébrés par les voyageurs: la villa Melzi de l'autre côté du lacvis-à-vis le châteauet qui lui sert de point de vueau-dessus le bois sacré des Sfondrataet le hardi promontoire qui sépare les deux branches du laccelle de Cômesi voluptueuseet celle qui court vers Leccopleine de sévérité: aspects sublimes et gracieuxque le site le plus renommé du mondela baie de Napleségalemais ne surpasse point. C'était avec ravissement que la comtesse retrouvait les souvenirs de sa première jeunesse et les comparait à ses sensations actuelles. Le lac de Cômese disait-ellen'est point environnécomme le lac de Genèvede grandes pièces de terre bien closes et cultivées selon les meilleures méthodeschoses qui rappellent l'argent et la spéculation. Ici de tous côtés je vois des collines d'inégales hauteurs couvertes de bouquets d'arbres plantés par le hasardet que la main de l'homme n'a point encore gâtés et forcés à rendre du revenu. Au milieu de ces collines aux formes admirables et se précipitant vers le lac par des pentes si singulièresje puis garder toutes les illusions des descriptions du Tasse et de l'Arioste. Tout est noble et tendretout parle d'amourrien ne rappelle les laideurs de la civilisation. Les villages situés à mi-côte sont cachés par de grands arbreset au-dessus des sommets des arbres s'élève l'architecture charmante de leurs jolis clochers. Si quelque petit champ de cinquante pas de large vient interrompre de temps à autre les bouquets de châtaigniers et de cerisiers sauvagesl'oeil satisfait y voit croître des plantes plus vigoureuses et plus heureuses là qu'ailleurs. Par-delà ces collinesdont le faîte offre des ermitages qu'on voudrait tous habiterl'oeil étonné aperçoit les pics des Alpestoujours couverts de neigeet leur austérité sévère lui rappelle des malheurs de la vie ce qu'il en faut pour accroître la volupté présente. L'imagination est touchée par le son lointain de la cloche de quelque petit village caché sous les arbres: ces sons portés sur les eaux qui les adoucissent prennent une teinte de douce mélancolie et de résignationet semblent dire à l'homme: La vie s'enfuitne te montre donc point si difficile envers le bonheur qui se présentehâte-toi de jouir. Le langage de ces lieux ravissantset qui n'ont point de pareils au monderendit à la comtesse son coeur de seize ans. Elle ne concevait pas comment elle avait pu passer tant d'années sans revoir le lac. Est-ce donc au commencement de la vieillessese disait-elleque le bonheur se serait réfugié? Elle acheta une barque que Fabricela marquise et elle ornèrent de leurs mainscar on manquait d'argent pour toutau milieu de l'état de maison le plus splendide; depuis sa disgrâce le marquis del Dongo avait redoublé de faste aristocratique. Par exemplepour gagner dix pas de terrain sur le lacprès de la fameuse allée de platanesà côté de la Cadenabiail faisait construire une digue dont le devis allait à quatre-vingt mille francs. A l'extrémité de la digue on voyait s'éleversur les dessins du fameux marquis Cagnolaune chapelle bâtie tout entière en blocs de granit énormesetdans la chapelleMarchesile sculpteur à la mode de Milanlui bâtissait un tombeau sur lequel des bas-reliefs nombreux devaient représenter les belles actions de ses ancêtres.
Le frère aîné de Fabricele marchesine Ascagnevoulut se mettre des promenades de ces dames; mais sa tante jetait de l'eau sur ses cheveux poudréset avait tous les jours quelque nouvelle niche à lancer à sa gravité. Enfin il délivra de l'aspect de sa grosse figure blafarde la joyeuse troupe qui n'osait rire en sa présence. On pensait qu'il était l'espion du marquis son pèreet il fallait ménager ce despote sévère et toujours furieux depuis sa démission forcée.
Ascagne jura de se venger de Fabrice.
Il y eut une tempête où l'on courut des dangers; quoiqu'on eût infiniment peu d'argenton paya généreusement les deux bateliers pour qu'ils ne dissent rien au marquisqui déjà témoignait beaucoup d'humeur de ce qu'on emmenait ses deux filles. On rencontra une seconde tempête; elles sont terribles et imprévues sur ce beau lac: des rafales de vent sortent à l'improviste de deux gorges de montagnes placées dans des directions opposées et luttent sur les eaux. La comtesse voulut débarquer au milieu de l'ouragan et des coups de tonnerre; elle prétendait queplacée sur un rocher isolé au milieu du lacet grand comme une petite chambreelle aurait un spectacle singulier; elle se verrait assiégée de toutes parts par des vagues furieusesmaisen sautant de la barqueelle tomba dans l'eau. Fabrice se jeta après elle pour la sauveret tous deux furent entraînés assez loin. Sans doute il n'est pas beau de se noyermais l'ennuitout étonnéétait banni du château féodal. La comtesse s'était passionnée pour le caractère primitif et pour l'astrologie de l'abbé Blanès. Le peu d'argent qui lui restait après l'acquisition de la barque avait été employé à acheter un petit télescope de rencontreet presque tous les soirsavec ses nièces et Fabriceelle allait s'établir sur la plate-forme d'une des tours gothiques du château. Fabrice était le savant de la troupeet l'on passait là plusieurs heures fort gaiementloin des espions.
Il faut avouer qu'il y avait des journées où la comtesse n'adressait la parole à personne; on la voyait se promener sous les hauts châtaigniersplongée dans de sombres rêveries; elle avait trop d'esprit pour ne pas sentir parfois l'ennui qu'il y a à ne pas échanger ses idées. Mais le lendemain elle riait comme la veille: c'étaient les doléances de la marquisesa belle-soeurqui produisaient ces impressions sombres sur cette âme naturellement si agissante.
-- Passerons-nous donc ce qui nous reste de jeunesse dans ce triste château! s'écriait la marquise.
Avant l'arrivée de la comtesseelle n'avait pas même le courage d'avoir de ces regrets.
L'on vécut ainsi pendant l'hiver de 1814 à 1815. Deux foismalgré sa pauvretéla comtesse vint passer quelques jours à Milan; il s'agissait de voir un ballet sublime de Viganodonné au théâtre de la Scalaet le marquis ne défendait point à sa femme d'accompagner sa belle-soeur. On allait toucher les quartiers de la petite pensionet c'était la pauvre veuve du général cisalpin qui prêtait quelques sequins à la richissime marquise del Dongo. Ces parties étaient charmantes; on invitait à dîner de vieux amiset l'on se consolait en riant de toutcomme de vrais enfants. Cette gaieté italiennepleine de brio et d'imprévufaisait oublier la tristesse sombre que les regards du marquis et de son fils aîné répandaient autour d'eux à Grianta. Fabrice à peine âgé de seize ansreprésentait fort bien le chef de la maison.
Le 7 mars 1815les dames étaient de retourdepuis l'avant-veilled'un charmant petit voyage de Milan; elles se promenaient dans la belle allée de platanes récemment prolongée sur l'extrême bord du lac. Une barque parutvenant du côté de Cômeet fit des signes singuliers. Un agent du marquis sauta sur la digue: Napoléon venait de débarquer au golfe de Juan. L'Europe eut la bonhomie d'être surprise de cet événementqui ne surprit point le marquis del Dongo; il écrivit à son souverain une lettre pleine d'effusion de coeur; il lui offrait ses talents et plusieurs millionset lui répétait que ses ministres étaient des jacobins d'accord avec les meneurs de Paris.
Le 8 marsà six heures du matinle marquisrevêtu de ses insignesse faisait dicterpar son fils aînéle brouillon d'une troisième dépêche politique; il s'occupait avec gravité à la transcrire de sa belle écriture soignéesur du papier portant en filigrane l'effigie du souverain. Au même instantFabrice se faisait annoncer chez la comtesse Pietranera.
-- Je parslui dit-ilje vais rejoindre l'Empereurqui est aussi roi d'Italie; il avait tant d'amitié pour ton mari! Je passe par la Suisse. Cette nuità Menagiomon ami Vasile marchand de baromètresm'a donné son passeport; maintenant donne-moi quelques napoléonscar je n'en ai que deux à moi; mais s'il le fautj'irai à pied.
La comtesse pleurait de joie et d'angoisse.-- Grand Dieu! pourquoi faut-il que cette idée te soit venue! s'écriait-elle en saisissant les mains de Fabrice.
Elle se leva et alla prendre dans l'armoire au lingeoù elle était soigneusement cachéeune petite bourse ornée de perles; c'était tout ce qu'elle possédait au monde.
-- Prendsdit-elle à Fabrice; mais au nom de Dieu! ne te fais pas tuer. Que restera-t-il à ta malheureuse mère et à moisi tu nous manques? Quant au succès de Napoléonil est impossiblemon pauvre ami; nos messieurs sauront bien le faire périr. N'as-tu pas entenduil y a huit joursà Milanl'histoire des vingt-trois projets d'assassinat tous si bien combinés et auxquels il n'échappa que par miracle? et alors il était tout-puissant. Et tu as vu que ce n'est pas la volonté de le perdre qui manque à nos ennemis; la France n'était plus rien depuis son départ.
C'était avec l'accent de l'émotion la plus vive que la comtesse parlait à Fabrice des futures destinées de Napoléon. -- En te permettant d'aller le rejoindreje lui sacrifie ce que j'ai de plus cher au mondedisait-elle. Les yeux de Fabrice se mouillèrentil répandit des larmes en embrassant la comtessemais sa résolution de partir ne fut pas un instant ébranlée. Il expliquait avec effusion à cette amie si chère toutes les raisons qui le déterminaientet que nous prenons la liberté de trouver bien plaisantes.
-- Hier soiril était six heures moins sept minutesnous nous promenionscomme tu saissur le bord du lac dans l'allée de platanesau-dessous de la Casa Sommarivaet nous marchions vers le sud. Làpour la première foisj'ai remarqué au loin le bateau qui venait de Cômeporteur d'une si grande nouvelle. Comme je regardais ce bateau sans songer à l'Empereuret seulement enviant le sort de ceux qui peuvent voyagertout à coup j'ai été saisi d'une émotion profonde. Le bateau a pris terrel'agent a parlé bas à mon pèrequi a changé de couleuret nous a pris à part pour nous annoncer la terrible nouvelle. Je me tournai vers le lac sans autre but que de cacher les larmes de joie dont mes yeux étaient inondés. Tout à coupà une hauteur immense et à ma droite j'ai vu un aiglel'oiseau de Napoléon; il volait majestueusement se dirigeant vers la Suisseet par conséquent vers Paris. Et moi aussime suis-je dit à l'instantje traverserai la Suisse avec la rapidité de l'aigleet j'irai offrir à ce grand homme bien peu de chosemais enfin tout ce que je puis offrirle secours de mon faible bras. Il voulut nous donner une patrie et il aima mon oncle. A l'instantquand je voyais encore l'aiglepar un effet singulier mes larmes se sont taries; et la preuve que cette idée vient d'en hautc'est qu'au même momentsans discuterj'ai pris ma résolution et j'ai vu les moyens d'exécuter ce voyage. En un clin d'oeil toutes les tristesses quicomme tu saisempoisonnent ma viesurtout les dimanchesont été comme enlevées par un souffle divin. J'ai vu cette grande image de l'Italie se relever de la fange où les Allemands la retiennent plongée [ C'est un personnage passionné qui parleil traduit en prose quelques vers du célèbre Monti. ]; elle étendait ses bras meurtris et encore à demi chargés de chaînes vers son roi et son libérateur. Et moime suis-je ditfils encore inconnu de cette mère malheureuseje partiraij'irai mourir ou vaincre avec cet homme marqué par le destinet qui voulut nous laver du mépris que nous jettent même les plus esclaves et les plus vils parmi les habitants de l'Europe.
-- Tu saisajouta-t-il à voix basse en se rapprochant de la comtesseet fixant sur elle ses yeux d'où jaillissaient des flammestu sais ce jeune marronnier que ma mèrel'hiver de ma naissanceplanta elle-même au bord de la grande fontaine dans notre forêtà deux lieues d'ici: avant de rien fairej'ai voulu l'aller visiter. Le printemps n'est pas trop avancéme disais-je: eh bien! si mon arbre a des feuillesce sera un signe pour moi. Moi aussi je dois sortir de l'état de torpeur où je languis dans ce triste et froid château. Ne trouves-tu pas que ces vieux murs noircissymboles maintenant et autrefois moyens du despotismesont une véritable image du triste hiver? ils sont pour moi ce que l'hiver est pour mon arbre.
Le croirais-tuGina? hier soir à sept heures et demie j'arrivais à mon marronnier; il avait des feuillesde jolies petites feuilles déjà assez grandes! Je les baisai sans leur faire de mal. J'ai bêché la terre avec respect à l'entour de l'arbre chéri. Aussitôtrempli d'un transport nouveauj'ai traversé la montagne; je suis arrivé à Menagio: il me fallait un passeport pour entrer en Suisse. Le temps avait voléil était déjà une heure du matin quand je me suis vu à la porte de Vasi. Je pensais devoir frapper longtemps pour le réveiller; mais il était debout avec trois de ses amis. A mon premier mot: «Tu vas rejoindre Napoléon! » s'est-il écriéet il m'a sauté au cou. Les autres aussi m'ont embrassé avec transport. «Pourquoi suis-je marié! » disait l'un d'eux.
Madame Pietranera était devenue pensive; elle crut devoir présenter quelques objections. Si Fabrice eût eu la moindre expérienceil eût bien vu que la comtesse elle-même ne croyait pas aux bonnes raisons qu'elle se hâtait de lui donner. Maisà défaut d'expérienceil avait de la résolution; il ne daigna pas même écouter ces raisons. La comtesse se réduisit bientôt à obtenir de lui que du moins il fît part de son projet à sa mère.
-- Elle le dira à mes soeurset ces femmes me trahiront à leur insu! s'écria Fabrice avec une sorte de hauteur héroïque.
-- Parlez donc avec plus de respectdit la comtesse souriant au milieu de ses larmesdu sexe qui fera votre fortune; car vous déplairez toujours aux hommesvous avez trop de feu pour les âmes prosaïques.
La marquise fondit en larmes en apprenant l'étrange projet de son fils; elle n'en sentait pas l'héroïsmeet fit tout son possible pour le retenir. Quand elle fut convaincue que rien au mondeexcepté les murs d'une prisonne pourrait l'empêcher de partir elle lui remit le peu d'argent qu'elle possédait; puis elle se souvint qu'elle avait depuis la veille huit ou dix petits diamants valant peut-être dix mille francsque le marquis lui avait confiés pour les faire monter à Milan. Les soeurs de Fabrice entrèrent chez leur mère tandis que la comtesse cousait ces diamants dans l'habit de voyage de notre héros; il rendait à ces pauvres femmes leurs chétifs napoléons. Ses soeurs furent tellement enthousiasmées de son projetelles l'embrassaient avec une joie si bruyante qu'il prit à la main quelques diamants qui restaient encore à cacheret voulut partir sur-le-champ.
-- Vous me trahiriez à votre insudit-il à ses soeurs. Puisque j'ai tant d'argentil est inutile d'emporter des hardes; on en trouve partout. Il embrassa ces personnes qui lui étaient si chèreset partit à l'instant même sans vouloir rentrer dans sa chambre. Il marcha si vitecraignant toujours d'être poursuivi par des gens à chevalque le soir même il entrait à Lugano. Grâce à Dieuil était dans une ville suisseet ne craignait plus d'être violenté sur la route solitaire par des gendarmes payés par son père. De ce lieuil lui écrivit une belle lettrefaiblesse d'enfant qui donna de la consistance à la colère du marquis. Fabrice prit la postepassa le Saint-Gothard; son voyage fut rapideet il entra en France par Pontarlier. L'Empereur était à Paris. Là commencèrent les malheurs de Fabrice; il était parti dans la ferme intention de parler à l'Empereur: jamais il ne lui était venu à l'esprit que ce fût chose difficile. A Milandix fois par jour il voyait le prince Eugène et eût pu lui adresser la parole. A Paristous les matinsil allait dans la cour du château des Tuileries assister aux revues passées par Napoléon; mais jamais il ne put approcher de l'Empereur. Notre héros croyait tous les Français profondément émus comme lui de l'extrême danger que courait la patrie. A la table de l'hôtel où il était descenduil ne fit point mystère de ses projets et de son dévouement; il trouva des jeunes gens d'une douceur aimableencore plus enthousiastes que luiet quien peu de joursne manquèrent pas de lui voler tout l'argent qu'il possédait. Heureusementpar pure modestieil n'avait pas parlé des diamants donnés par sa mère. Le matin oùà la suite d'une orgieil se trouva décidément voléil acheta deux beaux chevauxprit pour domestique un ancien soldat palefrenier du maquignonetdans son mépris pour les jeunes Parisiens beaux parleurspartit pour l'armée. Il ne savait riensinon qu'elle se rassemblait vers Maubeuge. A peine fut-il arrivé sur la frontièrequ'il trouva ridicule de se tenir dans une maisonoccupé à se chauffer devant une bonne cheminéetandis que des soldats bivouaquaient. Quoi que pût lui dire son domestiquequi ne manquait pas de bon sensil courut se mêler imprudemment aux bivouacs de l'extrême frontièresur la route de Belgique. A peine fut-il arrivé au premier bataillon placé à côté de la routeque les soldats se mirent à regarder ce jeune bourgeoisdont la mise n'avait rien qui rappelât l'uniforme. La nuit tombaitil faisait un vent froid. Fabrice s'approcha d'un feuet demanda l'hospitalité en payant. Les soldats se regardèrent étonnés surtout de l'idée de payeret lui accordèrent avec bonté une place au feu; son domestique lui fit un abri. Maisune heure aprèsl'adjudant du régiment passant à portée du bivouacles soldats allèrent lui raconter l'arrivée de cet étranger parlant mal français. L'adjudant interrogea Fabricequi lui parla de son enthousiasme pour l'Empereur avec un accent fort suspect; sur quoi ce sous-officier le pria de le suivre jusque chez le colonelétabli dans une ferme voisine. Le domestique de Fabrice s'approcha avec les deux chevaux. Leur vue parut frapper si vivement l'adjudant sous-officierqu'aussitôt il changea de penséeet se mit à interroger aussi le domestique. Celui- ciancien soldatdevinant d'abord le plan de campagne de son interlocuteurparla des protections qu'avait son maîtreajoutant quecerteson ne lui chiperait pas ses beaux chevaux. Aussitôt un soldat appelé par l'adjudant lui mit la main sur le collet; un autre soldat prit soin des chevauxetd'un air sévèrel'adjudant ordonna à Fabrice de le suivre sans répliquer.
Après lui avoir fait faire une bonne lieueà pieddans l'obscurité rendue plus profonde en apparence par le feu des bivouacs qui de toutes parts éclairaient l'horizonl'adjudant remit Fabrice à un officier de gendarmerie quid'un air gravelui demanda ses papiers. Fabrice montra son passeport qui le qualifiait marchand de baromètres portant sa marchandise.
-- Sont-ils bêtess'écria l'officierc'est aussi trop fort!
Il fit des questions à notre héros qui parla de l'Empereur et de la liberté dans les termes du plus vif enthousiasme; sur quoi l'officier de gendarmerie fut saisi d'un rire fou.
-- Parbleu! tu n'es pas trop adroit! s'écria-t-il. Il est un peu fort de café que l'on ose nous expédier des blancs-becs de ton espèce! Et quoi que pût dire Fabricequi se tuait à expliquer qu'en effet il n'était pas marchand de baromètresl'officier l'envoya à la prison de B...petite ville du voisinage où notre héros arriva sur les trois heures du matinoutré de fureur et mort de fatigue.
Fabriced'abord étonnépuis furieuxne comprenant absolument rien à ce qui lui arrivaitpassa trente-trois longues journées dans cette misérable prison; il écrivait lettres sur lettres au commandant de la placeet c'était la femme du geôlierbelle Flamande de trente-six ansqui se chargeait de les faire parvenir. Mais comme elle n'avait nulle envie de faire fusiller un aussi joli garçonet que d'ailleurs il payait bienelle ne manquait pas de jeter au feu toutes ces lettres. Le soirfort tardelle daignait venir écouter les doléances du prisonnier; elle avait dit à son mari que le blanc-bec avait de l'argentsur quoi le prudent geôlier lui avait donné carte blanche. Elle usa de la permission et reçut quelques napoléons d'orcar l'adjudant n'avait enlevé que les chevauxet l'officier de gendarmerie n'avait rien confisqué du tout. Une après-midi du mois de juinFabrice entendit une forte canonnade assez éloignée. On se battait donc enfin! son coeur bondissait d'impatience. Il entendit aussi beaucoup de bruit dans la ville; en effet un grand mouvement s'opéraittrois divisions traversaient B... Quandsur les onze heures du soirla femme du geôlier vint partager ses peinesFabrice fut plus aimable encore que de coutume; puis lui prenant les mains:
-- Faites-moi sortir d'icije jurerai sur l'honneur de revenir dans la prison dès qu'on aura cessé de se battre.
-- Balivernes que tout cela! As-tu du quibus ? Il parut inquietil ne comprenait pas le mot quibus. La geôlièrevoyant ce mouvementjugea que les eaux étaient bassesetau lieu de parler de napoléons d'or comme elle l'avait résoluelle ne parla plus que de francs.
-- Ecoutelui dit-ellesi tu peux donner une centaine de francsje mettrai un double napoléon sur chacun des yeux du caporal qui va venir relever la garde pendant la nuit. Il ne pourra te voir partir de prisonet si son régiment doit filer dans la journéeil acceptera.
Le marché fut bientôt conclu. La geôlière consentit même à cacher Fabrice dans sa chambre d'où il pourrait plus facilement s'évader le lendemain matin.
Le lendemainavant l'aubecette femme tout attendrie dit à Fabrice:
-- Mon cher petittu es encore bien jeune pour faire ce vilain métier: crois-moin'y reviens plus.
-- Mais quoi! répétait Fabriceil est donc criminel de vouloir défendre la patrie?
-- Suffit. Rappelle-toi toujours que je t'ai sauvé la vie; ton cas était nettu aurais été fusillémais ne le dis à personnecar tu nous ferais perdre notre place à mon mari et à moi; surtout ne répète jamais ton mauvais conte d'un gentilhomme de Milan déguisé en marchand de baromètresc'est trop bête. Ecoute-moi bienje vais te donner les habits d'un hussard mort avant-hier dans la prison: n'ouvre la bouche que le moins possiblemais enfinsi un maréchal des logis ou un officier t'interroge de façon à te forcer de répondredis que tu es resté malade chez un paysan qui t'a recueilli par charité comme tu tremblais la fièvre dans un fossé de la route. Si l'on n'est pas satisfait de cette réponseajoute que tu vas rejoindre ton régiment. On t'arrêtera peut-être à cause de ton accent: alors dis que tu es né en Piémontque tu es un conscrit resté en France l'année passéeetc.etc.
Pour la première foisaprès trente-trois jours de fureurFabrice comprit le fin mot de tout ce qui lui arrivait. On le prenait pour un espion. Il raisonna avec la geôlièrequice matin-làétait fort tendreet enfin tandis qu'armée d'une aiguille elle rétrécissait les habits du hussardil raconta son histoire bien clairement à cette femme étonnée. Elle y crut un instant; il avait l'air si naïfet il était si joli habillé en hussard!
-- Puisque tu as tant de bonne volonté pour te battrelui dit-elle enfin à demi persuadéeil fallait donc en arrivant à Paris t'engager dans un régiment. En payant à boire à un maréchal des logiston affaire était faite! La geôlière ajouta beaucoup de bons avis pour l'aveniret enfinà la petite pointe du jourmit Fabrice hors de chez elleaprès lui avoir fait jurer cent et cent fois que jamais il ne prononcerait son nomquoi qu'il pût arriver. Dès que Fabrice fut sorti de la petite villemarchant gaillardement le sabre de hussard sous le brasil lui vint un scrupule. Me voicise dit-ilavec l'habit et la feuille de route d'un hussard mort en prisonoù l'avait conduitdit-onle vol d'une vache et de quelques couverts d'argent! j'ai pour ainsi dire succédé à son être... et cela sans le vouloir ni le prévoir en aucune manière! Gare la prison!... Le présage est clairj'aurai beaucoup à souffrir de la prison!
Il n'y avait pas une heure que Fabrice avait quitté sa bienfaitricelorsque la pluie commença à tomber avec une telle force qu'à peine le nouvel hussard pouvait-il marcherembarrassé par des bottes grossières qui n'étaient pas faites pour lui. Il fit rencontre d'un paysan monté sur un méchant chevalil acheta le cheval en s'expliquant par signes; la geôlière lui avait recommandé de parler le moins possibleà cause de son accent.
Ce jour-là l'arméequi venait de gagner la bataille de Lignyétait en pleine marche sur Bruxelles; on était à la veille de la bataille de Waterloo. Sur le midila pluie à verse continuant toujoursFabrice entendit le bruit du canon; ce bonheur lui fit oublier tout à fait les affreux moments de désespoir que venait de lui donner cette prison si injuste. Il marcha jusqu'à la nuit très avancéeet comme il commençait à avoir quelque bon sensil alla prendre son logement dans une maison de paysan fort éloignée de la route. Ce paysan pleurait et prétendait qu'on lui avait tout pris; Fabrice lui donna un écuet il trouva de l'avoine. Mon cheval n'est pas beause dit Fabrice; mais qu'importeil pourrait bien se trouver du goût de quelque adjudantet il alla coucher à l'écurie à ses côtés. Une heure avant le jourle lendemainFabrice était sur la routeetà force de caressesil était parvenu à faire prendre le trot à son cheval. Sur les cinq heuresil entendit la canonnade: c'étaient les préliminaires de Waterloo.
Livre Premier
Chapitre III.
Fabrice trouva bientôt des vivandièreset l'extrême reconnaissance qu'il avait pour la geôlière de B***; le porta à leur adresser la parole: il demanda à l'une d'elles où était le 4e régiment de hussardsauquel il appartenait.
-- Tu ferais tout aussi bien de ne pas tant te presser mon petit soldatdit la cantinière touchée par la pâleur et les beaux yeux de Fabrice. Tu n'as pas encore la poigne assez ferme pour les coups de sabre qui vont se donner aujourd'hui. Encore si tu avais un fusilje ne dis pastu pourrais lâcher ta balle tout comme un autre.
Ce conseil déplut à Fabrice; mais il avait beau pousser son chevalil ne pouvait aller plus vite que la charrette de la cantinière. De temps à autre le bruit du canon semblait se rapprocher et les empêchait de s'entendrecar Fabrice était tellement hors de lui d'enthousiasme et de bonheurqu'il avait renoué la conversation. Chaque mot de la cantinière redoublait son bonheur en le lui faisant comprendre. A l'exception de son vrai nom et de sa fuite de prisonil finit par tout dire à cette femme qui semblait si bonne. Elle était fort étonnée et ne comprenait rien du tout à ce que lui racontait ce beau jeune soldat.
-- Je vois le fin mots'écria-t-elle enfin d'un air de triomphe: vous êtes un jeune bourgeois amoureux de la femme de quelque capitaine du 4e de hussards. Votre amoureuse vous aura fait cadeau de l'uniforme que vous portezet vous courez après elle. Vraicomme Dieu est là-hautvous n'avez jamais été soldat; maiscomme un brave garçon que vous êtespuisque votre régiment est au feuvous voulez y paraîtreet ne pas passer pour un capon.
Fabrice convint de tout: c'était le seul moyen qu'il eût de recevoir de bons conseils. J'ignore toutes les façons d'agir de ces Françaisse disait-iletsi je ne suis pas guidé par quelqu'unje parviendrai encore à me faire jeter en prisonet l'on me volera mon cheval.
-- D'abordmon petitlui dit la cantinièrequi devenait de plus en plus son amieconviens que tu n'as pas vingt et un ans: c'est tout le bout du monde si tu en as dix-sept.
C'était la véritéet Fabrice l'avoua de bonne grâce.
-- Ainsitu n'es pas même conscrit; c'est uniquement à cause des beaux yeux de la madame que tu vas te faire casser les os. Peste! elle n'est pas dégoûtée. Si tu as encore quelques-uns de ces jaunets qu'elle t'a remisil faut primo que tu achètes un autre cheval; vois comme ta rosse dresse les oreilles quand le bruit du canon ronfle d'un peu près; c'est là un cheval de paysan qui te fera tuer dès que tu seras en ligne. Cette fumée blancheque tu vois là-bas par-dessus la haiece sont des feux de pelotonmon petit! Ainsiprépare-toi à avoir une fameuse venettequand tu vas entendre siffler les balles. Tu ferais aussi bien de manger un morceau tandis que tu en as encore le temps.
Fabrice suivit ce conseiletprésentant un napoléon à la vivandièrela pria de se payer.
-- C'est pitié de le voir! s'écria cette femme; le pauvre petit ne sait pas seulement dépenser son argent! Tu mériterais bien qu'après avoir empoigné ton napoléon je fisse prendre son grand trot à Cocotte; du diable si ta rosse pourrait me suivre. Que ferais-tunigauden me voyant détaler? Apprends quequand le brutal grondeon ne montre jamais d'or. Tienslui dit-ellevoilà dix-huit francs cinquante centimeset ton déjeuner te coûte trente sous. Maintenantnous allons bientôt avoir des chevaux à revendre. Si la bête est petitetu en donneras dix francsetdans tous les casjamais plus de vingt francsquand ce serait le cheval des quatre fils Aymon.
Le déjeuner finila vivandièrequi pérorait toujoursfut interrompue par une femme qui s'avançait à travers champset qui passa sur la route.
-- Holàhé! lui cria cette femme; holà! Margot! ton 6e léger est sur la droite.
-- Il faut que je te quittemon petitdit la vivandière à notre héros; mais en vérité tu me fais pitié; j'ai de l'amitié pour toisacrédié! Tu ne sais rien de rientu vas te faire mouchercomme Dieu est Dieu! Viens-t'en au 6e léger avec moi.
-- Je comprends bien que je ne sais rienlui dit Fabricemais je veux me battre et suis résolu d'aller là-bas vers cette fumée blanche.
-- Regarde comme ton cheval remue les oreilles! Dès qu'il sera là-basquelque peu de vigueur qu'il aitil te forcera la mainil se mettra à galoperet Dieu sait où il te mènera. Veux-tu m'en croire? Dès que tu seras avec les petits soldatsramasse un fusil et une gibernemets-toi à côté des soldats et fais comme euxexactement. Maismon Dieuje parie que tu ne sais pas seulement déchirer une cartouche.
Fabricefort piquéavoua cependant à sa nouvelle amie qu'elle avait deviné juste.
-- Pauvre petit! il va être tué tout de suite; vrai comme Dieu! ça ne sera pas long. Il faut absolument que tu viennes avec moireprit la cantinière d'un air d'autorité.
-- Mais je veux me battre.
-- Tu te battras aussi; vale 6e léger est un fameuxet aujourd'hui il y en a pour tout le monde.
-- Mais serons-nous bientôt à votre régiment?
-- Dans un quart d'heure tout au plus.
Recommandé par cette brave femmese dit Fabricemon ignorance de toutes choses ne me fera pas prendre pour un espionet je pourrai me battre. A ce momentle bruit du canon redoublaun coup n'attendait pas l'autre. C'est comme un chapeletdit Fabrice.
-- On commence à distinguer les feux de pelotondit la vivandière en donnant un coup de fouet à son petit cheval qui semblait tout animé par le feu.
La cantinière tourna à droite et prit un chemin de traverse au milieu des prairies; il y avait un pied de boue; la petite charrette fut sur le point d'y rester: Fabrice poussa à la roue. Son cheval tomba deux fois; bientôt le cheminmoins rempli d'eaune fut plus qu'un sentier au milieu du gazon. Fabrice n'avait pas fait cinq cents pas que sa rosse s'arrêta tout court: c'était un cadavreposé en travers du sentierqui faisait horreur au cheval et au cavalier.
La figure de Fabricetrès pâle naturellementprit une teinte verte fort prononcée: la cantinièreaprès avoir regardé le mortditcomme se parlant à elle-même: Ca n'est pas de notre division. Puislevant les yeux sur notre héroselle éclata de rire.
-- Ha! ha! mon petit! s'écria-t-elleen voilà du nanan! Fabrice restait glacé. Ce qui le frappait surtout c'était la saleté des pieds de ce cadavre qui déjà était dépouillé de ses soulierset auquel on n'avait laissé qu'un mauvais pantalon tout souillé de sang.
-- Approchelui dit la cantinière; descends de cheval; il faut que tu t'y accoutumes; tienss'écria-t-elleil en a eu par la tête.
Une balleentrée à côté du nezétait sortie par la tempe opposéeet défigurait ce cadavre d'une façon hideuse; il était resté avec un oeil ouvert.
-- Descends donc de chevalpetitdit la cantinièreet donne-lui une poignée de main pour voir s'il te la rendra.
Sans hésiterquoique prêt à rendre l'âme de dégoûtFabrice se jeta à bas de cheval et prit la main du cadavre qu'il secoua ferme; puis il resta comme anéanti; il sentait qu'il n'avait pas la force de remonter à cheval. Ce qui lui faisait horreur surtout c'était cet oeil ouvert.
La vivandière va me croire un lâchese disait-il avec amertume; mais il sentait l'impossibilité de faire un mouvement: il serait tombé. Ce moment fut affreux; Fabrice fut sur le point de se trouver mal tout à fait. La vivandière s'en aperçutsauta lestement à bas de sa petite voitureet lui présentasans mot direun verre d'eau-de-vie qu'il avala d'un trait; il put remonter sur sa rosseet continua la route sans dire une parole. La vivandière le regardait de temps à autre du coin de l'oeil.
-- Tu te battras demainmon petitlui dit-elle enfinaujourd'hui tu resteras avec moi. Tu vois bien qu'il faut que tu apprennes le métier de soldat.
-- Au contraireje veux me battre tout de suites'écria notre héros d'un air sombrequi sembla de bon augure à la vivandière. Le bruit du canon redoublait et semblait s'approcher. Les coups commençaient à former comme une basse continue; un coup n'était séparé du coup voisin par aucun intervalleet sur cette basse continuequi rappelait le bruit d'un torrent lointainon distinguait fort bien les feux de peloton.
Dans ce moment la route s'enfonçait au milieu d'un bouquet de bois; la vivandière vit trois ou quatre soldats des nôtres qui venaient à elle courant à toutes jambes; elle sauta lestement à bas de sa voiture et courut se cacher à quinze ou vingt pas du chemin. Elle se blottit dans un trou qui était resté au lieu où l'on venait d'arracher un grand arbre. Doncse dit Fabriceje vais voir si je suis un lâche! Il s'arrêta auprès de la petite voiture abandonnée par la cantinière et tira son sabre. Les soldats ne firent pas attention à lui et passèrent en courant le long du boisà gauche de la route.
-- Ce sont des nôtresdit tranquillement la vivandière en revenant tout essoufflée vers sa petite voiture... Si ton cheval était capable de galoperje te dirais: pousse en avant jusqu'au bout du boisvois s'il y a quelqu'un dans la plaine. Fabrice ne se le fit pas dire deux foisil arracha une branche à un peuplierl'effeuilla et se mit à battre son cheval à tour de bras; la rosse prit le galop un instant puis revint à son petit trot accoutumé. La vivandière avait mis son cheval au galop:-- Arrête-toidoncarrête! criait-elle à Fabrice. Bientôt tous les deux furent hors du bois; en arrivant au bord de la plaineils entendirent un tapage effroyablele canon et la mousqueterie tonnaient de tous les côtésà droiteà gauchederrière. Et comme le bouquet de bois d'où ils sortaient occupait un tertre élevé de huit ou dix pieds au-dessus de la plaineils aperçurent assez bien un coin de la bataille; mais enfin il n'y avait personne dans le pré au-delà du bois. Ce pré était bordéà mille pas de distancepar une longue rangée de saulestrès touffus; au-dessus des saules paraissait une fumée blanche qui quelquefois s'élevait dans le ciel en tournoyant.
-- Si je savais seulement où est le régiment! disait la cantinière embarrassée. Il ne faut pas traverser ce grand pré tout droit. A propostoidit-elle à Fabricesi tu vois un soldat ennemipique-le avec la pointe de ton sabrene va pas t'amuser à le sabrer.
Ace momentla cantinière aperçut les quatre soldats dont nous venons de parlerils débouchaient du bois dans la plaine à gauche de la route. L'un d'eux était à cheval.
-- Voilà ton affairedit-elle à Fabrice. Holà! ho! cria-t-elle à celui qui était à chevalviens donc ici boire le verre d'eau-de-vie; les soldats s'approchèrent.
-- Où est le 6e léger? cria-t-elle.
-- Là-basà cinq minutes d'icien avant de ce canal qui est le long des saules; même que le colonel Macon vient d'être tué.
-- Veux-tu cinq francs de ton chevaltoi?
-- Cinq francs! tu ne plaisantes pas malpetite mèreun cheval d'officier que je vais vendre cinq napoléons avant un quart d'heure.
-- Donne-m'en un de tes napoléonsdit la vivandière à Fabrice. Puis s'approchant du soldat à cheval: Descends vivementlui dit-ellevoilà ton napoléon.
Le soldat descenditFabrice sauta en selle gaiementla vivandière détachait le petit portemanteau qui était sur la rosse.
-- Aidez-moi doncvous autres! dit-elle aux soldatsc'est comme ça que vous laissez travailler une dame!
Mais à peine le cheval de prise sentit le portemanteauqu'il se mit à se cabreret Fabricequi montait fort bieneut besoin de toute sa force pour le contenir.
-- Bon signe! dit la vivandièrele monsieur n'est pas accoutumé au chatouillement du portemanteau.
-- Un cheval de générals'écriait le soldat qui l'avait venduun cheval qui vaut dix napoléons comme un liard!
-- Voilà vingt francslui dit Fabricequi ne se sentait pas de joie de se trouver entre les jambes un cheval qui eût du mouvement.
Ace momentun boulet donna dans la ligne de saulesqu'il prit de biaiset Fabrice eut le curieux spectacle de toutes ces petites branches volant de côté et d'autre comme rasées par un coup de faux.
-- Tiensvoilà le brutal qui s'avancelui dit le soldat en prenant ses vingt francs. Il pouvait être deux heures.
Fabrice était encore dans l'enchantement de ce spectacle curieuxlorsqu'une troupe de générauxsuivis d'une vingtaine de hussardstraversèrent au galop un des angles de la vaste prairie au bord de laquelle il était arrêté: son cheval hennitse cabra deux ou trois fois de suitepuis donna des coups de tête violents contre la bride qui le retenait. Hé biensoit! se dit Fabrice.
Le cheval laissé à lui-même partit ventre à terre et alla rejoindre l'escorte qui suivait les généraux. Fabrice compta quatre chapeaux bordés. Un quart d'heure aprèspar quelques mots que dit un hussard son voisinFabrice comprit qu'un de ces généraux était le célèbre maréchal Ney. Son bonheur fut au comble; toutefois il ne put deviner lequel des quatre généraux était le maréchal Ney; il eût donné tout au monde pour le savoirmais il se rappela qu'il ne fallait pas parler. L'escorte s'arrêta pour passer un large fossé rempli d'eau par la pluie de la veilleil était bordé de grands arbres et terminait sur la gauche la prairie à l'entrée de laquelle Fabrice avait acheté le cheval. Presque tous les hussards avaient mis pied à terre; le bord du fossé était à pic et fort glissantet l'eau se trouvait bien à trois ou quatre pieds en contrebas au-dessous de la prairie. Fabricedistrait par sa joiesongeait plus au maréchal Ney et à la gloire qu'à son chevallequel étant fort animésauta dans le canal; ce qui fit rejaillir l'eau à une hauteur considérable. Un des généraux fut entièrement mouillé par la nappe d'eauet s'écria en jurant: Au diable la f... bête! Fabrice se sentit profondément blessé de cette injure. Puis-je en demander raison? se dit-il. En attendantpour prouver qu'il n'était pas si gaucheil entreprit de faire monter à son cheval la rive opposée du fossé; mais elle était à pic et haute de cinq à six pieds. Il fallut y renoncer; alors il remonta le courantson cheval ayant de l'eau jusqu'à la têteet enfin trouva une sorte d'abreuvoir; par cette pente douce il gagna facilement le champ de l'autre côté du canal. Il fut le premier homme de l'escorte qui y parutil se mit à trotter fièrement le long du bord: au fond du canal les hussards se démenaientassez embarrassés de leur position; car en beaucoup d'endroits l'eau avait cinq pieds de profondeur. Deux ou trois chevaux prirent peur et voulurent nagerce qui fit un barbotement épouvantable. Un maréchal des logis s'aperçut de la manoeuvre que venait de faire ce blanc-becqui avait l'air si peu militaire.
-- Remontez! il y a un abreuvoir à gauche! s'écria-t-ilet peu à peu tous passèrent.
En arrivant sur l'autre riveFabrice y avait trouvé les généraux tout seuls; le bruit du canon lui sembla redoubler; ce fut à peine s'il entendit le généralpar lui si bien mouilléqui criait à son oreille:
-- Où as-tu pris ce cheval?
Fabrice était tellement troublé qu'il répondit en italien:
-- L'ho comprato poco fa. (Je viens de l'acheter à l'instant.)
-- Que dis-tu? lui cria le général.
Mais le tapage devint tellement fort en ce momentque Fabrice ne put lui répondre. Nous avouerons que notre héros était fort peu héros en ce moment. Toutefois la peur ne venait chez lui qu'en seconde ligne; il était surtout scandalisé de ce bruit qui lui faisait mal aux oreilles. L'escorte prit le galop; on traversait une grande pièce de terre labouréesituée au-delà du canalet ce champ était jonché de cadavres.
-- Les habits rouges! les habits rouges! criaient avec joie les hussards de l'escorteet d'abord Fabrice ne comprenait pas; enfin il remarqua qu'en effet presque tous les cadavres étaient vêtus de rouge. Une circonstance lui donna un frisson d'horreur; il remarqua que beaucoup de ces malheureux habits rouges vivaient encoreils criaient évidemment pour demander du secourset personne ne s'arrêtait pour leur en donner. Notre hérosfort humainse donnait toutes les peines du monde pour que son cheval ne mît les pieds sur aucun habit rouge. L'escorte s'arrêta; Fabricequi ne faisait pas assez d'attention à son devoir de soldatgalopait toujours en regardant un malheureux blessé.
-- Veux-tu bien t'arrêterblanc-bec! lui cria le maréchal des logis. Fabrice s'aperçut qu'il était à vingt pas sur la droite en avant des générauxet précisément du côté où ils regardaient avec leurs lorgnettes. En revenant se ranger à la queue des autres hussards restés à quelques pas en arrièreil vit le plus gros de ces généraux qui parlait à son voisingénéral aussid'un air d'autorité et presque de réprimande; il jurait. Fabrice ne put retenir sa curiosité; etmalgré le conseil de ne point parlerà lui donné par son amie la geôlièreil arrangea une petite phrase bien françaisebien correcteet dit à son voisin:
-- Quel est-il ce général qui gourmande son voisin?
-- Pardic'est le maréchal!
-- Quel maréchal?
-- Le maréchal Neybêta! Ah çà! où as-tu servi jusqu'ici?
Fabricequoique fort susceptiblene songea point à se fâcher de l'injure; il contemplaitperdu dans une admiration enfantinece fameux prince de la Moskovale brave des braves.
Tout à coup on partit au grand galop. Quelques instants aprèsFabrice vità vingt pas en avantune terre labourée qui était remuée d'une façon singulière. Le fond des sillons était plein d'eauet la terre fort humidequi formait la crête de ces sillonsvolait en petits fragments noirs lancés à trois ou quatre pieds de haut. Fabrice remarqua en passant cet effet singulier; puis sa pensée se remit à songer à la gloire du maréchal. Il entendit un cri sec auprès de lui: c'étaient deux hussards qui tombaient atteints par des boulets; etlorsqu'il les regardails étaient déjà à vingt pas de l'escorte. Ce qui lui sembla horriblece fut un cheval tout sanglant qui se débattait sur la terre labouréeen engageant ses pieds dans ses propres entrailles; il voulait suivre les autres: le sang coulait dans la boue.
Ah! m'y voilà donc enfin au feu! se dit-il. J'ai vu le feu! se répétait-il avec satisfaction. Me voici un vrai militaire. A ce momentl'escorte allait ventre à terreet notre héros comprit que c'étaient des boulets qui faisaient voler la terre de toutes parts. Il avait beau regarder du côté d'où venaient les bouletsil voyait la fumée blanche de la batterie à une distance énormeetau milieu du ronflement égal et continu produit par les coups de canonil lui semblait entendre des décharges beaucoup plus voisines; il n'y comprenait rien du tout.
Ace momentles généraux et l'escorte descendirent dans un petit chemin plein d'eauqui était à cinq pieds en contre-bas.
Le maréchal s'arrêtaet regarda de nouveau avec sa lorgnette. Fabricecette foisput le voir tout à son aise; il le trouva très blondavec une grosse tête rouge. Nous n'avons point des figures comme celle-là en Italiese dit-il. Jamaismoi qui suis si pâle et qui ai des cheveux châtainsje ne serai comme çaajoutait-il avec tristesse. Pour lui ces paroles voulaient dire: Jamais je ne serai un héros. Il regarda les hussards; à l'exception d'un seultous avaient des moustaches jaunes. Si Fabrice regardait les hussards de l'escortetous le regardaient aussi. Ce regard le fit rougiretpour finir son embarrasil tourna la tête vers l'ennemi. C'étaient des lignes fort étendues d'hommes rouges; maisce qui l'étonna fortces hommes lui semblaient tout petits. Leurs longues filesqui étaient des régiments ou des divisionsne lui paraissaient pas plus hautes que des haies. Une ligne de cavaliers rouges trottait pour se rapprocher du chemin en contre-bas que le maréchal et l'escorte s'étaient mis à suivre au petit paspataugeant dans la boue. La fumée empêchait de rien distinguer du côté vers lequel on s'avançait; l'on voyait quelquefois des hommes au galop se détacher sur cette fumée blanche.
Tout à coupdu côté de l'ennemiFabrice vit quatre hommes qui arrivaient ventre à terre. Ah! nous sommes attaquésse dit-il; puis il vit deux de ces hommes parler au maréchal. Un des généraux de la suite de ce dernier partit au galop du côté de l'ennemisuivi de deux hussards de l'escorte et des quatre hommes qui venaient d'arriver. Après un petit canal que tout le monde passaFabrice se trouva à côté d'un maréchal des logis qui avait l'air fort bon enfant. Il faut que je parle à celui-làse dit-ilpeut-être ils cesseront de me regarder. Il médita longtemps.
-- Monsieurc'est la première fois que j'assiste à la batailledit-il enfin au maréchal des logis; mais ceci est-il une véritable bataille?
-- Un peu. Mais vousqui êtes-vous?
-- Je suis le frère de la femme d'un capitaine.
-- Et comment l'appelez-vousce capitaine?
Notre héros fut terriblement embarrassé; il n'avait point prévu cette question. Par bonheurle maréchal et l'escorte repartaient au galop. Quel nom français dirai-je? pensait-il. Enfin il se rappela le nom du maître d'hôtel où il avait logé à Paris; il rapprocha son cheval de celui du maréchal des logiset lui cria de toutes ses forces:
-- Le capitaine Meunier! L'autreentendant mal à cause du roulement du canonlui répondit:-- Ah! le capitaine Teulier? Eh bien! il a été tué. Bravo! se dit Fabrice. Le capitaine Teulier; il faut faire l'affligé.-- Ahmon Dieu! cria-t-il; et il prit une mine piteuse. On était sorti du chemin en contre-bason traversait un petit préon allait ventre à terreles boulets arrivaient de nouveaule maréchal se porta vers une division de cavalerie. L'escorte se trouvait au milieu de cadavres et de blessés; mais ce spectacle ne faisait déjà plus autant d'impression sur notre héros; il avait autre chose à penser.
Pendant que l'escorte était arrêtéeil aperçut la petite voiture d'une cantinièreet sa tendresse pour ce corps respectable l'emportant sur toutil partit au galop pour la rejoindre.
-- Restez doncs...! lui cria le maréchal des logis.
Que peut-il me faire ici? pensa Fabrice et il continua de galoper vers la cantinière. En donnant de l'éperon à son chevalil avait eu quelque espoir que c'était sa bonne cantinière du matin; les chevaux et les petites charrettes se ressemblaient fortmais la propriétaire était tout autreet notre héros lui trouva l'air fort méchant. Comme il l'abordaitFabrice l'entendit qui disait: Il était pourtant bien bel homme! Un fort vilain spectacle attendait là le nouveau soldat; on coupait la cuisse à un cuirassierbeau jeune homme de cinq pieds dix pouces. Fabrice ferma les yeux et but coup sur coup quatre verres d'eau-de-vie.
-- Comme tu y vasgringalet! s'écria la cantinière. L'eau-de-vie lui donna une idée: il faut que j'achète la bienveillance de mes camarades les hussards de l'escorte.
-- Donnez-moi le reste de la bouteilledit-il à la vivandière.
-- Mais sais-turépondit-elleque ce reste-là coûte dix francsun jour comme aujourd'hui?
Comme il regagnait l'escorte au galop:
-- Ah! tu nous rapportes la goutte! s'écria le maréchal des logisc'est pour ça que tu désertais? Donne.
La bouteille circula; le dernier qui la prit la jeta en l'air après avoir bu. -- Mercicamarade! cria-t-il à Fabrice. Tous les yeux le regardèrent avec bienveillance. Ces regards ôtèrent un poids de cent livres de dessus le coeur de Fabrice: c'était un de ces coeurs de fabrique trop fine qui ont besoin de l'amitié de ce qui les entoure. Enfin il n'était plus mal vu de ses compagnonsil y avait liaison entre eux! Fabrice respira profondémentpuis d'une voix libreil dit au maréchal des logis:
-- Et si le capitaine Teulier a été tuéoù pourrais-je rejoindre ma soeur? Il se croyait un petit Machiavelde dire si bien Teulier au lieu de Meunier.
-- C'est ce que vous saurez ce soirlui répondit le maréchal des logis.
L'escorte repartit et se porta vers des divisions d'infanterie. Fabrice se sentait tout à fait enivré; il avait bu trop d'eau-de-vieil roulait un peu sur sa selle: il se souvint fort à propos d'un mot que répétait le cocher de sa mère: Quand on a levé le coudeil faut regarder entre les oreilles de son chevalet faire comme fait le voisin. Le maréchal s'arrêta longtemps auprès de plusieurs corps de cavalerie qu'il fit charger; mais pendant une heure ou deux notre héros n'eut guère la conscience de ce qui se passait autour de lui. Il se sentait fort laset quand son cheval galopait il retombait sur la selle comme un morceau de plomb.
Tout à coup le maréchal des logis cria à ses hommes:
-- Vous ne voyez donc pas l'Empereurs...! Sur-le-champ l'escorte cria vive l'Empereur! à tue-tête. On peut penser si notre héros regarda de tous ses yeuxmais il ne vit que des généraux qui galopaientsuiviseux aussid'une escorte. Les longues crinières pendantes que portaient à leurs casques les dragons de la suite l'empêchèrent de distinguer les figures. Ainsije n'ai pu voir l'Empereur sur un champ de batailleà cause de ces maudits verres d'eau-de-vie! Cette réflexion le réveilla tout à fait.
On redescendit dans un chemin rempli d'eaules chevaux voulurent boire.
-- C'est donc l'Empereur qui a passé là? dit-il à son voisin.
Eh! certainementcelui qui n'avait pas d'habit brodé. Comment ne l'avez-vous pas vu? lui répondit le camarade avec bienveillance. Fabrice eut grande envie de galoper après l'escorte de l'Empereur et de s'y incorporer. Quel bonheur de faire réellement la guerre à la suite de ce héros! C'était pour cela qu'il était venu en France. J'en suis parfaitement le maîtrese dit-ilcar enfin je n'ai d'autre raison pour faire le service que je faisque la volonté de mon cheval qui s'est mis à galoper pour suivre ces généraux.
Ce qui détermina Fabrice à resterc'est que les hussards ses nouveaux camarades lui faisaient bonne mine; il commençait à se croire l'ami intime de tous les soldats avec lesquels il galopait depuis quelques heures. Il voyait entre eux et lui cette noble amitié des héros du Tasse et de l'Arioste. S'il se joignait à l'escorte de l'Empereuril y aurait une nouvelle connaissance à faire; peut-être même on lui ferait la mine car ces autres cavaliers étaient des dragons et lui portait l'uniforme de hussard ainsi que tout ce qui suivait le maréchal. La façon dont on le regardait maintenant mit notre héros au comble du bonheur; il eût fait tout au monde pour ses camarades; son âme et son esprit étaient dans les nues. Tout lui semblait avoir changé de face depuis qu'il était avec des amisil mourait d'envie de faire des questions. Mais je suis encore un peu ivrese dit-ilil faut que je me souvienne de la geôlière. Il remarqua en sortant du chemin creux que l'escorte n'était plus avec le maréchal Ney; le général qu'ils suivaient était grandminceet avait la figure sèche et l'oeil terrible.
Ce général n'était autre que le comte d'A...le lieutenant Robert du 15 mai 1796. Quel bonheur il eût trouvé à voir Fabrice del Dongo.
Il y avait déjà longtemps que Fabrice n'apercevait plus la terre volant en miettes noires sous l'action des boulets; on arriva derrière un régiment de cuirassiersil entendit distinctement les biscaïens frapper sur les cuirasses et il vit tomber plusieurs hommes.
Le soleil était déjà fort baset il allait se coucher lorsque l'escortesortant d'un chemin creuxmonta une petite pente de trois ou quatre pieds pour entrer dans une terre labourée. Fabrice entendit un petit bruit singulier tout près de lui: il tourna la têtequatre hommes étaient tombés avec leurs chevaux; le général lui- même avait été renversémais il se relevait tout couvert de sang. Fabrice regardait les hussards jetés par terre: trois faisaient encore quelques mouvements convulsifsle quatrième criait: Tirez-moi de dessous. Le maréchal des logis et deux ou trois hommes avaient mis pied à terre pour secourir le général quis'appuyant sur son aide de campessayait de faire quelques pas; il cherchait à s'éloigner de son cheval qui se débattait renversé par terre et lançait des coups de pied furibonds.
Le maréchal des logis s'approcha de Fabrice. A ce moment notre héros entendit dire derrière lui et tout près de son oreille: C'est le seul qui puisse encore galoper. Il se sentit saisir les pieds; on les élevait en même temps qu'on lui soutenait le corps par-dessous les bras; on le fit passer par-dessus la croupe de son chevalpuis on le laissa glisser jusqu'à terreoù il tomba assis.
L'aide de camp prit le cheval de Fabrice par la bride; le généralaidé par le maréchal des logismonta et partit au galop; il fut suivi rapidement par les six hommes qui restaient. Fabrice se releva furieuxet se mit à courir après eux en criant: Ladri! ladri! (voleurs! voleurs!). Il était plaisant de courir après des voleurs au milieu d'un champ de bataille.
L'escorte et le généralcomte d'A...disparurent bientôt derrière une rangée de saules. Fabriceivre de colèrearriva aussi à cette ligne de saules; il se trouva tout contre un canal fort profond qu'il traversa. Puisarrivé de l'autre côtéil se remit à jurer en apercevant de nouveaumais à une très grande distancele général et l'escorte qui se perdaient dans les arbres. Voleurs! voleurs! criait-il maintenant en français. Désespérébien moins de la perte de son cheval que de la trahisonil se laissa tomber au bord du fosséfatigué et mourant de faim. Si son beau cheval lui eût été enlevé par l'ennemiil n'y eût pas songé; mais se voir trahir et voler par ce maréchal des logis qu'il aimait tant et par ces hussards qu'il regardait comme des frères! c'est ce qui lui brisait le coeur. Il ne pouvait se consoler de tant d'infamieetle dos appuyé contre un sauleil se mit à pleurer à chaudes larmes. Il défaisait un à un tous ses beaux rêves d'amitié chevaleresque et sublimecomme celle des héros de la Jérusalem délivrée. Voir arriver la mort n'était rienentouré d'âmes héroïques et tendresde nobles amis qui vous serrent la main au moment du dernier soupir! mais garder son enthousiasmeentouré de vils fripons!!! Fabrice exagérait comme tout homme indigné. Au bout d'un quart d'heure d'attendrissementil remarqua que les boulets commençaient à arriver jusqu'à la rangée d'arbres à l'ombre desquels il méditait. Il se leva et chercha à s'orienter. Il regardait ces prairies bordées par un large canal et la rangée de saules touffus: il crut se reconnaître. Il aperçut un corps d'infanterie qui passait le fossé et entrait dans les prairiesà un quart de lieue en avant de lui. J'allais m'endormirse dit-il; il s'agit de n'être pas prisonnier; et il se mit à marcher très vite. En avançant il fut rassuréil reconnut l'uniformeles régiments par lesquels il craignait d'être coupé étaient français. Il obliqua à droite pour les rejoindre.
Après la douleur morale d'avoir été si indignement trahi et voléil en était une autre quià chaque instantse faisait sentir plus vivement: il mourait de faim. Ce fut donc avec une joie extrême qu'après avoir marchéou plutôt couru pendant dix minutesil s'aperçut que le corps d'infanteriequi allait très vite aussis'arrêtait comme pour prendre position. Quelques minutes plus tardil se trouvait au milieu des premiers soldats.
-- Camaradespourriez-vous me vendre un morceau de pain?
-- Tienscet autre qui nous prend pour des boulangers!
Ce mot dur et le ricanement général qui le suivit accablèrent Fabrice. La guerre n'était donc plus ce noble et commun élan d'âmes amantes de la gloire qu'il s'était figuré d'après les proclamations de Napoléon! Il s'assitou plutôt se laissa tomber sur le gazon; il devint très pâle. Le soldat qui lui avait parléet qui s'était arrêté à dix pas pour nettoyer la batterie de son fusil avec son mouchoirs'approcha et lui jeta un morceau de painpuisvoyant qu'il ne le ramassait pasle soldat lui mit un morceau de ce pain dans la bouche. Fabrice ouvrit les yeuxet mangea ce pain sans avoir la force de parler. Quand enfin il chercha des yeux le soldat pour le payeril se trouva seulles soldats les plus voisins de lui étaient éloignés de cent pas et marchaient. Il se leva machinalement et les suivit. Il entra dans un bois; il allait tomber de fatigue et cherchait déjà de l'oeil une place commode; mais quelle ne fut pas sa joie en reconnaissant d'abord le chevalpuis la voitureet enfin la cantinière du matin! Elle accourut à lui et fut effrayée de sa mine.
-- Marche encoremon petitlui dit-elle; tu es donc blessé? et ton beau cheval? En parlant ainsi elle le conduisait vers sa voitureoù elle le fit monteren le soutenant par-dessous les bras. A peine dans la voiturenotre hérosexcédé de fatigues'endormit profondément. [ Para v. P. y E. 15 x. 38. ]
Livre Premier
Chapitre IV.
Rien ne put le réveillerni les coups de fusil tirés fort près de la petite charretteni le trot du cheval que la cantinière fouettait à tour de bras. Le régiment attaqué à l'improviste par des nuées de cavalerie prussienneaprès avoir cru à la victoire toute la journéebattait en retraiteou plutôt s'enfuyait du côté de la France.
Le colonelbeau jeune hommebienficeléqui venait de succéder à Maconfut sabré; le chef de bataillon qui le remplaça dans le commandementvieillard à cheveux blancsfit faire halte au régiment.-- F...! dit-il aux soldatsdu temps de la république on attendait pour filer d'y être forcé par l'ennemi... Défendez chaque pouce de terrain et faites-vous tuers'écriait-il en jurant; c'est maintenant le sol de la patrie que ces Prussiens veulent envahir!
La petite charrette s'arrêtaFabrice se réveilla tout à coup. Le soleil était couché depuis longtemps; il fut tout étonné de voir qu'il était presque nuit. Les soldats couraient de côté et d'autre dans une confusion qui surprit fort notre héros; il trouva qu'ils avaient l'air penaud.
-- Qu'est-ce donc? dit-il à la cantinière.
-- Rien du tout. C'est que nous sommes flambésmon petit; c'est la cavalerie des Prussiens qui nous sabrerien que ça. Le bêta de général a d'abord cru que c'était la nôtre. Allonsvivementaide-moi à réparer le trait de Cocotte qui s'est cassé.
Quelques coups de fusil partirent à dix pas de distance: notre hérosfrais et disposse dit: Mais réellementpendant toute la journéeje ne me suis pas battuj'ai seulement escorté un général.-- Il faut que je me battedit-il à la cantinière.
-- Sois tranquilletu te battraset plus que tu ne voudras! Nous sommes perdus!
-- Aubrymon garçoncria-t-elle à un caporal qui passaitregarde toujours de temps à autre où en est la petite voiture.
-- Vous allez vous battre? dit Fabrice à Aubry.
-- Nonje vais mettre mes escarpins pour aller à la danse!
-- Je vous suis.
-- Je te recommande le petit hussardcria la cantinièrele jeune bourgeois a du coeur. Le caporal Aubry marchait sans mot dire. Huit ou dix soldats le rejoignirent en courantil les conduisit derrière un gros chêne entouré de ronces. Arrivé là il les plaça au bord du boistoujours sans mot diresur une ligne fort étendue; chacun était au moins à dix pas de son voisin.
-- Ah çà! vous autres dit le caporalet c'était la première fois qu'il parlaitn'allez pas faire feu avant l'ordresongez que vous n'avez plus que trois cartouches.
Mais que se passe-t-il donc? se demandait Fabrice. Enfinquand il se trouva seul avec le caporalil lui dit:
-- Je n'ai pas de fusil.
-- Tais-toi d'abord! Avance-toi làà cinquante pas en avant du boistu trouveras quelqu'un des pauvres soldats du régiment qui viennent d'être sabrés; tu lui prendras sa giberne et son fusil. Ne va pas dépouiller un blesséau moins; prends le fusil et la giberne d'un qui soit bien mortet dépêche-toipour ne pas recevoir les coups de fusil de nos gens. Fabrice partit en courant et revint bien vite avec un fusil et une giberne.
-- Charge ton fusil et mets-toi là derrière cet arbreet surtout ne va pas tirer avant l'ordre que je t'en donnerai... Dieu de Dieu! dit le caporal en s'interrompantil ne sait pas même charger son arme!... Il aida Fabrice en continuant son discours. Si un cavalier ennemi galope sur toi pour te sabrertourne autour de ton arbre et ne lâche ton coup qu'à bout portant quand ton cavalier sera à trois pas de toi; il faut presque que ta baïonnette touche son uniforme.
-- Jette donc ton grand sabres'écria le caporalveux-tu qu'il te fasse tombernom de D...! Quels soldats on nous donne maintenant! En parlant ainsiil prit lui- même le sabre qu'il jeta au loin avec colère.
-- Toiessuie la pierre de ton fusil avec ton mouchoir. Mais as-tu jamais tiré un coup de fusil?
-- Je suis chasseur.
-- Dieu soit loué! reprit le caporal avec un gros soupir. Surtout ne tire pas avant l'ordre que je te donnerai; et il s'en alla.
Fabrice était tout joyeux. Enfin je vais me battre réellementse disait-iltuer un ennemi! Ce matin ils nous envoyaient des bouletset moi je ne faisais rien que m'exposer à être tué; métier de dupe. Il regardait de tous côtés avec une extrême curiosité. Au bout d'un momentil entendit partir sept à huit coups de fusil tout près de lui. Maisne recevant point l'ordre de tireril se tenait tranquille derrière son arbre. Il était presque nuit; il lui semblait être à l'espèreà la chasse de l'oursdans la montagne de la Tramezzinaau-dessus de Grianta. Il lui vint une idée de chasseur; il prit une cartouche dans sa giberne et en détacha la balle: si je le voisdit-ilil ne faut pas que je le manque et il fit couler cette seconde balle dans le canon de son fusil. Il entendit tirer deux coups de feu tout à côté de son arbre; en même temps il vit un cavalier vêtu de bleu qui passait au galop devant luise dirigeant de sa droite à sa gauche. Il n'est pas à trois passe dit-ilmais à cette distance je suis sûr de mon coupil suivit bien le cavalier du bout de son fusil et enfin pressa la détente; le cavalier tomba avec son cheval. Notre héros se croyait à la chasse: il courut tout joyeux sur la pièce qu'il venait d'abattre. Il touchait déjà l'homme qui lui semblait mourantlorsqueavec une rapidité incroyable deux cavaliers prussiens arrivèrent sur lui pour le sabrer. Fabrice se sauva à toutes jambes vers le bois; pour mieux courir il jeta son fusil. Les cavaliers prussiens n'étaient plus qu'à trois pas de lui lorsqu'il atteignit une nouvelle plantation de petits chênes gros comme le bras et bien droits qui bordaient le bois. Ces petits chênes arrêtèrent un instant les cavaliersmais ils passèrent et se remirent à poursuivre Fabrice dans une clairière. De nouveau ils étaient près de l'atteindrelorsqu'il se glissa entre sept à huit gros arbres. A ce momentil eut presque la figure brûlée par la flamme de cinq ou six coups de fusil qui partirent en avant de lui. Il baissa la tête; comme il la relevaitil se trouva vis-à-vis du caporal.
-- Tu as tué le tien? lui dit le caporal Aubry.
-- Ouimais j'ai perdu mon fusil.
-- Ce n'est pas les fusils qui nous manquent; tu es un bon b...; malgré ton air cornichontu as bien gagné ta journéeet ces soldats-ci viennent de manquer ces deux qui te poursuivaient et venaient droit à eux; moi je ne les voyais pas. Il s'agit maintenant de filer rondement; le régiment doit être à un demi-quart de lieueetde plusil y a un petit bout de prairie où nous pouvons être ramassés au demi- cercle.
Tout en parlantle caporal marchait rapidement à la tête de ses dix hommes. A deux cents pas de làen entrant dans la petite prairie dont il avait parléon rencontra un général blessé qui était porté par son aide de camp et par un domestique.
-- Vous allez me donner quatre hommesdit-il au caporal d'une voix éteinteil s'agit de me transporter à l'ambulance; j'ai la jambe fracassée.
-- Va te faire f...répondit le caporaltoi et tous les généraux. Vous avez tous trahi l'Empereur aujourd'hui.
-- Commentdit le général en fureurvous méconnaissez mes ordres! Savez-vous que je suis le général comte B***commandant votre divisionetc.etc. Il fit des phrases. L'aide de camp se jeta sur les soldats. Le caporal lui lança un coup de baïonnette dans le braspuis fila avec ses hommes en doublant le pas. Puissent- ils être tous comme toirépétait le caporal en jurantles bras et les jambes fracassés! Tas de freluquets! Tous vendus aux Bourbonset trahissant l'Empereur! Fabrice écoutait avec saisissement cette affreuse accusation.
Vers les dix heures du soirla petite troupe rejoignit le régiment à l'entrée d'un gros village qui formait plusieurs rues fort étroitesmais Fabrice remarqua que le caporal Aubry évitait de parler à aucun des officiers. Impossible d'avancers'écria le caporal! Toutes ces rues étaient encombrées d'infanteriede cavaliers et surtout de caissons d'artillerie et de fourgons. Le caporal se présenta à l'issue de trois de ces rues; après avoir fait vingt pasil fallait s'arrêter: tout le monde jurait et se fâchait.
Encore quelque traître qui commande! s'écria le caporal; si l'ennemi a l'esprit de tourner le village nous sommes tous prisonniers comme des chiens. Suivez-moivous autres. Fabrice regarda; il n'y avait plus que six soldats avec le caporal. Par une grande porte ouverte ils entrèrent dans une vaste basse-cour; de la basse-cour ils passèrent dans une écuriedont la petite porte leur donna entrée dans un jardin. Ils s'y perdirent un moment errant de côté et d'autre. Mais enfinen passant une haieils se trouvèrent dans une vaste pièce de blé noir. En moins d'une demi-heureguidés par les cris et le bruit confusils eurent regagné la grande route au-delà du village. Les fossés de cette route étaient remplis de fusils abandonnés; Fabrice en choisit un mais la routequoique fort largeétait tellement encombrée de fuyards et de charrettesqu'en une demi-heure de tempsà peine si le caporal et Fabrice avaient avancé de cinq cents pas; on disait que cette route conduisait à Charleroi. Comme onze heures sonnaient à l'horloge du village:
-- Prenons de nouveau à travers champs'écria le caporal. La petite troupe n'était plus composée que de trois soldatsle caporal et Fabrice. Quand on fut à un quart de lieue de la grande route:
-- Je n'en puis plusdit un des soldats.
-- Et moi itoudit un autre.
-- Belle nouvelle! Nous en sommes tous logés làdit le caporal; mais obéissez- moiet vous vous en trouverez bien. Il vit cinq ou six arbres le long d'un petit fossé au milieu d'une immense pièce de blé. Aux arbres! dit-il à ses hommes; couchez-vous làajouta-t-il quand on y fut arrivéet surtout pas de bruit. Maisavant de s'endormirqui est-ce qui a du pain?
-- Moidit un des soldats.
-- Donnedit le caporald'un air magistral; il divisa le pain en cinq morceaux et prit le plus petit.
-- Un quart d'heure avant le point du jourdit-il en mangeantvous allez avoir sur le dos la cavalerie ennemie. Il s'agit de ne pas se laisser sabrer. Un seul est flambéavec de la cavalerie sur le dosdans ces grandes plainescinq au contraire peuvent se sauver: restez avec moi bien unisne tirez qu'à bout portantet demain soir je me fais fort de vous rendre à Charleroi. Le caporal les éveilla une heure avant le jour; il leur fit renouveler la charge de leurs armesle tapage sur la grande route continuaitet avait duré toute la nuit: c'était comme le bruit d'un torrent entendu dans le lointain.
-- Ce sont comme des moutons qui se sauventdit Fabrice au caporald'un air naïf.
-- Veux-tu bien te taireblanc-bec! dit le caporal indigné; et les trois soldats qui composaient toute son armée avec Fabrice regardèrent celui-ci d'un air de colèrecomme s'il eût blasphémé. Il avait insulté la nation.
Voilà qui est fort! pensa notre héros; j'ai déjà remarqué cela chez le vice-roi à Milan; ils ne fuient pasnon! Avec ces Français il n'est pas permis de dire la vérité quand elle choque leur vanité. Mais quant à leur air méchant je m'en moqueet il faut que je le leur fasse comprendre. On marchait toujours à cinq cents pas de ce torrent de fuyards qui couvraient la grande route. A une lieue de là le caporal et sa troupe traversèrent un chemin qui allait rejoindre la route et où beaucoup de soldats étaient couchés. Fabrice acheta un cheval assez bon qui lui coûta quarante francset parmi tous les sabres jetés de côté et d'autreil choisit avec soin un grand sabre droit. Puisqu'on dit qu'il faut piquer pensa-t-ilcelui-ci est le meilleur. Ainsi équipé il mit son cheval au galop et rejoignit bientôt le caporal qui avait pris les devants. Il s'affermit sur ses étriersprit de la main gauche le fourreau de son sabre droitet dit aux quatre Français:
-- Ces gens qui se sauvent sur la grande route ont l'air d'un troupeau de moutons... Ils marchent comme des moutons effrayés...
Fabrice avait beau appuyer sur le mot moutonses camarades ne se souvenaient plus d'avoir été fâchés par ce mot une heure auparavant. Ici se trahit un des contrastes des caractères italien et français; le Français est sans doute le plus heureuxil glisse sur les événements de la vie et ne garde pas rancune.
Nous ne cacherons point que Fabrice fut très satisfait de sa personne après avoir parlé des moutons. On marchait en faisant la petite conversation. A deux lieues de là le caporaltoujours fort étonné de ne point voir la cavalerie ennemiedit à Fabrice:
-- Vous êtes notre cavaleriegalopez vers cette ferme sur ce petit tertredemandez au paysan s'il veut nous vendre à déjeunerdites bien que nous ne sommes que cinq. S'il hésite donnez-lui cinq francs d'avance de votre argent mais soyez tranquillenous reprendrons la pièce blanche après le déjeuner.
Fabrice regarda le caporalil vit en lui une gravité imperturbableet vraiment l'air de la supériorité morale; il obéit. Tout se passa comme l'avait prévu le commandant en chefseulement Fabrice insista pour qu'on ne reprît pas de vive force les cinq francs qu'il avait donnés au paysan.
-- L'argent est à moidit-il à ses camaradesje ne paie pas pour vousje paie pour l'avoine qu'il a donnée à mon cheval.
Fabrice prononçait si mal le françaisque ses camarades crurent voir dans ses paroles un ton de supérioritéils furent vivement choquéset dès lors dans leur esprit un duel se prépara pour la fin de la journée. Ils le trouvaient fort différent d'eux-mêmesce qui les choquait; Fabrice au contraire commençait à se sentir beaucoup d'amitié pour eux.
On marchait sans rien dire depuis deux heureslorsque le caporalregardant la grande routes'écria avec un transport de joie: Voici le régiment! On fut bientôt sur la route; maishélas! autour de l'aigle il n'y avait pas deux cents hommes. L'oeil de Fabrice eut bientôt aperçu la vivandière; elle marchait à piedavait les yeux rouges et pleurait de temps à autre. Ce fut en vain que Fabrice chercha la petite charrette et Cocotte.
-- Pillésperdusvoléss'écria la vivandière répondant aux regards de notre héros. Celui-cisans mot diredescendit de son chevalle prit par la brideet dit à la vivandière: Montez. Elle ne se le fit pas dire deux fois.
-- Raccourcis-moi les étriers fit-elle.
Une fois bien établie à cheval elle se mit à raconter à Fabrice tous les désastres de la nuit. Après un récit d'une longueur infiniemais avidement écouté par notre héros quià dire vraine comprenait rien à rienmais avait une tendre amitié pour la vivandièrecelle-ci ajouta:
-- Et dire que ce sont les Français qui m'ont pilléebattueabîmée...
-- Comment! ce ne sont pas les ennemis? dit Fabrice d'un air naïfqui rendait charmante sa belle figure grave et pâle...
-- Que tu es bêtemon pauvre petit! dit la vivandièresouriant au milieu de ses larmes; et quoique çatu es bien gentil.
-- Et tel que vous le voyezil a fort bien descendu son Prussiendit le caporal Aubry quiau milieu de la cohue généralese trouvait par hasard de l'autre côté du cheval monté par la cantinière. Mais il est fiercontinua le caporal... Fabrice fit un mouvement. Et comment t'appelles-tu? continua le caporalcar enfins'il y a un rapportje veux te nommer.
-- Je m'appelle Vasirépondit Fabrice faisant une mine singulièrec'est-à-dire Boulotajouta-t-il se reprenant vivement.
Boulot avait été le nom du propriétaire de la feuille de route que la geôlière de B... lui avait remise; l'avant-veille il l'avait étudiée avec sointout en marchantcar il commençait à réfléchir quelque peu et n'était plus si étonné des choses. Outre la feuille de route du hussard Boulotil conservait précieusement le passeport italien d'après lequel il pouvait prétendre au noble nom de Vasimarchand de baromètres. Quand le caporal lui avait reproché d'être fieril avait été sur le point de répondre: Moi fier! moi Fabrice Valserramarchesino del Dongoqui consens à porter le nom d'un Vasimarchand de baromètres!
Pendant qu'il faisait des réflexions et qu'il se disait: Il faut bien me rappeler que je m'appelle Boulotou gare la prison dont le sort me menacele caporal et la cantinière avaient échangé plusieurs mots sur son compte.
-- Ne m'accusez pas d'être une curieuselui dit la cantinière en cessant de le tutoyer; c'est pour votre bien que je vous fais des questions. Qui êtes-vouslàréellement?
Fabrice ne répondit pas d'abord; il considérait que jamais il ne pourrait trouver d'amis plus dévoués pour leur demander conseilet il avait un pressant besoin de conseils. Nous allons entrer dans une place de guerrele gouverneur voudra savoir qui je suiset gare la prison si je fais voir par mes réponses que je ne connais personne au 4e régiment de hussards dont je porte l'uniforme! En sa qualité de sujet de l'AutricheFabrice savait toute l'importance qu'il faut attacher à un passeport. Les membres de sa famillequoique nobles et dévotsquoique appartenant au parti vainqueuravaient été vexés plus de vingt fois à l'occasion de leurs passeports; il ne fut donc nullement choqué de la question que lui adressait la cantinière. Mais commeavant que de répondreil cherchait les mots français les plus clairsla cantinièrepiquée d'une vive curiositéajouta pour l'engager à parler: Le caporal Aubry et moi nous allons vous donner de bons avis pour vous conduire.
-- Je n'en doute pasrépondit Fabrice: je m'appelle Vasi et je suis de Gênes; ma soeurcélèbre par sa beautéa épousé un capitaine. Comme je n'ai que dix-sept anselle me faisait venir auprès d'elle pour me faire voir la Franceet me former un peu; ne la trouvant pas à Paris et sachant qu'elle était à cette arméej'y suis venuje l'ai cherchée de tous les côtés sans pouvoir la trouver. Les soldatsétonnés de mon accentm'ont fait arrêter. J'avais de l'argent alorsj'en ai donné au gendarmequi m'a remis une feuille de routeun uniforme et m'a dit: Fileet jure- moi de ne jamais prononcer mon nom.
-- Comment s'appelait-il? dit la cantinière.
-- J'ai donné ma paroledit Fabrice.
-- Il a raisonreprit le caporalle gendarme est un gredinmais le camarade ne doit pas le nommer. Et comment s'appelle-t-ilce capitainemari de votre soeur? Si nous savons son nom nous pourrons le chercher.
-- Teuliercapitaine au 4e de hussardsrépondit notre héros.
-- Ainsidit le caporal avec assez de finesseà votre accent étrangerles soldats vous prirent pour un espion?
-- C'est là le mot infâme! s'écria Fabriceles yeux brillants. Moi qui aime tant l'Empereur et les Français! Et c'est par cette insulte que je suis le plus vexé.
-- Il n'y a pas d'insultevoilà ce qui vous trompe; l'erreur des soldats était fort naturellereprit gravement le caporal Aubry.
Alors il lui expliqua avec beaucoup de pédanterie qu'à l'armée il faut appartenir à un corps et porter un uniformefaute de quoi il est tout simple qu'on vous prenne pour un espion. L'ennemi nous en lâche beaucoup: tout le monde trahit dans cette guerre. Les écailles tombèrent des yeux de Fabrice; il comprit pour la première fois qu'il avait tort dans tout ce qui lui arrivait depuis deux mois.
-- Mais il faut que le petit nous raconte toutdit la cantinière dont la curiosité était de plus en plus excitée. Fabrice obéit. Quand il eut fini:
-- Au faitdit la cantinière parlant d'un air grave au caporalcet enfant n'est point militaire; nous allons faire une vilaine guerre maintenant que nous sommes battus et trahis. Pourquoi se ferait-il casser les os gratis pro Deo ?
-- Et mêmedit le caporalqu'il ne sait pas charger son fusilni en douze tempsni à volontéc'est moi qui ai chargé le coup qui a descendu le Prussien.
-- De plusil montre son argent à tout le mondeajouta la cantinière; il sera volé de tout dès qu'il ne sera plus avec nous.
-- Le premier sous-officier de cavalerie qu'il rencontredit le caporalle confisque à son profit pour se faire payer la goutteet peut-être on le recrute pour l'ennemicar tout le monde trahit. Le premier venu va lui ordonner de le suivreet il le suivra; il ferait mieux d'entrer dans notre régiment.
-- Non pass'il vous plaîtcaporal! s'écria vivement Fabrice; il est plus commode d'aller à chevalet d'ailleurs je ne sais pas charger un fusilet vous avez vu que je manie un cheval.
Fabrice fut très fier de ce petit discours. Nous ne rendrons pas compte de la longue discussion sur sa destinée future qui eut lieu entre le caporal et la cantinière. Fabrice remarqua qu'en discutant ces gens répétaient trois ou quatre fois toutes les circonstances de son histoire: les soupçons des soldatsle gendarme lui vendant une feuille de route et un uniformela façon dont la veille il s'était trouvé faire partie de l'escorte du maréchall'Empereur vu au galople cheval escofiéetc.etc.
Avec une curiosité de femmela cantinière revenait sans cesse sur la façon dont on l'avait dépossédé du bon cheval qu'elle lui avait fait acheter.
-- Tu t'es senti saisir par les piedson t'a fait passer doucement par-dessus la queue de ton chevalet l'on t'a assis par terre! Pourquoi répéter si souventse disait Fabricece que nous connaissons tous trois parfaitement bien? Il ne savait pas encore que c'est ainsi qu'en France les gens du peuple vont à la recherche des idées.
Combien as-tu d'argent? lui dit tout à coup la cantinière. Fabrice n'hésita pas à répondre; il était sûr de la noblesse d'âme de cette femme: c'est là le beau côté de la France.
-- En toutil peut me rester trente napoléons en or et huit ou dix écus de cinq francs.
-- En ce castu as le champ libre! s'écria la cantinière; tire-toi du milieu de cette armée en déroute; jette-toi de côtéprends la première route un peu frayée que tu trouveras là sur ta droite; pousse ton cheval fermetoujours t'éloignant de l'armée. A la première occasion achète des habits de pékin. Quand tu seras à huit ou dix lieueset que tu ne verras plus de soldatsprends la posteet va te reposer huit jours et manger des biftecks dans quelque bonne ville. Ne dis jamais à personne que tu as été à l'armée les gendarmes te ramasseraient comme déserteur; etquoique tu sois bien gentilmon petittu n'es pas encore assez fûté pour répondre à des gendarmes. Dès que tu auras sur le dos des habits de bourgeoisdéchire ta feuille de route en mille morceaux et reprends ton nom véritable; dis que tu es Vasi. Et d'où devra-t-il dire qu'il vient? fit-elle au caporal.
-- De Cambrai sur l'Escaut: c'est une bonne ville toute petiteentends-tu? et où il y a une cathédrale et Fénelon.
-- C'est çadit la cantinière; ne dis jamais que tu as été à la bataillene souffle mot de B***ni du gendarme qui t'a vendu la feuille de route. Quand tu voudras rentrer à Parisrends-toi d'abord à Versailleset passe la barrière de Paris de ce côté-là en flânanten marchant à pied comme un promeneur. Couds tes napoléons dans ton pantalon; et surtout quand tu as à payer quelque chosene montre tout juste que l'argent qu'il faut pour payer. Ce qui me chagrinec'est qu'on va t'empaumeron va te chiper tout ce que tu as; et que feras-tu une fois sans argent? toi qui ne sais pas te conduire? etc.
La bonne cantinière parla longtemps encore; le caporal appuyait ses avis par des signes de têtene pouvant trouver jour à saisir la parole. Tout à coup cette foule qui couvrait la grande routed'abord doubla le pas; puisen un clin d'oeilpassa le petit fossé qui bordait la route à gaucheet se mit à fuir à toutes jambes. -- Les Cosaques! les Cosaques! criait-on de tous les côtés.
-- Reprends ton cheval! s'écria la cantinière.
-- Dieu m'en garde! dit Fabrice. Galopez! fuyez! je vous le donne. Voulez-vous de quoi racheter une petite voiture? La moitié de ce que j'ai est à vous.
-- Reprends ton chevalte dis-je! s'écria la cantinière en colère; et elle se mettait en devoir de descendre. Fabrice tira son sabre:-- Tenez-vous bien! lui cria-t-ilet il donna deux ou trois coups de plat de sabre au chevalqui prit le galop et suivit les fuyards.
Notre héros regarda la grande route; naguère trois ou quatre mille individus s'y pressaientserrés comme des paysans à la suite d'une procession. Après le mot cosaques il n'y vit exactement plus personne; les fuyards avaient abandonné des shakosdes fusilsdes sabresetc. Fabriceétonnémonta dans un champ à droite du cheminet qui était élevé de vingt ou trente pieds; il regarda la grande route des deux côtés et la plaineil ne vit pas trace de cosaques. Drôles de gensque ces Français! se dit-il. Puisque je dois aller sur la droitepensa-t-ilautant vaut marcher tout de suite; il est possible que ces gens aient pour courir une raison que je ne connais pas. Il ramassa un fusilvérifia qu'il était chargéremua la poudre de l'amorcenettoya la pierrepuis choisit une giberne bien garnieet regarda encore de tous les côtés; il était absolument seul au milieu de cette plaine naguère si couverte de monde. Dans l'extrême lointainil voyait les fuyards qui commençaient à disparaître derrière les arbreset couraient toujours. Voilà qui est bien singulier! se dit-il; etse rappelant la manoeuvre employée la veille par le caporalil alla s'asseoir au milieu d'un champ de blé. Il ne s'éloignait pasparce qu'il désirait revoir ses bons amisla cantinière et le caporal Aubry.
Dans ce bléil vérifia qu'il n'avait plus que dix-huit napoléonsau lieu de trente comme il le pensait; mais il lui restait de petits diamants qu'il avait placés dans la doublure des bottes du hussardle matindans la chambre de la geôlièreà B***. Il cacha ses napoléons du mieux qu'il puttout en réfléchissant profondément à cette disparition si soudaine. Cela est-il d'un mauvais présage pour moi? se disait- il. Son principal chagrin était de ne pas avoir adressé cette question au caporal Aubry: Ai-je réellement assisté à une bataille? Il lui semblait que ouiet il eût été au comble du bonheurs'il en eût été certain.
Toutefoisse dit-ilj'y ai assisté portant le nom d'un prisonnierj'avais la feuille de route d'un prisonnier dans ma pocheetbien plusson habit sur moi! Voilà qui est fatal pour l'avenir: qu'en eût dit l'abbé Blanès? Et ce malheureux Boulot est mort en prison! Tout cela est de sinistre augure; le destin me conduira en prison. Fabrice eût donné tout au monde pour savoir si le hussard Boulot était réellement coupable; en rappelant ses souvenirsil lui semblait que la geôlière de B*** lui avait dit que le hussard avait été ramassé non seulement pour des couverts d'argentmais encore pour avoir volé la vache d'un paysanet battu le paysan à toute outrance: Fabrice ne doutait pas qu'il ne fût mis un jour en prison pour une faute qui aurait quelque rapport avec celle du hussard Boulot. Il pensait à son ami le curé Blanès; que n'eût-il pas donné pour pouvoir le consulter! Puis il se rappela qu'il n'avait pas écrit à sa tante depuis qu'il avait quitté Paris. Pauvre Gina! se dit- ilet il avait les larmes aux yeuxlorsque tout à coup il entendit un petit bruit tout près de luic'était un soldat qui faisait manger le blé par trois chevaux auxquels il avait ôté la brideet qui semblaient morts de faim; il les tenait par le bridon. Fabrice se leva comme un perdreaule soldat eut peur. Notre héros le remarquaet céda au plaisir de jouer un instant le rôle de hussard.
-- Un de ces chevaux m'appartientf...! s'écria-t-ilmais je veux bien te donner cinq francs pour la peine que tu as prise de me l'amener ici.
-- Est-ce que tu te fiches de moi? dit le soldat. Fabrice le mit en joue à six pas de distance.
-- Lâche le cheval ou je te brûle!
Le soldat avait son fusil en bandoulièreil donna un tour d'épaule pour le reprendre.
-- Si tu fais le plus petit mouvement tu es mort! s'écria Fabrice en lui courant dessus.
-- Eh bien! donnez les cinq francs et prenez un des chevauxdit le soldat confusaprès avoir jeté un regard de regret sur la grande route où il n'y avait absolument personne. Fabricetenant son fusil haut de la main gauchede la droite lui jeta trois pièces de cinq francs.
-- Descendsou tu es mort... Bride le noir et va-t'en plus loin avec les deux autres... Je te brûle si tu remues.
Le soldat obéit en rechignant. Fabrice s'approcha du cheval et passa la bride dans son bras gauchesans perdre de vue le soldat qui s'éloignait lentement; quand Fabrice le vit à une cinquantaine de pasil sauta lestement sur le cheval. Il y était à peine et cherchait l'étrier de droite avec le piedlorsqu'il entendit sifflerune balle de fort près: c'était le soldat qui lui lâchait son coup de fusil. Fabricetransporté de colèrese mit à galoper sur le soldat qui s'enfuit à toutes jambeset bientôt Fabrice le vit monté sur un de ses deux chevaux et galopant. Bonle voilà hors de portéese dit-il. Le cheval qu'il venait d'acheter était magnifiquemais paraissait mourant de faim. Fabrice revint sur la grande routeoù il n'y avait toujours âme qui vive; il la traversa et mit son cheval au trot pour atteindre un petit pli de terrain sur la gauche où il espérait retrouver la cantinière; mais quand il fut au sommet de la petite montée il n'aperçutà plus d'une lieue de distanceque quelques soldats isolés. Il est écrit que je ne la reverrai plusse dit-il avec un soupirbrave et bonne femme! Il gagna une ferme qu'il apercevait dans le lointain et sur la droite de la route. Sans descendre de chevalet après avoir payé d'avanceil fit donner de l'avoine à son pauvre chevaltellement affamé qu'il mordait la mangeoire. Une heure plus tardFabrice trottait sur la grande route toujours dans le vague espoir de retrouver la cantinièreou du moins le caporal Aubry. Allant toujours et regardant de tous les côtés il arriva à une rivière marécageuse traversée par un pont en bois assez étroit. Avant le pontsur la droite de la routeétait une maison isolée portant l'enseigne du Cheval Blanc. Làje vais dînerse dit Fabrice. Un officier de cavalerie avec le bras en écharpe se trouvait à l'entrée du pont; il était à cheval et avait l'air fort triste; à dix pas de luitrois cavaliers à pied arrangeaient leurs pipes.
-- Voilà des gensse dit Fabricequi m'ont bien la mine de vouloir m'acheter mon cheval encore moins cher qu'il ne m'a coûté. L'officier blessé et les trois piétons le regardaient venir et semblaient l'attendre. Je devrais bien ne pas passer sur ce pontet suivre le bord de la rivière à droitece serait la route conseillée par la cantinière pour sortir d'embarras... Ouise dit notre héros; mais si je prends la fuitedemain j'en serai tout honteux: d'ailleurs mon cheval a de bonnes jambescelui de l'officier est probablement fatigué; s'il entreprend de me démonter je galoperai. En faisant ces raisonnementsFabrice rassemblait son cheval et s'avançait au plus petit pas possible.
-- Avancez donchussardlui cria l'officier d'un air d'autorité.
Fabrice avança quelques pas et s'arrêta.
-- Voulez-vous me prendre mon cheval? cria-t-il.
-- Pas le moins du monde; avancez.
Fabrice regarda l'officier: il avait des moustaches blancheset l'air le plus honnête du monde; le mouchoir qui soutenait son bras gauche était plein de sanget sa main droite aussi était enveloppée d'un linge sanglant. Ce sont les piétons qui vont sauter à la bride de mon cheval se dit Fabrice; maisen y regardant de prèsil vit que les piétons aussi étaient blessés.
-- Au nom de l'honneurlui dit l'officier qui portait les épaulettes de colonelrestez ici en vedetteet dites à tous les dragonschasseurs et hussards que vous verrez que le colonel Le Baron est dans l'auberge que voilàet que je leur ordonne de venir me joindre. Le vieux colonel avait l'air navré de douleur; dès le premier mot il avait fait la conquête de notre hérosqui lui répondit avec bon sens:
-- Je suis bien jeunemonsieurpour que l'on veuille m'écouter; il faudrait un ordre écrit de votre main.
-- Il a raisondit le colonel en le regardant beaucoupécris l'ordreLa Rosetoi qui as une main droite.
Sans rien direLa Rose tira de sa poche un petit livret de parcheminécrivit quelques lignesetdéchirant une feuillela remit à Fabrice; le colonel répéta l'ordre à celui-ciajoutant qu'après deux heures de faction il serait relevécomme de justepar un des trois cavaliers blessés qui étaient avec lui. Cela ditil entra dans l'auberge avec ses hommes. Fabrice les regardait marcher et restait immobile au bout de son pont de boistant il avait été frappé par la douleur morne et silencieuse de ces trois personnages. On dirait des génies enchantésse dit-il. Enfin il ouvrit le papier plié et lut l'ordre ainsi conçu:
«Le colonel Le Barondu 6e dragonscommandant la seconde brigade de la première division de cavalerie du 14e corpsordonne à tous cavaliersdragonschasseurs et hussards de ne point passer le pontet de le rejoindre à l'auberge du Cheval Blancprès le pontoù est son quartier général.
«Au quartier généralprès le pont de la Saintele 19 juin 1815.
«Pour le colonel Le Baronblessé au bras droitet par son ordrele maréchal des logis
«LA ROSE. »
Il y avait à peine une demi-heure que Fabrice était en sentinelle au pontquand il vit arriver six chasseurs montés et trois à pied; il leur communique l'ordre du colonel. -- Nous allons revenirdisent quatre des chasseurs montéset ils passent le pont au grand trot. Fabrice parlait alors aux deux autres. Durant la discussion qui s'animaitles trois hommes à pied passent le pont. Un des deux chasseurs montés qui restaient finit par demander à revoir l'ordreet l'emporte en disant:
-- Je vais le porter à mes camarades qui ne manqueront pas de revenirattends-les ferme. Et il part au galop; son camarade le suit. Tout cela fut fait en un clin d'oeil.
Fabricefurieuxappela un des soldats blessésqui parut à une des fenêtres du Cheval Blanc. Ce soldatauquel Fabrice vit des galons de maréchal des logisdescendit et lui cria en s'approchant:
-- Sabre à la main donc! vous êtes en faction. Fabrice obéitpuis lui dit:
-- Ils ont emporté l'ordre.
-- Ils ont de l'humeur de l'affaire d'hierreprit l'autre d'un air morne. Je vais vous donner un de mes pistolets; si l'on force de nouveau la consignetirez-le en l'airje viendraiou le colonel lui-même paraîtra.
Fabrice avait fort bien vu un geste de surprise chez le maréchal des logisà l'annonce de l'ordre enlevé; il comprit que c'était une insulte personnelle qu'on lui avait faiteet se promit bien de ne plus se laisser jouer.
Armé du pistolet d'arçon du maréchal des logisFabrice avait repris fièrement sa faction lorsqu'il vit arriver à lui sept hussards montés: il s'était placé de façon à barrer le pontil leur communique l'ordre du colonelils en ont l'air fort contrariéle plus hardi cherche à passer. Fabrice suivant le sage précepte de son amie la vivandière quila veille au matinlui disait qu'il fallait piquer et non sabrerabaisse la pointe de son grand sabre droit et fait mine d'en porter un coup à celui qui veut forcer la consigne.
-- Ah! il veut nous tuerle blanc-bec! s'écrient les hussardscomme si nous n'avions pas été assez tués hier! Tous tirent leurs sabres à la fois et tombent sur Fabriceil se crut mort; mais il songea à la surprise du maréchal des logiset ne voulut pas être méprisé de nouveau. Tout en reculant sur son pontil tâchait de donner des coups de pointe. Il avait une si drôle de mine en maniant ce grand sabre droit de grosse cavaleriebeaucoup plus lourd pour luique les hussards virent bientôt à qui ils avaient affaire; ils cherchèrent alors non pas à le blessermais à lui couper son habit sur le corps. Fabrice reçut ainsi trois ou quatre petits coups de sabre sur les bras. Pour luitoujours fidèle au précepte de la cantinièreil lançait de tout son coeur force coups de pointe. Par malheur un de ces coups de pointe blessa un hussard à la main: fort en colère d'être touché par un tel soldatil riposta par un coup de pointe à fond qui atteignit Fabrice au haut de la cuisse. Ce qui fit porter le coupc'est que le cheval de notre hérosloin de fuir la bagarresemblait y prendre plaisir et se jeter sur les assaillants. Ceux-ci voyant couler le sang de Fabrice le long de son bras droitcraignirent d'avoir poussé le jeu trop avantetle poussant vers le parapet gauche du pontpartirent au galop. Dès que Fabrice eut un moment de loisir il tira en l'air son coup de pistolet pour avertir le colonel.
Quatre hussards montés et deux à pieddu même régiment que les autresvenaient vers le pont et en étaient encore à deux cents pas lorsque le coup de pistolet partit: ils regardaient fort attentivement ce qui se passait sur le pontet s'imaginant que Fabrice avait tiré sur leurs camaradesles quatre à cheval fondirent sur lui au galop et le sabre haut; c'était une véritable charge. Le colonel Le Baronaverti par le coup de pistoletouvrit la porte de l'auberge et se précipita sur le pont au moment où les hussards au galop y arrivaientet il leur intima lui- même l'ordre de s'arrêter.
-- Il n'y a plus de colonel icis'écria l'un d'euxet il poussa son cheval. Le colonel exaspéré interrompit la remontrance qu'il leur adressaitetde sa main droite blesséesaisit la rêne de ce cheval du côté hors du montoir.
-- Arrête! mauvais soldatdit-il au hussard; je te connaistu es de la compagnie du capitaine Henriet.
-- Eh bien! que le capitaine lui-même me donne l'ordre! Le capitaine Henriet a été tué hierajouta-t-il en ricanant; et va te faire f...
En disant ces paroles il veut forcer le passage et pousse le vieux colonel qui tombe assis sur le pavé du pont. Fabricequi était à deux pas plus loin sur le pontmais faisant face au côté de l'aubergepousse son chevalet tandis que le poitrail du cheval de l'assaillant jette par terre le colonel qui ne lâche point la rêne hors du montoirFabriceindignéporte au hussard un coup de pointe à fond. Par bonheur le cheval du hussardse sentant tiré vers la terre par la bride que tenait le colonelfit un mouvement de côtéde façon que la longue lame du sabre de grosse cavalerie de Fabrice glissa le long du gilet du hussard et passa tout entière sous ses yeux. Furieuxle hussard se retourne et lance un coup de toutes ses forcesqui coupe la manche de Fabrice et entre profondément dans son bras: notre héros tombe.
Un des hussards démontés voyant les deux défenseurs du pont par terresaisit l'à-propossaute sur le cheval de Fabrice et veut s'en emparer en le lançant au galop sur le pont.
Le maréchal des logisen accourant de l'aubergeavait vu tomber son colonelet le croyait gravement blessé. Il court après le cheval de Fabrice et plonge la pointe de son sabre dans les reins du voleur; celui-ci tombe. Les hussardsne voyant plus sur le pont que le maréchal des logis à piedpassent au galop et filent rapidement. Celui qui était à pied s'enfuit dans la campagne.
Le maréchal des logis s'approcha des blessés. Fabrice s'était déjà relevéil souffrait peumais perdait beaucoup de sang. Le colonel se releva plus lentement; il était tout étourdi de sa chutemais n'avait reçu aucune blessure.
-- Je ne souffredit-il au maréchal des logisque de mon ancienne blessure à la main.
Le hussard blessé par le maréchal des logis mourait.
-- Le diable l'emporte! s'écria le colonelmaisdit-il au maréchal des logis et aux deux autres cavaliers qui accouraientsongez à ce petit jeune homme que j'ai exposé mal à propos. Je vais rester au pont moi-même pour tâcher d'arrêter ces enragés. Conduisez le petit jeune homme à l'auberge et pansez son bras; prenez une de mes chemises.
Livre Premier
Chapitre V.
Toute cette aventure n'avait pas duré une minute; les blessures de Fabrice n'étaient rien; on lui serra le bras avec des bandes taillées dans la chemise du colonel. On voulait lui arranger un lit au premier étage de l'auberge:
-- Mais pendant que je serai ici bien choyé au premier étagedit Fabrice au maréchal des logismon chevalqui est à l'écuries'ennuiera tout seul et s'en ira avec un autre maître.
-- Pas mal pour un conscrit! dit le maréchal des logis; et l'on établit Fabrice sur de la paille bien fraîchedans la mangeoire même à laquelle son cheval était attaché.
Puiscomme Fabrice se sentait très faiblele maréchal des logis lui apporta une écuelle de vin chaud et fit un peu la conversation avec lui. Quelques compliments inclus dans cette conversation mirent notre héros au troisième ciel.
Fabrice ne s'éveilla que le lendemain au point du jour; les chevaux poussaient de longs hennissements et faisaient un tapage affreux; l'écurie se remplissait de fumée. D'abord Fabrice ne comprenait rien à tout ce bruitet ne savait même où il était; enfin à demi étouffé par la fuméeil eut l'idée que la maison brûlait; en un clin d'oeil il fut hors de l'écurie et à cheval. Il leva la tête; la fumée sortait avec violence par les deux fenêtres au-dessus de l'écurie et le toit était couvert d'une fumée noire qui tourbillonnait. Une centaine de fuyards étaient arrivés dans la nuit à l'auberge du Cheval Blanc; tous criaient et juraient. Les cinq ou six que Fabrice put voir de près lui semblèrent complètement ivres; l'un d'eux voulait l'arrêter et lui criait: Où emmènes-tu mon cheval?
Quand Fabrice fut à un quart de lieueil tourna la tête; personne ne le suivaitla maison était en flammes. Fabrice reconnut le pontil pensa à sa blessure et sentit son bras serré par des bandes et fort chaud. Et le vieux colonelque sera-t-il devenu? Il a donné sa chemise pour panser mon bras. Notre héros était ce matin- là du plus beau sang-froid du monde; la quantité de sang qu'il avait perdue l'avait délivré de toute la partie romanesque de son caractère.
Adroite! se dit-ilet filons. Il se mit tranquillement à suivre le cours de la rivière quiaprès avoir passé sous le pontcoulait vers la droite de la route. Il se rappelait les conseils de la bonne cantinière. Quelle amitié! se disait-ilquel caractère ouvert!
Après une heure de marcheil se trouva très faible. Ah çà! vais-je m'évanouir? se dit-il: si je m'évanouison me vole mon chevalet peut-être mes habitset avec les habits le trésor. Il n'avait plus la force de conduire son chevalet il cherchait à se tenir en équilibrelorsqu'un paysanqui bêchait dans un champ à côté de la grande routevit sa pâleur et vint lui offrir un verre de bière et du pain.
-- A vous voir si pâlej'ai pensé que vous étiez un des blessés de la grande bataille! lui dit le paysan. Jamais secours ne vint plus à propos. Au moment où Fabrice mâchait le morceau de pain noirles yeux commençaient à lui faire mal quand il regardait devant lui. Quand il fut un peu remisil remercia. Et où suis-je? demanda-t-il. Le paysan lui apprit qu'à trois quarts de lieue plus loin se trouvait le bourg de Zondersoù il serait très bien soigné. Fabrice arriva dans ce bourgne sachant pas trop ce qu'il faisaitet ne songeant à chaque pas qu'à ne pas tomber de cheval. Il vit une grande porte ouverteil entra: c'était l'auberge de l'Etrille. Aussitôt accourut la bonne maîtresse de la maisonfemme énorme; elle appela du secours d'une voix altérée par la pitié. Deux jeunes filles aidèrent Fabrice à mettre pied à terre; à peine descendu de chevalil s'évanouit complètement. Un chirurgien fut appeléon le saigna. Ce jour-là et ceux qui suivirentFabrice ne savait pas trop ce qu'on lui faisaitil dormait presque sans cesse.
Le coup de pointe à la cuisse menaçait d'un dépôt considérable. Quand il avait sa tête à luiil recommandait qu'on prît soin de son chevalet répétait souvent qu'il paierait bience qui offensait la bonne maîtresse de l'auberge et ses filles. Il y avait quinze jours qu'il était admirablement soignéet il commençait à reprendre un peu ses idéeslorsqu'il s'aperçut un soir que ses hôtesses avaient l'air fort troublé. Bientôt un officier allemand entra dans sa chambre: on se servait pour lui répondre d'une langue qu'il n'entendait pas; mais il vit bien qu'on parlait de lui; il feignit de dormir. Quelque temps aprèsquand il pensa que l'officier pouvait être sortiil appela ses hôtesses:
-- Cet officier ne vient-il pas m'écrire sur une liste et me faire prisonnier? L'hôtesse en convint les larmes aux yeux.
-- Eh bien! il y a de l'argent dans mon dolman! s'écria-t-il en se relevant sur son litachetez-moi des habits bourgeoisetcette nuitje pars sur mon cheval. Vous m'avez déjà sauvé la vie une fois en me recevant au moment où j'allais tomber mourant dans la rue; sauvez-la-moi encore en me donnant les moyens de rejoindre ma mère.
En ce momentles filles de l'hôtesse se mirent à fondre en larmes; elles tremblaient pour Fabrice; et comme elles comprenaient à peine le françaiselles s'approchèrent de son lit pour lui faire des questions. Elles discutèrent en flamand avec leur mère; maisà chaque instantdes yeux attendris se tournaient vers notre héros; il crut comprendre que sa fuite pouvait les compromettre gravementmais qu'elles voulaient bien en courir la chance. Il les remercia avec effusion et en joignant les mains. Un juif du pays fournit un habillement complet; maisquand il l'apporta vers les dix heures du soirces demoiselles reconnurenten comparant l'habit avec le dolman de Fabricequ'il fallait le rétrécir infiniment. Aussitôt elles se mirent à l'ouvrage; il n'y avait pas de temps à perdre. Fabrice indiqua quelques napoléons cachés dans ses habitset pria ses hôtesses de les coudre dans les vêtements qu'on venait d'acheter. On avait apporté avec les habits une belle paire de bottes neuves. Fabrice n'hésita point à prier ces bonnes filles de couper les bottes à la hussarde à l'endroit qu'il leur indiquaet l'on cacha ses petits diamants dans la doublure des nouvelles bottes.
Par un effet singulier de la perte du sang et de la faiblesse qui en était la suiteFabrice avait presque tout à fait oublié le français; il s'adressait en italien à ses hôtessesqui parlaient un patois flamandde façon que l'on s'entendait presque uniquement par signes. Quand les jeunes fillesd'ailleurs parfaitement désintéresséesvirent les diamantsleur enthousiasme pour lui n'eut plus de bornes; elles le crurent un prince déguisé. Anikenla cadette et la plus naïvel'embrassa sans autre façon. Fabricede son côtéles trouvait charmantes; et vers minuitlorsque le chirurgien lui eut permis un peu de vinà cause de la route qu'il allait entreprendreil avait presque envie de ne pas partir. Où pourrais-je être mieux qu'ici? disait-il. Toutefoissur les deux heures du matinil s'habilla. Au moment de sortir de sa chambrela bonne hôtesse lui apprit que son cheval avait été emmené par l'officier quiquelques heures auparavantétait venu faire la visite de la maison.
-- Ah! canaille! s'écriait Fabrice en jurantà un blessé! Il n'était pas assez philosophece jeune Italienpour se rappeler à quel prix lui-même avait acheté ce cheval.
Aniken lui apprit en pleurant qu'on avait loué un cheval pour lui; elle eût voulu qu'il ne partît pas; les adieux furent tendres. Deux grands jeunes gensparents de la bonne hôtesseportèrent Fabrice sur la selle; pendant la route ils le soutenaient à chevaltandis qu'un troisièmequi précédait le petit convoi de quelques centaines de pasexaminait s'il n'y avait point de patrouille suspecte sur les chemins. Après deux heures de marcheon s'arrêta chez une cousine de l'hôtesse de l'Etrille. Quoi que Fabrice pût leur direles jeunes gens qui l'accompagnaient ne voulurent jamais le quitter; ils prétendaient qu'ils connaissaient mieux que personne les passages dans les bois.
-- Mais demain matinquand on saura ma fuiteet qu'on ne vous verra pas dans le paysvotre absence vous compromettradisait Fabrice.
On se remit en marche. Par bonheurquand le jour vint à paraîtrela plaine était couverte d'un brouillard épais. Vers les huit heures du matinl'on arriva près d'une petite ville. L'un des jeunes gens se détacha pour voir si les chevaux de la poste avaient été volés. Le maître de poste avait eu le temps de les faire disparaîtreet de recruter des rosses infâmes dont il avait garni ses écuries. On alla chercher deux chevaux dans les marécages où ils étaient cachésettrois heures aprèsFabrice monta dans un petit cabriolet tout délabrémais attelé de deux bons chevaux de poste. Il avait repris des forces. Le moment de la séparation avec les jeunes gensparents de l'hôtessefut du dernier pathétique; jamaisquelque prétexte aimable que Fabrice pût trouverils ne voulurent accepter d'argent.
-- Dans votre étatmonsieurvous en avez plus de besoin que nousrépondaient toujours ces braves jeunes gens. Enfin ils partirent avec des lettres où Fabriceun peu fortifié par l'agitation de la route avait essayé de faire connaître à ses hôtesses tout ce qu'il sentait pour elles. Fabrice écrivait les larmes aux yeuxet il y avait certainement de l'amour dans la lettre adressée à la petite Aniken.
Le reste du voyage n'eut rien que d'ordinaire. En arrivant à Amiens il souffrait beaucoup du coup de pointe qu'il avait reçu à la cuisse; le chirurgien de campagne n'avait pas songé à débrider la plaieet malgré les saignéesil s'y était formé un dépôt. Pendant les quinze jours que Fabrice passa dans l'auberge d'Amienstenue par une famille complimenteuse et avideles alliés envahissaient la Franceet Fabrice devint comme un autre hommetant il fit de réflexions profondes sur les choses qui venaient de lui arriver. Il n'était resté enfant que sur un point: ce qu'il avait vu était-ce une batailleet en second lieucette bataille était-elle Waterloo? Pour la première fois de sa vie il trouva du plaisir à lire; il espérait toujours trouver dans les journauxou dans les récits de la bataillequelque description qui lui permettrait de reconnaître les lieux qu'il avait parcourus à la suite du maréchal Neyet plus tard avec l'autre général. Pendant son séjour à Amiensil écrivit presque tous les jours à ses bonnes amies de l'Etrille. Dès qu'il fut guériil vint à Paris; il trouva à son ancien hôtel vingt lettres de sa mère et de sa tante qui le suppliaient de revenir au plus vite. Une dernière lettre de la comtesse Pietranera avait un certain tour énigmatique qui l'inquiéta fortcette lettre lui enleva toutes ses rêveries tendres. C'était un caractère auquel il ne fallait qu'un mot pour prévoir facilement les plus grands malheurs; son imagination se chargeait ensuite de lui peindre ces malheurs avec les détails les plus horribles.
«Garde-toi bien de signer les lettres que tu écris pour donner de tes nouvelleslui disait la comtesse. A ton retour tu ne dois point venir d'emblée sur le lac de Côme: arrête-toi à Luganosur le territoire suisse. » Il devait arriver dans cette petite ville sous le nom de Cavi; il trouverait à la principale auberge le valet de chambre de la comtessequi lui indiquerait ce qu'il fallait faire. Sa tante finissait par ces mots: «Cache par tous les moyens possibles la folie que tu as faiteet surtout ne conserve sur toi aucun papier imprimé ou écrit; en Suisse tu seras environné des amis de Sainte-Marguerite. [M. Pellico a rendu ce nom européenc'est celui de la rue de Milan où se trouvent le palais et les prisons de la police.] Si j'ai assez d'argentlui disait la comtessej'enverrai quelqu'un à Genèveà l'hôtel des Balanceset tu auras des détails que je ne puis écrire et qu'il faut pourtant que tu saches avant d'arriver. Maisau nom de Dieupas un jour de plus à Paris; tu y serais reconnu par nos espions. » L'imagination de Fabrice se mit à se figurer les choses les plus étrangeset il fut incapable de tout autre plaisir que celui de chercher à deviner ce que sa tante pouvait avoir à lui apprendre de si étrange. Deux foisen traversant la Franceil fut arrêté; mais il sut se dégager; il dut ces désagréments à son passeport italien et à cette étrange qualité de marchand de baromètresqui n'était guère d'accord avec sa figure jeune et son bras en écharpe.
Enfindans Genèveil trouva un homme appartenant à la comtesse qui lui raconta de sa partque luiFabriceavait été dénoncé à la police de Milan comme étant allé porter à Napoléon des propositions arrêtées par une vaste conspiration organisée dans le ci-devant royaume d'Italie. Si tel n'eût pas été le but de son voyagedisait la dénonciationà quoi bon prendre un nom supposé? Sa mère chercherait à prouver ce qui était vrai; c'est-à-dire:
1 Qu'il n'était jamais sorti de la Suisse:
2 Qu'il avait quitté le château à l'improviste à la suite d'une querelle avec son frère aîné.
Ace récitFabrice eut un sentiment d'orgueil. J'aurais été une sorte d'ambassadeur auprès de Napoléon! se dit-il; j'aurais eu l'honneur de parler à ce grand hommeplût à Dieu! Il se souvint que son septième aïeulle petit-fils de celui qui arriva à Milan à la suite de Sforceeut l'honneur d'avoir la tête tranchée par les ennemis du ducqui le surprirent comme il allait en Suisse porter des propositions aux louables cantons et recruter des soldats. Il voyait des yeux de l'âme l'estampe relative à ce faitplacée dans la généalogie de la famille. Fabriceen interrogeant ce valet de chambrele trouva outré d'un détail qui enfin lui échappamalgré l'ordre exprès de le lui taireplusieurs fois répété par la comtesse. C'était Ascagneson frère aînéqui l'avait dénoncé à la police de Milan. Ce mot cruel donna comme un accès de folie à notre héros. De Genève pour aller en Italie on passe par Lausanne; il voulut partir à pied et sur-le-champet faire ainsi dix ou douze lieuesquoique la diligence de Genève à Lausanne dût partir deux heures plus tard. Avant de sortir de Genèveil se prit de querelle dans un des tristes cafés du paysavec un jeune homme qui le regardaitdisait-ild'une façon singulière. Rien de plus vraile jeune Genevois flegmatiqueraisonnable et ne songeant qu'à l'argentle croyait fou; Fabrice en entrant avait jeté des regards furibonds de tous les côtéspuis renversé sur son pantalon la tasse de café qu'on lui servait. Dans cette querellele premier mouvement de Fabrice fut tout à fait du XVle siècle: au lieu de parler du duel au jeune Genevoisil tira son poignard et se jeta sur lui pour l'en percer. En ce moment de passionFabrice oubliait tout ce qu'il avait appris sur les règles de l'honneuret revenait à l'instinctoupour mieux direaux souvenirs de la première enfance.
L'homme de confiance intime qu'il trouva dans Lugano augmenta sa fureur en lui donnant de nouveaux détails. Comme Fabrice était aimé à Griantapersonne n'eût prononcé son nomet sans l'aimable procédé de son frèretout le monde eût feint de croire qu'il était à Milanet jamais l'attention de la police de cette ville n'eût été appelée sur son absence.
-- Sans doute les douaniers ont votre signalement lui dit l'envoyé de sa tanteet si nous suivons la grande routeà la frontière du royaume lombardo-vénitienvous serez arrêté.
Fabrice et ses gens connaissaient les moindres sentiers de la montagne qui sépare Lugano du lac de Côme: ils se déguisèrent en chasseursc'est-à-dire en contrebandierset comme ils étaient trois et porteurs de mines assez résoluesles douaniers qu'ils rencontrèrent ne songèrent qu'à les saluer. Fabrice s'arrangea de façon à n'arriver au château que vers minuit; à cette heureson père et tous les valets de chambre portant de la poudre étaient couchés depuis longtemps. Il descendit sans peine dans le fossé profond et pénétra dans le château par la petite fenêtre d'une cave: c'est là qu'il était attendu par sa mère et sa tantebientôt ses soeurs accoururent. Les transports de tendresse et les larmes se succédèrent pendant longtempset l'on commençait à peine à parler raison lorsque les premières lueurs de l'aube vinrent avertir ces êtres qui se croyaient malheureuxque le temps volait.
-- J'espère que ton frère ne se sera pas douté de ton arrivéelui dit madame Pietranera; je ne lui parlais guère depuis sa belle équipéece dont son amour- propre me faisait l'honneur d'être fort piqué: ce soir à souper j'ai daigné lui adresser la parole; j'avais besoin de trouver un prétexte pour cacher la joie folle qui pouvait lui donner des soupçons. Puislorsque je me suis aperçue qu'il était tout fier de cette prétendue réconciliationj'ai profité de sa joie pour le faire boire d'une façon désordonnéeet certainement il n'aura pas songé à se mettre en embuscade pour continuer son métier d'espion.
-- C'est dans ton appartement qu'il faut cacher notre hussarddit la marquiseil ne peut partir tout de suite dans ce premier momentnous ne sommes pas assez maîtresses de notre raisonet il s'agit de choisir la meilleure façon de mettre en défaut cette terrible police de Milan.
On suivit cette idée; mais le marquis et son fils aîné remarquèrentle jour d'aprèsque la marquise était sans cesse dans la chambre de sa belle-soeur. Nous ne nous arrêterons pas à peindre les transports de tendresse et de joie qui ce jour-là encore agitèrent ces êtres si heureux. Les coeurs italiens sontbeaucoup plus que les nôtrestourmentés par les soupçons et par les idées folles que leur présente une imagination brûlantemais en revanche leurs joies sont bien plus intenses et durent plus longtemps. Ce jour-là la comtesse et la marquise étaient absolument privées de leur raison; Fabrice fut obligé de recommencer tous ses récits: enfin on résolut d'aller cacher la joie commune à Milantant il sembla difficile de se dérober plus longtemps à la police du marquis et de son fils Ascagne.
On prit la barque ordinaire de la maison pour aller à Côme; en agir autrement eût été réveiller mille soupçons; mais en arrivant au port de Côme la marquise se souvint qu'elle avait oublié à Grianta des papiers de la dernière importance: elle se hâta d'y envoyer les batelierset ces hommes ne purent faire aucune remarque sur la manière dont ces deux dames employaient leur temps à Côme. A peine arrivéeselles louèrent au hasard une de ces voitures qui attendent pratique près de cette haute tour du moyen âge qui s'élève au-dessus de la porte de Milan. On partit à l'instant même sans que le cocher eût le temps de parler à personne. A un quart de lieue de la ville on trouva un jeune chasseur de la connaissance de ces dameset qui par complaisancecomme elles n'avaient aucun homme avec ellesvoulut bien leur servir de chevalier jusqu'aux portes de Milanoù il se rendait en chassant. Tout allait bienet ces dames faisaient la conversation la plus joyeuse avec le jeune voyageurlorsqu'à un détour que fait la route pour tourner la charmante colline et le bois de San-Giovannitrois gendarmes déguisés sautèrent à la bride des chevaux.-- Ah! mon mari nous a trahis! s'écria la marquiseet elle s'évanouit. Un maréchal des logis qui était resté un peu en arrière s'approcha de la voiture en trébuchantet dit d'une voix qui avait l'air de sortir du cabaret:
-- Je suis fâché de la mission que j'ai à remplirmais je vous arrêtegénéral Fabio Conti.
Fabrice crut que le maréchal des logis lui faisait une mauvaise plaisanterie en l'appelant général. Tu me le paierasse dit-il; il regardait les gendarmes déguisés et guettait le moment favorable pour sauter à bas de la voiture et se sauver à travers champs.
La comtesse sourit à tout hasardje croispuis dit au maréchal des logis:
-- Maismon cher maréchalest-donc cet enfant de seize ans que vous prenez pour le général Conti?
-- N'êtes-vous pas la fille du général? dit le maréchal des logis.
-- Voyez mon pèredit la comtesse en montrant Fabrice. Les gendarmes furent saisis d'un rire fou.
-- Montrez vos passeports sans raisonnerreprit le maréchal des logis piqué de la gaieté générale.
-- Ces dames n'en prennent jamais pour aller à Milandit le cocher d'un air froid et philosophique; elles viennent de leur château de Grianta. Celle-ci est madame la comtesse Pietraneracelle-làmadame la marquise del Dongo.
Le maréchal des logistout déconcertépassa à la tête des chevauxet là tint conseil avec ses hommes. La conférence durait bien depuis cinq minuteslorsque la comtesse Pietranera pria ces messieurs de permettre que la voiture fût avancée de quelques pas et placée à l'ombre; la chaleur était accablantequoiqu'il ne fût que onze heures du matinFabricequi regardait fort attentivement de tous les côtéscherchant le moyen de se sauvervit déboucher d'un petit sentier à travers champset arriver sur la grande routecouverte de poussièreune jeune fille de quatorze à quinze ans qui pleurait timidement sous son mouchoir. Elle s'avançait à pied entre deux gendarmes en uniformeetà trois pas derrière elleaussi entre deux gendarmesmarchait un grand homme sec qui affectait des airs de dignité comme un préfet suivant une procession.
-- Où les avez-vous donc trouvés? dit le maréchal des logis tout à fait ivre en ce moment.
-- Se sauvant à travers champset pas plus de passeports que sur la main.
Le maréchal des logis parut perdre tout à fait la tête; il avait devant lui cinq prisonniers au lieu de deux qu'il lui fallait. Il s'éloigna de quelques pasne laissant qu'un homme pour garder le prisonnier qui faisait de la majestéet un autre pour empêcher les chevaux d'avancer.
-- Restedit la comtesse à Fabrice qui déjà avait sauté à terretout va s'arranger.
On entendit un gendarme s'écrier:
-- Qu'importe! s'ils n'ont pas de passeportsils sont de bonne prise tout de même. Le maréchal des logis semblait n'être pas tout à fait aussi décidé; le nom de la comtesse Pietranera lui donnait de l'inquiétudeil avait connu le généraldont il ne savait pas la mort. Le général n'est pas un homme à ne pas se venger si j'arrête sa femme mal à proposse disait-il.
Pendant cette délibération qui fut longuela comtesse avait lié conversation avec la jeune fille qui était à pied sur la route et dans la poussière à côté de la calèche; elle avait été frappée de sa beauté.
-- Le soleil va vous faire malmademoiselle; ce brave soldatajouta-t-elle en parlant au gendarme placé à la tête des chevauxvous permettra bien de monter en calèche.
Fabricequi rôdait autour de la voitures'approcha pour aider la jeune fille à monter. Celle-ci s'élançait déjà sur le marchepiedle bras soutenu par Fabricelorsque l'homme imposantqui était à six pas en arrière de la voiturecria d'une voix grossie par la volonté d'être digne:
-- Restez sur la routene montez pas dans une voiture qui ne vous appartient pas.
Fabrice n'avait pas entendu cet ordre; la jeune filleau lieu de monter dans la calèchevoulut redescendreet Fabrice continuant à la soutenir elle tomba dans ses bras. Il souritelle rougit profondément; ils restèrent un instant à se regarder après que la jeune fille se fut dégagée de ses bras.
-- Ce serait une charmante compagne de prisonse dit Fabrice: quelle pensée profonde sous ce front! elle saurait aimer.
Le maréchal des logis s'approcha d'un air d'autorité:
-- Laquelle de ces dames se nomme Clélia Conti?
-- Moidit la jeune fille.
-- Et mois'écria l'homme âgéje suis le général Fabio Contichambellan de S.A.S. monseigneur le prince de Parme; je trouve fort inconvenant qu'un homme de ma sorte soit traqué comme un voleur.
-- Avant-hieren vous embarquant au port de Cômen'avez-vous pas envoyé promener l'inspecteur de police qui vous demandait votre passeport? Eh bien! aujourd'hui il vous empêche de vous promener.
-- Je m'éloignais déjà avec ma barquej'étais presséle temps étant à l'orage; un homme sans uniforme m'a crié du quai de rentrer au portje lui ai dit mon nom et j'ai continué mon voyage.
-- Et ce matin vous vous êtes enfui de Côme?
-- Un homme comme moi ne prend pas de passeport pour aller de Milan voir le lac. Ce matinà Cômeon m'a dit que je serais arrêté à la porteje suis sorti à pied avec ma fille; j'espérais trouver sur la route quelque voiture qui me conduirait jusqu'à Milanoù certes ma première visite sera pour porter mes plaintes au général commandant la province.
Le maréchal des logis parut soulagé d'un grand poids.
-- Eh bien! généralvous êtes arrêtéet je vais vous conduire à Milan. Et vousqui êtes-vous? dit-il à Fabrice.
-- Mon filsreprit la comtesse: Ascagnefils du général de division Pietranera.
-- Sans passeportmadame la comtesse? dit le maréchal des logis fort radouci.
-- A son âge il n'en a jamais pris; il ne voyage jamais seulil est toujours avec moi.
Pendant ce colloquele général Conti faisait de la dignité de plus en plus offensée avec les gendarmes.
-- Pas tant de paroleslui dit l'un d'euxvous êtes arrêtésuffit!
-- Vous serez trop heureuxdit le maréchal des logisque nous consentions à ce que vous louiez un cheval de quelque paysan; autrementmalgré la poussière et la chaleuret le grade de chambellan de Parmevous marcherez fort bien à pied au milieu de nos chevaux.
Le général se mit à jurer.
-- Veux-tu bien te taire! reprit le gendarme. Où est ton uniforme de général? Le premier venu ne peut-il pas dire qu'il est général?
Le général se fâcha de plus belle. Pendant ce temps les affaires allaient beaucoup mieux dans la calèche.
La comtesse faisait marcher les gendarmes comme s'ils eussent été ses gens. Elle venait de donner un écu à l'un d'eux pour aller chercher du vin et surtout de l'eau fraîche dans une cassine que l'on apercevait à deux cents pas. Elle avait trouvé le temps de calmer Fabricequià toute forcevoulait se sauver dans le bois qui couvrait la colline; j'ai de bons pistoletsdisait-il. Elle obtint du général irrité qu'il laisserait monter sa fille dans la voiture. A cette occasionle généralqui aimait à parler de lui et de sa familleapprit à ces dames que sa fille n'avait que douze ansétant née en I803le 27 octobre; mais tout le monde lui donnait quatorze ou quinze anstant elle avait de raison.
Homme tout à fait commundisaient les yeux de la comtesse à la marquise. Grâce à la comtessetout s'arrangea après un colloque d'une heure. Un gendarmequi se trouva avoir affaire dans le village voisinloua son cheval au général Contiaprès que la comtesse lui eut dit: Vous aurez 10 francs. Le maréchal des logis partit seul avec le général; les autres gendarmes restèrent sous un arbre en compagnie avec quatre énormes bouteilles de vinsorte de petites dames- jeannesque le gendarme envoyé à la cassine avait rapportéesaidé par un paysan. Clélia Conti fut autorisée par le digne chambellan à accepterpour revenir à Milanune place dans la voiture de ces dameset personne ne songea à arrêter le fils du brave général comte Pietranera. Après les premiers moments donnés à la politesse et aux commentaires sur le petit incident qui venait de se terminerClélia Conti remarqua la nuance d'enthousiasme avec laquelle une aussi belle dame que la comtesse parlait à Fabrice; certainement elle n'était pas sa mère. Son attention fut surtout excitée par des allusions répétées à quelque chose d'héroïquede hardide dangereux au suprême degréqu'il avait fait depuis peu; malgré toute son intelligencela jeune Clélia ne put deviner de quoi il s'agissait.
Elle regardait avec étonnement ce jeune héros dont les yeux semblaient respirer encore tout le feu de l'action. Pour luiil était un peu interdit de la beauté si singulière de cette jeune fille de douze anset ses regards la faisaient rougir.
Une lieue avant d'arriver à MilanFabrice dit qu'il allait voir son oncleet prit congé des dames.
-- Si jamais je me tire d'affairedit-il à Cléliaj'irai voir les beaux tableaux de Parmeet alors daignerez-vous vous rappeler ce nom: Fabrice del Dongo?
-- Bon! dit la comtessevoilà comme tu sais garder l'incognito! Mademoiselledaignez vous rappeler que ce mauvais sujet est mon fils et s'appelle Pietranera et non del Dongo.
Le soirfort tardFabrice rentra dans Milan par la porte Renzaqui conduit à une promenade à la mode. L'envoi des deux domestiques en Suisse avait épuisé les fort petites économies de la marquise et de sa soeur; par bonheurFabrice avait encore quelques napoléonset l'un des diamantsqu'on résolut de vendre.
Ces dames étaient aimées et connaissaient toute la ville; les personnages les plus considérables dans le parti autrichien et dévot allèrent parler en faveur de Fabrice au baron Binderchef de la police. Ces messieurs ne concevaient pasdisaient-ilscomment l'on pouvait prendre au sérieux l'incartade d'un enfant de seize ans qui se dispute avec un frère aîné et déserte la maison paternelle.
-- Mon métier est de tout prendre au sérieuxrépondait doucement le baron Binderhomme sage et triste; il établissait alors cette fameuse police de Milanet s'était engagé à prévenir une révolution comme celle de 1746qui chassa les Autrichiens de Gênes. Cette police de Milandevenue depuis si célèbre par les aventures de MM. Pellico et d'Andryanene fut pas précisément cruelleelle exécutait raisonnablement et sans pitié des lois sévères. L'empereur François II voulait qu'on frappât de terreur ces imaginations italiennes si hardies.
-- Donnez-moi jour par jourrépétait le baron Binder aux protecteurs de Fabricel'indication prouvée de ce qu'a fait le jeune marchesino del Dongo; prenons-le depuis le moment de son départ de Grianta8 marsjusqu'à son arrivéehier soirdans cette villeoù il est caché dans une des chambres de l'appartement de sa mèreet je suis prêt à le traiter comme le plus aimable et le plus espiègle des jeunes gens de la ville. Si vous ne pouvez pas me fournir l'itinéraire du jeune homme pendant toutes les journées qui ont suivi son départ de Griantaquels que soient la grandeur de sa naissance et le respect que je porte aux amis de sa famillemon devoir n'est-il pas de le faire arrêter? Ne dois-je pas le retenir en prison jusqu'à ce qu'il m'ait donné la preuve qu'il n'est pas allé porter des paroles à Napoléon de la part de quelques mécontents qui peuvent exister en Lombardie parmi les sujets de Sa Majesté Impériale et Royale? Remarquez encoremessieursque si le jeune del Dongo parvient à se justifier sur ce pointil restera coupable d'avoir passé à l'étranger sans passeport régulièrement délivréet de plus en prenant un faux nom et faisant usage sciemment d'un passeport délivré à un simple ouvrierc'est-à-dire à un individu d'une classe tellement au-dessous de celle à laquelle il appartient.
Cette déclarationcruellement raisonnableétait accompagnée de toutes les marques de déférence et de respect que le chef de la police devait à la haute position de la marquise del Dongo et à celle des personnages importants qui venaient s'entremettre pour elle.
La marquise fut au désespoir quand elle apprit la réponse du baron Binder.
-- Fabrice va être arrêtés'écria-t-elle en pleurant et une fois en prisonDieu sait quand il en sortira! Son père le reniera!
Mme Pietranera et sa belle-soeur tinrent conseil avec deux ou trois amis intimesetquoi qu'ils pussent direla marquise voulut absolument faire partir son fils dès la nuit suivante.
-- Mais tu vois bienlui disait la comtesseque le baron Binder sait que ton fils est ici; cet homme n'est point méchant.
-- Nonmais il veut plaire à l'empereur François.
-- Mais s'il croyait utile à son avancement de jeter Fabrice en prisonil y serait déjàet c'est lui marquer une défiance injurieuse que de le faire sauver.
-- Mais nous avouer qu'il sait où est Fabrice c'est nous dire: faites-le partir! Nonje ne vivrai pas tant que je pourrai me répéter: Dans un quart d'heure mon fils peut être entre quatre murailles! Quelle que soit l'ambition du baron Binderajoutait la marquiseil croit utile à sa position personnelle en ce pays d'afficher des ménagements pour un homme du rang de mon mariet j'en vois une preuve dans cette ouverture de coeur singulière avec laquelle il avoue qu'il sait où prendre mon fils. Bien plusle baron détaille complaisamment les deux contraventions dont Fabrice est accusé d'après la dénonciation de son indigne frère; il explique que ces deux contraventions emportent la prison; n'est-ce pas nous dire que si nous aimons mieux l'exilc'est à nous de choisir?
-- Si tu choisis l'exilrépétait toujours la comtessede la vie nous ne le reverrons. Fabriceprésent à tout l'entretienavec un des anciens amis de la marquise maintenant conseiller au tribunal formé par l'Autricheétait grandement d'avis de prendre la clef des champs. Eten effetle soir même il sortit du palais caché dans la voiture qui conduisait au théâtre de la Scala sa mère et sa tante. Le cocherdont on se défiaitalla faire comme d'habitude une station au cabaretet pendant que le laquaishomme sûrgardait les chevauxFabricedéguisé en paysanse glissa hors de la voiture et sortit de la ville. Le lendemain matin il passa la frontière avec le même bonheuret quelques heures plus tard il était installé dans une terre que sa mère avait en Piémontprès de Novareprécisément à Romagnanooù Bayard fut tué.
On peut penser avec quelle attention ces dames arrivées dans leur logeà la Scalaécoutaient le spectacle. Elles n'y étaient allées que pour pouvoir consulter plusieurs de leurs amis appartenant au parti libéralet dont l'apparition au palais del Dongo eût pu être mal interprétée par la police. Dans la logeil fut résolu de faire une nouvelle démarche auprès du baron Binder. Il ne pouvait pas être question d'offrir une somme d'argent à ce magistrat parfaitement honnête hommeet d'ailleurs ces dames étaient fort pauvreselles avaient forcé Fabrice à emporter tout ce qui restait sur le produit du diamant.
Il était fort important toutefois d'avoir le dernier mot du baron. Les amis de la comtesse lui rappelèrent un certain chanoine Bordajeune homme fort aimablequi jadis avait voulu lui faire la couret avec d'assez vilaines façons; ne pouvant réussiril avait dénoncé son amitié pour Limercati au général Pietranerasur quoi il avait été chassé comme un vilain. Or maintenant ce chanoine faisait tous les soirs la partie de tarots de la baronne Binderet naturellement était l'ami intime du mari. La comtesse se décida à la démarche horriblement pénible d'aller voir ce chanoine; et le lendemain matin de bonne heureavant qu'il sortît de chez luielle se fit annoncer.
Lorsque le domestique unique du chanoine prononça le nom de la comtesse Pietraneracet homme fut ému au point d'en perdre la voix; il ne chercha point à réparer le désordre d'un négligé fort simple.
-- Faites entrer et allez-vous-endit-il d'une voix éteinte. La comtesse entra; Borda se jeta à genoux.
-- C'est dans cette position qu'un malheureux fou doit recevoir vos ordresdit-il à la comtesse qui ce matin-làdans son négligé à demi-déguisementétait d'un piquant irrésistible. Le profond chagrin de l'exil de Fabricela violence qu'elle se faisait pour paraître chez un homme qui en avait agi traîtreusement avec elletout se réunissait pour donner à son regard un éclat incroyable.
-- C'est dans cette position que je veux recevoir vos ordress'écria le chanoinecar il est évident que vous avez quelque service à me demanderautrement vous n'auriez pas honoré de votre présence la pauvre maison d'un malheureux fou: jadis transporté d'amour et de jalousieil se conduisit avec vous comme un lâcheune fois qu'il vit qu'il ne pouvait vous plaire.
Ces paroles étaient sincères et d'autant plus belles que le chanoine jouissait maintenant d'un grand pouvoir: la comtesse en fut touchée jusqu'aux larmes; l'humiliationla crainte glaçaient son âmeen un instant l'attendrissement et un peu d'espoir leur succédaient. D'un état fort malheureux elle passait en un clin d'oeil presque au bonheur.
-- Baise ma maindit-elle au chanoine en la lui présentantet lève-toi. (Il faut savoir qu'en Italie le tutoiement indique la bonne et franche amitié tout aussi bien qu'un sentiment plus tendre.) Je viens te demander grâce pour mon neveu Fabrice. Voici la vérité complète et sans le moindre déguisement comme on la dit à un vieil ami. A seize ans et demi il vient de faire une insigne folie; nous étions au château de Griantasur le lac de Côme. Un soirà sept heures nous avons apprispar un bateau de Cômele débarquement de l'Empereur au golfe de Juan. Le lendemain matin Fabrice est parti pour la Franceaprès s'être fait donner le passeport d'un de ses amis du peupleun marchand de baromètres nommé Vasi. Comme il n'a pas l'air précisément d'un marchand de baromètresà peine avait-il fait dix lieues en Franceque sur sa bonne mine on l'a arrêté; ses élans d'enthousiasme en mauvais français semblaient suspects. Au bout de quelque temps il s'est sauvé et a pu gagner Genève; nous avons envoyé à sa rencontre à Lugano...
-- C'est-à-dire à Genèvedit le chanoine en souriant. La comtesse acheva l'histoire.
-- Je ferai pour vous tout ce qui est humainement possiblereprit le chanoine avec effusion; je me mets entièrement à vos ordres. Je ferai même des imprudencesajouta-t-il. Ditesque dois-je faire au moment où ce pauvre salon sera privé de cette apparition célesteet qui fait époque dans l'histoire de ma vie?
-- Il faut aller chez le baron Binder lui dire que vous aimez Fabrice depuis sa naissanceque vous avez vu naître cet enfant quand vous veniez chez nouset qu'enfinau nom de l'amitié qu'il vous accordevous le suppliez d'employer tous ses espions à vérifier siavant son départ pour la SuisseFabrice a eu la moindre entrevue avec aucun de ces libéraux qu'il surveille. Pour peu que le baron soit bien serviil verra qu'il s'agit ici uniquement d'une véritable étourderie de jeunesse. Vous savez que j'avaisdans mon bel appartement du palais Dugnaniles estampes des batailles gagnées par Napoléon: c'est en lisant les légendes de ces gravures que mon neveu apprit à lire. Dès l'âge de cinq ans mon pauvre mari lui expliquait ces batailles; nous lui mettions sur la tête le casque de mon maril'enfant traînait son grand sabre. Eh bien! un beau jouril apprend que le dieu de mon marique l'Empereur est de retour en France; il part pour le rejoindrecomme un étourdimais il n'y réussit pas. Demandez à votre baron de quelle peine il veut punir ce moment de folie.
-- J'oubliais une choses'écria le chanoinevous allez voir que je ne suis pas tout à fait indigne du pardon que vous m'accordez. Voicidit-il en cherchant sur la table parmi ses papiersvoici la dénonciation de cet infâme coltorto (hypocrite)voyezsignée Ascanio Valserra del DONGO qui a commencé toute cette affaire; je l'ai prise hier soir dans les bureaux de la policeet suis allé à la Scaladans l'espoir de trouver quelqu'un allant d'habitude dans votre logepar lequel je pourrais vous la faire communiquer. Copie de cette pièce est à Vienne depuis longtemps. Voilà l'ennemi que nous devons combattre. Le chanoine lut la dénonciation avec la comtesseet il fut convenu que dans la journéeil lui en ferait tenir une copie par une personne sûre. Ce fut la joie dans le coeur que la comtesse rentra au palais del Dongo.
-- Il est impossible d'être plus galant homme que cet ancien coquindit-elle à la marquise; ce soir à la Scalaà dix heures trois quarts à l'horloge du théâtrenous renverrons tout le monde de notre logenous éteindrons les bougiesnous fermerons notre porteetà onze heuresle chanoine lui-même viendra nous dire ce qu'il a pu faire. C'est ce que nous avons trouvé de moins compromettant pour lui.
Ce chanoine avait beaucoup d'esprit; il n'eut garde de manquer au rendez-vous: il y montra une bonté complète et une ouverture de coeur sans réserve que l'on ne trouve guère que dans les pays où la vanité ne domine pas tous les sentiments. Sa dénonciation de la comtesse au général Pietranerason mariétait un des grands remords de sa vieet il trouvait un moyen d'abolir ce remords.
Le matinquand la comtesse était sortie de chez lui: La voilà qui fait l'amour avec son neveus'était-il dit avec amertumecar il n'était point guéri. Altière comme elle l'estêtre venue chez moi!... A la mort de ce pauvre Pietraneraelle repoussa avec horreur mes offres de servicequoique fort polies et très bien présentées par le colonel Scottison ancien amant. La belle Pietranera vivre avec 1 500 francs! ajoutait le chanoine en se promenant avec action dans sa chambre! Puis aller habiter le château de Grianta avec un abominable secatorece marquis del Dongo!... Tout s'explique maintenant! Au faitce jeune Fabrice est plein de grâcesgrandbien faitune figure toujours riante... etmieux que celaun certain regard chargé de douce volupté... une physionomie à la Corrègeajoutait le chanoine avec amertume.
La différence d'âge... point trop grande... Fabrice né après l'entrée des Françaisvers 98ce me semble; la comtesse peut avoir vingt-sept ou vingt-huit ansimpossible d'être plus jolieplus adorable; dans ce pays fertile en beautéselle les bat toutes; la Marinila Gherardila Rugal'Aresila Pietragruaelle l'emporte sur toutes ces femmes... Ils vivaient heureux cachés sur ce beau lac de Côme quand le jeune homme a voulu rejoindre Napoléon... Il y a encore des âmes en Italie! etquoi qu'on fasse! Chère patrie!... Noncontinuait ce coeur enflammé par la jalousieimpossible d'expliquer autrement cette résignation à végéter à la campagneavec le dégoût de voir tous les joursà tous les repas cette horrible figure du marquis del Dongoplus cette infâme physionomie blafarde du marchesino Ascanioqui sera pis que son père!... Eh bien! je la servirai franchement. Au moins j'aurai le plaisir de la voir autrement qu'au bout de ma lorgnette.
Le chanoine Borda expliqua fort clairement l'affaire à ces dames. Au fondBinder était on ne peut pas mieux disposé; il était charmé que Fabrice eût pris la clef des champs avant les ordres qui pouvaient arriver de Vienne; car le Binder n'avait pouvoir de décider de rienil attendait des ordres pour cette affaire comme pour toutes les autres; il envoyait à Vienne chaque jour la copie exacte de toutes les informations: puis il attendait.
Il fallait que dans son exil à Romagnan Fabrice
1: Ne manquât pas d'aller à la messe tous les joursprît pour confesseur un homme d'espritdévoué à la cause de la monarchieet ne lui avouâtau tribunal de la pénitenceque des sentiments fort irréprochables;
2: Il ne devait fréquenter aucun homme passant pour avoir de l'espritetdans l'occasionil fallait parler de la révolte avec horreuret comme n'étant jamais permise;
3: Il ne devait point se faire voir au caféil ne fallait jamais lire d'autres journaux que les gazettes officielles de Turin et de Milan; en généralmontrer du dégoût pour la lecturene jamais liresurtout aucun ouvrage imprimé après 1720exception tout au plus pour les romans de Walter Scott;
4: Enfinajouta le chanoine avec un peu de maliceil faut surtout qu'il fasse ouvertement la cour à quelqu'une des jolies femmes du paysde la classe noblebien entendu; cela montrera qu'il n'a pas le génie sombre et mécontent d'un conspirateur en herbe.
Avant de se coucherla comtesse et la marquise écrivirent à Fabrice deux lettres infinies dans lesquelles on lui expliquait avec une anxiété charmante tous les conseils donnés par Borda.
Fabrice n'avait nulle envie de conspirer: il aimait Napoléoneten sa qualité de noblese croyait fait pour être plus heureux qu'un autre et trouvait les bourgeois ridicules. Jamais il n'avait ouvert un livre depuis le collègeoù il n'avait lu que des livres arrangés par les jésuites. Il s'établit à quelque distance de Romagnandans un palais magnifiquel'un des chefs-d'oeuvre du fameux architecte San-Micheli; mais depuis trente ans on ne l'avait pas habitéde sorte qu'il pleuvait dans toutes les pièces et pas une fenêtre ne fermait. Il s'empara des chevaux de l'homme d'affairesqu'il montait sans façon toute la journée; il ne parlait pointet réfléchissait. Le conseil de prendre une maîtresse dans une famille ultra lui parut plaisant et il le suivit à la lettre. Il choisit pour confesseur un jeune prêtre intrigant qui voulait devenir évêque (comme le confesseur du Spielberg) [Voir les curieux Mémoires de M. Andryaneamusants comme un conteet qui resteront comme Tacite.]; mais il faisait trois lieues à pied et s'enveloppait d'un mystère qu'il croyait impénétrablepour lire le Constitutionnelqu'il trouvait sublime: cela est aussi beau qu'Alfieri et le Dante! s'écriait-il souvent. Fabrice avait cette ressemblance avec la jeunesse française qu'il s'occupait beaucoup plus sérieusement de son cheval et de son journal que de sa maîtresse bien pensante. Mais il n'y avait pas encore de place pour l'imitation des autres dans cette âme naïve et fermeet il ne fit pas d'amis dans la société du gros bourg de Romagnan; sa simplicité passait pour de la hauteur; on ne savait que dire de ce caractère. C'est un cadet mécontent de n'être pas aînédit le curé.
Livre Premier
Chapitre VI.
Nous avouerons avec sincérité que la jalousie du chanoine Borda n'avait pas absolument tort; à son retour de FranceFabrice parut aux yeux de la comtesse Pietranera comme un bel étranger qu'elle eût beaucoup connu jadis. S'il eût parlé d'amourelle l'eût aimé; n'avait-elle pas déjà pour sa conduite et sa personne une admiration passionnée et pour ainsi dire sans bornes? Mais Fabrice l'embrassait avec une telle effusion d'innocente reconnaissance et de bonne amitiéqu'elle se fût fait horreur à elle-même si elle eût cherché un autre sentiment dans cette amitié presque filiale. Au fondse disait la comtessequelques amis qui m'ont connue il y a six ansà la cour du prince Eugènepeuvent encore me trouver jolie et même jeunemais pour lui je suis une femme respectable... ets'il faut tout dire sans nul ménagement pour mon amour-propreune femme âgée. La comtesse se faisait illusion sur l'époque de la vie où elle était arrivéemais ce n'était pas à la façon des femmes vulgaires. A son âged'ailleursajoutait-elleon s'exagère un peu les ravages du temps; un homme plus avancé dans la vie...
La comtessequi se promenait dans son salons'arrêta devant une glacepuis sourit. Il faut savoir que depuis quelques mois le coeur de Mme Pietranera était attaqué d'une façon sérieuse et par un singulier personnage. Peu après le départ de Fabrice pour la Francela comtesse quisans qu'elle se l'avouât tout à faitcommençait déjà à s'occuper beaucoup de luiétait tombée dans une profonde mélancolie. Toutes ses occupations lui semblaient sans plaisiretsi l'on ose ainsi parlersans saveur; elle se disait que Napoléon voulant s'attacher ses peuples d'Italie prendrait Fabrice pour aide de camp.-- Il est perdu pour moi! s'écriait-elle en pleurantje ne le reverrai plus; il m'écriramais que serai-je pour lui dans dix ans?
Ce fut dans ces dispositions qu'elle fit un voyage à Milan; elle espérait y trouver des nouvelles plus directes de Napoléonetqui saitpeut-être par contrecoup des nouvelles de Fabrice. Sans se l'avouercette âme active commençait à être bien lasse de la vie monotone qu'elle menait à la campagne: c'est s'empêcher de mourirse disait-ellece n'est pas vivre. Tous les jours voir ces figures poudrées le frèrele neveu Ascagneleurs valets de chambre! Que seraient les promenades sur le lac sans Fabrice? Son unique consolation était puisée dans l'amitié qui l'unissait à la marquise. Mais depuis quelque tempscette intimité avec la mère de Fabriceplus âgée qu'elleet désespérant de la viecommençait à lui être moins agréable.
Telle était la position singulière de Mme Pietranera: Fabrice partielle espérait peu de l'avenir; son coeur avait besoin de consolation et de nouveauté. Arrivée à Milanelle se prit de passion pour l'opéra à la mode; elle allait s'enfermer toute seuledurant de longues heuresà la Scaladans la loge du général Scottison ancien ami. Les hommes qu'elle cherchait à rencontrer pour avoir des nouvelles de Napoléon et de son armée lui semblaient vulgaires et grossiers. Rentrée chez elleelle improvisait sur son piano jusqu'à trois heures du matin. Un soirà la Scaladans la loge d'une de ses amiesoù elle allait chercher des nouvelles de Franceon lui présenta le comte Moscaministre de Parme: c'était un homme aimable et qui parla de la France et de Napoléon de façon à donner à son coeur de nouvelles raisons pour espérer ou pour craindre. Elle retourna dans cette loge le lendemain: cet homme d'esprit revintettout le temps du spectacleelle lui parla avec plaisir. Depuis le départ de Fabriceelle n'avait pas trouvé une soirée vivante comme celle-là. Cet homme qui l'amusaitle comte Mosca della Rovere Sorezanaétait alors ministre de la guerrede la police et des finances de ce fameux prince de ParmeErnest IVsi célèbre par ses sévérités que les libéraux de Milan appelaient des cruautés. Mosca pouvait avoir quarante ou quarante-cinq ans; il avait de grands traitsaucun vestige d'importanceet un air simple et gai qui prévenait en sa faveur; il eût été fort bien encoresi une bizarrerie de son prince ne l'eût obligé à porter de la poudre dans les cheveux comme gages de bons sentiments politiques. Comme on craint peu de choquer la vanitéon arrive fort vite en Italie au ton de l'intimitéet à dire des choses personnelles. Le correctif de cet usage est de ne pas se revoir si l'on s'est blessé.
-- Pourquoi donccomteportez-vous de la poudre? lui dit Mme Pietranera la troisième fois qu'elle le voyait. De la poudre! un homme comme vousaimableencore jeune et qui a fait la guerre en Espagne avec nous!
-- C'est que je n'ai rien volé dans cette Espagneet qu'il faut vivre. J'étais fou de la gloire; une parole flatteuse du général françaisGouvion-Saint-Cyrqui nous commandaitétait alors tout pour moi. A la chute de Napoléonil s'est trouvé quetandis que je mangeais mon bien à son servicemon pèrehomme d'imagination et qui me voyait déjà généralme bâtissait un palais dans Parme. En 1813je me suis trouvé pour tout bien un grand palais à finir et une pension.
-- Une pension: 3 500 francscomme mon mari?
-- Le comte Pietranera était général de division. Ma pensionà moipauvre chef d'escadronn'a jamais été que de 800 francset encore je n'en ai été payé que depuis que je suis ministre des finances.
Comme il n'y avait dans la loge que la dame d'opinions fort libérales à laquelle elle appartenaitl'entretien continua avec la même franchise. Le comte Moscainterrogéparla de sa vie à Parme. En Espagnesous le général Saint-Cyrj'affrontais des coups de fusil pour arriver à la croix et ensuite à un peu de gloiremaintenant je m'habille comme un personnage de comédie pour gagner un grand état de maison et quelques milliers de francs. Une fois entré dans cette sorte de jeu d'échecschoqué des insolences de mes supérieursj'ai voulu occuper une des premières places; j'y suis arrivé: mais mes jours les plus heureux sont toujours ceux que de temps à autre je puis venir passer à Milan; là vit encorece me semblele coeur de votre armée d'Italie.
La franchisela disinvoltura avec laquelle parlait ce ministre d'un prince si redouté piqua la curiosité de la comtesse; sur son titre elle avait cru trouver un pédant plein d'importanceelle voyait un homme qui avait honte de la gravité de sa place. Mosca lui avait promis de lui faire parvenir toutes les nouvelles de France qu'il pourrait recueillir: c'était une grande indiscrétion à Milandans le mois qui précéda Waterloo; il s'agissait alors pour l'Italie d'être ou de n'être pas; tout le monde avait la fièvreà Miland'espérance ou de crainte. Au milieu de ce trouble universella comtesse fit des questions sur le compte d'un homme qui parlait si lestement d'une place si enviée et qui était sa seule ressource.
Des choses curieuses et d'une bizarrerie intéressante furent rapportées à Mme Pietranera: Le comte Mosca della Rovere Sorezanalui dit-onest sur le point de devenir premier ministre et favori déclaré de Ranuce-Ernest IVsouverain absolu de Parmeetde plusl'un des princes les plus riches de l'Europe. Le comte serait déjà arrivé à ce poste suprême s'il eût voulu prendre une mine plus grave; on dit que le prince lui fait souvent la leçon à cet égard.
-- Qu'importent mes façons à Votre Altesserépond-il librementsi je fais bien ses affaires?
-- Le bonheur de ce favoriajoutait-onn'est pas sans épines. Il faut plaire à un souverainhomme de sens et d'esprit sans doutemais quidepuis qu'il est monté sur un trône absolusemble avoir perdu la tête et montrepar exempledes soupçons dignes d'une femmelette.
Ernest IV n'est brave qu'à la guerre. Sur les champs de batailleon l'a vu vingt fois guider une colonne à l'attaque en brave général; mais après la mort de son père Ernest IIIde retour dans ses étatsoùpour son malheuril possède un pouvoir sans limitesil s'est mis à déclamer follement contre les libéraux et la liberté. Bientôt il s'est figuré qu'on le haïssait; enfindans un moment de mauvaise humeur il a fait pendre deux libérauxpeut-être peu coupablesconseillé à cela par un misérable nommé Rassisorte de ministre de la justice.
Depuis ce moment fatalla vie du prince a été changée; on le voit tourmenté par les soupçons les plus bizarres. Il n'a pas cinquante anset la peur l'a tellement amoindrisi l'on peut parler ainsiquedès qu'il parle des jacobins et des projets du comité directeur de Parison lui trouve la physionomie d'un vieillard de quatre-vingts ans; il retombe dans les peurs chimériques de la première enfance. Son favori Rassifiscal général (ou grand juge)n'a d'influence que par la peur de son maître; et dès qu'il craint pour son créditil se hâte de découvrir quelque nouvelle conspiration des plus noires et des plus chimériques. Trente imprudents se réunissent-ils pour lire un numéro du ConstitutionnelRassi les déclare conspirateurs et les envoie prisonniers dans cette fameuse citadelle de Parmeterreur de toute la Lombardie. Comme elle est fort élevéecent quatre-vingts piedsdit-onon l'aperçoit de fort loin au milieu de cette plaine immense; et la forme physique de cette prisonde laquelle on raconte des choses horriblesla fait reinede par la peurde toute cette plainequi s'étend de Milan à Bologne.
-- Le croiriez-vous? disait à la comtesse un autre voyageurla nuitau troisième étage de son palaisgardé par quatre-vingts sentinelles quitous les quarts d'heurehurlent une phrase entièreErnest IV tremble dans sa chambre. Toutes les portes fermées à dix verrouset les pièces voisinesau-dessus comme au- dessousremplies de soldatsil a peur des jacobins. Si une feuille du parquet vient à crieril saute sur ses pistolets et croit à un libéral caché sous son lit. Aussitôt toutes les sonnettes du château sont en mouvementet un aide de camp va réveiller le comte Mosca. Arrivé au châteauce ministre de la police se garde bien de nier la conspirationau contraire; seul avec le princeet armé jusqu'aux dentsil visite tous les coins des appartementsregarde sous les litseten un motse livre à une foule d'actions ridicules dignes d'une vieille femme. Toutes ces précautions eussent semblé bien avilissantes au prince lui-même dans les temps heureux où il faisait la guerre et n'avait tué personne qu'à coups de fusil. Comme c'est un homme d'infiniment d'espritil a honte de ces précautions; elles lui semblent ridiculesmême au moment où il s'y livreet la source de l'immense crédit du comte Moscac'est qu'il emploie toute son adresse à faire que le prince n'ait jamais à rougir en sa présence. C'est luiMoscaquien sa qualité de ministre de la policeinsiste pour regarder sous les meublesetdit-on à Parmejusque dans les étuis des contrebasses. C'est le prince qui s'y opposeet plaisante son ministre sur sa ponctualité excessive. Ceci est un parilui répond le comte Mosca: songez aux sonnets satiriques dont les jacobins nous accableraient si nous vous laissions tuer. Ce n'est pas seulement votre vie que nous défendonsc'est notre honneur: mais il paraît que le prince n'est dupe qu'à demicar si quelqu'un dans la ville s'avise de dire que la veille on a passé une nuit blanche au châteaule grand fiscal Rassi envoie le mauvais plaisant à la citadelle; et une fois dans cette demeure élevée et en bon aircomme on dit à Parmeil faut un miracle pour que l'on se souvienne du prisonnier. C'est parce qu'il est militaireet qu'en Espagne il s'est sauvé vingt fois le pistolet à la mainau milieu des surprisesque le prince préfère le comte Mosca à Rassiqui est bien plus flexible et plus bas. Ces malheureux prisonniers de la citadelle sont au secret le plus rigoureuxet l'on fait des histoires sur leur compte. Les libéraux prétendent quepar une invention de Rassiles geôliers et confesseurs ont ordre de leur persuader que tous les mois à peu prèsl'un d'eux est conduit à la mort. Ce jour-là les prisonniers ont la permission de monter sur l'esplanade de l'immense tourà cent quatre-vingts pieds d'élévationet de là ils voient défiler un cortège avec un espion qui joue le rôle d'un pauvre diable qui marche à la mort.
Ces conteset vingt autres du même genre et d'une non moindre authenticitéintéressaient vivement Mme Pietranera; le lendemainelle demandait des détails au comte Moscaqu'elle plaisantait vivement. Elle le trouvait amusant et lui soutenait qu'au fond il était un monstre sans s'en douter. Un jouren rentrant à son aubergele comte se dit: Non seulement cette comtesse Pietranera est une femme charmante; mais quand je passe la soirée dans sa logeje parviens à oublier certaines choses de Parme dont le souvenir me perce le coeur. «Ce ministremalgré son air léger et ses façons brillantesn'avait pas une âme à la française ; il ne savait pas oublier les chagrins. Quand son chevet avait une épineil était obligé de la briser et de l'user à force d'y piquer ses membres palpitant ». Je demande pardon pour cette phrasetraduite de l'italien. Le lendemain de cette découvertele comte trouva que malgré les affaires qui l'appelaient à Milanla journée était d'une longueur énorme; il ne pouvait tenir en place; il fatigua les chevaux de sa voiture. Vers les six heuresil monta à cheval pour aller au Corso; il avait quelque espoir d'y rencontrer Mme Pietranera; ne l'y ayant pas vueil se rappela qu'à huit heures le théâtre de la Scala ouvrait; il y entra et ne vit pas dix personnes dans cette salle immense. Il eut quelque pudeur de se trouver là. Est-il possiblese dit-ilqu'à quarante-cinq ans sonnés je fasse des folies dont rougirait un sous-lieutenant! Par bonheur personne ne les soupçonne. Il s'enfuit et essaya d'user le temps en se promenant dans ces rues si jolies qui entourent le théâtre de la Scala. Elles sont occupées par des cafés quià cette heureregorgent de monde; devant chacun de ces cafésdes foules de curieux établis sur des chaisesau milieu de la rueprennent des glaces et critiquent les passants. Le comte était un passant remarquable; aussi eut-il le plaisir d'être reconnu et accosté. Trois ou quatre importuns de ceux qu'on ne peut brusquersaisirent cette occasion d'avoir audience d'un ministre si puissant. Deux d'entre eux lui remirent des pétitions; le troisième se contenta de lui adresser des conseils fort longs sur sa conduite politique.
On ne dort pointdit-ilquand on a tant d'esprit; on ne se promène point quand on est aussi puissant. Il rentra au théâtre et eut l'idée de louer une loge au troisième rang; de là son regard pourrait plongersans être remarqué de personnesur la loge des secondes où il espérait voir arriver la comtesse. Deux grandes heures d'attente ne parurent point trop longues à cet amoureux; sûr de n'être point vuil se livrait avec bonheur à toute sa folie. La vieillessese disait-iln'est- ce pasavant toutn'être plus capable de ces enfantillages délicieux?
Enfin la comtesse parut. Armé de sa lorgnetteil l'examinait avec transport: Jeunebrillantelégère comme un oiseause disait-ilelle n'a pas vingt-cinq ans. Sa beauté est son moindre charme: où trouver ailleurs cette âme toujours sincèrequi jamais n'agit avec prudencequi se livre tout entière à l'impression du momentqui ne demande qu'à être entraînée par quelque objet nouveau? Je conçois les folies du comte Nani.
Le comte se donnait d'excellentes raisons pour être foutant qu'il ne songeait qu'à conquérir le bonheur qu'il voyait sous ses yeux. Il n'en trouvait plus d'aussi bonnes quand il venait à considérer son âge et les soucis quelquefois fort tristes qui remplissaient sa vie. Un homme habile à qui la peur ôte l'esprit me donne une grande existence et beaucoup d'argent pour être son ministre; mais que demain il me renvoieje reste vieux et pauvrec'est-à-dire tout ce qu'il y a au monde de plus méprisé; voilà un aimable personnage à offrir à la comtesse! Ces pensées étaient trop noiresil revint à Mme Pietranera; il ne pouvait se lasser de la regarderet pour mieux penser à elle il ne descendait pas dans sa loge. Elle n'avait pris Nanivient-on de me direque pour faire pièce à cet imbécile de Limercati qui ne voulut pas entendre à donner un coup d'épée ou à faire donner un coup de poignard à l'assassin du mari. Je me battrais vingt fois pour elle! s'écria le comte avec transport. A chaque instant il consultait l'horloge du théâtre qui par des chiffres éclatants de lumière et se détachant sur un fond noir avertit les spectateurstoutes les cinq minutesde l'heure où il leur est permis d'arriver dans une loge amie. Le comte se disait: Je ne saurais passer qu'une demi-heure tout au plus dans sa logemoiconnaissance de si fraîche date; si j'y reste davantageje m'afficheet grâce à mon âge et plus encore à ces maudits cheveux poudrésj'aurai l'air attrayant d'un Cassandre. Mais une réflexion le décida tout à coup: Si elle allait quitter cette loge pour faire une visiteje serais bien récompensé de l'avarice avec laquelle je m'économise ce plaisir. Il se levait pour descendre dans la loge où il voyait la comtesse; tout à coup il ne se sentit presque plus d'envie de s'y présenter. Ah! voici qui est charmants'écria-t-il en riant de soi-mêmeet s'arrêtant sur l'escalier; c'est un mouvement de timidité véritable! voilà bien vingt-cinq ans que pareille aventure ne m'est arrivée.
Il entra dans la loge en faisant presque effort sur lui-même; etprofitant en homme d'esprit de l'accident qui lui arrivaitil ne chercha point du tout à montrer de l'aisance ou à faire de l'esprit en se jetant dans quelque récit plaisant; il eut le courage d'être timideil employa son esprit à laisser entrevoir son trouble sans être ridicule. Si elle prend la chose de traversse disait-ilje me perds à jamais. Quoi! timide avec des cheveux couverts de poudreet qui sans le secours de la poudre paraîtraient gris! Mais enfin la chose est vraiedonc elle ne peut être ridicule que si je l'exagère ou si j'en fais trophée. La comtesse s'était si souvent ennuyée au château de Griantavis-à-vis des figures poudrées de son frèrede son neveu et de quelques ennuyeux bien pensants du voisinagequ'elle ne songea pas à s'occuper de la coiffure de son nouvel adorateur.
L'esprit de la comtesse ayant un bouclier contre l'éclat de rire de l'entréeelle ne fut attentive qu'aux nouvelles de France que Mosca avait toujours à lui donner en particulieren arrivant dans la loge; sans doute il inventait. En les discutant avec luielle remarqua ce soir-là son regardqui était beau et bienveillant.
-- Je m'imaginelui dit-ellequ'à Parme au milieu de vos esclavesvous n'allez pas avoir ce regard aimablecela gâterait tout et leur donnerait quelque espoir de n'être pas pendus.
L'absence totale d'importance chez un homme qui passait pour le premier diplomate de l'Italie parut singulière à la comtesse; elle trouva même qu'il avait de la grâce. Enfincomme il parlait bien et avec feuelle ne fut point choquée qu'il eût jugé à propos de prendre pour une soiréeet sans conséquencele rôle d'attentif.
Ce fut un grand pas de faitet bien dangereux; par bonheur pour le ministrequià Parmene trouvait pas de cruellesc'était seulement depuis peu de jours que la comtesse arrivait de Grianta; son esprit était encore tout raidi par l'ennui de la vie champêtre. Elle avait comme oublié la plaisanterie; et toutes ces choses qui appartiennent à une façon de vivre élégante et légère avaient pris à ses yeux comme une teinte de nouveauté qui les rendait sacrées; elle n'était disposée à se moquer de rienpas même d'un amoureux de quarante-cinq ans et timide. Huit jours plus tardla témérité du comte eût pu recevoir un tout autre accueil.
A la Scalail est d'usage de ne faire durer qu'une vingtaine de minutes ces petites visites que l'on fait dans les logesle comte passa toute la soirée dans celle où il avait le bonheur de rencontrer Mme Pietranera: c'est une femmese disait-ilqui me rend toutes les folies de la jeunesse! Mais il sentait bien le danger. Ma qualité de pacha tout-puissant à quarante lieues d'ici me fera-t-elle pardonner cette sottise? je m'ennuie tant à Parme! Toutefoisde quart d'heure en quart d'heure il se promettait de partir.
-- Il faut avouermadamedit-il en riant à la comtessequ'à Parme je meurs d'ennuiet il doit m'être permis de m'enivrer de plaisir quand j'en trouve sur ma route. Ainsisans conséquence et pour une soiréepermettez-moi de jouer auprès de vous le rôle d'amoureux. Hélas! dans peu de jours je serai bien loin de cette loge qui me fait oublier tous les chagrins et mêmedirez-voustoutes les convenances.
Huit jours après cette visite monstre dans la loge à la Scala et à la suite de plusieurs petits incidents dont le récit semblerait long peut-êtrele comte Mosca était absolument fou d'amouret la comtesse pensait déjà que l'âge ne devait pas faire objectionsi d'ailleurs on le trouvait aimable. On en était à ces pensées quand Mosca fut rappelé par un courrier de Parme. On eût dit que son prince avait peur tout seul. La comtesse retourna à Grianta; son imagination ne parant plus ce beau lieuil lui parut désert. Est-ce que je me serais attachée à cet homme? se dit-elle. Mosca écrivit et n'eut rien à jouerl'absence lui avait enlevé la source de toutes ses pensées; ses lettres étaient amusantesetpar une petite singularité qui ne fut pas mal prisepour éviter les commentaires du marquis del Dongo qui n'aimait pas à payer des ports de lettresil envoyait des courriers qui jetaient les siennes à la poste à Cômeà Leccoà Varèse ou dans quelque autre de ces petites villes charmantes des environs du lac. Ceci tendait à obtenir que le courrier rapportât les réponses; il y parvint.
Bientôt les jours de courrier firent événement pour la comtesse; ces courriers apportaient des fleursdes fruitsde petits cadeaux sans valeurmais qui l'amusaient ainsi que sa belle-soeur. Le souvenir du comte se mêlait à l'idée de son grand pouvoir; la comtesse était devenue curieuse de tout ce qu'on disait de luiles libéraux eux-mêmes rendaient hommage à ses talents. La principale source de mauvaise réputation pour le comtec'est qu'il passait pour le chef du parti ultra à la cour de Parmeet que le parti libéral avait à sa tête une intrigante capable de toutet même de réussirla marquise Raversiimmensément riche. Le prince était fort attentif à ne pas décourager celui des deux partis qui n'était pas au pouvoir; il savait bien qu'il serait toujours le maîtremême avec un ministère pris dans le salon de Mme Raversi. On donnait à Grianta mille détails sur ces intrigues; l'absence de Moscaque tout le monde peignait comme un ministre du premier talent et un homme d'actionpermettait de ne plus songer aux cheveux poudréssymbole de tout ce qui est lent et tristec'était un détail sans conséquenceune des obligations de la couroù il jouait d'ailleurs un si beau rôle. Une courc'est ridiculedisait la comtesse à la marquisemais c'est amusant; c'est un jeu qui intéressemais dont il faut accepter les règles. Qui s'est jamais avisé de se récrier contre le ridicule des règles du whist? Et pourtant une fois qu'on s'est accoutumé aux règlesil est agréable de faire l'adversaire chlemm.
La comtesse pensait souvent à l'auteur de tant de lettres aimables. Le jour où elle les recevait était agréable pour elle; elle prenait sa barque et allait les lire dans les beaux sites du lacà la Plinianaà Bélanau bois des Sfondrata. Ces lettres semblaient la consoler un peu de l'absence de Fabrice. Elle ne pouvait du moins refuser au comte d'être fort amoureux; un mois ne s'était pas écouléqu'elle songeait à lui avec une amitié tendre. De son côtéle comte Mosca était presque de bonne foi quand il lui offrait de donner sa démissionde quitter le ministèreet de venir passer sa vie avec elle à Milan ou ailleurs. J'ai 400 000 francsajoutait-ilce qui nous fera toujours 15 000 livres de rente. De nouveau une logedes chevaux! etc.se disait la comtessec'étaient des rêves aimables. Les sublimes beautés des aspects du lac de Côme recommençaient à la charmer. Elle allait rêver sur ses bords à ce retour de vie brillante et singulière quicontre toute apparenceredevenait possible pour elle. Elle se voyait sur le Corsoà Milanheureuse et gaie comme au temps du vice-roi; la jeunesseou du moins la vie active recommencerait pour moi!
Quelquefois son imagination ardente lui cachait les chosesmais jamais avec elle il n'y avait de ces illusions volontaires que donne la lâcheté. C'était surtout une femme de bonne foi avec elle-même. Si je suis un peu trop âgée pour faire des foliesse disait-ellel'enviequi se fait des illusions comme l'amourpeut empoisonner pour moi le séjour de Milan. Après la mort de mon marima pauvreté noble eut du succèsainsi que le refus de deux grandes fortunes. Mon pauvre petit comte Mosca n'a pas la vingtième partie de l'opulence que mettaient à mes pieds ces deux nigauds Limercati et Nani. La chétive pension de veuve péniblement obtenueles gens congédiésce qui eut de l'éclatla petite chambre au cinquième qui amenait vingt carrosses à la portetout cela forma jadis un spectacle singulier. Mais j'aurai des moments désagréablesquelque adresse que j'y mettesine possédant toujours pour fortune que la pension de veuveje reviens vivre à Milan avec la bonne petite aisance bourgeoise que peuvent nous donner les 15 000 livres qui resteront à Mosca après sa démission. Une puissante objectiondont l'envie se fera une arme terriblec'est que le comtequoique séparé de sa femme depuis longtempsest marié. Cette séparation se sait à Parrnemais à Milan elle sera nouvelleet on me l'attribuera. Ainsimon beau théâtre de la Scalamon divin lac de Côme... adieu! adieu!
Malgré toutes ces prévisionssi la comtesse avait eu la moindre fortune elle eût accepté l'offre de la démission de Mosca. Elle se croyait une femme âgéeet la cour lui faisait peur; maisce qui paraîtra de la dernière invraisemblance de ce côté-ci des Alpesc'est que le comte eût donné cette démission avec bonheur. C'est du moins ce qu'il parvint à persuader à son amie. Dans toutes ses lettres il sollicitait avec une folie toujours croissante une seconde entrevue à Milanon la lui accorda. Vous jurer que j'ai pour vous une passion follelui disait la comtesseun jour à Milance serait mentir; je serais trop heureuse d'aimer aujourd'huià trente ans passéscomme jadis j'aimais à vingt-deux! Mais j'ai vu tomber tant de choses que j'avais crues éternelles! J'ai pour vous la plus tendre amitiéje vous accorde une confiance sans borneset de tous les hommesvous êtes celui que je préfère. La comtesse se croyait parfaitement sincèrepourtant vers la fincette déclaration contenait un petit mensonge. Peut-êtresi Fabrice l'eût vouluil l'eût emporté sur tout dans son coeur. Mais Fabrice n'était qu'un enfant aux yeux du comte Mosca; celui-ci arriva à Milan trois jours après le départ du jeune étourdi pour Novareet il se hâta d'aller parler en sa faveur au baron Binder. Le comte pensa que l'exil était une affaire sans remède.
Il n'était point arrivé seul à Milanil avait dans sa voiture le duc Sanseverina- Taxisjoli petit vieillard de soixante-huit ansgris pommelébien polibien propreimmensément richemais pas assez noble. C'était son grand-père seulement qui avait amassé des millions par le métier de fermier général des revenus de l'Etat de Parme. Son père s'était fait nommer ambassadeur du prince de Parme à la cour de ***à la suite du raisonnement que voici: -- Votre Altesse accorde 30 000 francs à son envoyé à la cour de ***lequel y fait une figure fort médiocre. Si elle daigne me donner cette placej'accepterai 6 000 francs d'appointements. Ma dépense à la cour de *** ne sera jamais au-dessous de 100 000 francs par an et mon intendant remettra chaque année 20 000 francs à la caisse des affaires étrangères à Parme. Avec cette sommel'on pourra placer auprès de moi tel secrétaire d'ambassade que l'on voudraet je ne me montrerai nullement jaloux des secrets diplomatiquess'il y en a. Mon but est de donner de l'éclat à ma maison nouvelle encoreet de l'illustrer par une des grandes charges du pays.
Le duc actuelfils de cet ambassadeuravait eu la gaucherie de se montrer à demi libéraletdepuis deux ansil était au désespoir. Du temps de Napoléonil avait perdu deux ou trois millions par son obstination à rester à l'étrangeret toutefoisdepuis le rétablissement de l'ordre en Europeil n'avait pu obtenir un certain grand cordon qui ornait le portrait de son père; l'absence de ce cordon le faisait dépérir.
Au point d'intimité qui suit l'amour en Italieil n'y avait plus d'objection de vanité entre les deux amants. Ce fut donc avec la plus parfaite simplicité que Mosca dit à la femme qu'il adorait:
-- J'ai deux ou trois plans de conduite à vous offrirtous assez bien combinés; je ne rêve qu'à cela depuis trois mois.
1: Je donne ma démissionet nous vivons en bons bourgeois à Milanà Florenceà Naplesoù vous voudrez. Nous avons quinze mille livres de renteindépendamment des bienfaits du prince qui dureront plus ou moins.
2: Vous daignez venir dans le pays où je puis quelque chosevous achetez une terreSaccapar exemplemaison charmanteau milieu d'une forêtdominant le cours du Pôvous pouvez avoir le contrat de vente signé d'ici à huit jours. Le prince vous attache à sa cour. Mais ici se présente une immense objection. On vous recevra bien à cette cour; personne ne s'aviserait de broncher devant moi; d'ailleurs la princesse se croit malheureuseet je viens de lui rendre des services à votre intention. Mais je vous rappellerai une objection capitale: le prince est parfaitement dévotet comme vous le savez encorela fatalité veut que je sois marié. De là un million de désagréments de détail. Vous êtes veuvec'est un beau titre qu'il faudrait échanger contre un autreet ceci fait l'objet de ma troisième proposition.
On pourrait trouver un nouveau mari point gênant. Mais d'abord il le faudrait fort avancé en âgecar pourquoi me refuseriez-vous l'espoir de le remplacer un jour? Eh bien? j'ai conclu cette affaire singulière avec le duc Sanseverina-Taxisquibien entendune sait pas le nom de la future duchesse. Il sait seulement qu'elle le fera ambassadeur et lui donnera un grand cordon qu'avait son pèreet dont l'absence le rend le plus infortuné des mortels. A cela prèsce duc n'est point trop imbécile; il fait venir de Paris ses habits et ses perruques. Ce n'est nullement un homme à méchancetés pourpensées d'avanceil croit sérieusement que l'honneur consiste à avoir un cordonet il a honte de son bien. Il vint il y a un an me proposer de fonder un hôpital pour gagner ce cordon; je me moquai de luimais il ne s'est point moqué de moi quand je lui ai proposé un mariage; ma première condition a étébien entenduque jamais il ne remettrait le pied dans Parme.
-- Mais savez-vous que ce que vous me proposez là est fort immoral? dit la comtesse.
-- Pas plus immoral que tout ce qu'on fait à notre cour et dans vingt autres. Le pouvoir absolu a cela de commode qu'il sanctifie tout aux yeux des peuples; orqu'est-ce qu'un ridicule que personne n'aperçoit? Notre politiquependant vingt ansva consister à avoir peur des jacobinset quelle peur! Chaque année nous nous croirons à la veille de 93. Vous entendrezj'espèreles phrases que je fais là- dessus à mes réceptions! C'est beau! Tout ce qui pourra diminuer un peu cette peur sera souverainement moral aux yeux des nobles et des dévots. Orà Parmetout ce qui n'est pas noble ou dévot est en prisonou fait ses paquets pour y entrer; soyez bien convaincue que ce mariage ne semblera singulier chez nous que du jour où je serai disgracié. Cet arrangement n'est une friponnerie envers personnevoilà l'essentielce me semble. Le princede la faveur duquel nous faisons métier et marchandisen'a mis qu'une condition à son consentementc'est que la future duchesse fût née noble. L'an passéma placetout calculém'a valu cent sept mille francs; mon revenu a dû être au total de cent vingt-deux mille; j'en ai placé vingt mille à Lyon. Eh bien! choisissez: 1° une grande existence basée sur cent vingt-deux mille francs à dépenserquià Parmefont au moins comme quatre cent mille à Milan; mais avec ce mariage qui vous donne le nom d'un homme passable et que vous ne verrez jamais qu'à l'autel; 2° ou bien la petite vie bourgeoise avec quinze mille francs à Florence ou à Naplescar je suis de votre avison vous a trop admirée à Milan; l'envie nous y persécuteraitet peut-être parviendrait-elle à nous donner de l'humeur. La grande existence à Parme auraje l'espèrequelques nuances de nouveautémême à vos yeux qui ont vu la cour du prince Eugène; il serait sage de la connaître avant de s'en fermer la porte. Ne croyez pas que je cherche à influencer votre opinion. Quant à moimon choix est bien arrêté: j'aime mieux vivre dans un quatrième étage avec vous que de continuer seul cette grande existence.
La possibilité de cet étrange mariage fut débattue chaque jour entre les deux amants. La comtesse vit au bal de la Scala le duc Sanseverina-Taxis qui lui sembla fort présentable. Dans une de leurs dernières conversationsMosca résumait ainsi sa proposition: il faut prendre un parti décisifsi nous voulons passer le reste de notre vie d'une façon allègre et n'être pas vieux avant le temps. Le prince a donné son approbation; Sanseverina est un personnage plutôt bien que mal; il possède le plus beau palais de Parme et une fortune sans bornes; il a soixante-huit ans et une passion folle pour le grand cordon; mais une grande tache gâte sa vieil acheta jadis dix mille francs un buste de Napoléon par Canova. Son second péché qui le fera mourirsi vous ne venez pas à son secoursc'est d'avoir prêté vingt-cinq napoléons à Ferrante Pallaun fou de notre paysmais quelque peu homme de génieque depuis nous avons condamné à mortheureusement par contumace. Ce Ferrante a fait deux cents vers en sa viedont rien n'approche; je vous les réciteraic'est aussi beau que le Dante. Le prince envoie Sanseverina à la cour de ***il vous épouse le jour de son départet la seconde année de son voyagequ'il appellera une ambassadeil reçoit ce cordon de *** sans lequel il ne peut vivre. Vous aurez en lui un frère qui ne sera nullement désagréableil signe d'avance tous les papiers que je veuxet d'ailleurs vous le verrez peu ou jamaiscomme il vous conviendra. Il ne demande pas mieux que de ne point se montrer à Parme où son grand-père fermier et son prétendu libéralisme le gênent. Rassinotre bourreauprétend que le duc a été abonné en secret au Constitutionnel par l'intermédiaire de Ferrante Pella le poèteet cette calomnie a fait longtemps obstacle sérieux au consentement du prince.
Pourquoi l'historien qui suit fidèlement les moindres détails du récit qu'on lui a fait serait-il coupable? Est-ce sa faute si les personnagesséduits par des passions qu'il ne partage point malheureusement pour luitombent dans des actions profondément immorales? Il est vrai que des choses de cette sorte ne se font plus dans un pays où l'unique passion survivante à toutes les autres est l'argentmoyen de vanité.
Trois mois après les événements racontés jusqu'icila duchesse Sanseverina- Taxis étonnait la cour de Parme par son amabilité facile et par la noble sérénité de son esprit; sa maison fut sans comparaison la plus agréable de la ville. C'est ce que le comte Mosca avait promis à son maître. Ranuce-Ernest IVle prince régnantet la princesse sa femmeauxquels elle fut présentée par deux des plus grandes dames du payslui firent un accueil fort distingué. La duchesse était curieuse de voir ce prince maître du sort de l'homme qu'elle aimaitelle voulut lui plaire et y réussit trop. Elle trouva un homme d'une taille élevéemais un peu épaisse; ses cheveuxses moustachesses énormes favoris étaient d'un beau blond selon ses courtisans; ailleurs ils eussent provoquépar leur couleur effacéele mot ignoble de filasse. Au milieu d'un gros visage s'élevait fort peu un tout petit nez presque féminin. Mais la duchesse remarqua que pour apercevoir tous ces motifs de laideuril fallait chercher à détailler les traits du prince. Au totalil avait l'air d'un homme d'esprit et d'un caractère ferme. Le port du princesa manière de se tenir n'étaient point sans majestémais souvent il voulait imposer à son interlocuteur; alors il s'embarrassait lui-même et tombait dans un balancement d'une jambe à l'autre presque continuel. Du resteErnest 1V avait un regard pénétrant et dominateur; les gestes de ses bras avaient de la noblesseet ses paroles étaient à la fois mesurées et concises.
Mosca avait prévenu la duchesse que le prince avaitdans le grand cabinet où il recevait en audienceun portrait en pied de Louis XIVet une table fort belle de scagliola de Florence. Elle trouva que l'imitation était frappante; évidemment il cherchait le regard et la parole noble de Louis XIVet il s'appuyait sur la table de scagliola de façon à se donner la tournure de Joseph II. Il s'assit aussitôt après les premières paroles adressées par lui à la duchesseafin de lui donner l'occasion de faire usage du tabouret qui appartenait à son rang. A cette courles duchessesles princesses et les femmes des grands d'Espagne s'assoient seules; les autres femmes attendent que le prince ou la princesse les y engagent; etpour marquer la différence des rangsces personnes augustes ont toujours soin de laisser passer un petit intervalle avant de convier les dames non duchesses à s'asseoir. La duchesse trouva qu'en de certains moments l'imitation de Louis XIV était un peu trop marquée chez le prince; par exempledans sa façon de sourire avec bonté tout en renversant la tête.
Ernest IV portait un frac à la mode arrivant de Paris; on lui envoyait tous les mois de cette villequ'il abhorraitun fracune redingote et un chapeau. Maispar un bizarre mélange de costumesle jour où la duchesse fut reçue il avait pris une culotte rougedes bas de soie et des souliers fort couvertsdont on peut trouver les modèles dans les portraits de Joseph II.
Il reçut Mme Sanseverina avec grâce; il lui dit des choses spirituelles et fines; mais elle remarqua fort bien qu'il n'y avait pas excès dans la bonne réception. -- Savez-vous pourquoi? lui dit le comte Mosca au retour de l'audiencec'est que Milan est une ville plus grande et plus belle que Parme. Il eût crainten vous faisant l'accueil auquel je m'attendais et qu'il m'avait fait espérerd'avoir l'air d'un provincial en extase devant les grâces d'une belle dame arrivant de la capitale. Sans doute aussi il est encore contrarié d'une particularité que je n'ose vous dire: le prince ne voit à sa cour aucune femme qui puisse vous le disputer en beauté . Tel a été hier soirà son petit coucherl'unique sujet de son entretien avec Perniceson premier valet de chambrequi a des bontés pour moi. Je prévois une petite révolution dans l'étiquette; mon plus grand ennemi à cette cour est un sot qu'on appelle le général Fabio Conti. Figurez-vous un original qui a été à la guerre un jour peut-être en sa vieet qui part de là pour imiter la tenue de Frédéric le Grand. De plusil tient aussi à reproduire l'affabilité noble du général Lafayetteet cela parce qu'il est ici le chef du parti libéral. (Dieu sait quels libéraux!)
-- Je connais le Fabio Contidit la duchesse; j'en ai eu la vision près de Côme; il se disputait avec la gendarmerie. Elle raconta la petite aventure dont le lecteur se souvient peut-être.
-- Vous saurez un jourmadamesi votre esprit parvient jamais à se pénétrer des profondeurs de notre étiquetteque les demoiselles ne paraissent à la cour qu'après leur mariage. Eh bienle prince a pour la supériorité de sa ville de Parme sur toutes les autres un patriotisme tellement brûlantque je parierais qu'il va trouver un moyen de se faire présenter la petite Clélia Contifille de notre Lafayette. Elle est ma foi charmanteet passait encoreil y a huit jourspour la plus belle personne des états du prince.
Je ne saiscontinua le comtesi les horreurs que les ennemis du souverain ont publiées sur son compte sont arrivées jusqu'au château de Grianta; on en a fait un monstreun ogre. Le fait est qu'Ernest IV avait tout plein de bonnes petites vertuset l'on peut ajouter ques'il eût été invulnérable comme Achilleil eût continué à être le modèle des potentats. Mais dans un moment d'ennui et de colèreet aussi un peu pour imiter Louis XIV faisant couper la tête à je ne sais quel héros de la Fronde que l'on découvrit vivant tranquillement et insolemment dans une terre à côté de Versaillescinquante ans après la FrondeErnest IV a fait pendre un jour deux libéraux. I1 paraît que ces imprudents se réunissaient à jour fixe pour dire du mal du prince et adresser au ciel des voeux ardentsafin que la peste pût venir à Parmeet les délivrer du tyran. Le mot tyran a été prouvé. Rassi appela cela conspirer; il les fit condamner à mortet l'exécution de l'un d'euxle comte L...fut atroce. Ceci se passait avant moi. Depuis ce moment fatalajouta le comte en baissant la voixle prince est sujet à des accès de peur indignes d'un hommemais qui sont la source unique de la faveur dont je jouis. Sans la peur souverainej'aurais un genre de mérite trop brusquetrop âpre pour cette couroù l'imbécile foisonne. Croiriez-vous que le prince regarde sous les lits de son appartement avant de se coucheret dépense un millionce qui à Parme est comme quatre millions à Milanpour avoir une bonne policeet vous voyez devant vousmadame la duchessele chef de cette police terrible. Par la policec'est-à-dire par la peurje suis devenu ministre de la guerre et des finances; et comme le ministre de l'intérieur est mon chef nominalen tant qu'il a la police dans ses attributionsj'ai fait donner ce portefeuille au comte Zurla-Contariniun imbécile bourreau de travailqui se donne le plaisir d'écrire quatre-vingts lettres chaque jour. Je viens d'en recevoir une ce matin sur laquelle le comte Zurla- Contarini a eu la satisfaction d'écrire de sa propre main le numéro 20 715.
La duchesse Sanseverina fut présentée à la triste princesse de Parme Clara- Paolinaquiparce que son mari avait une maîtresse (une assez jolie femmela marquise Balbi)se croyait la plus malheureuse personne de l'universce qui l'en avait rendue peut-être la plus ennuyeuse. La duchesse trouva une femme fort grande et fort maigrequi n'avait pas trente-six ans et en paraissait cinquante. Une figure régulière et noble eût pu passer pour bellequoique un peu déparée par de gros yeux ronds qui n'y voyaient guèresi la princesse ne se fût pas abandonnée elle-même. Elle reçut la duchesse avec une timidité si marquéeque quelques courtisans ennemis du comte Mosca osèrent dire que la princesse avait l'air de la femme qu'on présenteet la duchesse de la souveraine. La duchessesurprise et presque déconcertéene savait où trouver des termes pour se mettre à une place inférieure à celle que la princesse se donnait à elle-même. Pour rendre quelque sang-froid à cette pauvre princessequi au fond ne manquait point d'espritla duchesse ne trouva rien de mieux que d'entamer et de faire durer une longue dissertation sur la botanique. La princesse était réellement savante en ce genre; elle avait de fort belles serres avec force plantes des tropiques. La duchesseen cherchant tout simplement à se tirer d'embarrasfit à jamais la conquête de la princesse Clara-Paolinaquide timide et d'interdite qu'elle avait été au commencement de l'audiencese trouva vers la fin tellement à son aisequecontre toutes les règles de l'étiquettecette première audience ne dura pas moins de cinq quarts d'heure. Le lendemainla duchesse fit acheter des plantes exotiqueset se porta pour grand amateur de botanique.
La princesse passait sa vie avec le vénérable père Landrianiarchevêque de Parmehomme de sciencehomme d'esprit mêmeet parfaitement honnête hommemais qui offrait un singulier spectacle quand il était assis dans sa chaise de velours cramoisi (c'était le droit de sa place)vis-à-vis le fauteuil de la princesseentourée de ses dames d'honneur et de ses deux dames pour accompagner. Le vieux prélat en longs cheveux blancs était encore plus timides'il se peutque la princesse; ils se voyaient tous les jourset toutes les audiences commençaient par un silence d'un gros quart d'heure. C'est au point que la comtesse Alviziune des dames pour accompagner était devenue une sorte de favoriteparce qu'elle avait l'art de les encourager à se parler et de les faire rompre le silence.
Pour terminer le cours de ses présentationsla duchesse fut admise chez S.A.S. le prince héréditairepersonnage d'une plus haute taille que son pèreet plus timide que sa mère. Il était fort en minéralogieet avait seize ans. Il rougit excessivement en voyant entrer la duchesseet fut tellement désorientéque jamais il ne put inventer un mot à dire à cette belle dame. Il était fort bel hommeet passait sa vie dans les bois un marteau à la main. Au moment où la duchesse se levait pour mettre fin à cette audience silencieuse:
-- Mon Dieu! madameque vous êtes jolie! s'écria le prince héréditairece qui ne fut pas trouvé de trop mauvais goût par la dame présentée.
La marquise Balbijeune femme de vingt-cinq anspouvait encore passer pour le plus parfait modèle du joli italiendeux ou trois ans avant l'arrivée de la duchesse Sanseverina à Parme. Maintenant c'étaient toujours les plus beaux yeux du monde et les petites mines les plus gracieuses; maisvue de prèssa peau était parsemée d'un nombre infini de petites rides finesqui faisaient de la marquise comme une jeune vieille. Aperçue à une certaine distance par exemple au théâtredans sa logec'était encore une beauté; et les gens du parterre trouvaient le prince de fort bon goût. Il passait toutes les soirées chez la marquise Balbimais souvent sans ouvrir la boucheet l'ennui où elle voyait le prince avait fait tomber cette pauvre femme dans une maigreur extraordinaire. Elle prétendait à une finesse sans borneset toujours souriait avec malice; elle avait les plus belles dents du mondeet à tout hasard n'ayant guère de senselle voulaitpar un sourire malinfaire entendre autre chose que ce que disaient ses paroles. Le comte Mosca disait que c'étaient ces sourires continuelstandis qu'elle bâillait intérieurementqui lui donnaient tant de rides. La Balbi entrait dans toutes les affaireset l'état ne faisait pas un marché de mille francssans qu'il y eût un souvenir pour la marquise (c'était le mot honnête à Parme). Le bruit public voulait qu'elle eût placé dix millions de francs en Angleterremais sa fortuneà la vérité de fraîche datene s'élevait pas en réalité à quinze cent mille francs. C'était pour être à l'abri de ses finesseset pour l'avoir dans sa dépendanceque le comte Mosca s'était fait ministre des finances. La seule passion de la marquise était la peur déguisée en avarice sordide: Je mourrai sur la pailledisait-elle quelquefois au prince que ce propos outrait. La duchesse remarqua que l'antichambreresplendissante de doruresdu palais de la Balbiétait éclairée par une seule chandelle coulant sur une table de marbre précieuxet les portes de son salon étaient noircies par les doigts des laquais.
-- Elle m'a reçuedit la duchesse à son amicomme si elle eût attendu de moi une gratification de cinquante francs.
Le cours des succès de la duchesse fut un peu interrompu par la réception que lui fit la femme la plus adroite de la courla célèbre marquise Raversiintrigante consommée qui se trouvait à la tête du parti opposé à celui du comte Mosca. Elle voulait le renverseret d'autant plus depuis quelques moisqu'elle était nièce du duc Sanseverinaet craignait de voir attaquer l'héritage par les grâces de la nouvelle duchesse. La Raversi n'est point une femme à mépriserdisait le comte à son amieje la tiens pour tellement capable de tout que je me suis séparé de ma femme uniquement parce qu'elle s'obstinait à prendre pour amant le chevalier Bentivogliol'un des amis de la Raversi. Cette damegrande virago aux cheveux fort noirsremarquable par les diamants qu'elle portait dès le matinet par le rouge dont elle couvrait ses jouess'était déclarée d'avance l'ennemie de la duchesseet en la recevant chez elle prit à tâche de commencer la guerre. Le duc Sanseverinadans les lettres qu'il écrivait de ***paraissait tellement enchanté de son ambassade et surtout de l'espoir du grand cordonque sa famille craignait qu'il ne laissât une partie de sa fortune à sa femme qu'il accablait de petits cadeaux. La Raversiquoique régulièrement laideavait pour amant le comte Balbile plus joli homme de la cour: en général elle réussissait à tout ce qu'elle entreprenait.
La duchesse tenait le plus grand état de maison. Le palais Sanseverina avait toujours été un des plus magnifiques de la ville de Parmeet le ducà l'occasion de son ambassade et de son futur grand cordondépensait de fort grosses sommes pour l'embellir: la duchesse dirigeait les réparations.
Le comte avait deviné juste: peu de jours après la présentation de la duchessela jeune Clélia Conti vint à la couron l'avait faite chanoinesse. Afin de parer le coup que cette faveur pouvait avoir l'air de porter au crédit du comtela duchesse donna une fête sous prétexte d'inaugurer le jardin de son palaisetpar ses façons pleines de grâceselle fit de Cléliaqu'elle appelait sa jeune amie du lac de Cômela reine de la soirée. Son chiffre se trouva comme par hasard sur les principaux transparents. La jeune Cléliaquoique un peu pensivefut aimable dans ses façons de parler de la petite aventure près du lacet de sa vive reconnaissance. On la disait fort dévote et fort amie de la solitude. Je parieraisdisait le comtequ'elle a assez d'esprit pour avoir honte de son père. La duchesse fit son amie de cette jeune filleelle se sentait de l'inclination pour elle; elle ne voulait pas paraître jalouseet la mettait de toutes ses parties de plaisir; enfin son système était de chercher à diminuer toutes les haines dont le comte était l'objet.
Tout souriait à la duchesse; elle s'amusait de cette existence de cour où la tempête est toujours à craindre; il lui semblait recommencer la vie. Elle était tendrement attachée au comtequi littéralement était fou de bonheur. Cette aimable situation lui avait procuré un sang-froid parfait pour tout ce qui ne regardait que ses intérêts d'ambition. Aussi deux mois à peine après l'arrivée de la duchesseil obtint la patente et les honneurs de premier ministrelesquels approchent fort de ceux que l'on rend au souverain lui-même. Le comte pouvait tout sur l'esprit de son maîtreon en eut à Parme une preuve qui frappa tous les esprits.
Au sud-estet à dix minutes de la villes'élève cette fameuse citadelle si renommée en Italieet dont la grosse tour a cent quatre-vingts pieds de haut et s'aperçoit de si loin. Cette tourbâtie sur le modèle du mausolée d'Adrienà Romepar les Farnèsepetits-fils de Paul IIIvers le commencement du XVIe siècleest tellement épaisseque sur l'esplanade qui la termine on a pu bâtir un palais pour le gouverneur de la citadelle et une nouvelle prison appelée la tour Farnèse. Cette prisonconstruite en l'honneur du fils aîné de Ranuce-Ernest IIlequel était devenu l'amant aimé de sa belle-mèrepasse pour belle et singulière dans le pays. La duchesse eut la curiosité de la voir; le jour de sa visitela chaleur était accablante à Parmeet là-hautdans cette position élevéeelle trouva de l'airce dont elle fut tellement raviequ'elle y passa plusieurs heures. On s'empressa de lui ouvrir les salles de la tour Farnèse.
La duchesse rencontra sur l'esplanade de la grosse tour un pauvre libéral prisonnierqui était venu jouir de la demi-heure de promenade qu'on lui accordait tous les trois jours. Redescendue à Parmeet n'ayant pas encore la discrétion nécessaire dans une cour absolueelle parla de cet homme qui lui avait raconté toute son histoire. Le parti de la marquise Raversi s'empara de ces propos de la duchesse et les répéta beaucoupespérant fort qu'ils choqueraient le prince. En effetErnest IV répétait souvent que l'essentiel était surtout de frapper les imaginations. Toujours est un grand motdisait-ilet plus terrible en Italie qu'ailleurs: en conséquencede sa vie il n'avait accordé de grâce. Huit jours après sa visite à la forteressela duchesse reçut une lettre de commutation de peine signée du prince et du ministreavec le nom en blanc. Le prisonnier dont elle écrirait le nom devait obtenir la restitution de ses bienset la permission d'aller passer en Amérique le reste de ses jours. La duchesse écrivit le nom de l'homme qui lui avait parlé. Par malheur cet homme se trouva un demi-coquinune âme faible; c'était sur ses aveux que le fameux Ferrante Palla avait été condamné à mort.
La singularité de cette grâce mit le comble à l'agrément de la position de Mme Sanseverina. Le comte Mosca était fou de bonheurce fut une belle époque de sa vieet elle eut une influence décisive sur les destinées de Fabrice. Celui-ci était toujours à Romagnan près de Novarese confessantchassantne lisant point et faisant la cour à une femme noble comme le portaient ses instructions. La duchesse était toujours un peu choquée de cette dernière nécessité. Un autre signe qui ne valait rien pour le comtec'est qu'étant avec lui de la dernière franchise sur tout au mondeet pensant tout haut en sa présenceelle ne lui parlait jamais de Fabrice qu'après avoir songé à la tournure de sa phrase.
-- Si vous voulezlui disait un jour le comtej'écrirai à cet aimable frère que vous avez sur le lac de Cômeet je forcerai bien ce marquis del Dongoavec un peu de peine pour moi et mes amis de ***à demander la grâce de votre aimable Fabrice. S'il est vraicomme je me garderais bien d'en douterque Fabrice soit un peu au-dessus des jeunes gens qui promènent leurs chevaux anglais dans les rues de Milanquelle vie que celle qui à dix-huit ans ne fait rien et a la perspective de ne jamais rien faire! Si le ciel lui avait accordé une vraie passion pour quoi que ce soitfût-ce pour la pêche à la ligneje la respecterais; mais que fera-t-il à Milan même après sa grâce obtenue? Il montera un cheval qu'il aurait fait venir d'Angleterre à une certaine heureà une autre le désoeuvrement le conduira chez sa maîtresse qu'il aimera moins que son cheval... Mais si vous m'en donnez l'ordreje tâcherai de procurer ce genre de vie à votre neveu.
-- Je le voudrais officierdit la duchesse.
-- Conseilleriez-vous à un souverain de confier un poste quidans un jour donnépeut être de quelque importance à un jeune homme 1° susceptible d'enthousiasme2° qui a montré de l'enthousiasme pour Napoléonau point d'aller le rejoindre à Waterloo? Songez à ce que nous serions tous si Napoléon eût vaincu à Waterloo! Nous n'aurions point de libéraux à craindreil est vraimais les souverains des anciennes familles ne pourraient régner qu'en épousant les filles de ses maréchaux. Ainsi la carrière militaire pour Fabricec'est la vie de l'écureuil dans la cage qui tourne: beaucoup de mouvement pour n'avancer en rien. Il aura le chagrin de se voir primer par tous les dévouements plébéiens. La première qualité chez un jeune homme aujourd'huic'est-à-dire pendant cinquante ans peut-êtretant que nous aurons peur et que la religion ne sera point rétabliec'est de n'être pas susceptible d'enthousiasme et de n'avoir pas d'esprit.
J'ai pensé à une chosemais qui va vous faire jeter les hauts cris d'abordet qui me donnera à moi des peines infinies et pendant plus d'un jourc'est une folie que je veux faire pour vous. Maisdites-moisi vous le savezquelle folie je ne ferais pas pour obtenir un sourire.
-- Eh bien? dit la duchesse.
-- Eh bien! nous avons eu pour archevêques à Parme trois membres de votre famille: Ascagne del Dongo qui a écriten 16...Fabrice en 1699et un second Ascagne en 1740. Si Fabrice veut entrer dans la prélature et marquer par des vertus du premier ordreje le fais évêque quelque partpuis archevêque icisi toutefois mon influence dure. L'objection réelle est celle-ci: resterai-je ministre assez longtemps pour réaliser ce beau plan qui exige plusieurs années? Le prince peut mouriril peut avoir le mauvais goût de me renvoyer. Mais enfin c'est le seul moyen que j'aie de faire pour Fabrice quelque chose qui soit digne de vous.
On discuta longtemps: cette idée répugnait fort à la duchesse.
-- Réprouvez-moidit-elle au comteque toute autre carrière est impossible pour Fabrice. Le comte prouva.-- Vous regrettezajouta-t-ille brillant uniforme; mais à cela je ne sais que faire.
Après un mois que la duchesse avait demandé pour réfléchirelle se rendit en soupirant aux vues sages du ministre.-- Monter d'un air empesé un cheval anglais dans quelque grande villerépétait le comteou prendre un état qui ne jure pas avec sa naissance; je ne vois pas de milieu. Par malheurun gentilhomme ne peut se faire ni médecinni avocatet le siècle est aux avocats.
Rappelez-vous toujoursmadamerépétait le comteque vous faites à votre neveusur le pavé de Milanle sort dont jouissent les jeunes gens de son âge qui passent pour les plus fortunés. Sa grâce obtenuevous lui donnez quinzevingttrente mille francs; peu vous importeni vous ni moi ne prétendons faire des économies.
La duchesse était sensible à la gloire; elle ne voulait pas que Fabrice fût un simple mangeur d'argent; elle revint au plan de son amant.
-- Remarquezlui disait le comteque je ne prétends pas faire de Fabrice un prêtre exemplaire comme vous en voyez tant. Non; c'est un grand seigneur avant tout; il pourra rester parfaitement ignorant si bon lui sembleet n'en deviendra pas moins évêque et archevêquesi le prince continue à me regarder comme un homme utile.
Si vos ordres daignent changer ma proposition en décret immuableajouta le comteil ne faut point que Parme voie notre protégé dans une petite fortune. La sienne choquerasi on l'a vu ici simple prêtre: il ne doit paraître à Parme qu'avec les bas violets [En Italie les jeunes gens protégés ou savants deviennent monsignore et prélatce qui ne veut pas dire évêque; on porte alors des bas violets. On ne fait pas de voeux pour être monsignore. On peut quitter les bas violets et se marier.] et dans un équipage convenable. Tout le monde alors devinera que votre neveu doit être évêqueet personne ne sera choqué.
Si vous m'en croyezvous enverrez Fabrice faire sa théologieet passer trois années à Naples. Pendant les vacances de l'Académie ecclésiastiqueil iras'il veutvoir Paris et Londres; mais il ne se montrera jamais à Parme. Ce mot donna comme un frisson à la duchesse.
Elle envoya un courrier à son neveuet lui donna rendez-vous à Plaisance. Faut-il dire que ce courrier était porteur de tous les moyens d'argent et de tous les passeports nécessaires?
Arrivé le premier à PlaisanceFabrice courut au-devant de la duchesseet l'embrassa avec des transports qui la firent fondre en larmes. Elle fut heureuse que le comte ne fût pas présent; depuis leurs amoursc'était la première fois qu'elle éprouvait cette sensation.
Fabrice fut profondément touchéet ensuite affligé des plans que la duchesse avait faits pour lui; son espoir avait toujours été queson affaire de Waterloo arrangéeil finirait par être militaire. Une chose frappa la duchesse et augmenta encore l'opinion romanesque qu'elle s'était formée de son neveu; il refusa absolument de mener la vie de café dans une des grandes villes d'Italie.
-- Te vois-tu au Corso de Florence ou de Naplesdisait la duchesseavec des chevaux anglais de pur sang! Pour le soirune voitureun joli appartementetc. Elle insistait avec délices sur la description de ce bonheur vulgaire qu'elle voyait Fabrice repousser avec dédain. C'est un hérospensait-elle.
-- Et après dix ans de cette vie agréablequ'aurai-je fait? disait Fabrice; que serai- je? Un jeune homme mûr qui doit céder le haut du pavé au premier bel adolescent qui débute dans le mondelui aussi sur un cheval anglais.
Fabrice rejeta d'abord bien loin le parti de l'Eglise; il parlait d'aller à New Yorkde se faire citoyen et soldat républicain en Amérique.
-- Quelle erreur est la tienne! Tu n'auras pas la guerreet tu retombes dans la vie de caféseulement sans élégancesans musiquesans amoursrépliqua la duchesse. Crois-moipour toi comme pour moice serait une triste vie que celle d'Amérique. Elle lui expliqua le culte du dieu dollaret ce respect qu'il faut avoir pour les artisans de la ruequi par leurs votes décident de tout. On revint au parti de l'Eglise.
-- Avant de te gendarmerlui dit la duchessecomprends donc ce que le comte te demande: il ne s'agit pas du tout d'être un pauvre prêtre plus ou moins exemplaire et vertueuxcomme l'abbé Blanès. Rappelle-toi ce que furent tes oncles les archevêques de Parme; relis les notices sur leurs viesdans le supplément à la généalogie. Avant tout il convient à un homme de ton nom d'être un grand seigneurnoble généreuxprotecteur de la justicedestiné d'avance à se trouver à la tête de son ordre... et dans toute sa vie ne faisant qu'une coquineriemais celle- là fort utile.
-- Ainsi voilà toutes mes illusions à vau-l'eaudisait Fabrice en soupirant profondément; le sacrifice est cruel! je l'avoueje n'avais pas réfléchi à cette horreur pour l'enthousiasme et l'espritmême exercés à leur profitqui désormais va régner parmi les souverains absolus.
-- Songe qu'une proclamationqu'un caprice du coeur précipite l'homme enthousiaste dans le parti contraire à celui qu'il a servi toute la vie!
-- Moi enthousiaste! répéta Fabrice; étrange accusation! je ne puis pas même être amoureux!
-- Comment? s'écria la duchesse.
-- Quand j'ai l'honneur de faire la cour à une beautémême de bonne naissanceet dévoteje ne puis penser à elle que quand je la vois.
Cet aveu fit une étrange impression sur la duchesse.
-- Je te demande un moisreprit Fabricepour prendre congé de madame C. de Novare etce qui est encore plus difficiledes châteaux en Espagne de toute ma vie. J'écrirai à ma mèrequi sera assez bonne pour venir me voir à Belgiratesur la rive piémontaise du lac Majeuret le trente et unième jour après celui-cije serai incognito dans Parme.
-- Garde-t'en bien! s'écria la duchesse. Elle ne voulait pas que le comte Mosca la vît parler à Fabrice.
Les mêmes personnages se revirent à Plaisance; la duchesse cette fois était fort agitée; un orage s'était élevé à la courle parti de la marquise Raversi touchait au triomphe; il était possible que le comte Mosca fût remplacé par le général Fabio Contichef de ce qu'on appelait à Parme le parti libéral. Excepté le nom du rival qui croissait dans la faveur du princela duchesse dit tout à Fabrice. Elle discuta de nouveau les chances de son avenirmême avec la perspective de manquer de la toute-puissante protection du comte.
-- Je vais passer trois ans à l'Académie ecclésiastique de Napless'écria Fabrice; mais puisque je dois être avant tout un jeune gentilhommeet que tu ne m'astreins pas à mener la vie sévère d'un séminariste vertueuxce séjour à Naples ne m'effraie nullementcette vie-là vaudra bien celle de Romagnano; la bonne compagnie de l'endroit commençait à me trouver jacobin. Dans mon exil j'ai découvert que je ne sais rienpas même le latinpas même l'orthographe. J'avais le projet de refaire mon éducation à Novarej'étudierai volontiers la théologie à Naples: c'est une science compliquée. La duchesse fut ravie; si nous sommes chasséslui dit-ellenous irons te voir à Naples. Mais puisque tu acceptes jusqu'à nouvel ordre le parti des bas violetsle comtequi connaît bien l'Italie actuellem'a chargé d'une idée pour toi. Crois ou ne crois pas à ce qu'on t'enseigneramais ne fais jamais aucune objection. Figure-toi qu'on t'enseigne les règles du jeu de whist; est-ce que tu ferais des objections aux règles du whist? J'ai dit au comte que tu croyaiset il s'en est félicité; cela est utile dans ce monde et dans l'autre. Mais si tu croisne tombe point dans la vulgarité de parler avec horreur de VoltaireDiderotRaynalet de tous ces écervelés de Français précurseurs des deux chambres. Que ces noms-là se trouvent rarement dans ta bouche; mais enfin quand il le fautparle de ces messieurs avec une ironie calme; ce sont gens depuis longtemps réfutéset dont les attaques ne sont plus d'aucune conséquence. Crois aveuglément tout ce que l'on te dira à l'Académie. Songe qu'il y a des gens qui tiendront note fidèle de tes moindres objections; on te pardonnera une petite intrigue galante si elle est bien menéeet non pas un doute; l'âge supprime l'intrigue et augmente le doute. Agis sur ce principe au tribunal de la pénitence. Tu auras une lettre de recommandation pour un évêque factotum du cardinal archevêque de Naples; à lui seul tu dois avouer ton escapade en Franceet ta présencele 18 juindans les environs de Waterloo. Du reste abrège beaucoupdiminue cette aventureavoue-la seulement pour qu'on ne puisse pas te reprocher de l'avoir cachée; tu étais si jeune alors!
La seconde idée que le comte t'envoie est celle-ci: S'il te vient une raison brillanteune réplique victorieuse qui change le cours de la conversationne cède point à la tentation de brillergarde le silence; les gens fins verront ton esprit dans tes yeux. Il sera temps d'avoir de l'esprit quand tu seras évêque.
Fabrice débuta à Naples avec une voiture modeste et quatre domestiquesbons Milanaisque sa tante lui avait envoyés. Après une année d'étude personne ne disait que c'était un homme d'espriton le regardait comme un grand seigneur appliquéfort généreuxmais un peu libertin.
Cette annéeassez amusante pour Fabricefut terrible pour la duchesse. Le comte fut trois ou quatre fois à deux doigts de sa perte; le princeplus peureux que jamais parce qu'il était malade cette année-làcroyaiten le renvoyantse débarrasser de l'odieux des exécutions faites avant l'entrée du comte au ministère. Le Rassi était le favori du coeur qu'on voulait garder avant tout. Les périls du comte lui attachèrent passionnément la duchesseelle ne songeait plus à Fabrice. Pour donner une couleur à leur retraite possibleil se trouva que l'air de Parmeun peu humide en effetcomme celui de toute la Lombardiene convenait nullement à sa santé. Enfin après des intervalles de disgrâcequi allèrent pour le comtepremier ministrejusqu'à passer quelquefois vingt jours entiers sans voir son maître en particulierMosca l'emporta; il fit nommer le général Fabio Contile prétendu libéralgouverneur de la citadelle où l'on enfermait les libéraux jugés par Rassi. Si Conti use d'indulgence envers ses prisonniersdisait Mosca à son amieon le disgracie comme un jacobin auquel ses idées politiques font oublier ses devoirs de général; s'il se montre sévère et impitoyableet c'est ce me semble de ce côté-là qu'il inclinerail cesse d'être le chef de son propre partiet s'aliène toutes les familles qui ont un des leurs à la citadelle. Ce pauvre homme sait prendre un air tout confit de respect à l'approche du prince; au besoin il change de costume quatre fois en un jour; il peut discuter une question d'étiquettemais ce n'est point une tête capable de suivre le chemin difficile par lequel seulement il peut se sauver; et dans tous les cas je suis là.
Le lendemain de la nomination du général Fabio Contiqui terminait la crise ministérielleon apprit que Parme aurait un journal ultra-monarchique.
-- Que de querelles ce journal va faire naître! disait la duchesse.
-- Ce journaldont l'idée est peut-être mon chef-d'oeuvrerépondait le comte en riantpeu à peu je m'en laisserai bien malgré moi ôter la direction par les ultra- furibonds. J'ai fait attacher de beaux appointements aux places de rédacteur. De tous côtés on va solliciter ces places: cette affaire va nous faire passer un mois ou deuxet l'on oubliera les périls que je viens de courir. Les graves personnages P. et D. sont déjà sur les rangs.
-- Mais ce journal sera d'une absurdité révoltante.
-- J'y compte bienrépliquait le comte. Le prince le lira tous les matins et admirera ma doctrine à moi qui l'ai fondé. Pour les détailsil approuvera ou sera choqué; des heures qu'il consacre au travail en voilà deux de prises. Le journal se fera des affairesmais à l'époque où arriveront les plaintes sérieusesdans huit ou dix moisil sera entièrement dans les mains des ultra-furibonds. Ce sera ce parti qui me gêne qui devra répondremoi j'élèverai des objections contre le journal; au fondj'aime mieux cent absurdités atroces qu'un seul pendu. Qui se souvient d'une absurdité deux ans après le numéro du journal officiel? Au lieu que les fils et la famille du pendu me vouent une haine qui durera autant que moi et qui peut- être abrégera ma vie.
La duchessetoujours passionnée pour quelque chosetoujours agissantejamais oisiveavait plus d'esprit que toute la cour de Parme; mais elle manquait de patience et d'impassibilité pour réussir dans les intrigues. Toutefoiselle était parvenue à suivre avec passion les intérêts des diverses coterieselle commençait même à avoir un crédit personnel auprès du prince. Clara-Paolinala princesse régnanteenvironnée d'honneursmais emprisonnée dans l'étiquette la plus surannéese regardait comme la plus malheureuse des femmes. La duchesse Sanseverina lui fit la couret entreprit de lui prouver qu'elle n'était point si malheureuse. Il faut savoir que le prince ne voyait sa femme qu'à dîner: ce repas durait trente minutes et le prince passait des semaines entières sans adresser la parole à Clara-Paolina. Mme Sanseverina essaya de changer tout cela; elle amusait le princeet d'autant plus qu'elle avait su conserver toute son indépendance. Quand elle l'eût vouluelle n'eût pas pu ne jamais blesser aucun des sots qui pullulaient à cette cour. C'était cette parfaite inhabileté de sa part qui la faisait exécrer du vulgaire des courtisanstous comtes ou marquisjouissant en général de cinq mille livres de rentes. Elle comprit ce malheur dès les premiers jourset s'attacha exclusivement à plaire au souverain et à sa femmelaquelle dominait absolument le prince héréditaire. La duchesse savait amuser le souverain et profitait de l'extrême attention qu'il accordait à ses moindres paroles pour donner de bons ridicules aux courtisans qui la haïssaient. Depuis les sottises que Rassi lui avait fait faireet les sottises de sang ne se réparent pasle prince avait peur quelquefoiset s'ennuyait souventce qui l'avait conduit à la triste envie; il sentait qu'il ne s'amusait guèreet devenait sombre quand il croyait voir que d'autres s'amusaient; l'aspect du bonheur le rendait furieux. Il faut cacher nos amoursdit la duchesse à son ami; et elle laissa deviner au prince qu'elle n'était plus que fort médiocrement éprise du comtehomme d'ailleurs si estimable.
Cette découverte avait donné un jour heureux à Son Altesse. De temps à autrela duchesse laissait tomber quelques mots du projet qu'elle aurait de se donner chaque année un congé de quelques mois qu'elle emploierait à voir l'Italie qu'elle ne connaissait point: elle irait visiter NaplesFlorence Rome. Orrien au monde ne pouvait faire plus de peine au prince qu'une telle apparence de désertion: c'était là une de ses faiblesses les plus marquéesles démarches qui pouvaient être imputées à mépris pour sa ville capitale lui perçaient le coeur. Il sentait qu'il n'avait aucun moyen de retenir Mme Sanseverinaet Mme Sanseverina était de bien loin la femme la plus brillante de Parme. Chose unique avec la paresse italienneon revenait des campagnes environnantes pour assister à ses jeudis ; c'étaient de véritables fêtes; presque toujours la duchesse y avait quelque chose de neuf et de piquant. Le prince mourait d'envie de voir un de ces jeudis mais comment s'y prendre? Allez chez un simple particulier! c'était une chose que ni son père ni lui n'avaient jamais faite!
Un certain jeudiil pleuvaitil faisait froid; à chaque instant de la soirée le duc entendait des voitures qui ébranlaient le pavé de la place du palaisen allant chez Mme Sanseverina. Il eut un mouvement d'impatience: d'autres s'amusaientet luiprince souverainmaître absoluqui devait s'amuser plus que personne au mondeil connaissait l'ennui! Il sonna son aide de campil fallut le temps de placer une douzaine de gens affidés dans la rue qui conduisait du palais de Son Altesse au palais Sanseverina. Enfinaprès une heure qui parut un siècle au princeet pendant laquelle il fut vingt fois tenté de braver les poignards et de sortir à l'étourdie et sans nulle précautionil parut dans le premier salon de Mme Sanseverina. La foudre serait tombée dans ce salon qu'elle n'eût pas produit une pareille surprise. En un clin d'oeilet à mesure que le prince s'avançaits'établissait dans ces salons si bruyants et si gais un silence de stupeur; tous les yeuxfixés sur le princes'ouvraient outre mesure. Les courtisans paraissaient déconcertés; la duchesse elle seule n'eut point l'air étonné. Quand enfin l'on eut retrouvé la force de parlerla grande préoccupation de toutes les personnes présentes fut de décider cette importante question: la duchesse avait-elle été avertie de cette visiteou bien a-t-elle été surprise comme tout le monde?
Le prince s'amusaet l'on va juger du caractère tout de premier mouvement de la duchesseet du pouvoir infini que les idées vagues de départ adroitement jetées lui avaient laissé prendre.
En reconduisant le prince qui lui adressait des mots fort aimablesil lui vint une idée singulière et qu'elle osa bien lui dire tout simplementet comme une chose des plus ordinaires.
-- Si Votre Altesse Sérénissime voulait adresser à la princesse trois ou quatre de ces phrases charmantes qu'elle me prodigueelle ferait mon bonheur bien plus sûrement qu'en me disant ici que je suis jolie. C'est que je ne voudrais pas pour tout au monde que la princesse pût voir de mauvais oeil l'insigne marque de faveur dont Votre Altesse vient de m'honorer. Le prince la regarda fixement et répliqua d'un air sec:
-- Apparemment que je suis le maître d'aller où il me plaît.
La duchesse rougit.
-- Je voulais seulementreprit-elle à l'instantne pas exposer Son Altesse à faire une course inutilecar ce jeudi sera le dernier; je vais aller passer quelques jours à Bologne ou à Florence.
Comme elle rentrait dans ses salonstout le monde la croyait au comble de la faveuret elle venait de hasarder ce que de mémoire d'homme personne n'avait osé à Parme. Elle fit un signe au comte qui quitta sa table de whist et la suivit dans un petit salon éclairémais solitaire.
-- Ce que vous avez fait est bien hardilui dit-il; je ne vous l'aurais pas conseillé; mais dans les coeurs bien éprisajouta-t-il en riantle bonheur augmente l'amouret si vous partez demain matinje vous suis demain soir. Je ne serai retardé que par cette corvée du ministère des finances dont j'ai eu la sottise de me chargermais en quatre heures de temps bien employées on peut faire la remise de bien des caisses. Rentronschère amieet faisons de la fatuité ministérielle en toute libertéet sans nulle retenuec'est peut-être la dernière représentation que nous donnons en cette ville. S'il se croit bravél'homme est capable de tout; il appellera cela faire un exemple. Quand ce monde sera partinous aviserons aux moyens de vous barricader pour cette nuit; le mieux serait peut-être de partir sans délai pour votre maison de Saccaprès du Pôqui a l'avantage de n'être qu'à une demi-heure de distance des Etats autrichiens.
L'amour et l'amour-propre de la duchesse eurent un moment délicieux; elle regarda le comteet ses yeux se mouillèrent de larmes. Un ministre si puissantenvironné de cette foule de courtisans qui l'accablaient d'hommages égaux à ceux qu'ils adressaient au prince lui-mêmetout quitter pour elle et avec cette aisance!
En rentrant dans les salonselle était folle de joie. Tout le monde se prosternait devant elle.
Comme le bonheur change la duchessedisaient de toutes parts les courtisansc'est à ne pas la reconnaître. Enfin cette âme romaine et au-dessus de tout daigne pourtant apprécier la faveur exorbitante dont elle vient d'être l'objet de la part du souverain.
Vers la fin de la soiréele comte vint à elle:-- Il faut que je vous dise des nouvelles. Aussitôt les personnes qui se trouvaient auprès de la duchesse s'éloignèrent.
-- Le prince en rentrant au palaiscontinua le comtes'est fait annoncer chez sa femme. Jugez de la surprise! Je viens vous rendre comptelui a-t-il ditd'une soirée fort aimableen véritéque j'ai passée chez la Sanseverina. C'est elle qui m'a prié de vous faire le détail de la façon dont elle a arrangé ce vieux palais enfumé. Alors le princeaprès s'être assiss'est mis à faire la description de chacun de vos salons.
Il a passé plus de vingt-cinq minutes chez sa femme qui pleurait de joie; malgré son espritelle n'a pas pu trouver un mot pour soutenir la conversation sur le ton léger que Son Altesse voulait bien lui donner.
Ce prince n'était point un méchant hommequoi qu'en pussent dire les libéraux d'Italie. A la véritéil avait fait jeter dans les prisons un assez bon nombre d'entre euxmais c'était par peuret il répétait quelquefois comme pour se consoler de certains souvenirs: Il vaut mieux tuer le diable que si le diable nous tue. Le lendemain de la soirée dont nous venons de parleril était tout joyeuxil avait fait deux belles actions: aller au jeudi et parler à sa femme. A dîneril lui adressa la parole; en un motcejeudi de Mme Sanseverina amena une révolution d'intérieur dont tout Parme retentit; la Raversi fut consternéeet la duchesse eut une double joie: elle avait pu être utile à son amant et l'avait trouvé plus épris que jamais.
Tout cela à cause d'une idée bien imprudente qui m'est venue! disait-elle au comte. Je serais plus libre sans doute à Rome ou à Naplesmais y trouverais-je un jeu aussi attachant? Nonen véritémon cher comteet vous faites mon bonheur.
Livre Premier
Chapitre VII.
C'est de petits détails de cour aussi insignifiants que celui que nous venons de raconter qu'il faudrait remplir l'histoire des quatre années qui suivirent. Chaque printempsla marquise venait avec ses filles passer deux mois au palais Sanseverina ou à la terre de Saccaaux bords du Pôil y avait des moments bien douxet l'on parlait de Fabrice; mais le comte ne voulut jamais lui permettre une seule visite à Parme. La duchesse et le ministre eurent bien à réparer quelques étourderiesmais en général Fabrice suivait assez sagement la ligne de conduite qu'on lui avait indiquée: un grand seigneur qui étudie la théologie et qui ne compte point absolument sur sa vertu pour faire son avancement. A Naplesil s'était pris d'un goût très vif pour l'étude de l'antiquitéil faisait des fouilles; cette passion avait presque remplacé celle des chevaux. Il avait vendu ses chevaux anglais pour continuer des fouilles à Misèneoù il avait trouvé un buste de Tibèrejeune encorequi avait pris rang parmi les plus beaux restes de l'antiquité. La découverte de ce buste fut presque le plaisir le plus vif qu'il eût rencontré à Naples. Il avait l'âme trop haute pour chercher à imiter les autres jeunes gensetpar exemplepour vouloir jouer avec un certain sérieux le rôle d'amoureux. Sans doute il ne manquait point de maîtressesmais elles n'étaient pour lui d'aucune conséquenceetmalgré son âgeon pouvait dire de lui qu'il ne connaissait point l'amour; il n'en était que plus aimé. Rien ne l'empêchait d'agir avec le plus beau sang-froidcar pour lui une femme jeune et jolie était toujours l'égale d'une autre femme jeune et jolie; seulement la dernière connue lui semblait la plus piquante. Une des dames les plus admirées à Naples avait fait des folies en son honneur pendant la dernière année de son séjource qui d'abord l'avait amuséet avait fini par l'excéder d'ennuitellement qu'un des bonheurs de son départ fut d'être délivré des attentions de la charmante duchesse d'A... Ce fut en 1821qu'ayant subi passablement tous ses examensson directeur d'études ou gouverneur eut une croix et un cadeauet lui partit pour voir enfin cette ville de Parmeà laquelle il songeait souvent. Il était Monsignoreet il avait quatre chevaux à sa voiture; à la poste avant Parmeil n'en prit que deuxet dans la ville fit arrêter devant l'église de Saint-Jean. Là se trouvait le riche tombeau de l'archevêque Ascagne del Dongoson arrière-grand-onclel'auteur de la Généalogie latine. Il pria auprès du tombeaupuis arriva au pied au palais de la duchesse qui ne l'attendait que quelques jours plus tard. Elle avait grand monde dans son salonbientôt on la laissa seule.
-- Eh bien! es-tu contente de moi? lui dit-il en se jetant dans ses bras: grâce à toij'ai passé quatre années assez heureuses à Naplesau lieu de m'ennuyer à Novare avec ma maîtresse autorisée par la police.
La duchesse ne revenait pas de son étonnementelle ne l'eût pas reconnu à le voir passer dans la rue; elle le trouvait ce qu'il était en effetl'un des plus jolis hommes de l'Italie; il avait surtout une physionomie charmante. Elle l'avait envoyé à Naples avec la tournure d'un hardi casse-cou; la cravache qu'il portait toujours alors semblait faire partie inhérente de son être: maintenant il avait l'air le plus noble et le plus mesuré devant les étrangerset dans le particulierelle lui trouvait tout le feu de sa première jeunesse. C'était un diamant qui n'avait rien perdu à être poli. Il n'y avait pas une heure que Fabrice était arrivélorsque le comte Mosca survint; il arriva un peu trop tôt. Le jeune homme lui parla en si bons termes de la croix de Parme accordée à son gouverneuret il exprima sa vive reconnaissance pour d'autres bienfaits dont il n'osait parler d'une façon aussi claireavec une mesure si parfaiteque du premier coup d'oeil le ministre le jugea favorablement. Ce neveudit-il tout bas à la duchesseest fait pour orner toutes les dignités auxquelles vous voudrez l'élever par la suite. Tout allait à merveille jusque-làmais quand le ministrefort content de Fabriceet jusque-là attentif uniquement à ses faits et gestesregarda la duchesseil lui trouva des yeux singuliers. Ce jeune homme fait ici une étrange impressionse dit-il. Cette réflexion fut amère; le comte avait atteint la cinquantainec'est un mot bien cruel et dont peut-être un homme éperdument amoureux peut seul sentir tout le retentissement. Il était fort bonfort digne d'être aiméà ses sévérités près comme ministre. Maisà ses yeuxce mot cruel la cinquantaine jetait du noir sur toute sa vie et eût été capable de le faire cruel pour son propre compte. Depuis cinq années qu'il avait décidé la duchesse à venir à Parmeelle avait souvent excité sa jalousie surtout dans les premiers tempsmais jamais elle ne lui avait donné de sujet de plainte réel. Il croyait mêmeet il avait raisonque c'était dans le dessein de mieux s'assurer de son coeur que la duchesse avait eu recours à ces apparences de distinction en faveur de quelques jeunes beaux de la cour. Il était sûrpar exemplequ'elle avait refusé les hommages du princequi mêmeà cette occasionavait dit un mot instructif.
-- Mais si j'acceptais les hommages de Votre Altesselui disait la duchesse en riantde quel front oser reparaître devant le comte?
-- Je serais presque aussi décontenancé que vous. Le cher comte! mon ami! Mais c'est un embarras bien facile à tourner et auquel j'ai songé: le comte serait mis à la citadelle pour le reste de ses jours.
Au moment de l'arrivée de Fabricela duchesse fut tellement transportée de bonheurqu'elle ne songea pas du tout aux idées que ses yeux pourraient donner au comte. L'effet fut profond et les soupçons sans remède.
Fabrice fut reçu par le prince deux heures après son arrivée; la duchesseprévoyant le bon effet que cette audience impromptue devait produire dans le publicla sollicitait depuis deux mois: cette faveur mettait Fabrice hors de pair dès le premier instant; le prétexte avait été qu'il ne faisait que passer à Parme pour aller voir sa mère en Piémont. Au moment où un petit billet charmant de la duchesse vint dire au prince que Fabrice attendait ses ordresSon Altesse s'ennuyait. Je vais voirse dit-elleun petit saint bien niaisune mine plate ou sournoise. Le commandant de la place avait déjà rendu compte de la première visite au tombeau de l'oncle archevêque. Le prince vit entrer un grand jeune hommequesans ses bas violetsil eût pris pour quelque jeune officier.
Cette petite surprise chassa l'ennui: voilà un gaillardse dit-ilpour lequel on va me demander Dieu sait quelles faveurstoutes celles dont je puis disposer. Il arriveil doit être ému: je m'en vais faire de la politique jacobine; nous verrons un peu comment il répondra.
Après les premiers mots gracieux de la part du prince:
-- Eh bien! Monsignoredit-il à Fabriceles peuples de Naples sont-ils heureux? Le roi est-il aimé?
-- Altesse Sérénissimerépondit Fabrice sans hésiter un instantj'admiraisen passant dans la ruel'excellente tenue des soldats des divers régiments de S.M. le Roi; la bonne compagnie est respectueuse envers ses maîtres comme elle doit l'être; mais j'avouerai que de la vie je n'ai souffert que les gens des basses classes me parlassent d'autre chose que du travail pour lequel je les paie.
-- Peste! dit le princequel sacre! voici un oiseau bien styléc'est l'esprit de la Sanseverina. Piqué au jeule prince employa beaucoup d'adresse à faire parler Fabrice sur ce sujet si scabreux. Le jeune hommeanimé par le dangereut le bonheur de trouver des réponses admirables: c'est presque de l'insolence que d'afficher de l'amour pour son roidisait-ilc'est de l'obéissance aveugle qu'on lui doit. A la vue de tant de prudence le prince eut presque de l'humeur; il paraît que voici un homme d'esprit qui nous arrive de Napleset je n'aime pas cette engeance ; un homme d'esprit a beau marcher dans les meilleurs principes et même de bonne foitoujours par quelque côté il est cousin germain de Voltaire et de Rousseau.
Le prince se trouvait comme bravé par les manières si convenables et les réponses tellement inattaquables du jeune échappé de collège; ce qu'il avait prévu n'arrivait point: en un clin d'oeil il prit le ton de la bonhomieetremontanten quelques motsjusqu'aux grands principes des sociétés et du gouvernementil débitaen les adaptant à la circonstancequelques phrases de Fénelon qu'on lui avait fait apprendre par coeur dès l'enfance pour les audiences publiques.
-- Ces principes vous étonnentjeune hommedit-il à Fabrice (il l'avait appelé monsignore au commencement de l'audienceet il comptait lui donner du monsignore en le congédiantmais dans le courant de la conversation il trouvait plus adroitplus favorable aux tournures pathétiquesde l'interpeller par un petit nom d'amitié); ces principes vous étonnentjeune hommej'avoue qu'ils ne ressemblent guère aux tartines d'absolutisme (ce fut le mot) que l'on peut lire tous les jours dans mon journal officiel... Maisgrand Dieu! qu'est-ce que je vais vous citer là? ces écrivains du journal sont pour vous bien inconnus.
-- Je demande pardon à Votre Altesse Sérénissime; non seulement je lis le journal de Parmequi me semble assez bien écritmais encore je tiensavec luique tout ce qui a été fait depuis la mort de Louis XIVen 1715est à la fois un crime et une sottise. Le plus grand intérêt de l'hommec'est son salutil ne peut pas y avoir deux façons de voir à ce sujetet ce bonheur-là doit durer une éternité. Les mots libertéjusticebonheur du plus grand nombresont infâmes et criminels: ils donnent aux esprits l'habitude de la discussion et de la méfiance. Une chambre des députés se défie de ce que ces gens-là appellent le ministère. Cette fatale habitude de la méfiance une fois contractéela faiblesse humaine l'applique à toutl'homme arrive à se méfier de la Bibledes ordres de l'Eglisede la traditionetc.etc.; dès lors il est perdu. Quand bien mêmece qui est horriblement faux et criminel à direcette méfiance envers l'autorité des princes établis de Dieu donnerait le bonheur pendant les vingt ou trente années de vie que chacun de nous peut prétendrequ'est-ce qu'un demi- siècle ou un siècle tout entiercomparé à une éternité de supplices? etc.
On voyaità l'air dont Fabrice parlaitqu'il cherchait à arranger ses idées de façon à les faire saisir le plus facilement possible par son auditeuril était clair qu'il ne récitait pas une leçon.
Bientôt le prince ne se soucia plus de lutter avec ce jeune homme dont les manières simples et graves le gênaient.
-- Adieumonsignorelui dit-il brusquementje vois qu'on donne une excellente éducation dans l'Académie ecclésiastique de Napleset il est tout simple que quand ces bons préceptes tombent sur un esprit aussi distinguéon obtienne des résultats brillants. Adieu; et il lui tourna le dos.
Je n'ai point plu à cet animal-làse dit Fabrice.
Maintenant il nous reste à voirdit le prince dès qu'il fut seulsi ce beau jeune homme est susceptible de passion pour quelque chose; en ce cas il serait complet... Peut-on répéter avec plus d'esprit les leçons de la tante? Il me semblait l'entendre parler; s'il y avait une révolution chez moice serait elle qui rédigerait le Moniteurcomme jadis la San Felice à Naples! Mais la San Felicemalgré ses vingt-cinq ans et sa beautéfut un peu pendue! Avis aux femmes de trop d'esprit. En croyant Fabrice l'élève de sa tantele prince se trompait: les gens d'esprit qui naissent sur le trône ou à côté perdent bientôt toute finesse de tact; ils proscriventautour d'euxla liberté de conversation qui leur paraît grossièreté; ils ne veulent voir que des masques et prétendent juger de la beauté du teint; le plaisant c'est qu'ils se croient beaucoup de tact. Dans ce cas-cipar exempleFabrice croyait à peu près tout ce que nous lui avons entendu dire; il est vrai qu'il ne songeait pas deux fois par mois à tous ces grands principes. Il avait des goûts vifsil avait de l'espritmais il avait la foi.
Le goût de la libertéla mode et le culte du bonheur du plus grand nombredont le XIXe siècle s'est entichén'étaient à ses yeux qu'une hérésie qui passera comme les autresmais après avoir tué beaucoup d'âmescomme la peste tandis qu'elle règne dans une contrée tue beaucoup de corps. Et malgré tout cela Fabrice lisait avec délices les journaux françaiset faisait même des imprudences pour s'en procurer.
Comme Fabrice revenait tout ébouriffé de son audience au palaiset racontait à sa tante les diverses attaques du prince:
-- Il fautlui dit-elleque tu ailles tout présentement chez le père Landrianinotre excellent archevêque; vas-y à piedmonte doucement l'escalierfais peu de bruit dans les antichambres; si l'on te fait attendretant mieuxmille fois tant mieux! en un motsois apostolique!
-- J'entendsdit Fabricenotre homme est un Tartufe.
-- Pas le moins du mondec'est la vertu même.
-- Même après ce qu'il a faitreprit Fabrice étonnélors du supplice du comte Palanza?
-- Ouimon amiaprès ce qu'il a fait: le père de notre archevêque était un commis au ministère des financesun petit bourgeoisvoilà qui explique tout. Monseigneur Landriani est un homme d'un esprit vif étenduprofond; il est sincèreil aime la vertu: je suis convaincue que si un empereur Décius revenait au mondeil subirait le martyre comme le Polyeucte de l'Opéraqu'on nous donnait la semaine passée. Voilà le beau côté de la médaillevoici le revers: dès qu'il est en présence du souverainou seulement du premier ministreil est ébloui de tant de grandeuril se troubleil rougit; il lui est matériellement impossible de dire non. De là les choses qu'il a faiteset qui lui ont valu cette cruelle réputation dans toute l'Italie; mais ce qu'on ne sait pasc'est quelorsque l'opinion publique vint l'éclairer sur le procès du comte Palanzail s'imposa pour pénitence de vivre au pain et à l'eau pendant treize semainesautant de semaines qu'il y a de lettres dans les noms Davide Palanza. Nous avons à cette cour un coquin d'infiniment d'espritnommé Rassigrand juge ou fiscal généralquilors de la mort du comte Palanzaensorcela le père Landriani. A l'époque de la pénitence des treize semainesle comte Moscapar pitié et un peu par malicel'invitait à dîner une et même deux fois par semaine; le bon archevêquepour faire sa courdînait comme tout le monde. Il eût cru qu'il y avait rébellion et jacobinisme à afficher une pénitence pour une action approuvée du souverain. Mais l'on savait quepour chaque dîneroù son devoir de fidèle sujet l'avait obligé à manger comme tout le mondeil s'imposait une pénitence de deux journées de nourriture au pain et à l'eau.
Monseigneur Landrianiesprit supérieursavant du premier ordren'a qu'un faibleil veut être aimé : ainsiattendris-toi en le regardantetà la troisième visiteaime-le tout à fait. Celajoint à ta naissancete fera adorer tout de suite. Ne marque pas de surprise s'il te reconduit jusque sur l'escalieraie l'air d'être accoutumé à ces façons; c'est un homme né à genoux devant la noblesse. Du restesois simpleapostoliquepas d'espritpas de brillantpas de repartie prompte; si tu ne l'effarouches pointil se plaira avec toi; songe qu'il faut que de son propre mouvement il te fasse son grand vicaire. Le comte et moi nous serons surpris et même fâchés de ce trop rapide avancementcela est essentiel vis-à-vis du souverain.
Fabrice courut à l'archevêché: par un bonheur singulierle valet de chambre du bon prélatun peu sourdn'entendit pas le nom del Dongo ; il annonça un jeune prêtrenommé Fabrice; l'archevêque se trouvait avec un curé de moeurs peu exemplaireset qu'il avait fait venir pour le gronder. Il était en train de faire une réprimandechose très pénible pour luiet ne voulait pas avoir ce chagrin sur le coeur plus longtemps; il fit donc attendre trois quarts d'heure le petit neveu du grand archevêque Ascanio del Dongo.
Comment peindre ses excuses et son désespoir quandaprès avoir reconduit le curé jusqu'à la seconde antichambreet lorsqu'il demandait en repassant à cet homme qui attendaiten quoi il pouvait le serviril aperçut les bas violets et entendit le nom Fabrice del Dengo? La chose parut si plaisante à notre hérosquedès cette première visiteil hasarda de baiser la main du saint prélatdans un transport de tendresse. Il fallait entendre l'archevêque répéter avec désespoir: Un del Dongo attendre dans mon antichambre! Il se crut obligéen forme d'excusede lui raconter toute l'anecdote du curéses tortsses réponsesetc.
Est-il bien possiblese disait Fabrice en revenant au palais Sanseverinaque ce soit là l'homme qui a fait hâter le supplice de ce pauvre comte Palanza!
-- Que pense Votre Excellencelui dit en riant le comte Moscaen le voyant rentrer chez la duchesse (le comte ne voulait pas que Fabrice l'appelât Excellence).
-- Je tombe des nues; je ne connais rien au caractère des hommes: j'aurais pariési je n'avais pas su son nomque celui-ci ne peut voir saigner un poulet.
-- Et vous auriez gagnéreprit le comte; mais quand il est devant le princeou seulement devant moiil ne peut dire non. A la véritépour que je produise tout mon effetil faut que j'aie le grand cordon jaune passé par-dessus l'habit; en frac il me contrediraitaussi je prends toujours un uniforme pour le recevoir. Ce n'est pas à nous à détruire le prestige du pouvoirles journaux français le démolissent bien assez vite; à peine si la manie respectante vivra autant que nouset vousmon neveuvous survivrez au respect. Vousvous serez bon homme!
Fabrice se plaisait fort dans la société du comte: c'était le premier homme supérieur qui eût daigné lui parler sans comédie; d'ailleurs ils avaient un goût communcelui des antiquités et des fouilles. Le comtede son côtéétait flatté de l'extrême attention avec laquelle le jeune homme l'écoutait; mais il y avait une objection capitale: Fabrice occupait un appartement dans le palais Sanseverinapassait sa vie avec la duchesselaissait voir en toute innocence que cette intimité faisait son bonheuret Fabrice avait des yeuxun teint d'une fraîcheur désespérante.
De longue mainRanuce-Ernest IVqui trouvait rarement de cruellesétait piqué de ce que la vertu de la duchessebien connue à la courn'avait pas fait une exception en sa faveur. Nous l'avons vul'esprit et la présence d'esprit de Fabrice l'avaient choqué dès le premier jour. Il prit mal l'extrême amitié que sa tante et lui se montraient à l'étourdie; il prêta l'oreille avec une extrême attention aux propos de ses courtisansqui furent infinis. L'arrivée de ce jeune homme et l'audience si extraordinaire qu'il avait obtenue firent pendant un mois à la cour la nouvelle et l'étonnement; sur quoi le prince eut une idée.
Il avait dans sa garde un simple soldat qui supportait le vin d'une admirable façon; cet homme passait sa vie au cabaretet rendait compte de l'esprit du militaire directement au souverain. Carlone manquait d'éducationsans quoi depuis longtemps il eût obtenu de l'avancement. Orsa consigne était de se trouver devant le palais tous les jours quand midi sonnait à la grande horloge. Le prince alla lui-même un peu avant midi disposer d'une certaine façon la persienne d'un entre-sol tenant à la pièce où Son Altesse s'habillait. Il retourna dans cet entre-sol un peu après que midi eut sonnéil y trouva le soldat; le prince avait dans sa poche une feuille de papier et une écritoireil dicta au soldat le billet que voici:
«Votre Excellence a beaucoup d'espritsans douteet c'est grâce à sa profonde sagacité que nous voyons cet Etat si bien gouverné. Maismon cher comtede si grands succès ne marchent point sans un peu d'envieet je crains fort qu'on ne rie un peu à vos dépenssi votre sagacité ne devine pas qu'un certain beau jeune homme a eu le bonheur d'inspirermalgré lui peut-êtreun amour des plus singuliers. Cet heureux mortel n'adit-onque vingt-trois ansetcher comtece qui complique la questionc'est que vous et moi nous avons beaucoup plus que le double de cet âge. Le soirà une certaine distancele comte est charmantsémillanthomme d'espritaimable au possible; mais le matindans l'intimitéà bien prendre les chosesle nouveau venu a peut-être plus d'agréments. Ornous autres femmesnous faisons grand cas de cette fraîcheur de la jeunessesurtout quand nous avons passé la trentaine. Ne parle-t-on pas déjà de fixer cet aimable adolescent à notre courpar quelque belle place? Et quelle est donc la personne qui en parle le plus souvent à votre Excellence? »
Le prince prit la lettre et donna deux écus au soldat.
-- Ceci outre vos appointementslui dit-il d'un air morne; le silence absolu envers tout le mondeou bien la plus humide des basses fosses à la citadelle. Le prince avait dans son bureau une collection d'enveloppes avec les adresses de la plupart des gens de la courde la main de ce même soldat qui passait pour ne pas savoir écrireet n'écrivait jamais même ses rapports de police: le prince choisit celle qu'il fallait.
Quelques heures plus tardle comte Mosca reçut une lettre par la poste; on avait calculé l'heure où elle pourrait arriveret au moment où le facteurqu'on avait vu entrer tenant une petite lettre à la mainsortit du palais du ministèreMosca fut appelé chez Son Altesse. Jamais le favori n'avait paru dominé par une plus noire tristesse; pour en jouir plus à l'aisele prince lui cria en le voyant:
-- J'ai besoin de me délasser en jasant au hasard avec l'amiet non pas de travailler avec le ministre. Je jouis ce soir d'un mal à la tête fouet de plus il me vient des idées noires.
Faut-il parler de l'humeur abominable qui agitait le Premier ministrecomte Mosca de la Rovèreà l'instant où il lui fut permis de quitter son auguste maître? Ranuce-Ernest IV était parfaitement habile dans l'art de torturer un coeuret je pourrais faire ici sans trop d'injustice la comparaison du tigre qui aime à jouer avec sa proie.
Le comte se fit reconduire chez lui au galop; il cria en passant qu'on ne laissât monter âme qui vivefit dire à l'auditeur de service qu'il lui rendait la liberté (savoir un être humain à portée de sa voix lui était odieux)et courut s'enfermer dans la grande galerie de tableaux. Là enfin il put se livrer à toute sa fureur; là il passa la soirée sans lumières à se promener au hasardcomme un homme hors de lui. Il cherchait à imposer silence à son coeurpour concentrer toute la force de son attention dans la discussion du parti à prendre. Plongé dans des angoisses qui eussent fait pitié à son plus cruel ennemiil se disait: L'homme que j'abhorre loge chez la duchessepasse tous ses moments avec elle. Dois-je tenter de faire parler une de ses femmes? Rien de plus dangereux; elle est si bonne; elle les paie bien! elle en est adorée! (Et de quigrand Dieun'est-elle pas adorée!) Voici la questionreprenait-il avec rage:
Faut-il laisser deviner la jalousie qui me dévoreou ne pas en parler?
Si je me taison ne se cachera point de moi. Je connais Ginac'est une femme toute de premier mouvement; sa conduite est imprévue même pour elle; si elle veut se tracer un rôle d'avanceelle s'embrouille; toujoursau moment de l'actionil lui vient une nouvelle idée qu'elle suit avec transport comme étant ce qu'il y a de mieux au mondeet qui gâte tout.
Ne disant mot de mon martyreon ne se cache point de moi et je vois tout ce qui peut se passer...
Ouimais en parlantje fais naître d'autres circonstances; je fais faire des réflexions; je préviens beaucoup de ces choses horribles qui peuvent arriver... Peut-être on l'éloigne (le comte respira)alors j'ai presque partie gagnée; quand même on aurait un peu d'humeur dans le momentje la calmerai... et cette humeur quoi de plus naturel?... elle l'aime comme un fils depuis quinze ans. Là gît tout mon espoir: comme un fils... mais elle a cessé de le voir depuis sa fuite pour Waterloo; mais en revenant de Naplessurtout pour ellec'est un autre homme. Un autre hommerépéta-t-il avec rageet cet homme est charmant; il a surtout cet air naïf et tendre et cet oeil souriant qui promettent tant de bonheur! et ces yeux-là la duchesse ne doit pas être accoutumée à les trouver à notre cour!... Ils y sont remplacés par le regard morne et sardonique. Moi-mêmepoursuivi par les affairesne régnant que par mon influence sur un homme qui voudrait me tourner en ridiculequels regards dois-je avoir souvent? Ah! quelques soins que je prennec'est surtout mon regard qui doit être vieux en moi! Ma gaieté n'est-elle pas toujours voisine de l'ironie?... Je dirai plusici il faut être sincèrema gaieté ne laisse-t-elle pas entrevoircomme chose toute prochele pouvoir absolu... et la méchanceté? Est-ce que quelquefois je ne me dis pas à moi-mêmesurtout quand on m'irrite: Je puis ce que je veux? et même j'ajoute une sottise: je dois être plus heureux qu'un autrepuisque je possède ce que les autres n'ont pas: le pouvoir souverain dans les trois quarts des choses. Eh bien! soyons juste; l'habitude de cette pensée doit gâter mon sourire... doit me donner un air d'égoïsme... content... Etcomme son sourire à lui est charmant! il respire le bonheur facile de la première jeunesseet il le fait naître.
Par malheur pour le comtece soir-là le temps était chaudétoufféannonçant la tempête; de ces tempsen un motquidans ces pays-làportent aux résolutions extrêmes. Comment rapporter tous les raisonnementstoutes les façons de voir ce qui lui arrivaitquidurant trois mortelles heuresmirent à la torture cet homme passionné? Enfin le parti de la prudence l'emportauniquement par suite de cette réflexion: Je suis fouprobablement; en croyant raisonnerje ne raisonne pas; je me retourne seulement pour chercher une position moins cruelleje passe sans la voir à côté de quelque raison décisive. Puisque je suis aveuglé par l'excessive douleursuivons cette règleapprouvée de tous les gens sagesqu'on appelle prudence.
D'ailleursune fois que j'ai prononcé le mot fatal jalousiemon rôle est tracé à tout jamais. Au contrairene disant rien aujourd'huije puis parler demainje reste maître de tout. La crise était trop fortele comte serait devenu fousi elle eût duré. Il fut soulagé pour quelques instantsson attention vint à s'arrêter sur la lettre anonyme. De quelle part pouvait-elle venir? Il y eut là une recherche de nomset un jugement à propos de chacun d'euxqui fit diversion. A la fin le comte se rappela un éclair de malice qui avait jailli de l'oeil du souverain quand il en était venu à dire vers la fin de l'audience: Ouicher ami convenons-enles plaisirs et les soins de l'ambition la plus heureusemême du pouvoir sans bornesne sont rien auprès du bonheur intime que donnent les relations de tendresse et d'amour. Je suis homme avant d'être princeetquand j'ai le bonheur d'aimerma maîtresse s'adresse à l'homme et non au prince. Le comte rapprocha ce moment de bonheur malin de cette phrase de la lettre: C'est grâce à votre profonde sagacité que nous voyons cet état si bien gouverné. Cette phrase est du princes'écria-t-ilchez un courtisan elle serait d'une imprudence gratuite; la lettre vient de Son Altesse.
Ce problème résolula petite joie causée par le plaisir de deviner fut bientôt effacée par la cruelle apparition des grâces charmantes de Fabricequi revint de nouveau. Ce fut comme un poids énorme qui retomba sur le coeur du malheureux. Qu'importe de qui soit la lettre anonyme! s'écria-t-il avec fureurle fait qu'elle me dénonce en existe-t-il moins? Ce caprice peut changer ma viedit-il comme pour s'excuser d'être tellement fou. Au premier momentsi elle l'aime d'une certaine façonelle part avec lui pour Belgiratepour la Suissepour quelque coin du monde. Elle est richeet d'ailleursdût-elle vivre avec quelques louis chaque annéeque lui importe? Ne m'avouait-elle pasil n'y a pas huit joursque son palaissi bien arrangési magnifiquel'ennuie? Il faut du nouveau à cette âme si jeune! Et avec quelle simplicité se présente cette félicité nouvelle! elle sera entraînée avant d'avoir songé au dangeravant d'avoir songé à me plaindre! Et je suis pourtant si malheureux! s'écria le comte fondant en larmes.
Il s'était juré de ne pas aller chez la duchesse ce soir-làmais il n'y put tenir; jamais ses yeux n'avaient eu une telle soif de la regarder. Sur le minuit il se présenta chez elle; il la trouva seule avec son neveuà dix heures elle avait renvoyé tout le monde et fait fermer sa porte.
A l'aspect de l'intimité tendre qui régnait entre ces deux êtreset de la joie naïve de la duchesseune affreuse difficulté s'éleva devant les yeux du comteet à l'improviste! il n'y avait pas songé durant la longue délibération dans la galerie de tableaux: comment cacher sa jalousie?
Ne sachant à quel prétexte avoir recoursil prétendit que ce soir-làil avait trouvé le prince excessivement prévenu contre luicontredisant toutes ses assertionsetc.etc. Il eut la douleur de voir la duchesse l'écouter à peineet ne faire aucune attention à ces circonstances quil'avant-veille encorel'auraient jetée dans des raisonnements infinis. Le comte regarda Fabrice: jamais cette belle figure lombarde ne lui avait paru si simple et si noble! Fabrice faisait plus d'attention que la duchesse aux embarras qu'il racontait.
Réellementse dit-ilcette tête joint l'extrême bonté à l'expression d'une certaine joie naïve et tendre qui est irrésistible. Elle semble dire: il n'y a que l'amour et le bonheur qu'il donne qui soient choses sérieuses en ce monde. Et pourtant arrive- t-on à quelque détail où l'esprit soit nécessaireson regard se réveille et vous étonneet l'on reste confondu.
Tout est simple à ses yeux parce que tout est vu de haut. Grand Dieu! comment combattre un tel ennemi? Et après toutqu'est-ce que la vie sans l'amour de Gina? Avec quel ravissement elle semble écouter les charmantes saillies de cet esprit si jeuneet quipour une femmedoit sembler unique au monde!
Une idée atroce saisit le comte comme une crampe: le poignarder là devant elleet me tuer après?
Il fit un tour dans la chambre se soutenant à peine sur ses jambesmais la main serrée convulsivement autour du manche de son poignard. Aucun des deux ne faisait attention à ce qu'il pouvait faire. Il dit qu'il allait donner un ordre à son laquaison ne l'entendit même pas; la duchesse riait tendrement d'un mot que Fabrice venait de lui adresser. Le comte s'approcha d'une lampe dans le premier salonet regarda si la pointe de son poignard était bien affilée. Il faut être gracieux et de manières parfaites envers ce jeune hommese disait-il en revenant et se rapprochant d'eux.
Il devenait fou; il lui sembla qu'en se penchant ils se donnaient des baiserslàsous ses yeux. Cela est impossible en ma présencese dit-il; ma raison s'égare. Il faut se calmer; si j'ai des manières rudesla duchesse est capablepar simple pique de vanitéde le suivre à Belgirate; et làou pendant le voyagele hasard peut amener un mot qui donnera un nom à ce qu'ils sentent l'un pour l'autre; et aprèsen un instanttoutes les conséquences.
La solitude rendra ce mot décisifet d'ailleursune fois la duchesse loin de moique devenir? et siaprès beaucoup de difficultés surmontées du côté du princeje vais montrer ma figure vieille et soucieuse à Belgiratequel rôle jouerais-je au milieu de ces gens fous de bonheur?
Ici même que suis-je autre chose que le terzo incomodo (cette belle langue italienne est toute faite pour l'amour)! Terzo incomodo (un tiers présent qui incommode)! Quelle douleur pour un homme d'esprit de sentir qu'on joue ce rôle exécrableet de ne pouvoir prendre sur soi de se lever et de s'en aller!
Le comte allait éclater ou du moins trahir sa douleur par la décomposition de ses traits. Comme en faisant des tours dans le salonil se trouvait près de la porteil prit la fuite en criant d'un air bon et intime: Adieu vous autres! il faut éviter le sangse dit-il.
Le lendemain de cette horrible soiréeaprès une nuit passée tantôt à se détailler les avantages de Fabricetantôt dans les affreux transports de la plus cruelle jalousiele comte eut l'idée de faire appeler un jeune valet de chambre à lui; cet homme faisait la cour à une jeune fille nommée Chékinal'une des femmes de chambre de la duchesse et sa favorite. Par bonheur ce jeune domestique était fort rangé dans sa conduiteavare mêmeet il désirait une place de concierge dans l'un des établissements publics de Parme. Le comte ordonna à cet homme de faire venir à l'instant Chékinasa maîtresse. L'homme obéitet une heure plus tard le comte parut à l'improviste dans la chambre où cette fille se trouvait avec son prétendu. Le comte les effraya tous deux par la quantité d'or qu'il leur donna puis il adressa ce peu de mots à la tremblante Chékina en la regardant entre les deux yeux.
-- La duchesse fait-elle l'amour avec Monsignore?
-- Nondit cette fille prenant sa résolution après un moment de silence;... nonpas encoremais il baise souvent les mains de madameen riant il est vraimais avec transport.
Ce témoignage fut complété par cent réponses à autant de questions furibondes du comte; sa passion inquiète fit bien gagner à ces pauvres gens l'argent qu'il leur avait jeté: il finit par croire à ce qu'on lui disaitet fut moins malheureux. -- Si jamais la duchesse se doute de cet entretiendit-il à Chékinaj'enverrai votre prétendu passer vingt ans à la forteresseet vous ne le reverrez qu'en cheveux blancs.
Quelques jours se passèrent pendant lesquels Fabrice à son tour perdit toute sa gaieté.
-- Je t'assuredisait-il à la duchesseque le comte Mosca a de l'antipathie pour moi.
-- Tant pis pour Son Excellencerépondait-elle avec une sorte d'humeur.
Ce n'était point là le véritable sujet d'inquiétude qui avait fait disparaître la gaieté de Fabrice. La position où le hasard me place n'est pas tenablese disait-il. Je suis bien sûr qu'elle ne parlera jamaiselle aurait horreur d'un mot trop significatif comme d'un inceste. Mais si un soiraprès une journée imprudente et folle elle vient à faire l'examen de sa consciencesi elle croit que j'ai pu deviner le goût qu'elle semble prendre pour moiquel rôle jouerais-je à ses yeux? exactement le casto Giuseppe (proverbe italienallusion au rôle ridicule de Joseph avec la femme de l'eunuque Putiphar).
Faire entendre par une belle confidence que je ne suis pas susceptible d'amour sérieux? je n'ai pas assez de tenue dans l'esprit pour énoncer ce fait de façon à ce qu'il ne ressemble pas comme deux gouttes d'eau à une impertinence. Il ne me reste que la ressource d'une grande passion laissée à Naplesen ce casy retourner pour vingt-quatre heures: ce parti est sagemais c'est bien de la peine! Resterait un petit amour de bas étage à Parmece qui peut déplaire; mais tout est préférable au rôle affreux de l'homme qui ne veut pas deviner. Ce dernier parti pourraitil est vraicompromettre mon avenir; il faudraità force de prudence et en achetant la discrétiondiminuer le danger. Ce qu'il y avait de cruel au milieu de toutes ces penséesc'est que réellement Fabrice aimait la duchesse de bien loin plus qu'aucun être au monde. Il faut être bien maladroitse disait-il avec colèrepour tant redouter de ne pouvoir persuader ce qui est si vrai! Manquant d'habileté pour se tirer de cette positionil devint sombre et chagrin. Que serait-il de moigrand Dieu! si je me brouillais avec le seul être au monde pour qui j'aie un attachement passionné? D'un autre côtéFabrice ne pouvait se résoudre à gâter un bonheur si délicieux par un mot indiscret. Sa position était si remplie de charmes! l'amitié intime d'une femme si aimable et si jolie était si douce! Sous les rapports plus vulgaires de la viesa protection lui faisait une position si agréable à cette courdont les grandes intriguesgrâce à elle qui les lui expliquaitl'amusaient comme une comédie! Mais au premier moment je puis être réveillé par un coup de foudre! se disait-il. Ces soirées si gaiessi tendrespassées presque en tête à tête avec une femme si piquantesi elles conduisent à quelque chose de mieuxelle croira trouver en moi un amant; elle me demandera des transportsde la folieet je n'aurai toujours à lui offrir que l'amitié la plus vivemais sans amour; la nature m'a privé de cette sorte de folie sublime. Que de reproches n'ai-je pas eu à essuyer à cet égard! Je crois encore entendre la duchesse d'A ***et je me moquais de la duchesse! Elle croira que je manque d'amour pour elletandis que c'est l'amour qui manque en moi; jamais elle ne voudra me comprendre. Souvent à la suite d'une anecdote sur la cour contée par elle avec cette grâcecette folie qu'elle seule au monde possèdeet d'ailleurs nécessaire à mon instruction ionje lui baise les mains et quelquefois la joue. Que devenir si cette main presse la mienne d'une certaine façon?
Fabrice paraissait chaque jour dans les maisons les plus considérées et les moins gaies de Parme. Dirigé par les conseils habiles de la duchesseil faisait une cour savante aux deux princes père et filsà la princesse Clara-Paolina et à monseigneur l'archevêque. Il avait des succèsmais qui ne le consolaient point de la peur mortelle de se brouiller avec la duchesse.
Livre Premier
Chapitre VIII.
Ainsi moins d'un mois seulement après son arrivée à la courFabrice avait tous les chagrins d'un courtisanet l'amitié intime qui faisait le bonheur de sa vie était empoisonnée. Un soirtourmenté par ces idéesil sortit de ce salon de la duchesse où il avait trop l'air d'un amant régnant; errant au hasard dans la villeil passa devant le théâtre qu'il vit éclairé; il entra. C'était une imprudence gratuite chez un homme de sa robe et qu'il s'était bien promis d'éviter à Parmequi après tout n'est qu'une petite ville de quarante mille habitants. Il est vrai que dès les premiers jours il s'était affranchi de son costume officiel; le soirquand il n'allait pas dans le très grand mondeil était simplement vêtu de noir comme un homme en deuil.
Au théâtre il prit une loge du troisième rang pour n'être pas vu; l'on donnait la Jeune Hôtessede Goldoni. Il regardait l'architecture de la salle: à peine tournait-il les yeux vers la scène. Mais le public nombreux éclatait de rire à chaque instant; Fabrice jeta les yeux sur la jeune actrice qui faisait le rôle de l'hôtesseil la trouva drôle. Il regarda avec plus d'attentionelle lui sembla tout à fait gentille et surtout remplie de naturel: c'était une jeune fille naïve qui riait la première des jolies choses que Goldoni mettait dans sa boucheet qu'elle avait l'air tout étonnée de prononcer. Il demanda comment elle s'appelaiton lui dit: Marietta Valserra.
Ah! pensa-t-ilelle a pris mon nomc'est singulier; malgré ses projets il ne quitta le théâtre qu'à la fin de la pièce. Le lendemain il revint; trois jours après il savait l'adresse de la Marietta Valserra.
Le soir même du jour où il s'était procuré cette adresse avec assez de peineil remarqua que le comte lui faisait une mine charmante. Le pauvre amant jalouxqui avait toutes les peines du monde à se tenir dans les bornes de la prudenceavait mis des espions à la suite du jeune hommeet son équipée du théâtre lui plaisait. Comment peindre la joie du comte lorsque le lendemain du jour où il avait pu prendre sur lui d'être aimable avec Fabriceil apprit que celui-cià la vérité à demi déguisé par une longue redingote bleueavait monté jusqu'au misérable appartement que la Marietta Valserra occupait au quatrième étage d'une vieille maison derrière le théâtre? Sa joie redoubla lorsqu'il sut que Fabrice s'était présenté sous un faux nomet avait eu l'honneur d'exciter la jalousie d'un mauvais garnement nommé Gilettilequel à la ville jouait les troisièmes rôles de valetet dans les villages dansait sur la corde. Ce noble amant de la Marietta se répandait en injures contre Fabrice et disait qu'il voulait le tuer.
Les troupes d'opéra sont formées par un impresario qui engage de côté et d'autre les sujets qu'il peut payer ou qu'il trouve libreset la troupe amassée au hasard reste ensemble une saison ou deux tout au plus. Il n'en est pas de même des compagnies comiques ; tout en courant de ville en ville et changeant de résidence tous les deux ou trois moiselle n'en forme pas moins comme une famille dont tous les membres s'aiment ou se haïssent. Il y a dans ces compagnies des ménages établis que les beaux des villes où la troupe va jouer trouvent quelquefois beaucoup de difficultés à désunir. C'est précisément ce qui arrivait à notre héros: la petite Marietta l'aimait assezmais elle avait une peur horrible du Giletti qui prétendait être son maître unique et la surveillait de près. Il protestait partout qu'il tuerait le monsignorecar il avait suivi Fabrice et était parvenu à découvrir son nom. Ce Giletti était bien l'être le plus laid et le moins fait pour l'amour: démesurément grandil était horriblement maigrefort marqué de la petite vérole et un peu louche. Du resteplein des grâces de son métieril entrait ordinairement dans les coulisses où ses camarades étaient réunisen faisant la roue sur les pieds et sur les mains ou quelque autre tour gentil. Il triomphait dans les rôles où l'acteur doit paraître la figure blanchie avec de la farine et recevoir ou donner un nombre infini de coups de bâton. Ce digne rival de Fabrice avait 32 francs d'appointements par mois et se trouvait fort riche.
Il sembla au comte Mosca revenir des portes du tombeauquand ses observateurs lui donnèrent la certitude de tous ces détails. L'esprit aimable reparut; il sembla plus gai et de meilleure compagnie que jamais dans le salon de la duchesseet se garda bien de rien lui dire de la petite aventure qui le rendait à la vie. Il prit même des précautions pour qu'elle fût informée de tout ce qui se passait le plus tard possible. Enfin il eut le courage d'écouter la raison qui lui criait en vain depuis un mois que toutes les fois que le mérite d'un amant pâlitcet amant doit voyager.
Une affaire importante l'appela à Bologneet deux fois par jour des courriers du cabinet lui apportaient bien moins les papiers officiels de ses bureaux que des nouvelles des amours de la petite Mariettade la colère du terrible Giletti et des entreprises de Fabrice.
Un des agents du comte demanda plusieurs fois Arlequin squelette et pâtél'un des triomphes de Giletti (il sort du pâté au moment où son rival Brighella l'entame et le bâtonne); ce fut un prétexte pour lui faire passer cent francs. Giletticriblé de dettesse garda bien de parler de cette bonne aubainemais devint d'une fierté étonnante.
La fantaisie de Fabrice se changea en pique d'amour-propre (à son âgeles soucis l'avaient déjà réduit à avoir des fantaisies )! La vanité le conduisait au spectacle; la petite fille jouait fort gaiement et l'amusait; au sortir du théâtre il était amoureux pour une heure. Le comte revint à Parme sur la nouvelle que Fabrice courait des dangers réels; le Gilettiqui avait été dragon dans le beau régiment des dragons Napoléonparlait sérieusement de tuer Fabrice et prenait des mesures pour s'enfuir ensuite en Romagne. Si le lecteur est très jeuneil se scandalisera de notre admiration pour ce beau trait de vertu. Ce ne fut pas cependant un petit effort d'héroïsme de la part du comte que celui de revenir de Bologne; car enfinsouventle matinil avait le teint fatiguéet Fabrice avait tant de fraîcheurtant de sérénité! Qui eût songé à lui faire un sujet de reproche de la mort de Fabricearrivée en son absenceet pour une si sotte cause? Mais il avait une de ces âmes rares qui se font un remords éternel d'une action généreuse qu'elles pouvaient faire et qu'elles n'ont pas faite; d'ailleurs il ne put supporter l'idée de voir la duchesse tristeet par sa faute.
Il la trouvaà son arrivéesilencieuse et morne; voici ce qui s'était passé: la petite femme de chambreChékinatourmentée par les remordset jugeant de l'importance de sa faute par l'énormité de la somme qu'elle avait reçue pour la commettreétait tombée malade. Un soirla duchesse qui l'aimait monta jusqu'à sa chambre. La petite fille ne put résister à cette marque de bontéelle fondit en larmesvoulut remettre à sa maîtresse ce qu'elle possédait encore sur l'argent qu'elle avait reçuet enfin eut le courage de lui avouer les questions faites par le comte et ses réponses. La duchesse courut vers la lampe qu'elle éteignitpuis dit à la petite Chékina qu'elle lui pardonnaitmais à condition qu'elle ne dirait jamais un mot de cette étrange scène à qui que ce fût; le pauvre comteajouta-t-elle d'un air légercraint le ridicule; tous les hommes sont ainsi.
La duchesse se hâta de descendre chez elle. A peine enfermée dans sa chambreelle fondit en larmes; elle trouvait quelque chose d'horrible dans l'idée de faire l'amour avec ce Fabrice qu'elle avait vu naîtreet pourtant que voulait dire sa conduite?
Telle avait été la première cause de la noire mélancolie dans laquelle le comte la trouva plongée; lui arrivéelle eut des accès d'impatience contre luiet presque contre Fabrice; elle eût voulu ne plus les revoir ni l'un ni l'autre; elle était dépitée du rôle ridicule à ses yeux que Fabrice jouait auprès de la petite Marietta; car le comte lui avait tout dit en véritable amoureux incapable de garder un secret. Elle ne pouvait s'accoutumer à ce malheur: son idole avait un défaut; enfin dans un moment de bonne amitié elle demanda conseil au comtece fut pour celui-ci un instant délicieux et une belle récompense du mouvement honnête qui l'avait fait revenir à Parme.
-- Quoi de plus simple! dit le comte en riant; les jeunes gens veulent avoir toutes les femmespuis le lendemainils n'y pensent plus. Ne doit-il pas aller à Belgiratevoir la marquise del Dongo? Eh bien! qu'il parte. Pendant son absence je prierai la troupe comique de porter ailleurs ses talentsje paierai les frais de route; mais bientôt nous le verrons amoureux de la première jolie femme que le hasard conduira sur ses pas: c'est dans l'ordreet je ne voudrais pas le voir autrement... S'il est nécessairefaites écrire par la marquise.
Cette idéedonnée avec l'air d'une complète indifférencefut un trait de lumière pour la duchesseelle avait peur de Giletti. Le soir le comte annonçacomme par hasardqu'il y avait un courrier quiallant à Vienne passait par Milan; trois jours après Fabrice recevait une lettre de sa mère. Il partit fort piqué de n'avoir pu encoregrâce à la jalousie de Gilettiprofiter des excellentes intentions dont la petite Marietta lui faisait porter l'assurance par une mammaciavieille femme qui lui servait de mère.
Fabrice trouva sa mère et une des ses soeurs à Belgirategros village piémontaissur la rive droite du lac Majeur; la rive gauche appartient au Milanaiset par conséquent à l'Autriche. Ce lacparallèle au lac de Cômeet qui court aussi du nord au midiest situé à une vingtaine de lieues plus au couchant. L'air des montagnesl'aspect majestueux et tranquille de ce lac superbe qui lui rappelait celui près duquel il avait passé son enfancetout contribua à changer en douce mélancolie le chagrin de Fabricevoisin de la colère. C'était avec une tendresse infinie que le souvenir de la duchesse se présentait maintenant à lui; il lui semblait que de loin il prenait pour elle cet amour qu'il n'avait jamais éprouvé pour aucune femme; rien ne lui eût été plus pénible que d'en être à jamais séparéet dans ces dispositionssi la duchesse eût daigné avoir recours à la moindre coquetterieelle eût conquis ce coeurpar exempleen lui opposant un rival. Mais bien loin de prendre un parti aussi décisifce n'était pas sans se faire de vifs reproches qu'elle trouvait sa pensée toujours attachée aux pas du jeune voyageur. Elle se reprochait ce qu'elle appelait encore une fantaisiecomme si c'eût été une horreur; elle redoubla d'attentions et de prévenances pour le comte quiséduit par tant de grâcesn'écoutait pas la saine raison qui prescrivait un second voyage à Bologne.
La marquise del Dongopressée par les noces de sa fille aînée qu'elle mariait à un duc milanaisne put donner que trois jours à son fils bien-aimé; jamais elle n'avait trouvé en lui une si tendre amitié. Au milieu de la mélancolie qui s'emparait de plus en plus de l'âme de Fabriceune idée bizarre et même ridicule s'était présentée et tout à coup s'était fait suivre. Oserons-nous dire qu'il voulait consulter l'abbé Blanès? Cet excellent vieillard était parfaitement incapable de comprendre les chagrins d'un coeur tiraillé par des passions puériles et presque égales en force; d'ailleurs il eût fallu huit jours pour lui faire entrevoir seulement tous les intérêts que Fabrice devait ménager à Parme; mais en songeant à le consulter Fabrice retrouvait la fraîcheur de ses sensations de seize ans. Le croira- t-on? ce n'était pas simplement comme homme sagecomme ami parfaitement douéque Fabrice voulait lui parler; l'objet de cette course et les sentiments qui agitèrent notre héros pendant les cinquante heures qu'elle durasont tellement absurdes que sans doutedans l'intérêt du récitil eût mieux valu les supprimer. Je crains que la crédulité de Fabrice ne le prive de la sympathie du lecteur; mais enfinil était ainsipourquoi le flatter lui plutôt qu'un autre? Je n'ai point flatté le comte Mosca ni le prince.
Fabrice doncpuisqu'il faut tout direFabrice reconduisit sa mère jusqu'au portde Lavenorive gauche du lac Majeurrive autrichienneoù elle descendit vers les huit heures du soir. (Le lac est considéré comme un pays neutreet l'on ne demande point de passeport à qui ne descend point à terre.) Mais à peine la nuit fut-elle venue qu'il se fit débarquer sur cette même rive autrichienneau milieu d'un petit bois qui avance dans les flots. Il avait loué une sediolasorte de tilbury champêtre et rapideà l'aide duquel il put suivreà cinq cents pas de distancela voiture de sa mère; il était déguisé en domestique de la casa del Dongoet aucun des nombreux employés de la police ou de la douane n'eut l'idée de lui demander son passeport. A un quart de lieue de Cômeoù la marquise et sa fille devaient s'arrêter pour passer la nuitil prit un sentier à gauchequicontournant le bourg de Vicose réunit ensuite à un petit chemin récemment établi sur l'extrême bord du lac. Il était minuitet Fabrice pouvait espérer de ne rencontrer aucun gendarme. Les arbres des bouquets de bois que le petit chemin traversait à chaque instant dessinaient le noir contour de leur feuillage sur un ciel étoilémais voilé par une brume légère. Les eaux et le ciel étaient d'une tranquillité profonde; l'âme de Fabrice ne put résister à cette beauté sublime; il s'arrêtapuis s'assit sur un rocher qui s'avançait dans le lacformant comme un petit promontoire. Le silence universel n'était troubléà intervalles égauxque par la petite lame du lac qui venait expirer sur la grève. Fabrice avait un coeur italien; j'en demande pardon pour lui: ce défautqui le rendra moins aimableconsistait surtout en ceci: il n'avait de vanité que par accèset l'aspect seul de la beauté sublime le portait à l'attendrissementet ôtait à ses chagrins leur pointe âpre et dure. Assis sur son rocher isolén'ayant plus à se tenir en garde contre les agents de la policeprotégé par la nuit profonde et le vaste silencede douces larmes mouillèrent ses yeuxet il trouva làà peu de fraisles moments les plus heureux qu'il eût goûtés depuis longtemps.
Il résolut de ne jamais dire de mensonges à la duchesseet c'est parce qu'il l'aimait à l'adoration en ce momentqu'il se jura de ne jamais lui dire qu'il l'aimait ; jamais il ne prononcerait auprès d'elle le mot d'amourpuisque la passion que l'on appelle ainsi était étrangère à son coeur. Dans l'enthousiasme de générosité et de vertu qui faisait sa félicité en ce momentil prit la résolution de lui tout dire à la première occasion: son coeur n'avait jamais connu l'amour. Une fois ce parti courageux bien adoptéil se sentit comme délivré d'un poids énorme. Elle me dira peut-être quelques mots sur Marietta: eh bien! je ne reverrai jamais la petite Mariettase répondit-il à lui-même avec gaieté.
La chaleur accablante qui avait régné pendant la journée commençait à être tempérée par la brise du matin. Déjà l'aube dessinait par une faible lueur blanche les pics des Alpes qui s'élèvent au nord et à l'orient du lac de Côme. Leurs massesblanchies par les neigesmême au mois de juinse dessinent sur l'azur clair d'un ciel toujours pur à ces hauteurs immenses. Une branche des Alpes s'avançant au midi vers l'heureuse Italie sépare les versants du lac de Côme de ceux du lac de Garde. Fabrice suivait de l'oeil toutes les branches de ces montagnes sublimesl'aube en s'éclaircissant venait marquer les vallées qui les séparent en éclairant la brume légère qui s'élevait du fond des gorges.
Depuis quelques instants Fabrice s'était remis en marche; il passa la colline qui forme la presqu'île de Duriniet enfin parut à ses yeux ce clocher du village de Griantaoù si souvent il avait fait des observations d'étoiles avec l'abbé Blanès. Quelle n'était pas mon ignorance en ce temps-là! Je ne pouvais comprendrese disait-ilmême le latin ridicule de ces traités d'astrologie que feuilletait mon maîtreet je crois que je les respectais surtout parce quen'y entendant que quelques mots par-ci par-làmon imagination se chargeait de leur prêter un senset le plus romanesque possible.
Peu à peu sa rêverie prit un autre cours. Y aurait-il quelque chose de réel dans cette science? Pourquoi serait-elle différente des autres? Un certain nombre d'imbéciles et de gens adroits conviennent entre eux qu'ils savent le mexicainpar exemple; ils s'imposent en cette qualité à la société qui les respecte et aux gouvernements qui les paient. On les accable de faveurs précisément parce qu'ils n'ont point d'espritet que le pouvoir n'a pas à craindre qu'ils soulèvent les peuples et fassent du pathos à l'aide des sentiments généreux! Par exemple le père Bariauquel Ernest IV vient d'accorder quatre mille francs de pension et la croix de son ordre pour avoir restitué dix-neuf vers d'un dithyrambe grec!
Maisgrand Dieu! ai-je bien le droit de trouver ces choses-là ridicules? Est-ce bien à moi de me plaindre? se dit-il tout à coup en s'arrêtantest-ce que cette même croix ne vient pas d'être donnée à mon gouverneur de Naples? Fabrice éprouva un sentiment de malaise profond; le bel enthousiasme de vertu qui naguère venait de faire battre son coeur se changeait dans le vil plaisir d'avoir une bonne part dans un vol. Eh bien! se dit-il enfin avec les yeux éteints d'un homme mécontent de soipuisque ma naissance me donne le droit de profiter de ces abusil serait d'une insigne duperie à moi de n'en pas prendre ma part; mais il ne faut point m'aviser de les maudire en public. Ces raisonnements ne manquaient pas de justesse; mais Fabrice était bien tombé de cette élévation de bonheur sublime où il s'était trouvé transporté une heure auparavant. La pensée du privilège avait desséché cette plante toujours si délicate qu'on nomme le bonheur.
S'il ne faut pas croire à l'astrologiereprit-il en cherchant à s'étourdirsi cette science estcomme les trois quarts des sciences non mathématiquesune réunion de nigauds enthousiastes et d'hypocrites adroits et payés par qui ils serventd'où vient que je pense si souvent et avec émotion à cette circonstance fatale? Jadis je suis sorti de la prison de B***mais avec l'habit et la feuille de route d'un soldat jeté en prison pour de justes causes.
Le raisonnement de Fabrice ne put jamais pénétrer plus loin; il tournait de cent façonsautour de la difficulté sans parvenir à la surmonter. Il était trop jeune encore; dans ses moments de loisirson âme s'occupait avec ravissement à goûter les sensations produites par des circonstances romanesques que son imagination était toujours prête à lui fournir. Il était bien loin d'employer son temps à regarder avec patience les particularités réelles des choses pour ensuite deviner leurs causes. Le réel lui semblait encore plat et fangeux; je conçois qu'on n'aime pas à le regardermais alors il ne faut pas en raisonner. Il ne faut pas surtout faire des objections avec les diverses pièces de son ignorance.
C'est ainsi quesans manquer d'espritFabrice ne put parvenir à voir que sa demi- croyance dans les présages était pour lui une religionune impression profonde reçue à son entrée dans la vie. Penser à cette croyance c'était sentirc'était un bonheur. Et il s'obstinait à chercher comment ce pouvait être une science prouvéeréelledans le genre de la géométrie par exemple. Il recherchait avec ardeurdans sa mémoiretoutes les circonstances où des présages observés par lui n'avaient pas été suivis de l'événement heureux ou malheureux qu'ils semblaient annoncer. Mais tout en croyant suivre un raisonnement et marcher à la véritéson attention s'arrêtait avec bonheur sur le souvenir des cas où le présage avait été largement suivi par l'accident heureux ou malheureux qu'il lui semblait prédireet son âme était frappée de respect et attendrie; et il eût éprouvé une répugnance invincible pour l'être qui eût nié les présageset surtout s'il eût employé l'ironie.
Fabrice marchait sans s'apercevoir des distanceset il en était là de ses raisonnements impuissantslorsqu'en levant la tête il vit le mur du jardin de son père. Ce murqui soutenait une belle terrasses'élevait à plus de quarante pieds au-dessus du cheminà droite. Un cordon de pierres de taille tout en hautprès de la balustradelui donnait un air monumental. Il n'est pas malse dit froidement Fabricecela est d'une bonne architecturepresque dans le goût romain; il appliquait ses nouvelles connaissances en antiquités. Puis il détourna la tête avec dégoût; les sévérités de son pèreet surtout la dénonciation de son frère Ascagne au retour de son voyage en Francelui revinrent à l'esprit.
Cette dénonciation dénaturée a été l'origine de ma vie actuelle; je puis la haïrje puis la méprisermais enfin elle a changé ma destinée. Que devenais-je une fois relégué à Novare et n'étant presque que souffert chez l'homme d'affaires de mon pèresi ma tante n'avait fait l'amour avec un ministre puissant? si cette tante se fût trouvée n'avoir qu'une âme sèche et commune au lieu de cette âme tendre et passionnée et qui m'aime avec une sorte d'enthousiasme qui m'étonne? où en serais-je maintenant si la duchesse avait eu l'âme de son frère le marquis del Dongo?
Accablé par ces souvenirs cruelsFabrice ne marchait plus que d'un pas incertain; il parvint au bord du fossé précisément vis-à-vis la magnifique façade du château. Ce fut à peine s'il jeta un regard sur ce grand édifice noirci par le temps. Le noble langage de l'architecture le trouva insensible; le souvenir de son frère et de son père fermait son âme à toute sensation de beautéil n'était attentif qu'à se tenir sur ses gardes en présence d'ennemis hypocrites et dangereux. Il regarda un instantmais avec un dégoût marquéla petite fenêtre de la chambre qu'il occupait avant 1815 au troisième étage. Le caractère de son père avait dépouillé de tout charme les souvenirs de la première enfance. Je n'y suis pas rentrépensa-t-ildepuis le 7 mars à 8 heures du soir. J'en sortis pour aller prendre le passeport de Vasiet le lendemainla crainte des espions me fit précipiter mon départ. Quand je repassai après le voyage en Franceje n'eus pas le temps d'y montermême pour revoir mes gravureset cela grâce à la dénonciation de mon frère.
Fabrice détourna la tête avec horreur. L'abbé Blanès a plus de quatre-vingt-trois ansse dit-il tristementil ne vient presque plus au châteauà ce que m'a raconté ma soeur; les infirmités de la vieillesse ont produit leur effet. Ce coeur si ferme et si noble est glacé par l'âge. Dieu sait depuis combien de temps il ne va plus à son clocher! je me cacherai dans le celliersous les cuves ou sous le pressoir jusqu'au moment de son réveil; je n'irai pas troubler le sommeil du bon vieillard; probablement il aura oublié jusqu'à mes traits; six ans font beaucoup à cet âge! je ne trouverai plus que le tombeau d'un ami! Et c'est un véritable enfantillageajouta-t-ild'être venu ici affronter le dégoût que me cause le château de mon père.
Fabrice entrait alors sur la petite place de l'église; ce fut avec un étonnement allant jusqu'au délire qu'il vitau second étage de l'antique clocherla fenêtre étroite et longue éclairée par la petite lanterne de l'abbé Blanès. L'abbé avait coutume de l'y déposeren montant à la cage de planches qui formait son observatoireafin que la clarté ne l'empêchât pas de lire sur son planisphère. Cette carte du ciel était tendue sur un grand vase de terre cuite qui avait appartenu jadis à un oranger du château. Dans l'ouvertureau fond du vasebrûlait la plus exiguÎ des lampesdont un petit tuyau de fer-blanc conduisait la fumée hors du vaseet l'ombre du tuyau marquait le nord sur la carte. Tous ces souvenirs de choses si simples inondèrent d'émotions l'âme de Fabrice et la remplirent de bonheur.
Presque sans y songeril fit avec l'aide de ses deux mains le petit sifflement bas et bref qui autrefois était le signal de son admission. Aussitôt il entendit tirer à plusieurs reprises la corde quidu haut de l'observatoire ouvrait le loquet de la porte du clocher. Il se précipita dans l'escalierému jusqu'au transport; iltrouva l'abbé sur son fauteuil de bois à sa place accoutumée; son oeil était fixé sur la petite lunette d'un quart de cercle mural. De la main gauchel'abbé lui fit signe de ne pas l'interrompre dans son observation; un instant après il écrivit un chiffre sur une carte à jouerpuisse retournant sur son fauteuilil ouvrit les bras à notre héros qui s'y précipita en fondant en larmes. L'abbé Blanès était son véritable père.
-- Je t'attendaisdit Blanèsaprès les premiers mots d'épanchement et de tendresse. L'abbé faisait-il son métier de savant; ou biencomme il pensait souvent à Fabricequelque signe astrologique lui avait-il par un pur hasard annoncé son retour?
-- Voici ma mort qui arrivedit l'abbé Blanès.
-- Comment! s'écria Fabrice tout ému.
-- Ouireprit l'abbé d'un ton sérieuxmais point triste: cinq mois et demi ou six mois et demi après que je t'aurai revuma vie ayant trouvé son complément de bonheurs'éteindra
Come face al mancar dell alimento
(comme la petite lampe quand l'huile vient à manquer). Avant le moment suprêmeje passerai probablement un ou deux mois sans parleraprès quoi je serai reçu dans le sein de notre père; si toutefois il trouve que j'ai rempli mon devoir dans le poste où il m'avait placé en sentinelle.
Toi tu es excédé de fatigueton émotion te dispose au sommeil. Depuis que je t'attendsj'ai caché un pain et une bouteille d'eau-de-vie dans la grande caisse de mes instruments. Donne ces soutiens à ta vie et tâche de prendre assez de forces pour m'écouter encore quelques instants. Il est en mon pouvoir de te dire plusieurs choses avant que la nuit soit tout à fait remplacée par le jour; maintenant je les vois beaucoup plus distinctement que peut-être je ne les verrai demain. Carmon enfantnous sommes toujours faibleset il faut toujours faire entrer cette faiblesse en ligne de compte. Demain peut-être le vieil hommel'homme terrestre sera occupé en moi des préparatifs de ma mortet demain soir à 9 heuresil faut que tu me quittes.
Fabrice lui ayant obéi en silence comme c'était sa coutume:
-- Doncil est vraireprit le vieillardque lorsque tu as essayé de voir Waterlootu n'as trouvé d'abord qu'une prison.
-- Ouimon pèrerépliqua Fabrice étonné.
-- Eh bience fut un rare bonheurcaraverti par ma voixton âme peut se préparer à une autre prison bien autrement durebien plus terrible! Probablement tu n'en sortiras que par un crimemaisgrâce au cielce crime ne sera pas commis par toi. Ne tombe jamais dans le crime avec quelque violence que tu sois tenté; je crois voir qu'il sera question de tuer un innocentquisans le savoirusurpe tes droits; si tu résistes à la violente tentation qui semblera justifiée par les lois de l'honneurta vie sera très heureuse aux yeux des hommes...et raisonnablement heureuse aux yeux du sageajouta-t-ilaprès un instant de réflexion; tu mourras comme moimon filsassis sur un siège de boisloin de tout luxeet détrompé du luxeet comme moi n'ayant à te faire aucun reproche grave.
Maintenantles choses de l'état futur sont terminées entre nousje ne pourrais ajouter rien de bien important. C'est en vain que j'ai cherché à voir de quelle durée sera cette prison; s'agit-il de six moisd'un ande dix ans? Je n'ai rien pu découvrir; apparemment j'ai commis quelque fauteet le ciel a voulu me punir par le chagrin de cette incertitude. J'ai vu seulement qu'après la prisonmais je ne sais si c'est au moment même de la sortieil y aura ce que j'appelle un crimemais par bonheur je crois être sûr qu'il ne sera pas commis par toi. Si tu as la faiblesse de tremper dans ce crimetout le reste de mes calculs n'est qu'une longue erreur. Alors tu ne mourras point avec la paix de l'âmesur un siège de bois et vêtu de blanc. En disant ces motsl'abbé Blanès voulut se lever; ce fut alors que Fabrice s'aperçut des ravages du temps; il mit près d'une minute à se lever et à se retourner vers Fabrice. Celui-ci le laissait faireimmobile et silencieux. L'abbé se jeta dans ses bras à diverses reprises; il le serra avec une extrême tendresse. Après quoi il reprit avec toute sa gaieté d'autrefois: Tâche de t'arranger au milieu de mes instruments pour dormir un peu commodémentprends mes pelisses; tu en trouveras plusieurs de grand prix que la duchesse Sanseverina me fit parvenir il y a quatre ans. Elle me demanda une prédiction sur ton compteque je me gardai bien de lui envoyertout en gardant ses pelisses et son beau quart de cercle. Toute l'annonce de l'avenir est une infraction à la règleet a ce danger qu'elle peut changer l'événementauquel cas toute la science tombe par terre comme un véritable jeu d'enfant; et d'ailleurs il y avait des choses dures à dire à cette duchesse toujours si jolie. A proposne sois point effrayé dans ton sommeil par les cloches qui vont faire un tapage effroyable à côté de ton oreillelorsque l'on va sonner la messe de sept heures; plus tardà l'étage inférieurils vont mettre en branle le gros bourdon qui secoue tous mes instruments. C'est aujourd'hui saint Giovitamartyr et soldat. Tu saisle petit village de Grianta a le même patron que la grande ville de Bresciace quipar parenthèsetrompa d'une façon bien plaisante mon illustre maître Jacques Marini de Ravenne. Plusieurs fois il m'annonça que je ferais une assez belle fortune ecclésiastiqueil croyait que je serais curé de la magnifique église de Saint-Giovitaà Brescia; j'ai été curé d'un petit village de sept cent cinquante feux! Mais tout a été pour le mieux. J'ai vuil n'y a pas dix ans de celaque si j'eusse été curé à Bresciama destinée était d'être mis en prison sur une colline de la Moravieau Spielberg. Demain je t'apporterai toutes sortes de mets délicats volés au grand dîner que je donne à tous les curés des environs qui viennent chanter à ma grand-messe. Je les apporterai en basmais ne cherche point à me voirne descends pour te mettre en possession de ces bonnes choses que lorsque tu m'auras entendu ressortir. Il ne faut pas que tu me revoies de jouret le soleil se couchant demain à sept heures et vingt-sept minutesje ne viendrai t'embrasser que vers les huit heureset il faut que tu partes pendant que les heures se comptent encore par neufc'est-à-dire avant que l'horloge ait sonné dix heures. Prends garde que l'on ne te voie aux fenêtres du clocher: les gendarmes ont ton signalement et ils sont en quelque sorte sous les ordres de ton frère qui est un fameux tyran. Le marquis del Dongo s'affaiblitajouta Blanès d'un air tristeet s'il te revoyaitpeut-être te donnerait-il quelque chose de la main à la main. Mais de tels avantages entachés de fraude ne conviennent point à un homme tel que toidont la force sera un jour dans sa conscience. Le marquis abhorre son fils Ascagneet c'est à ce fils qu'échoiront les cinq ou six millions qu'il possède. C'est justice. Toià sa morttu auras une pension de quatre mille francset cinquante aunes de drap noir pour le deuil de tes gens.
Livre Premier
Chapitre IX.
L'âme de Fabrice était exaltée par les discours du vieillardpar la profonde attention et par l'extrême fatigue. Il eut grand-peine à s'endormiret son sommeil fut agité de songespeut-être présages de l'avenir; le matinà dix heuresil fut réveillé par le tremblement général du clocherun bruit effroyable semblait venir du dehors. Il se leva éperduet se crut à la fin du mondepuis il pensa qu'il était en prison; il lui fallut du temps pour reconnaître le son de la grosse cloche que quarante paysans mettaient en mouvement en l'honneur du grand saint Giovitadix auraient suffi.
Fabrice chercha un endroit convenable pour voir sans être vu; il s'aperçut que de cette grande hauteurson regard plongeait sur les jardinset même sur la cour intérieure du château de son père. Il l'avait oublié. L'idée de ce père arrivant aux bornes de la vie changeait tous ses sentiments. Il distinguait jusqu'aux moineaux qui cherchaient quelques miettes de pain sur le grand balcon de la salle à manger. Ce sont les descendants de ceux qu'autrefois j'avais apprivoisésse dit-il. Ce balconcomme tous les autres balcons du palaisétait chargé d'un grand nombre d'orangers dans des vases de terre plus ou moins grands: cette vue l'attendrit; l'aspect de cette cour intérieureainsi ornée avec ses ombres bien tranchées et marquées par un soleil éclatantétait vraiment grandiose.
L'affaiblissement de son père lui revenait à l'esprit. Mais c'est vraiment singulierse disait-ilmon père n'a que trente-cinq ans de plus que moi; trente-cinq et vingt- trois ne font que cinquante-huit! Ses yeuxfixés sur les fenêtres de la chambre de cet homme sévère et qui ne l'avait jamais aimése remplirent de larmes. Il frémitet un froid soudain courut dans ses veines lorsqu'il crut reconnaître son père traversant une terrasse garnie d'orangersqui se trouvait de plain-pied avec sa chambre; mais ce n'était qu'un valet de chambre. Tout à fait sous le clocherune quantité de jeunes filles vêtues de blanc et divisées en différentes troupes étaient occupées à tracer des dessins avec des fleurs rougesbleues et jaunes sur le sol des rues où devait passer la procession. Mais il y avait un spectacle qui parlait plus vivement à l'âme de Fabrice: du clocherses regards plongeaient sur les deux branches du lac à une distance de plusieurs lieueset cette vue sublime lui fit bientôt oublier toutes les autres; elle réveillait chez lui les sentiments les plus élevés. Tous les souvenirs de son enfance vinrent en foule assiéger sa pensée; et cette journée passée en prison dans un clocher fut peut-être l'une des plus heureuses de sa vie.
Le bonheur le porta à une hauteur de pensées assez étrangère à son caractère; il considérait les événements de la vieluisi jeunecomme si déjà il fût arrivé à sa dernière limite. Il faut en convenirdepuis mon arrivée à Parmese dit-il enfinaprès plusieurs heures de rêveries délicieusesje n'ai point eu de joie tranquille et parfaitecomme celle que je trouvais à Naples en galopant dans les chemins de Vomero ou en courant les rives de Misène. Tous les intérêts si compliqués de cette petite cour méchante m'ont rendu méchant... Je n'ai point du tout de plaisir à haïrje crois même que ce serait un triste bonheur pour moi que celui d'humilier mes ennemis si j'en avais; mais je n'ai point d'ennemi... Halte-là! se dit-il tout à coupj'ai pour ennemi Giletti... Voilà qui est singulierse dit-il; le plaisir que j'éprouverais à voir cet homme si laid aller à tous les diablessurvit au goût fort léger que j'avais pour la petite Marietta... Elle ne vaut pasà beaucoup prèsla duchesse d'A *** que j'étais obligé d'aimer à Naples puisque je lui avais dit que j'étais amoureux d'elle. Grand Dieu! que de fois je me suis ennuyé durant les longs rendez-vous que m'accordait cette belle duchesse; jamais rien de pareil dans la chambre délabrée et servant de cuisine où la petite Marietta m'a reçu deux foiset pendant deux minutes chaque fois.
Ehgrand Dieu! qu'est-ce que ces gens-là mangent? C'est à faire pitié! J'aurais dû faire à elle et à la mammacia une pension de trois beefsteacks payables tous les jours... La petite Mariettaajouta-t-ilme distrayait des pensées méchantes que me donnait le voisinage de cette cour.
J'aurais peut-être bien fait de prendre la vie de cafécomme dit la duchesse; elle semblait pencher de ce côté-làet elle a bien plus de génie que moi. Grâce à ses bienfaitsou bien seulement avec cette pension de quatre mille francs et ce fonds de quarante mille placés à Lyon et que ma mère me destinej'aurais toujours un cheval et quelques écus pour faire des fouilles et former un cabinet. Puisqu'il semble que je ne dois pas connaître l'amource seront toujours là pour moi les grandes sources de félicité; je voudraisavant de mouriraller revoir le champ de bataille de Waterlooet tâcher de reconnaître la prairie où je fus si gaiement enlevé de mon cheval et assis par terre. Ce pèlerinage accomplije reviendrais souvent sur ce lac sublime; rien d'aussi beau ne peut se voir au mondedu moins pour mon coeur. A quoi bon aller si loin chercher le bonheuril est là sous mes yeux!
Ah! se dit Fabricecomme objectionla police me chasse du lac de Cômemais je suis plus jeune que les gens qui dirigent les coups de cette police. Iciajouta-t-il en riantje ne trouverais point de duchesse d'A ***mais je trouverais une de ces petites filles là-bas qui arrangent des fleurs sur le pavé eten véritéje l'aimerais tout autant: l'hypocrisie me glace même en amouret nos grandes dames visent à des effets trop sublimes. Napoléon leur a donné des idées de moeurs et de constance.
Diable! se dit-il tout à coupen retirant la tête de la fenêtre comme s'il eût craint d'être reconnu malgré l'ombre de l'énorme jalousie de bois qui garantissait les cloches de la pluievoici une entrée de gendarmes en grande tenue. En effetdix gendarmesdont quatre sous-officiersparaissaient dans le haut de la grande rue du village. Le maréchal des logis les distribuait de cent pas en cent pasle long du trajet que devait parcourir la procession. Tout le monde me connaît ici; si l'on me voitje ne fais qu'un saut des bords du lac de Côme au Spielbergoù l'on m'attachera à chaque jambe une chaîne pesant cent dix livres: et quelle douleur pour la duchesse!
Fabrice eut besoin de deux ou trois minutes pour se rappeler que d'abord il était placé à plus de quatre-vingts pieds d'élévationque le lieu où il se trouvait était comparativement obscurque les yeux des gens qui pourraient le regarder étaient frappés par un soleil éclatantet qu'enfin ils se promenaient les yeux grands ouverts dans des rues dont toutes les maisons venaient d'être blanchies au lait de chauxen l'honneur de la fête de saint Giovita. Malgré dés raisonnements si clairsl'âme italienne de Fabrice eût été désormais hors d'état de goûter aucun plaisirs'il n'eût interposé entre lui et les gendarmes un lambeau de vieille toile qu'il cloua contre la fenêtre et auquel il fit deux trous pour les yeux.
Les cloches ébranlaient l'air depuis dix minutesla procession sortait de l'égliseles mortaretti se firent entendre. Fabrice tourna la tête et reconnut cette petite esplanade garnie d'un parapet et dominant le lacoù si souventdans sa jeunesseil s'était exposé à voir les mortaretti lui partir entre les jambesce qui faisait que le matin des jours de fête sa mère voulait le voir auprès d'elle.
Il faut savoir que les mortaretti (ou petits mortiers) ne sont autre chose que des canons de fusil que l'on scie de façon à ne leur laisser que quatre pouces de longueur; c'est pour cela que les paysans recueillent avidement les canons de fusil quedepuis 1796la politique de l'Europe a semés à foison dans les plaines de la Lombardie. Une fois réduits à quatre pouces de longueuron charge ces petits canons jusqu'à la gueuleon les place à terre dans une position verticaleet une traînée de poudre va de l'un à l'autre; ils sont rangés sur trois lignes comme un bataillonet au nombre de deux ou trois centsdans quelque emplacement voisin du lieu que doit parcourir la procession. Lorsque le Saint-Sacrement approcheon met le feu à la traînée de poudreet alors commence un feu de file de coups secsle plus inégal du monde et le plus ridicule; les femmes sont ivres de joie. Rien n'est gai comme le bruit de ces mortaretti entendu de loin sur le lacet adouci par le balancement des eaux; ce bruit singulier et qui avait fait si souvent la joie de son enfance chassa les idées un peu trop sérieuses dont notre héros était assiégé; il alla chercher la grande lunette astronomique de l'abbéet reconnut la plupart des hommes et des femmes qui suivaient la procession. Beaucoup de charmantes petites filles que Fabrice avait laissées à l'âge de onze et douze ans étaient maintenant des femmes superbes dans toute la fleur de la plus vigoureuse jeunesse; elles firent renaître le courage de notre héroset pour leur parler il eût fort bien bravé les gendarmes.
La procession passée et rentrée dans l'église par une porte latérale que Fabrice ne pouvait apercevoirla chaleur devint bientôt extrême même au haut du clocher; les habitants rentrèrent chez eux et il se fit un grand silence dans le village. Plusieurs barques se chargèrent de paysans retournant à Belagioà Menagio et autres villages situés sur le lac; Fabrice distinguait le bruit de chaque coup de rame: ce détail si simple le ravissait en extase; sa joie actuelle se composait de tout le malheurde toute la gêne qu'il trouvait dans la vie compliquée des cours. Qu'il eût été heureux en ce moment de faire une lieue sur ce beau lac si tranquille et qui réfléchissait si bien la profondeur des cieux! Il entendit ouvrir la porte d'en bas du clocher: c'était la vieille servante de l'abbé Blanèsqui apportait un grand panier; il eut toutes les peines du monde à s'empêcher de lui parler. Elle a pour moi presque autant d'amitié que son maîtrese disait-ilet d'ailleurs je pars ce soir à neuf heures; est-ce qu'elle ne garderait pas le secret qu'elle m'aurait juréseulement pendant quelques heures? Maisse dit Fabriceje déplairais à mon ami! je pourrais le compromettre avec les gendarmes! et il laissa partir la Ghita sans lui parler. Il fit un excellent dînerpuis s'arrangea pour dormir quelques minutes: il ne se réveilla qu'à huit heures et demie du soirl'abbé Blanès lui secouait le braset il était nuit.
Blanès était extrêmement fatiguéil avait cinquante ans de plus que la veille. Il ne parla plus de choses sérieuses; assis sur son fauteuil de boisembrasse-moidit-il à Fabrice. Il le reprit plusieurs fois dans ses bras. La mortdit-il enfinqui va terminer cette vie si longuen'aura rien d'aussi pénible que cette séparation. J'ai une bourse que je laisserai en dépôt à la Ghitaavec ordre d'y puiser pour ses besoinsmais de te remettre ce qui restera si jamais tu viens le demander. Je la connais; après cette recommandationelle est capablepar économie pour toide ne pas acheter de la viande quatre fois par ansi tu ne lui donnes des ordres bien précis. Tu peux toi-même être réduit à la misèreet l'obole du vieil ami te servira. N'attends rien de ton frère que des procédés atroceset tâche de gagner de l'argent par un travail qui te rende utile à la société. Je prévois des orages étranges; peut- être dans cinquante ans ne voudra-t-on plus d'oisifs. Ta mère et ta tante peuvent te manquertes soeurs devront obéir à leurs maris... Va-t'enva-t'en! fuis! s'écria Blanès avec empressement: il venait d'entendre un petit bruit dans l'horloge qui annonçait que dix heures allaient sonneril ne voulut pas même permettre à Fabrice de l'embrasser une dernière fois.
-- Dépêche! dépêche! lui cria-t-il; tu mettras au moins une minute à descendre l'escalier; prends garde de tomberce serait d'un affreux présage.
Fabrice se précipita dans l'escalieretarrivé sur la placese mit à courir. Il était à peine arrivé devant le château de son pèreque la cloche sonna dix heures; chaque coup retentissait dans sa poitrine et y portait un trouble singulier. Il s'arrêta pour réfléchirou plutôt pour se livrer aux sentiments passionnés que lui inspirait la contemplation de cet édifice majestueux qu'il jugeait si froidement la veille. Au milieu de sa rêveriedes pas d'homme vinrent le réveiller; il regarda et se vit au milieu de quatre gendarmes. Il avait deux excellents pistolets dont il venait de renouveler les amorces en dînantle petit bruit qu'il fit en les armant attira l'attention d'un des gendarmeset fut sur le point de le faire arrêter. Il s'aperçut du danger qu'il courait et pensa à faire feu le premier; c'était son droitcar c'était la seule manière qu'il eût de résister à quatre hommes bien armés. Par bonheur les gendarmesqui circulaient pour faire évacuer les cabaretsne s'étaient point montrés tout à fait insensibles aux politesses qu'ils avaient reçues dans plusieurs de ces lieux aimables; ils ne se décidèrent pas assez rapidement à faire leur devoir. Fabrice prit la fuite en courant à toutes jambes. Les gendarmes firent quelques pas en courant aussi et criant: Arrête! arrête! puis tout rentra dans le silence. A trois cents pas de làFabrice s'arrêta pour reprendre haleine. Le bruit de mes pistolets a failli me faire prendre; c'est bien pour le coup que la duchesse m'eût ditsi jamais il m'eût été donné de revoir ses beaux yeuxque mon âme trouve du plaisir à contempler ce qui arrivera dans dix anset oublie de regarder ce qui se passe actuellement à mes côtés.
Fabrice frémit en pensant au danger qu'il venait d'éviter; il doubla le pasmais bientôt il ne put s'empêcher de courirce qui n'était pas trop prudentcar il se fit remarquer de plusieurs paysans qui regagnaient leur logis. Il ne put prendre sur lui de s'arrêter que dans la montagneà plus d'une lieue de Grianta etmême arrêtéil eut une sueur froide en pensant au Spielberg.
Voilà une belle peur! se dit-il: en entendant le son de ce motil fut presque tenté d'avoir honte. Mais ma tante ne me dit-elle pas que la chose dont j'ai le plus besoin c'est d'apprendre à me pardonner? Je me compare toujours à un modèle parfaitet qui ne peut exister. Eh bien! je me pardonne ma peurcard'un autre côtéj'étais bien disposé à défendre ma libertéet certainement tous les quatre ne seraient pas restés debout pour me conduire en prison. Ce que je fais en ce momentajouta-t-iln'est pas militaire; au lieu de me retirer rapidementaprès avoir rempli mon objetet peut-être donné l'éveil à mes ennemisje m'amuse à une fantaisie plus ridicule peut-être que toutes les prédictions du bon abbé.
En effetau lieu de se retirer par la ligne la plus courteet de gagner les bords du lac Majeuroù sa barque l'attendaitil faisait un énorme détour pour aller voir son arbre. Le lecteur se souvient peut-être de l'amour que Fabrice portait à un marronnier planté par sa mère vingt-trois ans auparavant. Il serait digne de mon frèrese dit-ild'avoir fait couper cet arbre; mais ces êtres-là ne sentent pas les choses délicates; il n'y aura pas songé. Et d'ailleursce ne serait pas d'un mauvais augureajouta-t-il avec fermeté. Deux heures plus tard son regard fut consterné; des méchants ou un orage avaient rompu l'une des principales branches du jeune arbrequi pendait desséchée; Fabrice la coupa avec respectà l'aide de son poignardet tailla bien net la coupureafin que l'eau ne pût pas s'introduire dans le tronc. Ensuitequoique le temps fût bien précieux pour luicar le jour allait paraîtreil passa une bonne heure à bêcher la terre autour de l'arbre chéri. Toutes ces folies accompliesil reprit rapidement la route du lac Majeur. Au totalil n'était point tristel'arbre était d'une belle venueplus vigoureux que jamaiseten cinq ansil avait presque doublé. La branche n'était qu'un accident sans conséquence; une fois coupéeelle ne nuisait plus à l'arbreet même il serait plus élancésa membrure commençant plus haut.
Fabrice n'avait pas fait une lieuequ'une bande éclatante de blancheur dessinait à l'orient les pics du Resegon di Lekmontagne célèbre dans le pays. La route qu'il suivait se couvrait de paysans; maisau lieu d'avoir des idées militairesFabrice se laissait attendrir par les aspects sublimes ou touchants de ces forêts des environs du lac de Côme. Ce sont peut-être les plus belles du monde; je ne veux pas dire celles qui rendent le plus d'écus neufscomme on dirait en Suissemais celles qui parlent le plus à l'âme. Ecouter ce langage dans la position où se trouvait Fabriceen butte aux attentions de MM. les gendarmes lombardo-vénitiens c'était un véritable enfantillage. Je suis à une demi-lieue de la frontièrese dit-il enfinje vais rencontrer des douaniers et des gendarmes faisant leur ronde du matin: cet habit de drap fin va leur être suspectils vont me demander mon passeport; orce passeport porte en toutes lettres un nom promis à la prison; me voici dans l'agréable nécessité de commettre un meurtre. Sicomme de coutumeles gendarmes marchent deux ensembleje ne puis pas attendre bonnement pour faire feu que l'un des deux cherche à me prendre au collet; pour peu qu'en tombant il me retienne un instantme voilà au Spielberg. Fabricesaisi d'horreur surtout de cette nécessité de faire feu le premierpeut-être sur un ancien soldat de son onclele comte Pietraneracourut se cacher dans le tronc creux d'un énorme châtaignier; il renouvelait l'amorce de ses pistoletslorsqu'il entendit un homme qui s'avançait dans le bois en chantant très bien un air délicieux de Mercadantealors à la mode en Lombardie.
Voilà qui est d'un bon augure! se dit Fabrice. Cet air qu'il écoutait religieusement lui ôta la petite pointe de colère qui commençait à se mêler à ses raisonnements. Il regarda attentivement la grande route des deux côtésil n'y vit personne; le chanteur arrivera par quelque chemin de traversese dit-il. Presque au même instantil vit un valet de chambre très proprement vêtu à l'anglaiseet monté sur un cheval de suitequi s'avançait au petit pas en tenant en main un beau cheval de racepeut-être un peu trop maigre.
Ah! si je raisonnais comme Moscase dit Fabricelorsqu'il me répète que les dangers que court un homme sont toujours la mesure de ses droits sur le voisinje casserais la tête d'un coup de pistolet à ce valet de chambreetune fois monté sur le cheval maigreje me moquerais fort de tous les gendarmes du monde. A peine de retour à Parmej'enverrais de l'argent à cet homme ou à sa veuve... mais ce serait une horreur!
Livre Premier
Chapitre X.
Tout en se faisant la moraleFabrice sautait sur la grande route qui de Lombardie va en Suisse: en ce lieuelle est bien à quatre ou cinq pieds en contrebas de la forêt. Si mon homme prend peurse dit Fabriceil part d'un temps de galopet je reste planté là faisant la vraie figure d'un nigaud. En ce momentil se trouvait à dix pas du valet de chambre qui ne chantait plus: il vit dans ses yeux qu'il avait peur; il allait peut-être retourner ses chevaux. Sans être encore décidé à rienFabrice fit un saut et saisit la bride du cheval maigre.
-- Mon amidit-il au valet de chambreje ne suis pas un voleur ordinairecar je vais commencer par vous donner vingt francsmais je suis obligé de vous emprunter votre cheval; je vais être tué si je ne f... pas le camp rapidement. J'ai sur les talons les quatre frères Rivaces grands chasseurs que vous connaissez sans doute; ils viennent de me surprendre dans la chambre de leur soeurj'ai sauté par la fenêtre et me voici. Ils sont sortis dans la forêt avec leurs chiens et leurs fusils. Je m'étais caché dans ce gros châtaignier creuxparce que j'ai vu l'un d'eux traverser la routeleurs chiens vont me dépister! Je vais monter sur votre cheval et galoper jusqu'à une lieue au-delà de Côme; je vais à Milan me jeter aux genoux du vice-roi. Je laisserai votre cheval à la poste avec deux napoléons pour voussi vous consentez de bonne grâce. Si vous faites la moindre résistanceje vous tue avec les pistolets que voici. Siune fois partivous mettez les gendarmes à mes troussesmon cousinle brave comte Alariécuyer de l'empereuraura soin de vous faire casser les os.
Fabrice inventait ce discours à mesure qu'il le prononçait d'un air tout pacifique.
-- Au restedit-il en riantmon nom n'est point un secret; je suis le Marchesino Ascanio del Dongomon château est tout près d'icià Grianta. F...dit-ilen élevant la voixlâchez donc le cheval! Le valet de chambrestupéfaitne soufflait mot. Fabrice passa son pistolet dans la main gauchesaisit la bride que l'autre lâchasauta à cheval et partit au galop. Quand il fut à trois cents pasil s'aperçut qu'il avait oublié de donner les vingt francs promis; il s'arrêta: il n'y avait toujours personne sur la route que le valet de chambre qui le suivait au galop; il lui fit signe avec son mouchoir d'avanceret quand il le vit à cinquante pasil jeta sur la route une poignée de monnaieet repartit. Il vit de loin le valet de chambre ramasser les pièces d'argent. Voilà un homme vraiment raisonnablese dit Fabrice en riantpas un mot inutile. Il fila rapidement vers le midis'arrêta dans une maison écartéeet se remit en route quelques heures plus tard. A deux heures du matin il était sur le bord du lac Majeur; bientôt il aperçut sa barque qui battait l'eauelle vint au signal convenu. Il ne vit point de paysan à qui remettre le cheval; il rendit la liberté au noble animaltrois heures après il était à Belgirate. Làse trouvant en pays amiil prit quelque repos; il était fort joyeuxil avait réussi parfaitement bien. Oserons-nous indiquer les véritables causes de sa joie? Son arbre était d'une venue superbeet son âme avait été rafraîchie par l'attendrissement profond qu'il avait trouvé dans les bras de l'abbé Blanès. Croit-il réellementse disait-ilà toutes les prédictions qu'il m'a faites; ou bien comme mon frère m'a fait la réputation d'un jacobind'un homme sans foi ni loicapable de touta-t-il voulu seulement m'engager à ne pas céder à la tentation de casser la tête à quelque animal qui m'aura joué un mauvais tour? Le surlendemain Fabrice était à Parme où il amusa fort la duchesse et le comteen leur narrant avec la dernière exactitudecomme il faisait toujourstoute l'histoire de son voyage.
A son arrivéeFabrice trouva le portier et tous les domestiques du palais Sanseverina chargés des insignes du plus grand deuil.
-- Quelle perte avons-nous faite? demanda-t-il à la duchesse.
-- Cet excellent homme qu'on appelait mon mari vient de mourir à Baden. Il me laisse ce palais; c'était une chose convenuemais en signe de bonne amitiéil y ajoute un legs de trois cent mille francs qui m'embarrasse fort; je ne veux pas y renoncer en faveur de sa niècela marquise Raversiqui me joue tous les jours des tours pendables. Toi qui es amateuril faudra que tu me trouves quelque bon sculpteur; j'élèverai au duc un tombeau de trois cent mille francs. Le comte se mit à dire des anecdotes sur la Raversi.
-- C'est en vain que j'ai cherché à l'amadouer par des bienfaitsdit la duchesse. Quant aux neveux du ducje les ai tous faits colonels ou généraux. En revancheil ne se passe pas de mois qu'ils ne m'adressent quelque lettre anonyme abominablej'ai été obligée de prendre un secrétaire pour lire les lettres de ce genre.
-- Et ces lettres anonymes sont leurs moindres péchésreprit le comte Mosca; ils tiennent manufacture de dénonciations infâmes. Vingt fois j'aurais pu faire traduire toute cette clique devant les tribunauxet Votre Excellence peut penserajouta-t-il en s'adressant à Fabricesi mes bons juges les eussent condamnés.
-- Eh bien! voilà qui me gâte tout le resterépliqua Fabrice avec une naïveté bien plaisante à la courj'aurais mieux aimé les voir condamnés par des magistrats jugeant en conscience.
-- Vous me ferez plaisirvous qui voyagez pour vous instruirede me donner l'adresse de tels magistratsje leur écrirai avant de me mettre au lit.
-- Si j'étais ministrecette absence de juges honnêtes gens blesserait mon amour- propre.
-- Mais il me semblerépliqua le comteque Votre Excellencequi aime tant les Françaiset qui même jadis leur prêta secours de son bras invincibleoublie en ce moment une de leurs grandes maximes: Il vaut mieux tuer le diable que si le diable vous tue. Je voudrais voir comment vous gouverneriez ces âmes ardenteset qui lisent toute la journée l'histoire de la Révolution de France avec des juges qui renverraient acquittés les gens que j'accuse. Ils arriveraient à ne pas condamner les coquins le plus évidemment coupables et se croiraient des Brutus. Mais je veux vous faire une querelle; votre âme si délicate n'a-t-elle pas quelque remords au sujet de ce beau cheval un peu maigre que vous venez d'abandonner sur les rives du lac Majeur?
-- Je compte biendit Fabrice d'un grand sérieuxfaire remettre ce qu'il faudra au maître du cheval pour le rembourser des frais d'affiches et autresà la suite desquels il se le sera fait rendre par les paysans qui l'auront trouvé; je vais lire assidûment le journal de Milanafin d'y chercher l'annonce d'un cheval perdu; je connais fort bien le signalement de celui-ci.
-- Il est vraiment primitifdit le comte à la duchesse. Et que serait devenue Votre Excellencepoursuivit-il en riantsi lorsqu'elle galopait ventre à terre sur ce cheval empruntéil se fût avisé de faire un faux pas? Vous étiez au Spielbergmon cher petit neveuet tout mon crédit eût à peine pu parvenir à faire diminuer d'une trentaine de livres le poids de la chaîne attachée à chacune de vos jambes. Vous auriez passé en ce lieu de plaisance une dizaine d'années; peut-être vos jambes se fussent-elles enflées et gangrenéesalors on les eût fait couper proprement...
-- Ah! de grâcene poussez pas plus loin un si triste romans'écria la duchesse les larmes aux yeux. Le voici de retour...
-- Et j'en ai plus de joie que vousvous pouvez le croirerépliqua le ministred'un grand sérieux; mais enfin pourquoi ce cruel enfant ne m'a-t-il pas demandé un passeport sous un nom convenablepuisqu'il voulait pénétrer en Lombardie? A la première nouvelle de son arrestation je serais parti pour Milanet les amis que j'ai dans ce pays-là auraient bien voulu fermer les yeux et supposer que leur gendarmerie avait arrêté un sujet du prince de Parme. Le récit de votre course est gracieuxamusantj'en conviens volontiersrépliqua le comte en reprenant un ton moins sinistre; votre sortie du bois sur la grande route me plaît assez; mais entre nouspuisque ce valet de chambre tenait votre vie entre ses mainsvous aviez droit de prendre la sienne. Nous allons faire à Votre Excellence une fortune brillantedu moins voici madame qui me l'ordonneet je ne crois pas que mes plus grands ennemis puissent m'accuser d'avoir jamais désobéi à ses commandements. Quel chagrin mortel pour elle et pour moi si dans cette espèce de course au clocher que vous venez de faire avec ce cheval maigreil eût fait un faux pas. Il eût presque mieux valuajouta le comteque ce cheval vous cassât le cou.
-- Vous êtes bien tragique ce soirmon amidit la duchesse tout émue.
-- C'est que nous sommes environnés d'événements tragiquesrépliqua le comte aussi avec émotion; nous ne sommes pas ici en Franceoù tout finit par des chansons ou par un emprisonnement d'un an ou deuxet j'ai réellement tort de vous parler de toutes ces choses en riant. Ah çà! mon petit neveuje suppose que je trouve jour à vous faire évêquecar bonnement je ne puis pas commencer par l'archevêché de Parmeainsi que le veuttrès raisonnablementMme la Duchesse ici présente; dans cet évêché où vous serez loin de nos sages conseilsdites-nous un peu quelle sera votre politique?
-- Tuer le diable plutôt qu'il ne me tuecomme disent fort bien mes amis les Françaisrépliqua Fabrice avec des yeux ardents; conserver par tous les moyens possiblesy compris le coup de pistoletla position que vous m'aurez faite. J'ai lu dans la généalogie des del Dongo l'histoire de celui de nos ancêtres qui bâtit le château de Grianta. Sur la fin de sa vieson bon ami Galéasduc de Milanl'envoie visiter un château fort sur notre lac; on craignait une nouvelle invasion de la part des Suisses.-- Il faut pourtant que j'écrive un mot de politesse au commandantlui dit le duc de Milan en le congédiant; il écrit et lui remet une lettre de deux lignes; puis il la lui redemande pour la cacheterce sera plus polidit le prince. Vespasien del Dongo partmais en naviguant sur le lacil se souvient d'un vieux conte greccar il était savant; il ouvre la lettre de son bon maître et y trouve l'ordre adressé au commandant du châteaude le mettre à mort aussitôt son arrivée. Le Sforcetrop attentif à la comédie qu'il jouait avec notre aïeulavait laissé un intervalle entre la dernière ligne du billet et sa signature; Vespasien del Dongo y écrit l'ordre de le reconnaître pour gouverneur général de tous les châteaux sur le lacet supprime la tête de la lettre. Arrivé et reconnu dans le fortil jette le commandant dans un puitsdéclare la guerre au Sforceet au bout de quelques années il échange sa forteresse contre ces terres immenses qui ont fait la fortune de toutes les branches de notre familleet qui un jour me vaudront à moi quatre mille livres de rente.
-- Vous parlez comme un académiciens'écria le comte en riant; c'est un beau coup de tête que vous nous racontez làmais ce n'est que tous les dix ans que l'on a l'occasion amusante de faire de ces choses piquantes. Un être à demi stupidemais attentifmais prudent tous les joursgoûte très souvent le plaisir de triompher des hommes à imagination. C'est par une folie d'imagination que Napoléon s'est rendu au prudent John Bullau lieu de chercher à gagner l'Amérique. John Bulldans son comptoira bien ri de sa lettre où il cite Thémistocle. De tous temps les vils Sancho Pança l'emporteront à la longue sur les sublimes don Quichotte. Si vous voulez consentir à ne rien faire d'extraordinaireje ne doute pas que vous ne soyez un évêque très respectési ce n'est très respectable. Toutefoisma remarque subsiste; Votre Excellence s'est conduite avec légèreté dans l'affaire du chevalelle a été à deux doigts d'une prison éternelle.
Ce mot fit tressaillir Fabriceil resta plongé dans un profond étonnement. Etait-ce làse disait-ilcette prison dont je suis menacé? Est-ce le crime que je ne devais pas commettre? Les prédictions de Blanèsdont il se moquait fort en tant que prophétiesprenaient à ses yeux toute l'importance de présages véritables.
-- Eh bien! qu'as-tu donc? lui dit la duchesse étonnée; le comte t'a plongé dans les noires images.
-- Je suis illuminé par une vérité nouvelleet au lieu de me révolter contre ellemon esprit l'adopte. Il est vraij'ai passé bien près d'une prison sans fin! Mais ce valet de chambre était si joli dans son habit à l'anglaise! quel dommage de le tuer!
Le ministre fut enchanté de son petit air sage.
-- Il est fort bien de toutes façonsdit-il en regardant la duchesse. Je vous diraimon amique vous avez fait une conquêteet la plus désirable de toutespeut- être.
Ah! pensa Fabricevoici une plaisanterie sur la petite Marietta. Il se trompait; le comte ajouta:
-- Votre simplicité évangélique a gagné le coeur de notre vénérable archevêquele père Landriani. Un de ces jours nous allons faire de vous un grand vicaireetce qui fait le charme de cette plaisanteriec'est que les trois grands vicaires actuelsgens de méritetravailleurset dont deuxje penseétaient grands vicaires avant votre naissancedemanderontpar une belle lettre adressée à leur archevêqueque vous soyez le premier en rang parmi eux. Ces messieurs se fondent sur vos vertus d'abordet ensuite sur ce que vous êtes petit-neveu du célèbre archevêque Ascagne del Dongo. Quand j'ai appris le respect qu'on avait pour vos vertusj'ai sur-le-champ nommé capitaine le neveu du plus ancien des vicaires généraux; il était lieutenant depuis le siège de Tarragone par le maréchal Suchet.
-- Va-t'en tout de suite en négligécomme tu esfaire une visite de tendresse à ton archevêques'écria la duchesse. Raconte-lui le mariage de ta soeur; quand il saura qu'elle va être duchesseil te trouvera bien plus apostolique. Du restetu ignores tout ce que le comte vient de te confier sur ta future nomination.
Fabrice courut au palais archiépiscopal; il y fut simple et modestec'était un ton qu'il prenait avec trop de facilité; au contraireil avait besoin d'efforts pour jouer le grand seigneur. Tout en écoutant les récits un peu longs de monseigneur Landrianiil se disait: Aurais-je dû tirer un coup de pistolet au valet de chambre qui tenait par la bride le cheval maigre? Sa raison lui disait ouimais son coeur ne pouvait s'accoutumer à l'image sanglante du beau jeune homme tombant de cheval défiguré.
Cette prison où j'allais m'engloutirsi le cheval eût bronchéétait-elle la prison dont je suis menacé par tant de présages?
Cette question était de la dernière importance pour luiet l'archevêque fut content de son air de profonde attention.
Livre Premier
Chapitre XI.
Au sortir de l'archevêchéFabrice courut chez la petite Marietta; il entendit de loin la grosse voix de Giletti qui avait fait venir du vin et se régalait avec le souffleur et les moucheurs de chandelleses amis. La mammaciaqui faisait fonctions de mèrerépondit seule à son signal.
-- Il y a du nouveau depuis tois'écria-t-elle; deux ou trois de nos acteurs sont accusés d'avoir célébré par une orgie la fête du grand Napoléonet notre pauvre troupequ'on appelle jacobinea reçu l'ordre de vider les Etats de Parmeet vive Napoléon! Mais le ministre adit-oncraché au bassinet. Ce qu'il y a de sûrc'est que Giletti a de l'argentje ne sais pas combienmais je lui ai vu une poignée d'écus. Marietta a reçu cinq écus de notre directeur pour frais de voyage jusqu'à Mantoue et Veniseet moi un. Elle est toujours bien amoureuse de toimais Giletti lui fait peur; il y a trois joursà la dernière représentation que nous avons donnéeil voulait absolument la tuer; il lui a lancé deux fameux souffletsetce qui est abominableil lui a déchiré son châle bleu. Si tu voulais lui donner un châle bleutu serais bien bon enfantet nous dirions que nous l'avons gagné à une loterie. Le tambour-maître des carabiniers donne un assaut demaintu en trouveras l'heure affichée à tous les coins de rues. Viens nous voir; s'il est parti pour l'assautde façon à nous faire espérer qu'il restera dehors un peu longtempsje serai à la fenêtre et je te ferai signe de monter. Tâche de nous apporter quelque chose de bien joliet la Marietta t'aime à la passion.
En descendant l'escalier tournant de ce taudis infâmeFabrice était plein de componction: je ne suis point changése disait-il; toutes mes belles résolutions prises au bord de notre lac quand je voyais la vie d'un oeil si philosophique se sont envolées. Mon âme était hors de son assiette ordinairetout cela était un rêve et disparaît devant l'austère réalité. Ce serait le moment d'agirse dit Fabrice en rentrant au palais Sanseverina sur les onze heures du soir. Mais ce fut en vain qu'il chercha dans son coeur le courage de parler avec cette sincérité sublime qui lui semblait si facile la nuit qu'il passa aux rives du lac de Côme. Je vais fâcher la personne que j'aime le mieux au monde; si je parlej'aurai l'air d'un mauvais comédien; je ne vaux réellement quelque chose que dans de certains moments d'exaltation.
-- Le comte est admirable pour moidit-il à la duchesseaprès lui avoir rendu compte de la visite à l'archevêché; j'apprécie d'autant plus sa conduite que je crois m'apercevoir que je ne lui plais que fort médiocrement; ma façon d'agir doit donc être correcte à son égard. Il a ses fouilles de Sanguigna dont il est toujours fouà en juger du moins par son voyage d'avant-hier; il a fait douze lieues au galop pour passer deux heures avec ses ouvriers. Si l'on trouve des fragments de statues dans le temple antique dont il vient de découvrir les fondationsil craint qu'on ne les lui vole; j'ai envie de lui proposer d'aller passer trente-six heures à Sanguigna. Demainvers les cinq heuresje dois revoir l'archevêqueje pourrai partir dans la soirée et profiter de la fraîcheur de la nuit pour faire la route.
La duchesse ne répondit pas d'abord.
-- On dirait que tu cherches des prétextes pour t'éloigner de moilui dit-elle ensuite avec une extrême tendresse; à peine de retour de Belgiratetu trouves une raison pour partir.
Voici une belle occasion de parlerse dit Fabrice. Mais sur le lac j'étais un peu fouje ne me suis pas aperçu dans mon enthousiasme de sincérité que mon compliment finit par une impertinence; il s'agirait de dire: Je t'aime de l'amitié la plus dévouéeetc. etc.mais mon âme n'est pas susceptible d'amour. N'est-ce pas dire: Je vois que vous avez de l'amour pour moi; mais prenez gardeje ne puis vous payer en même monnaie? Si elle a de l'amourla duchesse peut se fâcher d'être devinéeet elle sera révoltée de mon impudence si elle n'a pour moi qu'une amitié toute simple... et ce sont de ces offenses qu'on ne pardonne point.
Pendant qu'il pesait ces idées importantesFabrice sans s'en apercevoirse promenait dans le salond'un air grave et plein de hauteuren homme qui voit le malheur à dix pas de lui.
La duchesse le regardait avec admiration; ce n'était plus l'enfant qu'elle avait vu naîtrece n'était plus le neveu toujours prêt à lui obéir: c'était un homme grave et duquel il serait délicieux de se faire aimer. Elle se leva de l'ottomane où elle était assiseetse jetant dans ses bras avec transport:
-- Tu veux donc me fuir? lui dit-elle.
-- Nonrépondit-il de l'air d'un empereur romainmais je voudrais être sage.
Ce mot était susceptible de diverses interprétations; Fabrice ne se sentit pas le courage d'aller plus loin et de courir le hasard de blesser cette femme adorable. Il était trop jeunetrop susceptible de prendre de l'émotion; son esprit ne lui fournissait aucune tournure aimable pour faire entendre ce qu'il voulait dire. Par un transport naturel et malgré tout raisonnementil prit dans ses bras cette femme charmante et la couvrit de baisers. Au même instanton entendit le bruit de la voiture du comte qui entrait dans la couret presque en même temps lui-même parut dans le salon; il avait l'air tout ému.
-- Vous inspirez des passions bien singulièresdit-il à Fabricequi resta presque confondu du mot.
L'archevêque avait ce soir l'audience que Son Altesse Sérénissime lui accorde tous les jeudis; le prince vient de me raconter que l'archevêqued'un air tout troubléa débuté par un discours appris par coeur et fort savantauquel d'abord le prince ne comprenait rien. Landriani a fini par déclarer qu'il était important pour l'église de Parme que Monsignore Fabrice del Dongo fût nommé son premier vicaire généraletpar la suitedès qu'il aurait vingt-quatre ans accomplisson coadjuteur avec future succession.
Ce mot m'a effrayéje l'avouedit le comte; c'est aller un peu bien viteet je craignais une boutade d'humeur chez le prince. Mais il m'a regardé en riant et m'a dit en français: Ce sont là de vos coupsmonsieur!
-- Je puis faire serment devant Dieu et devant Votre Altesseme suis-je écrié avec toute l'onction possibleque j'ignorais parfaitement le mot de future succession. Alors j'ai dit la véritéce que nous répétions ici même il y a quelques heures; j'ai ajoutéavec entraînementquepar la suiteje me serais regardé comme comblé des faveurs de Son Altessesi elle daignait m'accorder un petit évêché pour commencer. Il faut que le prince m'ait crucar il a jugé à propos de faire le gracieux; il m'a ditavec toute la simplicité possible: Ceci est une affaire officielle entre l'archevêque et moivous n'y entrez pour rien; le bonhomme m'adresse une sorte de rapport fort long et passablement ennuyeuxà la suite duquel il arrive à une proposition officielle; je lui ai répondu très froidement que le sujet était bien jeuneet surtout bien nouveau dans ma cour; que j'aurais presque l'air de payer une lettre de change tirée sur moi par l'Empereuren donnant la perspective d'une si haute dignité au fils d'un des grands officiers de son royaume lombardo- vénitien. L'archevêque a protesté qu'aucune recommandation de ce genre n'avait eu lieu. C'était une bonne sottise à me direà moi ; j'en ai été surpris de la part d'un homme aussi entendu; mais il est toujours désorienté quand il m'adresse la paroleet ce soir il était plus troublé que jamaisce qui m'a donné l'idée qu'il désirait la chose avec passion. Je lui ai dit que je savais mieux que lui qu'il n'y avait point eu de haute recommandation en faveur de del Dongoque personne à ma cour ne lui refusait de la capacitéqu'on ne parlait point trop mal de ses moeursmais que je craignais qu'il ne fût susceptible d'enthousiasmeet que je m'étais promis de ne jamais élever aux places considérables les fous de cette espèce avec lesquels un prince n'est sûr de rien. Alorsa continué Son Altessej'ai dû subir un pathos presque aussi long que le premier: l'archevêque me faisait l'éloge de l'enthousiasme de la maison de Dieu. Maladroitme disais-jetu t'égarestu compromets la nomination qui était presque accordée; il fallait couper court et me remercier avec effusion. Point: il continuait son homélie avec une intrépidité ridiculeje cherchais une réponse qui ne fût point trop défavorable au petit del Dongo; je l'ai trouvéeet assez heureusecomme vous allez en juger: Monseigneurlui ai-je ditPie VII fut un grand pape et un grand saint; parmi tous les souverainslui seul osa dire non au tyran qui voyait l'Europe à ses pieds! eh bien! il était susceptible d'enthousiasmece qui l'a portélorsqu'il était évêque d'Imolaà écrire sa fameuse pastorale du citoyen cardinal Chiaramonti en faveur de la république cisalpine.
Mon pauvre archevêque est resté stupéfaitetpour achever de le stupéfierje lui ai dit d'un air fort sérieux: Adieumonseigneurje prendrai vingt-quatre heures pour réfléchir à votre proposition. Le pauvre homme a ajouté quelques supplications assez mal tournées et assez inopportunes après le mot adieu prononcé par moi. Maintenantcomte Mosca della Rovèreje vous charge de dire à la duchesse que je ne veux pas retarder de vingt-quatre heures une chose qui peut lui être agréable; asseyez-vous là et écrivez à l'archevêque le billet d'approbation qui termine toute cette affaire. J'ai écrit le billetil l'a signéil m'a dit: Portez-le à l'instant même à la duchesse. Voici le billetmadameet c'est ce qui m'a donné un prétexte pour avoir le bonheur de vous revoir ce soir.
La duchesse lut le billet avec ravissement. Pendant le long récit du comteFabrice avait eu le temps de se remettre: il n'eut point l'air étonné de cet incidentil prit la chose en véritable grand seigneur qui naturellement a toujours cru qu'il avait droit à ces avancements extraordinairesà ces coups de fortune qui mettraient un bourgeois hors des gonds; il parla de sa reconnaissancemais en bons termeset finit par dire au comte:
-- Un bon courtisan doit flatter la passion dominante; hier vous témoigniez la crainte que vos ouvriers de Sanguigna ne volent les fragments de statues antiques qu'ils pourraient découvrir; j'aime beaucoup les fouillesmoi; si vous voulez bien le permettrej'irai voir les ouvriers. Demain soiraprès les remerciements convenables au palais et chez l'archevêqueje partirai pour Sanguigna.
-- Mais devinez-vousdit la duchesse au comted'où vient cette passion subite du bon archevêque pour Fabrice?
-- Je n'ai pas besoin de deviner; le grand vicaire dont le frère est capitaine me disait hier: Le père Landriani part de ce principe certainque le titulaire est supérieur au coadjuteuret il ne se sent pas de joie d'avoir sous ses ordres un del Dongo et de l'avoir obligé. Tout ce qui met en lumière la haute naissance de Fabrice ajoute à son bonheur intime: il a un tel homme pour aide de camp! En second lieu monseigneur Fabrice lui a pluil ne se sent point timide devant lui; enfin il nourrit depuis dix ans une haine bien conditionnée pour l'évêque de Plaisancequi affiche hautement la prétention de lui succéder sur le siège de Parmeet qui de plus est fils d'un meunier. C'est dans ce but de succession future que l'évêque de Plaisance a pris des relations fort étroites avec la marquise Raversiet maintenant ces liaisons font trembler l'archevêque pour le succès de son dessein favoriavoir un del Dongo à son état-majoret lui donner des ordres.
Le surlendemainde bonne heureFabrice dirigeait les travaux de la fouille de Sanguignavis-à-vis Colorno (c'est le Versailles des princes de Parme); ces fouilles s'étendaient dans la plaine tout près de la grande route qui conduit de Parme au pont de Casal-Maggiorepremière ville de l'Autriche. Les ouvriers coupaient la plaine par une longue tranchée profonde de huit pieds et aussi étroite que possible; on était occupé à rechercherle long de l'ancienne voie romaineles ruines d'un second temple quidisait-on dans le paysexistait encore au Moyen Age. Malgré les ordres du princeplusieurs paysans ne voyaient pas sans jalousie ces longs fossés traversant leurs propriétés. Quoi qu'on pût leur direils s'imaginaient qu'on était à la recherche d'un trésoret la présence de Fabrice était surtout convenable pour empêcher quelque petite émeute. Il ne s'ennuyait pointil suivait ces travaux avec passion; de temps à autre on trouvait quelque médailleet il ne voulait pas laisser le temps aux ouvriers de s'accorder entre eux pour l'escamoter.
La journée était belleil pouvait être six heures du matin: il avait emprunté un vieux fusil à un coupil tira quelques alouettes; l'une d'elles blessée alla tomber sur la grande route; Fabriceen la poursuivantaperçut de loin une voiture qui venait de Parme et se dirigeait vers la frontière de Casal-Maggiore. Il venait de recharger son fusil lorsque la voiture fort délabrée s'approchant au tout petit pasil reconnut la petite Marietta; elle avait à ses côtés le grand escogriffe Gilettiet cette femme âgée qu'elle faisait passer pour sa mère.
Giletti s'imagina que Fabrice s'était placé ainsi au milieu de la routeet un fusil à la mainpour l'insulter et peut-être même pour lui enlever la petite Marietta. En homme de coeur il sauta à bas de la voiture; il avait dans la main gauche un grand pistolet fort rouilléet tenait de la droite une épée encore dans son fourreaudont il se servait lorsque les besoins de la troupe forçaient de lui confier quelque rôle de marquis.
-- Ah! brigand! s'écria-t-ilje suis bien aise de te trouver ici à une lieue de la frontière; je vais te faire ton affaire; tu n'es plus protégé ici par tes bas violets.
Fabrice faisait des mines à la petite Marietta et ne s'occupait guère des cris jaloux du Gilettilorsque tout à coup il vit à trois pieds de sa poitrine le bout du pistolet rouillé; il n'eut que le temps de donner un coup sur ce pistoleten se servant de son fusil comme d'un bâton: le pistolet partitmais ne blessa personne.
-- Arrêtez doncf...cria Giletti au vetturino : en même temps il eut l'adresse de sauter sur le bout du fusil de son adversaire et de le tenir éloigné de la direction de son corps; Fabrice et lui tiraient le fusil chacun de toutes ses forces. Gilettibeaucoup plus vigoureuxplaçant une main devant l'autreavançait toujours vers la batterieet était sur le point de s'emparer du fusillorsque Fabricepour l'empêcher d'en faire usagefit partir le coup. Il avait bien observé auparavant que l'extrémité du fusil était à plus de trois pouces au-dessus de l'épaule de Giletti: la détonation eut lieu tout près de l'oreille de ce dernier. Il resta un peu étonnémais se remit en un clin d'oeil.
-- Ah! tu veux me faire sauter le crânecanaille! je vais te faire ton compte. Giletti jeta le fourreau de son épée de marquiset fondit sur Fabrice avec une rapidité admirable. Celui-ci n'avait point d'arme et se vit perdu.
Il se sauva vers la voiturequi était arrêtée à une dizaine de pas derrière Giletti; il passa à gaucheet saisissant de la main le ressort de la voitureil tourna rapidement tout autour et repassa tout près de la portière droite qui était ouverte. Gilettilancé avec ses grandes jambes et qui n'avait pas eu l'idée de se retenir au ressort de la voiture fit plusieurs pas dans sa première direction avant de pouvoir s'arrêter. Au moment où Fabrice passait auprès de la portière ouverteil entendit Marietta qui lui disait à demi-voix:
-- Prends garde à toi; il te tuera. Tiens!
Au même instantFabrice vit tomber de la portière une sorte de grand couteau de chasse; il se baissa pour le ramassermaisau même instant il fut touché à l'épaule par un coup d'épée que lui lançait Giletti. Fabriceen se relevantse trouva à six pouces de Giletti qui lui donna dans la figure un coup furieux avec le pommeau de son épée; ce coup était lancé avec une telle force qu'il ébranla tout à fait la raison de Fabrice; en ce moment il fut sur le point d'être tué. Heureusement pour luiGiletti était encore trop près pour pouvoir lui donner un coup de pointe. Fabricequand il revint à soiprit la fuite en courant de toutes ses forces; en courantil jeta le fourreau du couteau de chasse et ensuitese retournant vivementil se trouva à trois pas de Giletti qui le poursuivait. Giletti était lancéFabrice lui porta un coup de pointe; Giletti avec son épée eut le temps de relever un peu le couteau de chassemais il reçut le coup de pointe en plein dans la joue gauche. Il passa tout près de Fabrice qui se sentit percer la cuissec'était le couteau de Giletti que celui-ci avait eu le temps d'ouvrir. Fabrice fit un saut à droite; il se retournaet enfin les deux adversaires se trouvèrent à une juste distance de combat.
Giletti jurait comme un damné. Ah! je vais te couper la gorgegredin de prêtrerépétait-il à chaque instant. Fabrice était tout essoufflé et ne pouvait parler; le coup de pommeau d'épée dans la figure le faisait beaucoup souffriret son nez saignait abondamment; il para plusieurs coups avec son couteau de chasse et porta plusieurs bottes sans trop savoir ce qu'il faisait; il lui semblait vaguement être à un assaut public. Cette idée lui avait été suggérée par la présence de ses ouvriers quiau nombre de vingt-cinq ou trenteformaient cercle autour des combattantsmais à distance fort respectueuse; car on voyait ceux-ci courir à tout moment et s'élancer l'un sur l'autre.
Le combat semblait se ralentir un peu; les coups ne se suivaient plus avec la même rapiditélorsque Fabrice se dit: à la douleur que je ressens au visageil faut qu'il m'ait défiguré. Saisi de rage à cette idéeil sauta sur son ennemi la pointe du couteau de chasse en avant. Cette pointe entra dans le côté droit de la poitrine de Giletti et sortit vers l'épaule gauche; au même instant l'épée de Giletti pénétrait de toute sa longueur dans le haut du bras de Fabricemais l'épée glissa sous la peauet ce fut une blessure insignifiante.
Giletti était tombé; au moment où Fabrice s'avançait vers luiregardant sa main gauche qui tenait un couteaucette main s'ouvrait machinalement et laissait échapper son arme.
Le gredin est mortse dit Fabrice; il le regarda au visageGiletti rendait beaucoup de sang par la bouche. Fabrice courut à la voiture.
-- Avez-vous un miroir? cria-t-il à Marietta. Marietta le regardait très pâle et ne répondait pas. La vieille femme ouvrit d'un grand sang-froid un sac à ouvrage vertet présenta à Fabrice un petit miroir à manche grand comme la main. Fabriceen se regardantse maniait la figure: Les yeux sont sainsse disait-ilc'est déjà beaucoup; il regarda les dentselles n'étaient point cassées. D'où vient donc que je souffre tant? se disait-il à demi-voix.
La vieille femme lui répondit:
-- C'est que le haut de votre joue a été pilé entre le pommeau de l'épée de Giletti et l'os que nous avons là. Votre joue est horriblement enflée et bleue: mettez-y des sangsues à l'instantet ce ne sera rien.
-- Ah! des sangsues à l'instantdit Fabrice en riant et il reprit tout son sang-froid. Il vit que les ouvriers entouraient Giletti et le regardaient sans oser le toucher.
-- Secourez donc cet hommeleur cria-t-il; ôtez-lui son habit... Il allait continuermaisen levant les yeuxil vit cinq ou six hommes à trois cents pas sur la grande route qui s'avançaient à pied et d'un pas mesuré vers le lieu de la scène.
Ce sont des gendarmespensa-t-ilet comme il y a un homme de tuéils vont m'arrêteret j'aurai l'honneur de faire une entrée solennelle dans la ville de Parme. Quelle anecdote pour les courtisans amis de la Raversi et qui détestent ma tante!
Aussitôtet avec la rapidité de l'éclairil jette aux ouvriers ébahis tout l'argent qu'il avait dans ses pochesil s'élance dans la voiture.
-- Empêchez les gendarmes de me poursuivrecrie-t-il à ses ouvrierset je fais votre fortune; dites-leur que je suis innocentque cet homme m'a attaqué et voulait me tuer.
-- Et toidit-il au vetturinomets tes chevaux au galoptu auras quatre napoléons d'or si tu passes le Pô avant que ces gens là-bas puissent m'atteindre.
-- Ca va! dit le vetturino; mais n'ayez donc pas peurces hommes là-bas sont à piedet le trot seul de mes petits chevaux suffit pour les laisser fameusement derrière. Disant ces paroles il les mit au galop.
Notre héros fut choqué de ce mot peur employé par le cocher: c'est que réellement il avait eu une peur extrême après le coup de pommeau d'épée qu'il avait reçu dans la figure.
-- Nous pouvons contre-passer des gens à cheval venant vers nousdit le vetturino prudent et qui songeait aux quatre napoléonset les hommes qui nous suivent peuvent crier qu'on nous arrête. Ceci voulait dire: Rechargez vos armes...
-- Ah! que tu es bravemon petit abbé! s'écriait la Marietta en embrassant Fabrice. La vieille femme regardait hors de la voiture par la portière: au bout d'un peu de temps elle rentra la tête.
-- Personne ne vous poursuitmonsieurdit-elle à Fabrice d'un grand sang-froid; et il n'y a personne sur la route devant vous. Vous savez combien les employés de la police autrichienne sont formalistes: s'ils vous voient arriver ainsi au galopsur la digue au bord du Pôils vous arrêterontn'en ayez aucun doute.
Fabrice regarda par la portière.
-- Au trotdit-il au cocher. Quel passeport avez-vous? dit-il à la vieille femme.
-- Trois au lieu d'unrépondit-elleet qui nous ont coûté chacun quatre francs: n'est-ce pas une horreur pour de pauvres artistes dramatiques qui voyagent toute l'année! Voici le passeport de M. Gilettiartiste dramatiquece sera vous; voici nos deux passeports à la Mariettina et à moi. Mais Giletti avait tout notre argent dans sa pochequ'allons-nous devenir?
-- Combien avait-il? dit Fabrice.
-- Quarante beaux écus de cinq francsdit la vielle femme.
-- C'est-à-dire six de la petite monnaiedit la Marietta en riant; je ne veux pas que l'on trompe mon petit abbé.
-- N'est-il pas tout naturelmonsieurreprit la vieille femme d'un grand sang-froidque je cherche à vous accrocher trente-quatre écus? Qu'est-ce que trente-quatre écus pour vous? Et nousnous avons perdu notre protecteur; qui est-ce qui se chargera de nous logerde débattre les prix avec les vetturini quand nous voyageonset de faire peur à tout le monde? Giletti n'était pas beaumais il était bien commodeet si la petite que voilà n'était pas une sottequi d'abord s'est amourachée de vousjamais Giletti ne se fût aperçu de rienet vous nous auriez donné de beaux écus. Je vous assure que nous sommes bien pauvres.
Fabrice fut touché; il tira sa bourse et donna quelques napoléons à la vieille femme.
-- Vous voyezlui dit-ilqu'il ne m'en reste que quinzeainsi il est inutile dorénavant de me tirer aux jambes.
La petite Marietta lui sauta au couet la vieille lui baisait les mains. La voiture avançait toujours au petit trot. Quand on vit de loin les barrières jaunes rayées de noir qui annoncent les possessions autrichiennesla vieille femme dit à Fabrice:
-- Vous feriez mieux d'entrer à pied avec le passeport de Giletti dans votre poche; nousnous allons nous arrêter un instantsous prétexte de faire un peu de toilette. Et d'ailleursla douane visitera nos effets. Voussi vous m'en croyeztraversez Casal-Maggiore d'un pas nonchalant; entrez même au café et buvez le verre d'eau-de-vie; une fois hors du villagefilez ferme. La police est vigilante en diable en pays autrichien: elle saura bientôt qu'il y a eu un homme de tué: vous voyagez avec un passeport qui n'est pas le vôtreil n'en faut pas tant pour passer deux ans en prison. Gagnez le Pô à droite en sortant de la villelouez une barque et réfugiez-vous à Ravenne ou à Ferrare; sortez au plus vite des états autrichiens. Avec deux louis vous pourrez acheter un autre passeport de quelque douaniercelui-ci vous serait fatal; rappelez-vous que vous avez tué l'homme.
En approchant à pied du pont de bateaux de Casal-MaggioreFabrice relisait attentivement le passeport de Giletti. Notre héros avait grand'peuril se rappelait vivement tout ce que le comte Mosca lui avait dit du danger qu'il y avait pour lui à rentrer dans les états autrichiens; oril voyait à deux cents pas devant lui le pont terrible qui allait lui donner accès en ce paysdont la capitale à ses yeux était le Spielberg. Mais comment faire autrement? Le duché de Modène qui borne au midi l'état de Parme lui rendait les fugitifs en vertu d'une convention expresse; la frontière de l'état qui s'étend dans les montagnes du côté de Gênes était trop éloignée; sa mésaventure serait connue à Parme bien avant qu'il pût atteindre ces montagnes; il ne restait donc que les états de l'Autriche sur la rive gauche du Pô. Avant qu'on eût le temps d'écrire aux autorités autrichiennes pour les engager à l'arrêteril se passerait peut-être trente-six heures ou deux jours. Toutes réflexions faitesFabrice brûla avec le feu de son cigare son propre passeport; il valait mieux pour lui en pays autrichien être un vagabond que d'être Fabrice del Dongoet il était possible qu'on le fouillât.
Indépendamment de la répugnance bien naturelle qu'il avait à confier sa vie au passeport du malheureux Gilettice document présentait des difficultés matérielles: la taille de Fabrice atteignait tout au plus à cinq pieds cinq pouceset non pas à cinq pieds dix pouces comme l'énonçait le passeport; il avait près de vingt-quatre ans et paraissait plus jeuneGiletti en avait trente-neuf. Nous avouerons que notre héros se promena une grande demi-heure sur une contre- digue du Pô voisine du pont de barquesavant de se décider à y descendre. Que conseillerais-je à un autre qui se trouverait à ma place? se dit-il enfin. Evidemment de passer: il y a péril à rester dans l'état de Parme; un gendarme peut être envoyé à la poursuite de l'homme qui en a tué un autrefût-ce même à son corps défendant. Fabrice fit la revue de ses pochesdéchira tous les papiers et ne garda exactement que son mouchoir et sa boîte à cigares; il lui importait d'abréger l'examen qu'il allait subir. Il pensa à une terrible objection qu'on pourrait lui faire et à laquelle il ne trouvait que de mauvaises réponses: il allait dire qu'il s'appelait Giletti et tout son linge était marqué F.D.
Comme on voitFabrice était un de ces malheureux tourmentés par leur imagination; c'est assez le défaut des gens d'esprit en Italie. Un soldat français d'un courage égal ou même inférieur se serait présenté pour passer sur le pont tout de suiteet sans songer d'avance à aucune difficulté; mais aussi il y aurait porté tout son sang-froidet Fabrice était bien loin d'être de sang-froidlorsque au bout du pont un petit hommevêtu de grislui dit: Entrez au bureau de police pour votre passeport.
Ce bureau avait des murs sales garnis de clous auxquels les pipes et les chapeaux sales des employés étaient suspendus. Le grand bureau de sapin derrière lequel ils étaient retranchés était tout taché d'encre et de vin; deux ou trois gros registres reliés en peau verte portaient des taches de toutes couleurset la tranche de leurs pages était noircie par les mains. Sur les registres placés en pile l'un sur l'autre il y avait trois magnifiques couronnes de laurier qui avaient servi l'avant-veille pour une des fêtes de l'Empereur.
Fabrice fut frappé de tous ces détailsils lui serrèrent le coeur; il paya ainsi le luxe magnifique et plein de fraîcheur qui éclatait dans son joli appartement du palais Sanseverina. Il était obligé d'entrer dans ce sale bureau et d'y paraître comme inférieur; il allait subir un interrogatoire.
L'employé qui tendit une main jaune pour prendre son passeport était petit et noiril portait un bijou de laiton à sa cravate. Ceci est un bourgeois de mauvaise humeurse dit Fabrice; le personnage parut excessivement surpris en lisant le passeportet cette lecture dura bien cinq minutes.
-- Vous avez eu un accidentdit-il à l'étranger en indiquant sa joue du regard.
-- Le vetturino nous a jetés en bas de la digue du Pô. Puis le silence recommença et l'employé lançait des regards farouches sur le voyageur.
J'y suisse dit Fabriceil va me dire qu'il est fâché d'avoir une mauvaise nouvelle à m'apprendre et que je suis arrêté. Toutes sortes d'idées folles arrivèrent à la tête de notre hérosqui dans ce moment n'était pas fort logique. Par exempleil songea à s'enfuir par la porte du bureau qui était restée ouverte; je me défais de mon habit; je me jette dans le Pôet sans doute je pourrai le traverser à la nage. Tout vaut mieux que le Spielberg. L'employé de police le regardait fixement au moment où il calculait les chances de succès de cette équipéecela faisait deux bonnes physionomies. La présence du danger donne du génie à l'homme raisonnableelle le metpour ainsi direau-dessus de lui-même; à l'homme d'imagination elle inspire des romanshardis il est vrai mais souvent absurdes.
Il fallait voir l'oeil indigné de notre héros sous l'oeil scrutateur de ce commis de police orné de ses bijoux de cuivre. Si je le tuaisse disait Fabriceje serai condamné pour meurtre à vingt ans de galère ou à la mortce qui est bien moins affreux que le Spielberg avec une chaîne de cent vingt livres à chaque pied et huit onces de pain pour toute nourritureet cela dure vingt ans; ainsi je n'en sortirais qu'à quarante-quatre ans. La logique de Fabrice oubliait quepuisqu'il avait brûlé son passeportrien n'indiquait à l'employé de police qu'il fût le rebelle Fabrice del Dongo.
Notre héros était suffisamment effrayécomme on le voitil l'eût été bien davantage s'il eût connu les pensées qui agitaient le commis de police. Cet homme était ami de Giletti; on peut juger de sa surprise lorsqu'il vit son passeport entre les mains d'un autre; son premier mouvement fut de faire arrêter cet autrepuis il songea que Giletti pouvait bien avoir vendu son passeport à ce beau jeune homme qui apparemment venait de faire quelque mauvais coup à Parme. Si je l'arrêtese dit-ilGiletti sera compromis; on découvrira facilement qu'il a vendu son passeport; d'un autre côtéque diront mes chefs si l'on vient à vérifier que moiami de Gilettij'ai visé son passeport porté par un autre? L'employé se leva en bâillant et dit à Fabrice: -- Attendezmonsieur; puispar une habitude de policeil ajouta: il s'élève une difficulté. Fabrice dit à part soi: Il va s'élever ma fuite.
En effetl'employé quittait le bureau dont il laissait la porte ouverteet le passeport était resté sur la table de sapin. Le danger est évidentpensa Fabrice; je vais prendre mon passeport et repasser le pont au petit pasje dirai au gendarmes'il m'interrogeque j'ai oublié de faire viser mon passeport par le commissaire de police du dernier village des états de Parme. Fabrice avait déjà son passeport à la mainlorsqueà son inexprimable étonnementil entendit le commis aux bijoux de cuivre qui disait:
-- Ma foi je n'en puis plus; la chaleur m'étouffe; je vais au café prendre la demi- tasse. Entrez au bureau quand vous aurez fini votre pipeil y a un passeport à viser; l'étranger est là.
Fabricequi sortait à pas de loupse trouva face à face avec un beau jeune homme qui se disait en chantonnant: Eh bienvisons donc ce passeportje vais leur faire mon paraphe.
-- Où monsieur veut-il aller?
-- A MantoueVenise et Ferrare.
-- Ferrare soitrépondit l'employé en sifflant; il prit une griffeimprima le visa en encre bleue sur le passeportécrivit rapidement les mots: MantoueVenise et Ferrare dans l'espace laissé en blanc par la griffepuis il fit plusieurs tours en l'air avec la mainsigna et reprit de l'encre pour son paraphe qu'il exécuta avec lenteur et en se donnant des soins infinis. Fabrice suivait tous les mouvements de cette plume; le commis regarda son paraphe avec complaisanceil y ajouta cinq ou six pointsenfin il remit le passeport à Fabrice en disant d'un air léger: bon voyagemonsieur.
Fabrice s'éloignait d'un pas dont il cherchait à dissimuler la rapiditélorsqu'il se sentit arrêter par le bras gauche: instinctivement il mit la main sur le manche de son poignardet s'il ne se fût vu entouré de maisonsil fût peut-être tombé dans une étourderie. L'homme qui lui touchait le bras gauchelui voyant l'air tout effarélui dit en forme d'excuse:
-- Mais j'ai appelé monsieur trois foissans qu'il répondît; monsieur a-t-il quelque chose à déclarer à la douane?
-- Je n'ai sur moi que mon mouchoir; je vais ici tout près chasser chez un de mes parents.
Il eût été bien embarrassé si on l'eût prié de nommer ce parent. Par la grande chaleur qu'il faisait et avec ces émotions Fabrice était mouillé comme s'il fût tombé dans le Pô. Je ne manque pas de courage entre les comédiensmais les commis ornés de bijoux de cuivre me mettent hors de moi; avec cette idée je ferai un sonnet comique pour la duchesse.
A peine entré dans Casal-MaggioreFabrice prit à droite une mauvaise rue qui descend vers le Pô. J'ai grand besoinse dit-ildes secours de Bacchus et de Céréset il entra dans une boutique au dehors de laquelle pendait un torchon gris attaché à un bâton; sur le torchon était écrit le mot Trattoria. Un mauvais drap de lit soutenu par deux cerceaux de bois fort minceset pendant jusqu'à trois pieds de terremettait la porte de la Trattoria à l'abri des rayons directs du soleil. Làune femme à demi nue et fort jolie reçut notre héros avec respectce qui lui fit le plus vif plaisir; il se hâta de lui dire qu'il mourait de faim. Pendant que la femme préparait le déjeunerentra un homme d'une trentaine d'annéesil n'avait pas salué en entrant; tout à coup il se releva du banc où il s'était jeté d'un air familieret dit à Fabrice: Eccellenzala riverisco (je salue Votre Excellence). Fabrice était très gai en ce momentet au lieu de former des projets sinistresil répondit en riant:
-- Et d'où diable connais-tu mon Excellence?
-- Comment! Votre Excellence ne reconnaît pas Ludovicl'un des cochers de Mme la duchesse Sanseverina? A Saccala maison de campagne où nous allions tous les ansje prenais toujours la fièvre; j'ai demandé la pension à madame et me suis retiré. Me voici riche; au lieu de la pension de douze écus par an à laquelle tout au plus je pouvais avoir droitmadame m'a dit que pour me donner le loisir de faire des sonnetscar je suis poète en langue vulgaireelle m'accordait vingt-quatre écuset M. le comte m'a dit que si jamais j'étais malheureuxje n'avais qu'à venir lui parler. J'ai eu l'honneur de mener Monsignore pendant un relais lorsqu'il est allé faire sa retraite comme un bon chrétien à la chartreuse de Velleja.
Fabrice regarda cet homme et le reconnut un peu. C'était un des cochers les plus coquets de la casa Sanseverina: maintenant qu'il était richedisait-ilil avait pour tout vêtement une grosse chemise déchirée et une culotte de toilejadis teinte en noirqui lui arrivait à peine aux genoux; une paire de souliers et un mauvais chapeau complétaient l'équipage. De plusil ne s'était pas fait la barbe depuis quinze jours. En mangeant son omeletteFabrice fit la conversation avec lui absolument comme d'égal à égal; il crut voir que Ludovic était l'amant de l'hôtesse. Il termina rapidement son déjeunerpuis dit à demi-voix à Ludovic: J'ai un mot pour vous.
-- Votre Excellence peut parler librement devant ellec'est une femme réellement bonnedit Ludovic d'un air tendre.
-- Eh bienmes amisreprit Fabrice sans hésiterje suis malheureux et j'ai besoin de votre secours. D'abord il n'y a rien de politique dans mon affaire; j'ai tout simplement tué un homme qui voulait m'assassiner parce que je parlais à sa maîtresse.
-- Pauvre jeune homme! dit l'hôtesse.
-- Que Votre Excellence compte sur moi! s'écria le cocher avec des yeux enflammés par le dévouement le plus vif; où Son Excellence veut-elle aller?
-- A Ferrare. J'ai un passeportmais j'aimerais mieux ne pas parler aux gendarmesqui peuvent avoir connaissance du fait.
-- Quand avez-vous expédié cet autre?
-- Ce matin à six heures.
-- Votre Excellence n'a-t-elle point de sang sur ses vêtements? dit l'hôtesse.
-- J'y pensaisreprit le cocheret d'ailleurs le drap de ces vêtements est trop fin; on n'en voit pas beaucoup de semblable dans nos campagnescela nous attirerait les regards; je vais acheter des habits chez le juif. Votre Excellence est à peu près de ma taillemais plus mince.
-- De grâcene m'appelez plus Excellencecela peut attirer l'attention.
-- OuiExcellencerépondit le cocher en sortant de la boutique.
-- Eh bien! eh bien! cria Fabriceet l'argent! revenez donc!
-- Que parlez-vous d'argent! dit l'hôtesseil a soixante-sept écus qui sont fort à votre service. Moi-mêmeajouta-t-elle en baissant la voixj'ai une quarantaine d'écus que je vous offre de bien bon coeur; on n'a pas toujours de l'argent sur soi lorsqu'il arrive de ces accidents.
Fabrice avait ôté son habit à cause de la chaleur en entrant dans la Trattoria.
-- Vous avez là un gilet qui pourrait nous causer de l'embarras s'il entrait quelqu'un: cette belle toile anglaise attirerait l'attention. Elle donna à notre fugitif un gilet de toile teinte en noirappartenant à son mari. Un grand jeune homme entra dans la boutique par une porte intérieureil était mis avec une certaine élégance.
-- C'est mon maridit l'hôtesse. Pierre-Antoinedit-elle au marimonsieur est un ami de Ludovic; il lui est arrivé un accident ce matin de l'autre côté du fleuveil désire se sauver à Ferrare.
-- Eh! nous le passeronsdit le mari d'un air fort polinous avons la barque de Charles-Joseph.
Par une autre faiblesse de notre hérosque nous avouerons aussi naturellement que nous avons raconté sa peur dans le bureau de police au bout du pontil avait les larmes aux yeux; il était profondément attendri par le dévouement parfait qu'il rencontrait chez ces paysans: il pensait aussi à la bonté caractéristique de sa tante; il eût voulu pouvoir faire la fortune de ces gens. Ludovic rentra chargé d'un paquet.
-- Adieu cet autrelui dit le mari d'un air de bonne amitié.
--. Il ne s'agit pas de çareprit Ludovic d'un ton fort alarméon commence à parler de vouson a remarqué que vous avez hésité en entrant dans notre vicolo et quittant la belle rue comme un homme qui chercherait à se cacher.
-- Montez vite à la chambredit le mari.
Cette chambrefort grande et fort belleavait de la toile grise au lieu de vitres aux deux fenêtreson y voyait quatre lits larges chacun de six pieds et hauts de cinq.
-- Et viteet vite! dit Ludovic; il y a un fat de gendarme nouvellement arrivé qui voulait faire la cour à la jolie femme d'en baset auquel j'ai prédit que quand il va en correspondance sur la routeil pourrait bien se rencontrer avec une balle; si ce chien-là entend parler de Votre Excellenceil voudra nous jouer un touril cherchera à vous arrêter ici afin de faire mal noter laTrattoria de la Théodolinde.
Eh quoi! continua Ludovic en voyant sa chemise toute tachée de sang et des blessures serrées avec des mouchoirsle porco s'est donc défendu? En voilà cent fois plus qu'il n'en faut pour vous faire arrêter: je n'ai point acheté de chemise. Il ouvrit sans façon l'armoire du mari et donna une de ses chemises à Fabrice qui bientôt fut habillé en riche bourgeois de campagne. Ludovic décrocha un filet suspendu à la murailleplaça les habits de Fabrice dans le panier où l'on met le poissondescendit en courant et sortit rapidement par une porte de derrière; Fabrice le suivait.
-- Théodolindecria-t-il en passant près de la boutiquecache ce qui est en hautnous allons attendre dans les saules; et toiPierre-Antoineenvoie-nous bien vite une barqueon paie bien.
Ludovic fit passer plus de vingt fossés à Fabrice. Il y avait des planches fort longues et fort élastiques qui servaient de ponts sur les plus larges de ces fossés; Ludovic retirait ces planches après avoir passé. Arrivé au dernier canalil tira la planche avec empressement.
-- Respirons maintenantdit-il; ce chien de gendarme aurait plus de deux lieues à faire pour atteindre Votre Excellence. Vous voilà tout pâledit-il à Fabriceje n'ai point oublié la petite bouteille d'eau-de-vie.
-- Elle vient fort à propos: la blessure à la cuisse commence à se faire sentir; et d'ailleurs j'ai eu une fière peur dans le bureau de la police au bout du pont.
-- Je le crois biendit Ludovic; avec une chemise remplie de sang comme était la vôtreje ne conçois pas seulement comment vous avez osé entrer en un tel lieu. Quant aux blessuresje m'y connais: je vais vous mettre dans un endroit bien frais où vous pourrez dormir une heure; la barque viendra nous y chercher s'il y a moyen d'obtenir une barque; sinonquand vous serez un peu reposé nous ferons encore deux petites lieueset je vous mènerai à un moulin où je prendrai moi- même une barque. Votre Excellence a bien plus de connaissances que moi: madame va être au désespoir quand elle apprendra l'accident; on lui dira que vous êtes blessé à mortpeut-être même que vous avez tué l'autre en traître. La marquise Raversi ne manquera pas de faire courir tous les mauvais bruits qui peuvent chagriner madame. Votre Excellence pourrait écrire.
-- Et comment faire parvenir la lettre?
-- Les garçons du moulin où nous allons gagnent douze sous par jour; en un jour et demi ils sont à Parmedonc quatre francs pour le voyage; deux francs pour l'usure des souliers: si la course était faite pour un pauvre homme tel que moice serait six francs; comme elle est pour le service d'un seigneurj'en donnerai douze.
Quand on fut arrivé au lieu du repos dans un bois de vernes et de saulesbien touffu et bien fraisLudovic alla à plus d'une heure de là chercher de l'encre et du papier. Grand Dieuque je suis bien ici! s'écria Fabrice. Fortune! adieuje ne serai jamais archevêque!
A son retourLudovic le trouva profondément endormi et ne voulut pas l'éveiller. La barque n'arriva que vers le coucher du soleil; aussitôt que Ludovic la vit paraître au loinil appela Fabrice qui écrivit deux lettres.
-- Votre Excellence a bien plus de connaissances que moidit Ludovic d'un air peinéet je crains bien de lui déplaire au fond du coeurquoi qu'elle en disesi j'ajoute une certaine chose.
-- Je ne suis pas aussi nigaud que vous le pensezrépondit Fabriceetquoi que vous puissiez direvous serez toujours à mes yeux un serviteur fidèle de ma tanteet un homme qui a fait tout au monde pour me tirer d'un fort vilain pas.
Il fallut bien d'autres protestations encore pour décider Ludovic à parleret quand enfin il en eut pris la résolutionil commença par une préface qui dura bien cinq minutes. Fabrice s'impatientapuis il se dit: A qui la faute? à notre vanité que cet homme a fort bien vue du haut de son siège. Le dévouement de Ludovic le porta enfin à courir le risque de parler net.
-- Combien la marquise Raversi ne donnerait-elle pas au piéton que vous allez expédier à Parme pour avoir ces deux lettres! Elles sont de votre écritureet par conséquent font preuves judiciaires contre vous. Votre Excellence va me prendre pour un curieux indiscret; en second lieuelle aura peut-être honte de mettre sous les yeux de madame la duchesse ma pauvre écriture de cocher; mais enfin votre sûreté m'ouvre la bouchequoique vous puissiez me croire un impertinent. Votre Excellence ne pourrait-elle pas me dicter ces deux lettres? Alors je suis le seul compromiset encore bien peuje dirais au besoin que vous m'êtes apparu au milieu d'un champ avec une écritoire de corne dans une main et un pistolet dans l'autreet que vous m'avez ordonné d'écrire.
-- Donnez-moi la mainmon cher Ludovics'écria Fabriceet pour vous prouver que je ne veux point avoir de secret pour un ami tel que vouscopiez ces deux lettres telles qu'elles sont. Ludovic comprit toute l'étendue de cette marque de confiance et y fut extrêmement sensiblemais au bout de quelques lignescomme il voyait la barque s'avancer rapidement sur le fleuve:
-- Les lettres seront plus tôt terminéesdit-il à Fabricesi Votre Excellence veut prendre la peine de me les dicter. Les lettres finiesFabrice écrivit un A et un B à la dernière ligneetsur une petite rognure de papier qu'ensuite il chiffonnail mit en français: Croyez A et B. Le piéton devait cacher ce papier froissé dans ses vêtements.
La barque arrivant à portée de la voixLudovic appela les bateliers par des noms qui n'étaient pas les leurs; ils ne répondirent point et abordèrent cinq cents toises plus basregardant de tous les côtés pour voir s'ils n'étaient point aperçus par quelque douanier.
-- Je suis à vos ordresdit Ludovic à Fabricevoulez-vous que je porte moi-même les lettres à Parme? Voulez-vous que je vous accompagne à Ferrare?
-- M'accompagner à Ferrare est un service que je n'osais presque vous demander. Il faudra débarquer et tâcher d'entrer dans la ville sans montrer le passeport. Je vous dirai que j'ai la plus grande répugnance à voyager sous le nom de Gilettiet je ne vois que vous qui puissiez m'acheter un autre passeport.
-- Que ne parliez-vous à Casal-Maggiore! Je sais un espion qui m'aurait vendu un excellent passeportet pas cherpour quarante ou cinquante francs.
L'un des deux mariniers qui était né sur la rive droite du Pôet par conséquent n'avait pas besoin de passeport à l'étranger pour aller à Parmese chargea de porter les lettres. Ludovicqui savait manier la ramese fit fort de conduire la barque avec l'autre.
-- Nous allons trouver sur le bas Pôdit-ilplusieurs barques armées appartenant à la policeet je saurai les éviter. Plus de dix fois on fut obligé de se cacher au milieu de petites îles à fleur d'eauchargées de saules. Trois fois on mit pied à terre pour laisser passer les barques vides devant les embarcations de la police. Ludovic profita de ces longs moments de loisir pour réciter à Fabrice plusieurs de ses sonnets. Les sentiments étaient assez justesmais comme émoussés par l'expressionet ne valaient pas la peine d'être écrits; le singulierc'est que cet ex- cocher avait des passions et des façons de voir vives et pittoresques; il devenait froid et commun dès qu'il écrivait. C'est le contraire de ce que nous voyons dans le mondese dit Fabrice; l'on sait maintenant tout exprimer avec grâcemais les coeurs n'ont rien à dire. Il comprit que le plus grand plaisir qu'il pût faire à ce serviteur fidèle ce serait de corriger les fautes d'orthographe de ses sonnets.
-- On se moque de moi quand je prête mon cahierdisait Ludovic; mais si Votre Excellence daignait me dicter l'orthographe des mots lettre à lettreles envieux ne sauraient plus que dire: l'orthographe ne fait pas le génie. Ce ne fut que le surlendemain dans la nuit que Fabrice put débarquer en toute sûreté dans un bois de vernesune lieue avant que d'arriver à Ponte Lago Oscuro. Toute la journée il resta caché dans une chènevièreet Ludovic le précéda à Ferrare; il y loua un petit logement chez un juif pauvrequi comprit tout de suite qu'il y avait de l'argent à gagner si l'on savait se taire. Le soirà la chute du jourFabrice entra dans Ferrare monté sur un petit cheval; il avait bon besoin de ce secoursla chaleur l'avait frappé sur le fleuve; le coup de couteau qu'il avait à la cuisse et le coup d'épée que Giletti lui avait donné dans l'épauleau commencement du combats'étaient enflammés et lui donnaient de la fièvre.
Livre Premier
Chapitre XII.
Le juifmaître du logementavait procuré un chirurgien discretlequelcomprenant à son tour qu'il y avait de l'argent dans la boursedit à Ludovic que sa conscience l'obligeait à faire son rapport à la police sur les blessures du jeune homme que luiLudovicappelait son frère.
-- La loi est claireajouta-t-il; il est trop évident que votre frère ne s'est point blessé lui-mêmecomme il le raconteen tombant d'une échelleau moment où il tenait à la main un couteau tout ouvert.
Ludovic répondit froidement à cet honnête chirurgien ques'il s'avisait de céder aux inspirations de sa conscienceil aurait l'honneuravant de quitter Ferrarede tomber sur lui précisément avec un couteau ouvert à la main. Quand il rendit compte de cet incident à Fabricecelui-ci le blâma fortmais il n'y avait plus un instant à perdre pour décamper. Ludovic dit au juif qu'il voulait essayer de faire prendre l'air à son frère; il alla chercher une voitureet nos amis sortirent de la maison pour n'y plus rentrer. Le lecteur trouve bien longssans douteles récits de toutes ces démarches que rend nécessaires l'absence d'un passeport: ce genre de préoccupation n'existe plus en France; mais en Italieet surtout aux environs du Pôtout le monde parle passeport. Une fois sorti de Ferrare sans encombrecomme pour faire une promenadeLudovic renvoya le fiacrepuis il rentra en ville par une autre porteet revint prendre Fabrice avec une sediola qu'il avait louée pour faire douze lieues. Arrivés près de Bolognenos amis se firent conduire à travers champs sur la route qui de Florence conduit à Bologne; ils passèrent la nuit dans la plus misérable auberge qu'ils purent découvriretle lendemainFabrice se sentant la force de marcher un peuils entrèrent à Bologne comme des promeneurs. On avait brûlé le passeport de Giletti: la mort du comédien devait être connueet il y avait moins de péril à être arrêtés comme gens sans passeports que comme porteurs de passeport d'un homme tué.
Ludovic connaissait à Bologne deux ou trois domestiques de grandes maisons; il fut convenu qu'il irait prendre langue auprès d'eux. Il leur dit quevenant de Florence et voyageant avec son jeune frèrecelui-cise sentant le besoin de dormirl'avait laissé partir seul une heure avant le lever du soleil. Il devait le rejoindre dans le village où luiLudovics'arrêterait pour passer les heures de la grande chaleur. Mais Ludovicne voyant point arriver son frères'était déterminé à retourner sur ses pas; il l'avait retrouvé blessé d'un coup de pierre et de plusieurs coups de couteauetde plusvolé par des gens qui lui avaient cherché dispute. Ce frère était joli garçonsavait panser et conduire les chevauxlire et écrireet il voudrait bien trouver une place dans quelque bonne maison. Ludovic se réserva d'ajouterquand l'occasion s'en présenteraitqueFabrice tombéles voleurs s'étaient enfuis emportant le petit sac dans lequel étaient leur linge et leurs passeports.
En arrivant à BologneFabricese sentant très fatiguéet n'osantsans passeportse présenter dans une aubergeétait entré dans l'immense église de Saint-Pétrone. Il y trouva une fraîcheur délicieuse; bientôt il se sentit tout ranimé. Ingrat que je suisse dit-il tout à coupj'entre dans une égliseet c'est pour m'y asseoircomme dans un café! Il se jeta à genouxet remercia Dieu avec effusion de la protection évidente dont il était entouré depuis qu'il avait eu le malheur de tuer Giletti. Le danger qui le faisait encore frémirc'était d'être reconnu dans le bureau de police de Casal-Maggiore. Commentse disait-ilce commisdont les yeux marquaient tant de soupçons et qui a relu mon passeport jusqu'à trois foisne s'est-il pas aperçu que je n'ai pas cinq pieds dix poucesque je n'ai pas trente-huit ansque je ne suis pas fort marqué de la petite vérole? Que de grâces je vous doisô mon Dieu! Et j'ai pu tarder jusqu'à ce moment de mettre mon néant à vos pieds! Mon orgueil a voulu croire que c'était à une vaine prudence humaine que je devais le bonheur d'échapper au Spielberg qui déjà s'ouvrait pour m'engloutir!
Fabrice passa plus d'une heure dans cet extrême attendrissementen présence de l'immense bonté de DieuLudovic s'approcha sans qu'il l'entendît veniret se plaça en face de lui. Fabricequi avait le front caché dans ses mainsreleva la têteet son fidèle serviteur vit les larmes qui sillonnaient ses joues.
-- Revenez dans une heurelui dit Fabrice assez durement.
Ludovic pardonna ce ton à cause de la piété. Fabrice récita plusieurs fois les sept psaumes de la pénitencequ'il savait par coeur; il s'arrêtait longuement aux versets qui avaient du rapport avec sa situation présente.
Fabrice demandait pardon à Dieu de beaucoup de chosesmaisce qui est remarquablec'est qu'il ne lui vint pas à l'esprit de compter parmi ses fautes le projet de devenir archevêqueuniquement parce que le comte Mosca était premier ministreet trouvait cette place et la grande existence qu'elle donne convenables pour le neveu de la duchesse. Il l'avait désirée sans passionil est vraimais enfin il y avait songéexactement comme à une place de ministre ou de général. Il ne lui était point venu à la pensée que sa conscience pût être intéressée dans ce projet de la duchesse. Ceci est un trait remarquable de la religion qu'il devait aux enseignements des jésuites milanais. Cette religion ôte le courage de penser aux choses inaccoutuméeset défend surtout l'examen personnelcomme le plus énorme des péchés; c'est un pas vers le protestantisme. Pour savoir de quoi l'on est coupableil faut interroger son curéou lire la liste des péchéstelle qu'elle se trouve imprimée dans les livres intitulés: Préparation au sacrement de la Pénitence. Fabrice savait par coeur la liste des péchés rédigée en langue latinequ'il avait apprise à l'Académie ecclésiastique de Naples. Ainsien récitant cette listeparvenu à l'article du meurtreil s'était fort bien accusé devant Dieu d'avoir tué un hommemais en défendant sa vie. Il avait passé rapidementet sans y faire la moindre attentionsur les divers articles relatifs au péché de simonie (se procurer par de l'argent les dignités ecclésiastiques). Si on lui eût proposé de donner cent louis pour devenir premier grand vicaire de l'archevêque de Parmeil eût repoussé cette idée avec horreur; mais quoiqu'il ne manquât ni d'esprit ni surtout de logiqueil ne lui vint pas une seule fois à l'esprit que le crédit du comte Moscaemployé en sa faveurfût une simonie. Tel est le triomphe de l'éducation jésuitique: donner l'habitude de ne pas faire attention à des choses plus claires que le jour. Un Françaisélevé au milieu des traits d'intérêt personnel et de l'ironie de Pariseût pusans être de mauvaise foiaccuser Fabrice d'hypocrisie au moment même où notre héros ouvrait son âme à Dieu avec la plus extrême sincérité et l'attendrissement le plus profond.
Fabrice ne sortit de l'église qu'après avoir préparé la confession qu'il se proposait de faire dès le lendemain; il trouva Ludovic assis sur les marches du vaste péristyle en pierre qui s'élève sur la grande place en avant de la façade de Saint- Pétrone. Comme après un grand orage l'air est plus purainsi l'âme de Fabrice était tranquilleheureuse et comme rafraîchie.
-- Je me trouve fort bienje ne sens presque plus mes blessuresdit-il à Ludovic en l'abordant; mais avant tout je dois vous demander pardon; je vous ai répondu avec humeur lorsque vous êtes venu me parler dans l'église; je faisais mon examen de conscience. Eh bien! où en sont nos affaires?
-- Elles vont au mieux: j'ai arrêté un logementà la vérité bien peu digne de Votre Excellencechez la femme d'un de mes amisqui est fort jolie et de plus intimement liée avec l'un des principaux agents de la police. Demain j'irai déclarer comme quoi nos passeports nous ont été volés; cette déclaration sera prise en bonne part; mais je paierai le port de la lettre que la police écrira à Casal- Maggiorepour savoir s'il existe dans cette commune un nommé Ludovic San- Michelilequel a un frèrenommé Fabriceau service de Mme la duchesse Sanseverinaà Parme. Tout est finisiamo a cavallo (Proverbe italien: nous sommes sauvés).
Fabrice avait pris tout à coup un air fort sérieux: il pria Ludovic de l'attendre un instantrentra dans l'église presque en courantet à peine y fut-il que de nouveau il se précipita à genoux; il baisait humblement les dalles de pierre. C'est un miracleSeigneurs'écriait-il les larmes aux yeux: quand vous avez vu mon âme disposée à rentrer dans le devoirvous m'avez sauvé. Grand Dieu! il est possible qu'un jour je sois tué dans quelque affaire: souvenez-vous au moment de ma mort de l'état où mon âme se trouve en ce moment. Ce fut avec les transports de la joie la plus vive que Fabrice récita de nouveau les sept psaumes de la pénitence. Avant que de sortir il s'approcha d'une vieille femme qui était assise devant une grande madone et à côté d'un triangle de fer placé verticalement sur un pied de même métal. Les bords de ce triangle étaient hérissés d'un grand nombre de pointes destinées à porter les petits cierges que la piété des fidèles allume devant la célèbre madone de Cimabué. Sept cierges seulement étaient allumés quand Fabrice s'approcha; il plaça cette circonstance dans sa mémoire avec l'intention d'y réfléchir ensuite plus à loisir.
-- Combien coûtent les cierges? dit-il à la femme.
-- Deux bajocs pièces.
En effet ils n'étaient guère plus gros qu'un tuyau de plumeet n'avaient pas un pied de long.
-- Combien peut-on placer encore de cierges sur votre triangle?
-- Soixante-troispuisqu'il y en a sept d'allumés.
Ah! se dit Fabricesoixante-trois et sept font soixante-dix: ceci encore est à noter. Il paya les ciergesplaça lui-même et alluma les sept premierspuis se mit à genoux pour faire son offrandeet dit à la vieille femme en se relevant:
-- C'est pour grâce reçue.
-- Je meurs de faimdit Fabrice à Ludovicen le rejoignant.
-- N'entrons point dans un cabaretallons au logement; la maîtresse de la maison ira vous acheter ce qu'il faut pour déjeuner; elle volera une vingtaine de sous et en sera d'autant plus attachée au nouvel arrivant.
-- Ceci ne tend à rien moins qu'à me faire mourir de faim une grande heure de plusdit Fabrice en riant avec la sérénité d'un enfantet il entra dans un cabaret voisin de Saint-Pétrone. A son extrême surpriseil vit à une table voisine de celle où il était placéPépéle premier valet de chambre de sa tantecelui-là même qui autrefois était venu à sa rencontre jusqu'à Genève. Fabrice lui fit signe de se taire; puisaprès avoir déjeuné rapidementle sourire du bonheur errant sur ses lèvresil se leva; Pépé le suivitetpour la troisième fois notre héros entra dans Saint- Pétrone. Par discrétionLudovic resta à se promener sur la place.
-- Hémon Dieu monseigneur! Comment vont vos blessures? Mme la duchesse est horriblement inquiète: un jour entier elle vous a cru mort abandonné dans quelque île du Pôje vais lui expédier un courrier à l'instant même. Je vous cherche depuis six joursj'en ai passé trois à Ferrarecourant toutes les auberges.
-- Avez-vous un passeport pour moi?
-- J'en ai trois différents: l'un avec les noms et les titres de Votre Excellence; le second avec votre nom seulementet le troisième sous un nom supposéJoseph Bossi; chaque passeport est en double expéditionselon que Votre Excellence voudra arriver de Florence ou de Modène. Il ne s'agit que de faire une promenade hors de la ville. M. le comte vous verrait loger avec plaisir à l'auberge del Pelegrinodont le maître est son ami.
Fabriceayant l'air de marcher au hasards'avança dans la nef droite de l'église jusqu'au lieu où ses cierges étaient allumés; ses yeux se fixèrent sur la madone de Cimabuépuis il dit à Pépé en s'agenouillant: Il faut que je rende grâce un instant; Pépé l'imita. Au sortir de l'églisePépé remarqua que Fabrice donnait une pièce de vingt francs au premier pauvre qui lui demanda l'aumône; ce mendiant jeta des cris de reconnaissance qui attirèrent sur les pas de l'être charitable les nuées de pauvres de tout genre qui ornent d'ordinaire la place de Saint-Pétrone. Tous voulaient avoir leur part du napoléon. Les femmesdésespérant de pénétrer dans la mêlée qui l'entouraitfondirent sur Fabricelui criant s'il n'était pas vrai qu'il avait voulu donner son napoléon pour être divisé parmi tous les pauvres du bon Dieu. Pépébrandissant sa canne à pomme d'orleur ordonna de laisser Son Excellence tranquille.
-- Ah! Excellencereprirent toutes ces femmes d'une voix plus perçantedonnez aussi un napoléon d'or pour les pauvres femmes! Fabrice doubla le pasles femmes le suivirent en criantet beaucoup de pauvres mâlesaccourant par toutes les ruesfirent comme une sorte de petite sédition. Toute cette foule horriblement sale et énergique criait: Excellence. Fabrice eut beaucoup de peine à se délivrer de la cohue; cette scène rappela son imagination sur la terre. Je n'ai que ce que je méritese dit-ilje me suis frotté à la canaille.
Deux femmes le suivirent jusqu'à la porte de Saragosse par laquelle il sortait de la ville; Pépé les arrêta en les menaçant sérieusement de sa canneet leur jetant quelque monnaie. Fabrice monta la charmante colline de San-Michele in Boscofit le tour d'une partie de la ville en dehors des mursprit un sentierarriva à cinq cents pas sur la route de Florencepuis rentra dans Bologne et remit gravement au commis de la police un passeport où son signalement était noté d'une façon fort exacte. Ce passeport le nommait Joseph Bossiétudiant en théologie. Fabrice y remarqua une petite tache d'encre rouge jetéecomme par hasardau bas de la feuille vers l'angle droit. Deux heures plus tard il eut un espion à ses troussesà cause du titre d'Excellence que son compagnon lui avait donné devant les pauvres de Saint-Pétronequoique son passeport ne portât aucun des titres qui donnent à un homme le droit de se faire appeler Excellence par ses domestiques.
Fabrice vit l'espionet s'en moqua fort; il ne songeait plus ni aux passeports ni à la policeet s'amusait de tout comme un enfant. Pépéqui avait ordre de rester auprès de luile voyant fort content de Ludovicaima mieux aller porter lui- même de si bonnes nouvelles à la duchesse. Fabrice écrivit deux très longues lettres aux personnes qui lui étaient chères; puis il eut l'idée d'en écrire une troisième au vénérable archevêque Landriani. Cette lettre produisit un effet merveilleuxelle contenait un récit fort exact du combat avec Giletti. Le bon archevêquetout attendrine manqua pas d'aller lire cette lettre au princequi voulut bien l'écouterassez curieux de voir comment ce jeune monsignore s'y prenait pour excuser un meurtre aussi épouvantable. Grâce aux nombreux amis de la marquise Raversile prince ainsi que toute la ville de Parme croyait que Fabrice s'était fait aider par vingt ou trente paysans pour assommer un mauvais comédien qui avait l'insolence de lui disputer la petite Marietta. Dans les cours despotiquesle premier intrigant adroit dispose de la véritécomme la mode en dispose à Paris.
-- Maisque diable! disait le prince à l'archevêqueon fait faire ces choses-là par un autre; mais les faire soi-mêmece n'est pas l'usage; et puis on ne tue pas un comédien tel que Gilettion l'achète.
Fabrice ne se doutait en aucune façon de ce qui se passait à Parme. Dans le faitil s'agissait de savoir si la mort de ce comédienqui de son vivant gagnait trente- deux francs par moisamènerait la chute du ministère ultra et de son chef le comte Mosca.
En apprenant la mort de Gilettile princepiqué des airs d'indépendance que se donnait la duchesseavait ordonné au fiscal général Rassi de traiter tout ce procès comme s'il se fût agi d'un libéral. Fabricede son côtécroyait qu'un homme de son rang était au-dessus des lois; il ne calculait pas que dans les pays où les grands noms ne sont jamais punisl'intrigue peut toutmême contre eux. Il parlait souvent à Ludovic de sa parfaite innocence qui serait bien vite proclamée; sa grande raison c'est qu'il n'était pas coupable. Sur quoi Ludovic lui dit un jour:
-- Je ne conçois pas comment Votre Excellencequi a tant d'esprit et d'instructionprend la peine de dire de ces choses-là à moi qui suis son serviteur dévoué; Votre Excellence use de trop de précautionsces choses-là sont bonnes à dire en public ou devant un tribunal. Cet homme me croit un assassin et ne m'en aime pas moinsse dit Fabricetombant de son haut.
Trois jours après le départ de Pépéil fut bien étonné de recevoir une lettre énorme fermée avec une tresse de soie comme du temps de Louis XIVet adressée à Son Excellence révérendissime monseigneur Fabrice del Dongopremier grand vicaire du diocèse de Parmechanoineetc.
Maisest-ce que je suis encore tout cela? se dit-il en riant. L'épître de l'archevêque Landriani était un chef-d'oeuvre de logique et de clarté; elle n'avait pas moins de dix-neuf grandes pageset racontait fort bien tout ce qui s'était passé à Parme à l'occasion de la mort de Giletti.
«Une armée française commandée par le maréchal Ney et marchant sur la ville n'aurait pas produit plus d'effetlui disait le bon archevêque; à l'exception de la duchesse et de moimon très cher filstout le monde croit que vous vous êtes donné le plaisir de tuer l'histrion Giletti. Ce malheur vous fût-il arrivéce sont de ces choses qu'on assoupit avec deux cents louis et une absence de six mois; mais la Raversi veut renverser le comte Mosca à l'aide de cet incident. Ce n'est point l'affreux péché du meurtre que le public blâme en vousc'est uniquement la maladresse ou plutôt l'insolence de ne pas avoir daigné recourir à un bulo (sorte de fier-à-brassubalterne). Je vous traduis ici en termes clairs les discours qui m'environnentcar depuis ce malheur à jamais déplorableje me rends tous les jours dans trois maisons des plus considérables de la ville pour avoir l'occasion de vous justifier. Et jamais je n'ai cru faire un plus saint usage du peu d'éloquence que le Ciel a daigné m'accorder. »
Les écailles tombaient des yeux de Fabriceles nombreuses lettres de la duchesseremplies de transports d'amitiéne daignaient jamais raconter. La duchesse lui jurait de quitter Parme à jamaissi bientôt il n'y rentrait triomphant. Le comte fera pour toilui disait-elle dans la lettre qui accompagnait celle de l'archevêquetout ce qui est humainement possible. Quant à moitu as changé mon caractère avec cette belle équipée; je suis maintenant aussi avare que le banquier Tombone; j'ai renvoyé tous mes ouvriersj'ai fait plusj'ai dicté au comte l'inventaire de ma fortunequi s'est trouvée bien moins considérable que je ne le pensais. Après la mort de l'excellent comte Pietraneraquepar parenthèsetu aurais bien plutôt dû vengerau lieu de t'exposer contre un être de l'espèce de Gilettije restai avec douze cents livres de rente et cinq mille francs de dette; je me souviensentre autres chosesque j'avais deux douzaines et demie de souliers de satin blanc venant de Pariset une seule paire de souliers pour marcher dans la rue. Je suis presque décidée à prendre les trois cent mille francs que me laisse le ducet que je voulais employer en entier à lui élever un tombeau magnifique. Au restec'est la marquise Raversi qui est ta principale ennemiec'est-à-dire la mienne; si tu t'ennuies seul à Bolognetu n'as qu'à dire un motj'irai te joindre. Voici quatre nouvelles lettres de changeetc.etc.
La duchesse ne disait mot à Fabrice de l'opinion qu'on avait à Parme sur son affaireelle voulait avant tout le consoler etdans tous les casla mort d'un être ridicule tel que Giletti ne lui semblait pas de nature à être reprochée sérieusement à del Dongo. Combien de Giletti nos ancêtres n'ont-ils pas envoyés dans l'autre mondedisait-elle au comtesans que personne se soit mis en tête de leur en faire un reproche!
Fabrice tout étonnéet qui entrevoyait pour la première fois le véritable état des chosesse mit à étudier la lettre de l'archevêque. Par malheur l'archevêque lui- même le croyait plus au fait qu'il ne l'était réellement. Fabrice comprit que ce qui faisait surtout le triomphe de la marquise Raversic'est qu'il était impossible de trouver des témoins de visu de ce fatal combat. Le valet de chambre qui le premier en avait apporté la nouvelle à Parme était à l'auberge du village Sanguigna lorsqu'il avait eu lieu; la petite Marietta et la vieille femme qui lui servait de mère avaient disparuet la marquise avait acheté le vetturino qui conduisait la voiture et qui faisait maintenant une déposition abominable. « Quoique la procédure soit environnée du plus profond mystèreécrivait le bon archevêque avec son style cicéronienet dirigée par le fiscal général Rassidont la seule charité chrétienne peut m'empêcher de dire du malmais qui a fait sa fortune en s'acharnant après les malheureux accusés comme le chien de chasse après le lièvre; quoique le Rassidis-jedont votre imagination ne saurait s'exagérer la turpitude et la vénalitéait été chargé de la direction du procès par un prince irritéj'ai pu lire les trois dépositions du vetturino. Par un insigne bonheurce malheureux se contredit. Et j'ajouteraiparce que je parle à mon vicaire généralà celui quiaprès moidoit avoir la direction de ce diocèseque j'ai mandé le curé de la paroisse qu'habite ce pécheur égaré. Je vous diraimon très cher filsmais sous le secret de la confessionque ce curé connaît déjàpar la femme duvetturinole nombre d'écus qu'il a reçu de la marquise Raversi; je n'oserai dire que la marquise a exigé de lui de vous calomniermais le fait est probable. Les écus ont été remis par un malheureux prêtre qui remplit des fonctions peu relevées auprès de cette marquiseet auquel j'ai été obligé d'interdire la messe pour la seconde fois. Je ne vous fatiguerai point du récit de plusieurs autres démarches que vous deviez attendre de moiet qui d'ailleurs rentrent dans mon devoir. Un chanoinevotre collègue à la cathédraleet qui d'ailleurs se souvient un peu trop quelquefois de l'influence que lui donnent les biens de sa famille dontpar la permission divineil est resté le seul héritiers'étant permis de dire chez M. le comte Zurlaministre de l'intérieurqu'il regardait cette bagatelle comme prouvée contre vous (il parlait de l'assassinat du malheureux Giletti)je l'ai fait appeler devant moiet làen présence de mes trois autres vicaires générauxde mon aumônier et de deux curés qui se trouvaient dans la salle d'attenteje l'ai prié de nous communiquerà nous ses frèresles éléments de la conviction complète qu'il disait avoir acquise contre un de ses collègues à la cathédrale; le malheureux n'a pu articuler que des raisons peu concluantes; tout le monde s'est élevé contre luiet quoique je n'aie cru devoir ajouter que bien peu de parolesil a fondu en larmes et nous a rendus témoins du plein aveu de son erreur complètesur quoi je lui ai promis le secret en mon nom et en celui de toutes les personnes qui avaient assisté à cette conférencesous la condition toutefois qu'il mettrait tout son zèle à rectifier les fausses impressions qu'avaient pu causer les discours par lui proférés depuis quinze jours.
«Je ne vous répéterai pointmon cher filsce que vous devez savoir depuis longtempsc'est-à-dire que des trente-quatre paysans employés à la fouille entreprise par le comte Mosca et que la Raversi prétend soldés par vous pour vous aider dans un crimetrente-deux étaient au fond de leur fossétout occupés de leurs travauxlorsque vous vous saisîtes du couteau de chasse et l'employâtes à défendre votre vie contre l'homme qui vous attaquait à l'improviste. Deux d'entre euxqui étaient hors du fossécrièrent aux autres: On assassine Monseigneur! Ce cri seul montre votre innocence dans tout son éclat. Eh bien! le fiscal général Rassi prétend que ces deux hommes ont disparubien pluson a retrouvé huit des hommes qui étaient au fond du fossé; dans leur premier interrogatoire six ont déclaré avoir entendu le cri on assassine Monseigneur! Je saispar voies indirectesque dans leur cinquième interrogatoirequi a eu lieu hier soircinq ont déclaré qu'ils ne se souvenaient pas bien s'ils avaient entendu directement ce cri ou si seulement il leur avait été raconté par quelqu'un de leurs camarades. Des ordres sont donnés pour que l'on me fasse connaître la demeure de ces ouvriers terrassierset leurs curés leur feront comprendre qu'ils se damnent sipour gagner quelques écusils se laissent aller à altérer la vérité. »
Le bon archevêque entrait dans des détails infiniscomme on peut en juger par ceux que nous venons de rapporter. Puis il ajoutait en se servant de la langue latine:
«Cette affaire n'est rien moins d'une tentative de changement de ministère. Si vous êtes condamnéce ne peut être qu'aux galères ou à la mortauquel cas j'interviendrais en déclarantdu haut de ma chaire archiépiscopaleque je sais que vous êtes innocentque vous avez tout simplement défendu votre vie contre un brigandet qu'enfin je vous ai défendu de revenir à Parme tant que vos ennemis y triompheront; je me propose même de stigmatisercomme il le méritele fiscal général; la haine contre cet homme est aussi commune que l'estime pour son caractère est rare. Mais enfin la veille du jour où ce fiscal prononcera cet arrêt si injustela duchesse Sanseverina quittera la ville et peut-être même les états de Parme: dans ce cas l'on ne fait aucun doute que le comte ne donne sa démission. Alorstrès probablementle général Fabio Conti arrive au ministèreet la marquise Raversi triomphe. Le grand mal de votre affairec'est qu'aucun homme entendu n'est chargé en chef des démarches nécessaires pour mettre au jour votre innocence et déjouer les tentatives faites pour suborner des témoins. Le comte croit remplir ce rôle; mais il est trop grand seigneur pour descendre à de certains détails; de plusen sa qualité de ministre de la policeil a dû donnerdans le premier momentles ordres les plus sévères contre vous. Enfinoserai-je le dire? Notre souverain seigneur vous croit coupableou du moins simule cette croyanceet apporte quelque aigreur dans cette affaire. » (Les mots correspondant à notre souverain seigneur et à simule cette croyance étaient en grecet Fabrice sut un gré infini à l'archevêque d'avoir osé les écrire. Il coupa avec un canif cette ligne de sa lettreet la détruisit sur-le-champ.)
Fabrice s'interrompit vingt fois en lisant cette lettre il était agité des transports de la plus vive reconnaissance: il répondit à l'instant par une lettre de huit pages. Souvent il fut obligé de relever la tête pour que ses larmes ne tombassent pas sur son papier. Le lendemainau moment de cacheter cette lettreil en trouva le ton trop mondain. Je vais l'écrire en latinse dit-ilelle en paraîtra plus convenable au digne archevêque. Mais en cherchant à construire de belles phrases latines bien longuesbien imitées de Cicéronil se rappela qu'un jour l'archevêquelui parlant de Napoléonaffectait de l'appeler Buonaparte; à l'instant disparut toute l'émotion qui la veille le touchait jusqu'aux larmes. O roi d'Italies'écria-t-ilcette fidélité que tant d'autres t'ont jurée de ton vivantje te la garderai après ta mort. Il m'aimesans doutemais parce que je suis un del Dongo et lui le fils d'un bourgeois. Pour que sa belle lettre en italien ne fût pas perdueFabrice y fit quelques changements nécessaireset l'adressa au comte Mosca.
Ce jour-là mêmeFabrice rencontra dans la rue la petite Marietta; elle devint rouge de bonheuret lui fit signe de la suivre sans l'aborder. Elle gagna rapidement un portique désert; làelle avança encore la dentelle noire quisuivant la mode du payslui couvrait la têtede façon à ce qu'elle ne pût être reconnue; puisse retournant vivement:
-- Comment se fait-ildit-elle à Fabriceque vous marchiez ainsi librement dans la rue? Fabrice lui raconta son histoire.
-- Grand Dieu! vous avez été à Ferrare! Moi qui vous y ai tant cherché! Vous saurez que je me suis brouillée avec la vieille femme parce qu'elle voulait me conduire à Veniseoù je savais bien que vous n'iriez jamaispuisque vous êtes sur la liste noire de l'Autriche. J'ai vendu mon collier d'or pour venir à Bologneun pressentiment m'annonçait le bonheur que j'ai de vous y rencontrer; la vieille femme est arrivée deux jours après moi. Ainsije ne vous engagerai point à venir chez nouselle vous ferait encore de ces vilaines demandes d'argent qui me font tant de honte. Nous avons vécu fort convenablement depuis le jour fatal que vous savezet nous n'avons pas dépensé le quart de ce que vous lui donnâtes. Je ne voudrais pas aller vous voir à l'auberge du Pelegrinoce serait une publicité. Tâchez de louer une petite chambre dans une rue déserteet à l'Ave Maria (la tombée de la nuit)je me trouverai icisous ce même portique. Ces mots ditselle prit la fuite.
Livre Premier
Chapitre XIII.
Toutes les idées sérieuses furent oubliées à l'apparition imprévue de cette aimable personne. Fabrice se mit à vivre à Bologne dans une joie et une sécurité profondes. Cette disposition naïve à se trouver heureux de tout ce qui remplissait sa vie perçait dans les lettres qu'il adressait à la duchesse; ce fut au point qu'elle en prit de l'humeur. A peine si Fabrice le remarqua; seulement il écrivit en signes abrégés sur le cadran de sa montre: quand j'écris à la D. ne jamais dire quand j'étais prélatquand j'étais homme d'église ; cela la fâche. Il avait acheté deux petits chevaux dont il était fort content: il les attelait à une calèche de louage toutes les fois que la petite Marietta voulait aller voir quelqu'un de ces sites ravissants des environs de Bologne; presque tous les soirs il la conduisait à la Chute du Reno. Au retouril s'arrêtait chez l'aimable Crescentiniqui se croyait un peu le père de la Marietta.
Ma foi! si c'est là la vie de café qui me semblait si ridicule pour un homme de quelque valeurj'ai eu tort de la repousserse dit Fabrice. Il oubliait qu'il n'allait jamais au café que pour lire le Constitutionnelet queparfaitement inconnu à tout le beau monde de Bologneles jouissances de vanité n'entraient pour rien dans sa félicité présente. Quand il n'était pas avec la petite Mariettaon le voyait à l'Observatoireoù il suivait un cours d'astronomie; le professeur l'avait pris en grande amitié et Fabrice lui prêtait ses chevaux le dimanche pour aller briller avec sa femme au Corso de la Montagnola.
Il avait en exécration de faire le malheur d'un être quelconquesi peu estimable qu'il fût. La Marietta ne voulait pas absolument qu'il vît la vieille femme; mais un jour qu'elle était à l'égliseil monta chez la mammacia qui rougit de colère en le voyant entrer. C'est le cas de faire le del Dongose dit Fabrice.
-- Combien la Marietta gagne-t-elle par mois quand elle est engagée? s'écria-t-il de l'air dont un jeune homme qui se respecte entre à Paris au balcon des Bouffes.
-- Cinquante écus.
-- Vous mentez comme toujours; dites la véritéou par Dieu vous n'aurez pas un centime.
-- Eh bienelle gagnait vingt-deux écus dans notre compagnie à Parmequand nous avons eu le malheur de vous connaître; moi je gagnais douze écuset nous donnions à Giletti notre protecteurchacune le tiers de ce qui nous revenait. Sur quoitous les mois à peu prèsGiletti faisait un cadeau à la Marietta; ce cadeau pouvait bien valoir deux écus.
-- Vous mentez encore; vousvous ne receviez que quatre écus. Mais si vous êtes bonne avec la Marietta je vous engage comme si j'étais un impresario ; tous les mois vous recevrez douze écus pour vous et vingt-deux pour elle; mais si je lui vois les yeux rougesje fais banqueroute.
-- Vous faites le fier; eh bien! votre rebelle générosité nous ruinerépondit la vieille femme d'un ton furieux; nous perdons l'avviamento (l'achalandage). Quand nous aurons l'énorme malheur d'être privées de la protection de Votre Excellencenous ne serons plus connues d'aucune troupetoutes seront au grand complet; nous ne trouverons pas d'engagementet par vousnous mourrons de faim.
-- Va-t'en au diabledit Fabrice en s'en allant.
-- Je n'irai pas au diable; vilain impie! mais tout simplement au bureau de la policequi saura de moi que vous êtes un monsignore qui a jeté le froc aux ortieset que vous ne vous appelez pas plus Joseph Bossi que moi. Fabrice avait déjà descendu quelques marches de l'escalieril revint.
-- D'abord la police sait mieux que toi quel peut être mon vrai nom; mais si tu t'avises de me dénoncersi tu as cette infamielui dit-il d'un grand sérieuxLudovic te parleraet ce n'est pas six coups de couteau que recevra ta vieille carcassemais deux douzaineset tu seras pour six mois à l'hôpitalet sans tabac.
La vieille femme pâlit et se précipita sur la main de Fabricequ'elle voulut baiser:
-- J'accepte avec reconnaissance le sort que vous nous faitesà la Marietta et à moi. Vous avez l'air si bonque je vous prenais pour un niais; et pensez-y biend'autres que moi pourront commettre la même erreur; je vous conseille d'avoir habituellement l'air plus grand seigneur. Puis elle ajouta avec une impudence admirable: Vous réfléchirez à ce bon conseilet comme l'hiver n'est pas bien éloignévous nous ferez cadeau à la Marietta et à moi de deux bons habits de cette belle étoffe anglaise que vend le gros marchand qui est sur la place Saint- Pétrone.
L'amour de la jolie Marietta offrait à Fabrice tous les charmes de l'amitié la plus doucece qui le faisait songer au bonheur du même genre qu'il aurait pu trouver auprès de la duchesse.
Mais n'est-ce pas une chose bien plaisante se disait-il quelquefoisque je ne sois pas susceptible de cette préoccupation exclusive et passionnée qu'ils appellent de l'amour? Parmi les liaisons que le hasard m'a données à Novare ou à Naplesai-je jamais rencontré de femme dont la présencemême dans les premiers joursfût pour moi préférable à une promenade sur un joli cheval inconnu? Ce qu'on appelle amourajoutait-ilserait-ce donc encore un mensonge? J'aime sans doutecomme j'ai bon appétit à six heures! Serait-ce cette propension quelque peu vulgaire dont ces menteurs auraient fait l'amour d'Othellol'amour de Tancrède? ou bien faut-il croire que je suis organisé autrement que les autres hommes? Mon âme manquerait d'une passionpourquoi cela? ce serait une singulière destinée!
A Naplessurtout dans les derniers tempsFabrice avait rencontré des femmes quifières de leur rangde leur beauté et de la position qu'occupaient dans le monde les adorateurs qu'elles lui avaient sacrifiésavaient prétendu le mener. A la vue de ce projetFabrice avait rompu de la façon la plus scandaleuse et la plus rapide. Orse disait-ilsi je me laisse jamais transporter par le plaisirsans doute très vifd'être bien avec cette jolie femme qu'on appelle la duchesse Sanseverinaje suis exactement comme ce Français étourdi qui tua un jour la poule aux oeufs d'or. C'est à la duchesse que je dois le seul bonheur que j'aie jamais éprouvé par les sentiments tendres; mon amitié pour elle est ma vieet d'ailleurssans elle que suis-je? un pauvre exilé réduit à vivoter péniblement dans un château délabré des environs de Novare. Je me souviens que durant les grandes pluies d'automne j'étais obligéle soircrainte d'accidentd'ajuster un parapluie sur le ciel de mon lit. Je montais les chevaux de l'homme d'affairesqui voulait bien le souffrir par respect pour mon sang bleu (pour ma haute puissance)mais il commençait à trouver mon séjour un peu long; mon père m'avait assigné une pension de douze cents francset se croyait damné de donner du pain à un jacobin. Ma pauvre mère et mes soeurs se laissaient manquer de robes pour me mettre en état de faire quelques petits cadeaux à mes maîtresses. Cette façon d'être généreux me perçait le coeur. Etde pluson commençait à soupçonner ma misèreet la jeune noblesse des environs allait me prendre en pitié. Tôt ou tardquelque fat eût laissé voir son mépris pour un jacobin pauvre et malheureux dans ses desseinscaraux yeux de ces gens-làje n'étais pas autre chose. J'aurais donné ou reçu quelque bon coup d'épée qui m'eût conduit à la forteresse de Fenestrellesou bien j'eusse de nouveau été me réfugier en Suissetoujours avec douze cents francs de pension. J'ai le bonheur de devoir à la duchesse l'absence de tous ces maux; de plusc'est elle qui sent pour moi les transports d'amitié que je devrais éprouver pour elle.
Au lieu de cette vie ridicule et piètre qui eût fait de moi un animal tristeun sotdepuis quatre ans je vis dans une grande ville et j'ai une excellente voiturece qui m'a empêché de connaître l'envie et tous les sentiments bas de la province. Cette tante trop aimable me gronde toujours de ce que je ne prends pas assez d'argent chez le banquier. Veux-je gâter à jamais cette admirable position? Veux-je perdre l'unique amie que j'aie au monde? Il suffit de proférer un mensongeil suffit de dire à une femme charmante et peut-être unique au mondeet pour laquelle j'ai l'amitié la plus passionnée: Je t'aimemoi qui ne sais pas ce que c'est qu'aimer d'amour. Elle passerait la journée à me faire un crime de l'absence de ces transports qui me sont inconnus. La Mariettaau contrairequi ne voit pas dans mon coeur et qui prend une caresse pour un transport de l'âmeme croit fou d'amouret s'estime la plus heureuse des femmes.
Dans le fait je n'ai connu un peu cette préoccupation tendre qu'on appelleje croisl'amourque pour cette jeune Aniken de l'auberge de Zondersprès de la frontière de Belgique.
C'est avec regret que nous allons placer ici l'une des plus mauvaises actions de Fabrice: au milieu de cette vie tranquilleune misérable pique de vanité s'empara de ce coeur rebelle à l'amouret le conduisit fort loin. En même temps que lui se trouvait à Bologne la fameuse Fausta F ***sans contredit l'une des premières chanteuses de notre époqueet peut-être la femme la plus capricieuse que l'on ait jamais vue. L'excellent poète Buratide Veniseavait fait sur son compte ce fameux sonnet satirique qui alors se trouvait dans la bouche des princes comme des derniers gamins de carrefours.
«Vouloir et ne pas vouloiradorer et détester en un journ'être contente que dans l'inconstancemépriser ce que le monde adoretandis que le monde l'adorela Fausta a ces défauts et bien d'autres encore. Donc ne vois jamais ce serpent. Si tu la voisimprudenttu oublies ses caprices. As-tu le bonheur de l'entendretu t'oublies toi-mêmeet l'amour fait de toien un momentce que Circé fit jadis des compagnons d'Ulysse. »
Pour le moment ce miracle de beauté était sous le charme des énormes favoris et de la haute insolence du jeune comte M ***au point de n'être pas révoltée de son abominable jalousie. Fabrice vit ce comte dans les rues de Bologneet fut choqué de l'air de supériorité avec lequel il occupait le pavéet daignait montrer ses grâces au public. Ce jeune homme était fort richese croyait tout permiset comme ses prepotenze lui avaient attiré des menacesil ne se montrait guère qu'environné de huit ou dix buli (sorte de coupe-jarrets)revêtus de sa livréeet qu'il avait fait venir de ses terres dans les environs de Brescia. Les regards de Fabrice avaient rencontré une ou deux fois ceux de ce terrible comtelorsque le hasard lui fit entendre la Fausta. Il fut étonné de l'angélique douceur de cette voix: il ne se figurait rien de pareil; il lui dut des sensations de bonheur suprêmequi faisaient un beau contraste avec la placidité de sa vie présente. Serait-ce enfin là de l'amour? se dit-il. Fort curieux d'éprouver ce sentimentet d'ailleurs amusé par l'action de braver ce comte M ***dont la mine était plus terrible que celle d'aucun tambour-majornotre héros se livra à l'enfantillage de passer beaucoup trop souvent devant le palais Tanarique le comte M *** avait loué pour la Fausta.
Un jourvers la tombée de la nuitFabricecherchant à se faire apercevoir de la Faustafut salué par des éclats de rire fort marqués lancés par les buli du comtequi se trouvaient sur la porte du palais Tanari. Il courut chez luiprit de bonnes armes et repassa devant ce palais. La Faustacachée derrière ses persiennesattendait ce retouret lui en tint compte. M ***jaloux de toute la terredevint spécialement jaloux de M. Joseph Bossiet s'emporta en propos ridicules; sur quoi tous les matins notre héros lui faisait parvenir une lettre qui ne contenait que ces mots:
«M. Joseph Bossi détruit les insectes incommodeset loge au Pelegrinovia Largan° 79. »
Le comte M ***accoutumé aux respects que lui assuraient en tous lieux son énorme fortuneson sang bleu et la bravoure de ses trente domestiquesne voulut point entendre le langage de ce petit billet.
Fabrice en écrivait d'autres à la Fausta; M *** mit des espions autour de ce rivalqui peut-être ne déplaisait pas; d'abord il apprit son véritable nomet ensuite que pour le moment il ne pouvait se montrer à Parme. Peu de jours aprèsle comte M ***ses bulises magnifiques chevaux et la Fausta partirent pour Parme.
Fabricepiqué au jeules suivit le lendemain. Ce fut en vain que le bon Ludovic fit des remontrances pathétiques; Fabrice l'envoya promeneret Ludovicfort brave lui-mêmel'admira; d'ailleurs ce voyage le rapprochait de la jolie maîtresse qu'il avait à Casal-Maggiore. Par les soins de Ludovichuit ou dix anciens soldats des régiments de Napoléon entrèrent chez M. Joseph Bossisous le nom de domestiques. Pourvuse dit Fabrice en faisant la folie de suivre la Faustaque je n'aie aucune communication ni avec le ministre de la policecomte Moscani avec la duchesseje n'expose que moi. Je dirai plus tard à ma tante que j'allais à la recherche de l'amourcette belle chose que je n'ai jamais rencontrée. Le fait est que je pense à la Faustamême quand je ne la vois pas... Mais est-ce le souvenir de sa voix que j'aimeou sa personne? Ne songeant plus à la carrière ecclésiastiqueFabrice avait arboré des moustaches et des favoris presque aussi terribles que ceux du comte M ***ce qui le déguisait un peu. Il établit son quartier général non à Parmec'eût été trop imprudentmais dans un village des environsau milieu des boissur la route de Sacca où était le château de sa tante. D'après les conseils de Ludovicil s'annonça dans ce village comme le valet de chambre d'un grand seigneur anglais fort original qui dépensait cent mille francs par an pour se donner le plaisir de la chasseet qui arriverait sous peu du lac de Cômeoù il était retenu par la pêche des truites. Par bonheurle joli petit palais que le comte M *** avait loué pour la belle Fausta était situé à l'extrémité méridionale de la ville de Parmeprécisément sur la route de Saccaet les fenêtres de la Fausta donnaient sur les belles allées de grands arbres qui s'étendent sous la haute tour de la citadelle. Fabrice n'était point connu dans ce quartier désert; il ne manqua pas de faire suivre le comte M ***etun jour que celui-ci venait de sortir de chez l'admirable cantatriceil eut l'audace de paraître dans la rue en plein jour; à la véritéil était monté sur un excellent chevalet bien armé. Des musiciensde ceux qui courent les rues en Italieet qui parfois sont excellentsvinrent planter leurs contrebasses sous les fenêtres de la Fausta: après avoir préludéils chantèrent assez bien une cantate en son honneur. La Fausta se mit à la fenêtreet remarqua facilement un jeune homme fort poli quiarrêté à cheval au milieu de la ruela salua d'abordpuis se mit à lui adresser des regards fort peu équivoques. Malgré le costume anglais exagéré adopté par Fabriceelle eut bientôt reconnu l'auteur des lettres passionnées qui avaient amené son départ de Bologne. Voilà un être singulierse dit-elleil me semble que je vais l'aimer. J'ai cent louis devant moije puis fort bien planter là ce terrible comte M ***. Au faitil manque d'esprit et d'imprévuet n'est un peu amusant que par la mine atroce de ses gens.
Le lendemainFabrice ayant appris que tous les joursvers les onze heuresla Fausta allait entendre la messe au centre de la villedans cette même église de Saint-Jean où se trouvait le tombeau de son grand-onclel'archevêque Ascanio del Dongoil osa l'y suivre. A la véritéLudovic lui avait procuré une belle perruque anglaise avec des cheveux du plus beau rouge. A propos de la couleur de ces cheveuxqui était celle des flammes qui brûlaient son coeuril fit un sonnet que la Fausta trouva charmant; une main inconnue avait eu soin de le placer sur son piano. Cette petite guerre dura bien huit joursmais Fabrice trouvait quemalgré ses démarches de tout genreil ne faisait pas de progrès réels; la Fausta refusait de le recevoir. Il outrait la nuance de singularité; elle a dit depuis qu'elle avait peur de lui. Fabrice n'était plus retenu que par un reste d'espoir d'arriver à sentir ce qu'on appelle de l'amourmais souvent il s'ennuyait.
-- Monsieurallons-nous-enlui répétait Ludovicvous n'êtes point amoureux; je vous vois un sang-froid et un bon sens désespérants. D'ailleurs vous n'avancez point; par pure vergognedécampons. Fabrice allait partir au premier moment d'humeurlorsqu'il apprit que la Fausta devait chanter chez la duchesse Sanseverina; peut-être que cette voix sublime achèvera d'enflammer mon coeurse dit-il; et il osa bien s'introduire déguisé dans ce palais où tous les yeux le connaissaient. Qu'on juge de l'émotion de la duchesselorsque tout à fait vers la fin du concert elle remarqua un homme en livrée de chasseurdebout près de la porte du grand salon; cette tournure rappelait quelqu'un. Elle chercha le comte Mosca qui seulement alors lui apprit l'insigne et vraiment incroyable folie de Fabrice. Il la prenait très bien. Cet amour pour une autre que la duchesse lui plaisait fortle comteparfaitement galant homme hors de la politiqueagissait d'après cette maxime qu'il ne pouvait trouver le bonheur qu'autant que la duchesse serait heureuse. Je le sauverai de lui-mêmedit-il à son amie; jugez de la joie de nos ennemis si on l'arrêtait dans ce palais! Aussi ai-je ici plus de cent hommes à moiet c'est pour cela que je vous ai fait demander les clefs du grand château d'eau. Il se porte pour amoureux fou de la Faustaet jusqu'ici ne peut l'enlever au comte M *** qui donne à cette folle une existence de reine. La physionomie de la duchesse trahit la plus vive douleur: Fabrice n'était donc qu'un libertin tout à fait incapable d'un sentiment tendre et sérieux.
-- Et ne pas nous voir! c'est ce que jamais je ne pourrai lui pardonner! dit-elle enfin; et moi qui lui écris tous les jours à Bologne!
-- J'estime fort sa retenuerépliqua le comteil ne veut pas nous compromettre par son équipéeet il sera plaisant de la lui entendre raconter.
La Fausta était trop folle pour savoir taire ce qui l'occupait: le lendemain du concertdont ses yeux avaient adressé tous les airs à ce grand jeune homme habillé en chasseurelle parla au comte M *** d'un attentif inconnu. -- Où le voyez-vous? dit le comte furieux.-- Dans les ruesà l'égliserépondit la Fausta interdite. Aussitôt elle voulut réparer son imprudence ou du moins éloigner tout ce qui pouvait rappeler Fabrice: elle se jeta dans une description infinie d'un grand jeune homme à cheveux rougesil avait des yeux bleus; sans doute c'était quelque Anglais fort riche et fort gaucheou quelque prince. A ce motle comte M ***qui ne brillait pas par la justesse des aperçusalla se figurerchose délicieuse pour sa vanitéque ce rival n'était autre que le prince héréditaire de Parme. Ce pauvre jeune homme mélancoliquegardé par cinq ou six gouverneurssous-gouverneursprécepteursetc.etc.qui ne le laissaient sortir qu'après avoir tenu conseillançait d'étranges regards sur toutes les femmes passables qu'il lui était permis d'approcher. Au concert de la duchesseson rang l'avait placé en avant de tous les auditeurssur un fauteuil isoléà trois pas de la belle Faustaet ses regards avaient souverainement choqué le comte M ***. Cette folie d'exquise vanité: avoir un prince pour rivalamusa fort la Fausta qui se fit un plaisir de la confirmer par cent détails naïvement donnés.
-- Votre racedisait-elle au comteest aussi ancienne que celle des Farnèse à laquelle appartient ce jeune homme?
-- Que voulez-vous dire? aussi ancienne! Moi je n'ai point de bâtardise dans ma famille. [ Pierre-Louisle premier souverain de la famille Farnèsesi célèbre par ses vertusfutcomme on saitfils naturel du saint pape Paul III. ]
Le hasard voulut que jamais le comte M *** ne dût voir à son aise ce rival prétendu; ce qui le confirma dans l'idée flatteuse d'avoir un prince pour antagoniste. En effetquand les intérêts de son entreprise n'appelaient point Fabrice à Parmeil se tenait dans les bois vers Sacca et les bords du Pô. Le comte M *** était bien plus fiermais aussi plus prudent depuis qu'il se croyait en passe de disputer le coeur de la Fausta à un prince; il la pria fort sérieusement de mettre la plus grande retenue dans toutes ses démarches. Après s'être jeté à ses genoux en amant jaloux et passionnéil lui déclara fort net que son honneur était intéressé à ce qu'elle ne fût pas la dupe du jeune prince.
-- Permettezje ne serais pas sa dupe si je l'aimais; moije n'ai jamais vu de prince à mes pieds.
-- Si vous cédezreprit-il avec un regard hautainpeut-être ne pourrai-je pas me venger du prince; mais certesje me vengerai; et il sortit en fermant les portes à tour de bras. Si Fabrice se fût présenté en ce momentil gagnait son procès.
-- Si vous tenez à la vielui dit-il le soiren prenant congé d'elle après le spectaclefaites que je ne sache jamais que le jeune prince a pénétré dans votre maison. Je ne puis rien sur luimorbleu! mais ne me faites pas souvenir que je puis tout sur vous!
-- Ah! mon petit Fabrices'écria la Fausta; si je savais où te prendre!
La vanité piquée peut mener loin un jeune homme riche et dès le berceau toujours environné de flatteurs. La passion très véritable que le comte M *** avait eue pour la Fausta se réveilla avec fureur: il ne fut point arrêté par la perspective dangereuse de lutter avec le fils unique du souverain chez lequel il se trouvait; de même qu'il n'eut point l'esprit de chercher à voir ce princeou du moins à le faire suivre. Ne pouvant autrement l'attaquerM *** osa songer à lui donner un ridicule. Je serai banni pour toujours des états de Parmese dit-ileh! que m'importe? S'il eût cherché à reconnaître la position de l'ennemile comte M *** eût appris que le pauvre jeune prince ne sortait jamais sans être suivi par trois ou quatre vieillardsennuyeux gardiens de l'étiquetteet que le seul plaisir de son choix qu'on lui permît au mondeétait la minéralogie. De jour comme de nuitle petit palais occupé par la Fausta et où la bonne compagnie de Parme faisait fouleétait environné d'observateurs; M *** savait heure par heure ce qu'elle faisait et surtout ce qu'on fait autour d'elle. L'on peut louer ceci dans les précautions de ce jalouxcette femme si capricieuse n'eut d'abord aucune idée de ce redoublement de surveillance. Les rapports de tous ses agents disaient au comte M *** qu'un homme fort jeuneportant une perruque de cheveux rougesparaissait fort souvent sous les fenêtres de la Faustamais toujours avec un déguisement nouveau. Evidemmentc'est le jeune princese dit M ***autrement pourquoi se déguiser? et parbleu! un homme comme moi n'est pas fait pour lui céder. Sans les usurpations de la république de Veniseje serais prince souverainmoi aussi.
Le jour de San Stefanoles rapports des espions prirent une couleur plus sombre; ils semblaient indiquer que la Fausta commençait à répondre aux empressements de l'inconnu. Je puis partir à l'instant avec cette femmese dit M ***! Mais quoi! à Bolognej'ai fui devant del Dongo; ici je fuirais devant un prince! Mais que dirait ce jeune homme? Il pourrait penser qu'il a réussi à me faire peur! Et pardieu! je suis d'aussi bonne maison que lui. M *** était furieuxmaispour comble de misèretenait avant tout à ne point se donneraux yeux de la Fausta qu'il savait moqueusele ridicule d'être jaloux. Le jour de San Stefano doncaprès avoir passé une heure avec elleet en avoir été accueilli avec un empressement qui lui sembla le comble de la faussetéil la laissa sur les onze heuress'habillant pour aller entendre la messe à l'église de Saint-Jean. Le comte M *** revint chez luiprit l'habit noir râpé d'un jeune élève en théologieet courut à Saint-Jean; il choisit sa place derrière un des tombeaux que ornent la troisième chapelle à droite; il voyait tout ce qui se passait dans l'église par- dessous le bras d'un cardinal que l'on a représenté à genoux sur sa tombe; cette statue ôtait la lumière au fond de la chapelle et le cachait suffisamment. Bientôt il vit arriver la Fausta plus belle que jamais; elle était en grande toiletteet vingt adorateurs appartenant à la plus haute société lui faisaient cortège. Le sourire et la joie éclataient dans ses yeux et sur ses lèvres; il est évidentse dit le malheureux jalouxqu'elle compte rencontrer ici l'homme qu'elle aimeet que depuis longtemps peut-êtregrâce à moielle n'a pu voir. Tout à couple bonheur le plus vif sembla redoubler dans les yeux de la Fausta; mon rival est présentse dit M ***et sa fureur de vanité n'eut plus de bornes. Quelle figure est-ce que je fais iciservant de pendant à un jeune prince qui se déguise? Mais quelques efforts qu'il pût fairejamais il ne parvint à découvrir ce rival que ses regards affamés cherchaient de toutes parts.
A chaque instant la Faustaaprès avoir promené les yeux dans toutes les parties de l'églisefinissait par arrêter des regards chargés d'amour et de bonheursur le coin obscur où M *** s'était caché. Dans un coeur passionnél'amour est sujet à exagérer les nuances les plus légèresil en tire les conséquences les plus ridiculesle pauvre M *** ne finit-il pas par se persuader que la Fausta l'avait vuque malgré ses efforts s'étant aperçue de ma mortelle jalousieelle voulait la lui reprocher et en même temps l'en consoler par ces regards si tendres.
Le tombeau du cardinalderrière lequel M *** s'était placé en observationétait élevé de quatre ou cinq pieds sur le pavé de marbre de Saint-Jean. La messe à la mode finie vers les une heurela plupart des fidèles s'en allèrentet la Fausta congédia les beaux de la villes sous un prétexte de dévotion; restée agenouillée sur sa chaiseses yeuxdevenus plus tendres et plus brillantsétaient fixés sur M ***; depuis qu'il n'y avait plus que peu de personnes dans l'égliseses regards ne se donnaient plus la peine de la parcourir tout entièreavant de s'arrêter avec bonheur sur la statue du cardinal. Que de délicatessese disait le comte M *** se croyant regardé! Enfin la Fausta se leva et sortit brusquementaprès avoir faitavec les mainsquelques mouvements singuliers.
M ***ivre d'amour et presque tout à fait désabusé de sa folle jalousiequittait sa place pour voler au palais de sa maîtresse et la remercier mille et mille foislorsqu'en passant devant le tombeau du cardinal il aperçut un jeune homme tout en noir; cet être funeste s'était tenu jusque-là agenouillé tout contre l'épitaphe du tombeauet de façon à ce que les regards de l'amant jaloux qui le cherchaient dussent passer par-dessus sa tête et ne point le voir.
Ce jeune homme se levamarcha vite et fut à l'instant même environné par sept à huit personnages assez gauchesd'un aspect singulier et qui semblaient lui appartenir. M *** se précipita sur ses pasmaissans qu'il y eût rien de trop marquéil fut arrêté dans le défilé que forme le tambour de bois de la porte d'entréepar ces hommes gauches qui protégeaient son rival; enfinlorsque après eux il arriva à la rueil ne put que voir fermer la portière d'une voiture de chétive apparencelaquellepar un contraste bizarre était attelée de deux excellents chevauxet en un moment fut hors de sa vue.
Il rentra chez lui haletant de fureur; bientôt arrivèrent ses observateursqui lui rapportèrent froidement que ce jour-làl'amant mystérieuxdéguisé en prêtres'était agenouillé fort dévotementtout contre un tombeau placé à l'entrée d'une chapelle obscure de l'église de Saint-Jean. La Fausta était restée dans l'église jusqu'à ce qu'elle fût à peu près déserteet alors elle avait échangé rapidement certains signes avec cet inconnu; avec les mainselle faisait comme des croix. M *** courut chez l'infidèle; pour la première fois elle ne put cacher son trouble; elle raconta avec la naïveté menteuse d'une femme passionnéeque comme de coutume elle était allée à Saint-Jeanmais qu'elle n'y avait pas aperçu cet homme qui la persécutait. A ces motsM ***hors de luila traita comme la dernière des créatureslui dit tout ce qu'il avait vu lui-mêmeet la hardiesse des mensonges croissant avec la vivacité des accusationsil prit son poignard et se précipita sur elle. D'un grand sang-froid la Fausta lui dit:
-- Eh bien! tout ce dont vous vous plaignez est la pure véritémais j'ai essayé de vous la cacher afin de ne pas jeter votre audace dans des projets de vengeance insensés et qui peuvent nous perdre tous les deux; carsachez-le une bonne foissuivant mes conjecturesl'homme qui me persécute de ses soins est fait pour ne pas trouver d'obstacles à ses volontésdu moins en ce pays. Après avoir rappelé fort adroitement qu'après tout M *** n'avait aucun droit sur ellela Fausta finit par dire que probablement elle n'irait plus à l'église de Saint-Jean. M *** était éperdument amoureuxun peu de coquetterie avait pu se joindre à la prudence dans le coeur de cette jeune femmeil se sentit désarmer. Il eut l'idée de quitter Parme; le jeune princesi puissant qu'il fûtne pourrait le suivreou s'il le suivait ne serait plus que son égal. Mais l'orgueil représenta de nouveau que ce départ aurait toujours l'air d'une fuiteet le comte M *** se défendit d'y songer.
Il ne se doute pas de la présence de mon petit Fabricese dit la cantatrice ravieet maintenant nous pourrons nous moquer de lui d'une façon précieuse!
Fabrice ne devina point son bonheurtrouvant le lendemain les fenêtres de la cantatrice soigneusement ferméeset ne la voyant nulle partla plaisanterie commença à lui sembler longue. Il avait des remords. Dans quelle situation est-ce que je mets ce pauvre comte Moscalui ministre de la police! on le croira mon compliceje serai venu dans ce pays pour casser le cou à sa fortune! Mais si j'abandonne un projet si longtemps suivique dira la duchesse quand je lui conterai mes essais d'amour?
Un soir que prêt à quitter la partie il se faisait ainsi la morale en rôdant sous les grands arbres qui séparent le palais de la Fausta de la citadelleil remarqua qu'il était suivi par un espion de fort petite taille; ce fut en vain que pour s'en débarrasser il alla passer par plusieurs ruestoujours cet être microscopique semblait attaché à ses pas. Impatientéil courut dans une rue solitaire située le long de la Parmaet où ses gens étaient en embuscade; sur un signe qu'il fit ils sautèrent sur le pauvre petit espion qui se précipita à leurs genoux: c'était la Bettinafemme de chambre de la Fausta; après trois jours d'ennui et de réclusiondéguisée en homme pour échapper au poignard du comte M ***dont sa maîtresse et elle avaient grand-peurelle avait entrepris de venir dire à Fabrice qu'on l'aimait à la passion et qu'on brûlait de le voir; mais on ne pouvait plus paraître à l'église de Saint-Jean. Il était tempsse dit Fabricevive l'insistance!
La petite femme de chambre était fort joliece qui enleva Fabrice à ses rêveries morales. Elle lui apprit que la promenade et toutes les rues où il avait passé ce soir-là étaient soigneusement gardéessans qu'il y parûtpar des espions de M ***. Ils avaient loué des chambres au rez-de-chaussée ou au premier étagecachés derrière les persiennes et gardant un profond silenceils observaient tout ce qui se passait dans la rueen apparence la plus solitaireet entendaient ce qu'on y disait.
-- Si ces espions eussent reconnu ma voixdit la petite Bettinaj'étais poignardée sans rémission à ma rentrée au logiset peut-être ma pauvre maîtresse avec moi.
Cette terreur la rendait charmante aux yeux de Fabrice.
-- Le comte M ***continua-t-elleest furieuxet madame sait qu'il est capable de tout... Elle m'a chargée de vous dire qu'elle voudrait être à cent lieues d'ici avec vous!
Alors elle raconta la scène du jour de la Saint-Etienneet la fureur de M ***qui n'avait perdu aucun des regards et des signes d'amour que la Faustace jour-là folle de Fabricelui avait adressés. Le comte avait tiré son poignardavait saisi la Fausta par les cheveuxetsans sa présence d'espritelle était perdue.
Fabrice fit monter la jolie Bettina dans un petit appartement qu'il avait près de là. Il lui raconta qu'il était de Turinfils d'un grand personnage qui pour le moment se trouvait à Parmece qui l'obligeait à garder beaucoup de ménagements. La Bettina lui répondit en riant qu'il était bien plus grand seigneur qu'il ne voulait paraître. Notre héros eut besoin d'un peu de temps avant de comprendre que la charmante fille le prenait pour un non moindre personnage que le prince héréditaire lui-même. La Fausta commençait à avoir peur et à aimer Fabrice; elle avait pris sur elle de ne pas dire ce nom à sa femme de chambreet de lui parler du prince. Fabrice finit par avouer à la jolie fille qu'elle avait deviné juste: Mais si mon nom est ébruitéajouta-t-ilmalgré la grande passion dont j'ai donné tant de preuves à ta maîtresseje serai obligé de cesser de la voiret aussitôt les ministres de mon pèreces méchants drôles que je destituerai un journe manqueront pas de lui envoyer l'ordre de vider le paysque jusqu'ici elle a embelli de sa présence.
Vers le matinFabrice combina avec la petite camériste plusieurs projets de rendez-vous pour arriver à la Fausta; il fit appeler Ludovic et un autre de ses gens fort adroitqui s'entendirent avec la Bettinapendant qu'il écrivait à la Fausta la lettre la plus extravagante; la situation comportait toutes les exagérations de la tragédie et Fabrice ne s'en fit pas faute. Ce ne fut qu'à la pointe du jour qu'il se sépara de la petite caméristefort contente des façons du jeune prince.
Il avait été cent fois répété quemaintenant que la Fausta était d'accord avec son amantcelui-ci ne repasserait plus sous les fenêtres du petit palais que lorsqu'on pourrait l'y recevoiret alors il y aurait signal. Mais Fabriceamoureux de la Bettinaet se croyant près du dénouement avec la Faustane put se tenir dans son village à deux lieues de Parme. Le lendemainvers les minuitil vint à chevalet bien accompagnéchanter sous les fenêtres de la Fausta un air alors à la mode et dont il changeait les paroles. N'est-ce pas ainsi qu'en agissent messieurs les amants? se disait-il.
Depuis que la Fausta avait témoigné le désir d'un rendez-voustoute cette chasse semblait bien longue à Fabrice. Nonje n'aime pointse disait-il en chantant assez mal sous les fenêtres du petit palais; la Bettina me semble cent fois préférable à la Faustaet c'est par elle que je voudrais être reçu en ce moment. Fabrices'ennuyant assezretournait à son villagelorsque à cinq cents pas du palais de la Fausta quinze ou vingt hommes se jetèrent sur luiquatre d'entre eux saisirent la bride de son chevaldeux autres s'emparèrent de ses bras. Ludovic et les bravi de Fabrice furent assaillis mais purent se sauver; ils tirèrent quelques coups de pistolet. Tout cela fut l'affaire d'un instant: cinquante flambeaux allumés parurent dans la rue en un clin d'oeil et comme par enchantement. Tous ces hommes étaient bien armés. Fabrice avait sauté à bas de son chevalmalgré les gens qui le retenaient; il chercha à se faire jour; il blessa même un des hommes qui lui serrait les bras avec des mains semblables à des étaux; mais il fut bien étonné d'entendre cet homme lui dire du ton le plus respectueux:
-- Votre Altesse me fera une bonne pension pour cette blessurece qui vaudra mieux pour moi que de tomber dans le crime de lèse-majestéen tirant l'épée contre mon prince.
Voici justement le châtiment de ma sottisese dit Fabriceje me serai damné pour un péché qui ne me semblait point aimable.
A peine la petite tentative de combat fut-elle terminéeque plusieurs laquais en grande livrée parurent avec une chaise à porteurs dorée et peinte d'une façon bizarre: c'était une de ces chaises grotesques dont les masques se servent pendant le carnaval. Six hommesle poignard à la mainprièrent Son Altesse d'y entrerlui disant que l'air frais de la nuit pourrait nuire à sa voix; on affectait les formes les plus respectueusesle nom de prince était répété à chaque instantet presque en criant. Le cortège commença à défiler. Fabrice compta dans la rue plus de cinquante hommes portant des torches allumées. Il pouvait être une heure du matintout le monde s'était mis aux fenêtresla chose se passait avec une certaine gravité. Je craignais des coups de poignard de la part du comte M ***se dit Fabrice; il se contente de se moquer de moije ne lui croyais pas tant de goût. Mais pense-t-il réellement avoir affaire au prince? s'il sait que je ne suis que Fabricegare les coups de dague!
Ces cinquante hommes portant des torches et les vingt hommes armésaprès s'être longtemps arrêtés sous les fenêtres de la Faustaallèrent parader devant les plus beaux palais de la ville. Des majordomes placés aux deux côtés de la chaise à porteurs demandaient de temps à autre à Son Altesse si elle avait quelque ordre à leur donner. Fabrice ne perdit point la tête: à l'aide de la clarté que répandaient les torchesil voyait que Ludovic et ses hommes suivaient le cortège autant que possible. Fabrice se disait: Ludovic n'a que huit ou dix hommes et n'ose attaquer. De l'intérieur de sa chaise à porteursFabrice voyait fort bien que les gens chargés de la mauvaise plaisanterie étaient armés jusqu'aux dents. Il affectait de rire avec les majordomes chargés de le soigner. Après plus de deux heures de marche triomphaleil vit que l'on allait passer à l'extrémité de la rue où était situé le palais Sanseverina.
Comme on tournait la rue qui y conduitil ouvre avec rapidité la porte de la chaise pratiquée sur le devantsaute par-dessus l'un des bâtonsrenverse d'un coup de poignard l'un des estafiers qui lui portait sa torche au visage; il reçoit un coup de dague dans l'épauleun second estafier lui brûle la barbe avec sa torche alluméeet enfin Fabrice arrive à Ludovic auquel il crie: Tue! tue tout ce qui porte des torches! Ludovic donne des coups d'épée et le délivre de deux hommes qui s'attachaient à le poursuivre. Fabrice arrive en courant jusqu'à la porte du palais Sanseverina; par curiositéle portier avait ouvert la petite porte haute de trois pieds pratiquée dans la grandeet regardait tout ébahi ce grand nombre de flambeaux. Fabrice entre d'un saut et ferme derrière lui cette porte en miniature; il court au jardin et s'échappe par une porte qui donnait sur une rue solitaire. Une heure aprèsil était hors de la villeau jour il passait la frontière des états de Modène et se trouvait en sûreté. Le soir il entra dans Bologne. Voici une belle expéditionse dit-il; je n'ai pas même pu parler à ma belle. Il se hâta d'écrire des lettres d'excuses au comte et à la duchesselettres prudenteset quien peignant ce qui se passait dans son coeurne pouvaient rien apprendre à un ennemi. J'étais amoureux de l'amourdisait-il à la duchesse; j'ai fait tout au monde pour le connaîtremais il paraît que la nature m'a refusé un coeur pour aimer et être mélancolique; je ne puis m'élever plus haut que le vulgaire plaisiretc.etc.
On ne saurait donner l'idée du bruit que cette aventure fit dans Parme. Le mystère excitait la curiosité: une infinité de gens avaient vu les flambeaux et la chaise à porteurs. Mais quel était cet homme enlevé et envers lequel on affectait toutes les formes du respect? Le lendemain aucun personnage connu ne manqua dans la ville.
Le petit peuple qui habitait la rue d'où le prisonnier s'était échappé disait bien avoir vu un cadavremais au grand jourlorsque les habitants osèrent sortir de leurs maisonsils ne trouvèrent d'autres traces du combat que beaucoup de sang répandu sur le pavé. Plus de vingt mille curieux vinrent visiter la rue dans la journée. Les villes d'Italie sont accoutumées à des spectacles singuliersmais toujours elles savent le pourquoi et le comment. Ce qui choqua Parme dans cette occurrencece fut que même un mois aprèsquand on cessa de parler uniquement de la promenade aux flambeauxpersonnegrâce à la prudence du comte Moscan'avait pu deviner le nom du rival qui avait voulu enlever la Fausta au comte M ***. Cet amant jaloux et vindicatif avait pris la fuite dès le commencement de la promenade. Par ordre du comtela Fausta fut mise à la citadelle. La duchesse rit beaucoup d'une petite injustice que le comte dut se permettre pour arrêter tout à fait la curiosité du princequi autrement eût pu arriver jusqu'au nom de Fabrice.
On voyait à Parme un savant homme arrivé du nord pour écrire une histoire du moyen âge; il cherchait des manuscrits dans les bibliothèqueset le comte lui avait donné toutes les autorisations possibles. Mais ce savantfort jeune encorese montrait irascible; il croyaitpar exempleque tout le monde à Parme cherchait à se moquer de lui. Il est vrai que les gamins des rues le suivaient quelquefois à cause d'une immense chevelure rouge clair étalée avec orgueil. Ce savant croyait qu'à l'auberge on lui demandait des prix exagérés de toutes choseset il ne payait pas la moindre bagatelle sans en chercher le prix dans le voyage d'une Mme Starke qui est arrivé à une vingtième éditionparce qu'il indique à l'Anglais prudent le prix d'un dindond'une pommed'un verre de laitetc.etc...
Le savant à la crinière rougele soir même du jour où Fabrice fit cette promenade forcéedevint furieux à son aubergeet sortit de sa poche de petits pistolets pour se venger du cameriere qui lui demandait deux sous d'une pêche médiocre. On l'arrêtacar porter de petits pistolets est un grand crime!
Comme ce savant irascible était long et maigrele comte eut l'idéele lendemain matinde le faire passer aux yeux du prince pour le téméraire quiayant prétendu enlever la Fausta au comte M ***avait été mystifié. Le port des pistolets de poche est puni de trois ans de galère à Parme; mais cette peine n'est jamais appliquée. Après quinze jours de prisonpendant lesquels le savant n'avait vu qu'un avocat qui lui avait fait une peur horrible des lois atroces dirigées par la pusillanimité des gens au pouvoir contre les porteurs d'armes cachéesun autre avocat visita la prison et lui raconta la promenade infligée par le comte M *** à un rival qui était resté inconnu. La police ne veut pas avouer au prince qu'elle n'a pu savoir quel est ce rival: Avouez que vous vouliez plaire à la Faustaque cinquante brigands vous ont enlevé comme vous chantiez sous sa fenêtreque pendant une heure on vous a promené en chaise à porteurs sans vous adresser autre chose que des honnêtetés. Cet aveu n'a rien d'humilianton ne vous demande qu'un mot. Aussitôt après qu'en le prononçant vous aurez tiré la police d'embarraselle vous embarque sur une chaise de poste et vous conduit à la frontière où l'on vous souhaite le bonsoir.
Le savant résista pendant un mois; deux ou trois fois le prince fut sur le point de le faire amener au ministère de l'intérieuret de se trouver présent à l'interrogatoire. Mais enfin il n'y songeait plus quand l'historienennuyése détermina à tout avouer et fut conduit à la frontière. Le prince resta convaincu que le rival du comte M *** avait une forêt de cheveux rouges.
Trois jours après la promenadecomme Fabrice qui se cachait à Bologne organisait avec le fidèle Ludovic les moyens de trouver le comte M ***il apprit quelui aussise cachait dans un village de la montagne sur la route de Florence. Le comte n'avait que trois de ses buli avec lui; le lendemainau moment où il rentrait de la promenadeil fut enlevé par huit hommes masqués qui se donnèrent à lui pour des sbires de Parme. On le conduisitaprès lui avoir bandé les yeuxdans une auberge deux lieues plus avant dans la montagneoù il trouva tous les égards possibles et un souper fort abondant. On lui servit les meilleurs vins d'Italie et d'Espagne.
-- Suis-je donc prisonnier d'état? dit le comte.
-- Pas le moins du monde! lui répondit fort poliment Ludovic masqué. Vous avez offensé un simple particulieren vous chargeant de le faire promener en chaise à porteurs; demain matinil veut se battre en duel avec vous. Si vous le tuezvous trouverez deux bons chevauxde l'argent et des relais préparés sur la route de Gênes.
-- Quel est le nom du fier-à-bras? dit le comte irrité.
-- Il se nomme Bombace. Vous aurez le choix des armes et de bons témoinsbien loyauxmais il faut que l'un des deux meure!
-- C'est donc un assassinat! dit le comte M ***effrayé.
-- A Dieu ne plaise! c'est tout simplement un duel à mort avec le jeune homme que vous avez promené dans les rues de Parme au milieu de la nuitet qui resterait déshonoré si vous restiez en vie. L'un de vous deux est de trop sur la terreainsi tâchez de le tuer; vous aurez des épéesdes pistoletsdes sabrestoutes les armes qu'on a pu se procurer en quelques heurescar il a fallu se presser; la police de Bologne est fort diligentecomme vous pouvez le savoiret il ne faut pas qu'elle empêche ce duel nécessaire à l'honneur du jeune homme dont vous vous êtes moqué.
-- Mais si ce jeune homme est un prince...
-- C'est un simple particulier comme vouset même beaucoup moins riche que vousmais il veut se battre à mortet il vous forcera à vous battreje vous en avertis.
-- Je ne crains rien au monde! s'écria M ***.
-- C'est ce que votre adversaire désire avec le plus de passionrépliqua Ludovic. Demainde grand matinpréparez-vous à défendre votre vie; elle sera attaquée par un homme qui a raison d'être fort en colère et qui ne vous ménagera pas; je vous répète que vous aurez le choix des armes; et faites votre testament.
Vers les six heures du matinle lendemainon servit à déjeuner au comte M ***puis on ouvrit une porte de la chambre où il était gardéet on l'engagea à passer dans la cour d'une auberge de campagne; cette cour était environnée de haies et de murs assez hautset les portes en étaient soigneusement fermées.
Dans un anglesur une table de laquelle on invita le comte M *** à s'approcheril trouva quelques bouteilles de vin et d'eau-de-viedeux pistoletsdeux épéesdeux sabresdu papier et de l'encre; une vingtaine de paysans étaient aux fenêtres de l'auberge qui donnaient sur la cour. Le comte implora leur pitié.-- On veut m'assassiner! s'écriait-il; sauvez-moi la vie!
-- Vous vous trompez! ou vous voulez tromperlui cria Fabrice qui était à l'angle opposé de la courà côté d'une table chargée d'armes; il avait mis habit baset sa figure était cachée par un de ces masques en fils de fer qu'on trouve dans les salles d'armes.
-- Je vous engageajouta Fabriceà prendre le masque en fil de fer qui est près de vousensuite avancez vers moi avec une épée ou des pistolets; comme on vous l'a dit hier soirvous avez le choix des armes.
Le comte M *** élevait des difficultés sans nombreet semblait fort contrarié de se battre; Fabricede son côtéredoutait l'arrivée de la policequoique l'on fût dans la montagne à cinq grandes lieues de Bologne; il finit par adresser à son rival les injures les plus atroces; enfin il eut le bonheur de mettre en colère le comte M ***qui saisit une épée et marcha sur Fabrice; le combat s'engagea assez mollement.
Après quelques minutesil fut interrompu par un grand bruit. Notre héros avait bien senti qu'il se jetait dans une actionquipendant toute sa viepourrait être pour lui un sujet de reproches ou du moins d'imputations calomnieuses. Il avait expédié Ludovic dans la campagne pour lui recruter des témoins. Ludovic donna de l'argent à des étrangers qui travaillaient dans un bois voisin; ils accoururent en poussant des crispensant qu'il s'agissait de tuer un ennemi de l'homme qui payait. Arrivés à l'aubergeLudovic les pria de regarder de tous leurs yeuxet de voir si l'un de ces deux jeunes gens qui se battaientagissait en traître et prenait sur l'autre des avantages illicites.
Le combat un instant interrompu par les cris de mort des paysans tardait à recommencer; Fabrice insulta de nouveau la fatuité du comte.-- Monsieur le comtelui criait-ilquand on est insolentil faut être brave. Je sens que la condition est dure pour vousvous aimez mieux payer des gens qui sont braves. Le comtede nouveau piquése mit à lui crier qu'il avait longtemps fréquenté la salle d'armes du fameux Battistin à Napleset qu'il allait châtier son insolence; la colère du comte M *** ayant enfin reparuil se battit avec assez de fermetéce qui n'empêcha point Fabrice de lui donner un fort beau coup d'épée dans la poitrinequi le retint au lit plusieurs mois. Ludovicen donnant les premiers soins au blessélui dit à l'oreille: Si vous dénoncez ce duel à la policeje vous ferai poignarder dans votre lit.
Fabrice se sauva dans Florence; comme il s'était tenu caché à Bolognece fut à Florence seulement qu'il reçut toutes les lettres de reproches de la duchesse; elle ne pouvait lui pardonner d'être venu à son concert et de ne pas avoir cherché à lui parler. Fabrice fut ravi des lettres du comte Moscaelles respiraient une franche amitié et les sentiments les plus nobles. Il devina que le comte avait écrit à Bolognede façon à écarter les soupçons qui pouvaient peser sur lui relativement au duel; la police fut d'une justice parfaite: elle constata que deux étrangersdont l'un seulementle blesséétait connu (le comte M ***) s'étaient battus à l'épéedevant plus de trente paysansau milieu desquels se trouvait vers la fin du combat le curé du village qui avait fait de vains efforts pour séparer les duellistes. Comme le nom de Joseph Bossi n'avait point été prononcémoins de deux mois aprèsFabrice osa revenir à Bologneplus convaincu que jamais que sa destinée le condamnait à ne jamais connaître la partie noble et intellectuelle de l'amour. C'est ce qu'il se donna le plaisir d'expliquer fort au long à la duchesse; il était bien las de sa vie solitaire et désirait passionnément alors retrouver les charmantes soirées qu'il passait entre le comte et sa tante. Il n'avait pas revu depuis eux les douceurs de la bonne compagnie.
«Je me suis tant ennuyé à propos de l'amour que je voulais me donner et de la Faustaécrivait-il à la duchesseque maintenant son caprice me fût-il encore favorableje ne ferais pas vingt lieues pour aller la sommer de sa parole; ainsi ne crains pascomme tu me le disque j'aille jusqu'à Paris où je vois qu'elle débute avec un succès fou. Je ferais toutes les lieues possibles pour passer une soirée avec toi et avec ce comte si bon pour ses amis. »
Livre Second
Chapitre XIV.
Pendant que Fabrice était à la chasse de l'amour dans un village voisin de Parmele fiscal général Rassiqui ne le savait pas si près de luicontinuait à traiter son affaire comme s'il eût été un libéral: il feignit de ne pouvoir trouverou plutôt intimida les témoins à décharge; et enfinaprès un travail fort savant de près d'une annéeet environ deux mois après le dernier retour de Fabrice à Bologneun certain vendredila marquise Raversiivre de joiedit publiquement dans son salon quele lendemainla sentence qui venait d'être rendue depuis une heure contre le petit del Dongo serait présentée à la signature du prince et approuvée par lui. Quelques minutes plus tard la duchesse sut ce propos de son ennemie.
Il faut que le comte soit bien mal servi par ses agents! se dit-elle; encore ce matin il croyait que la sentence ne pouvait être rendue avant huit jours. Peut-être ne serait-il pas fâché d'éloigner de Parme mon jeune grand vicaire; maisajouta-t-elle en chantantnous le verrons reveniret un jour il sera notre archevêque. La duchesse sonna:
-- Réunissez tous les domestiques dans la salle d'attentedit-elle à son valet de chambremême les cuisiniers; allez prendre chez le commandant de la place le permis nécessaire pour avoir quatre chevaux de posteet enfin qu'avant une demi-heure ces chevaux soient attelés à mon landau. Toutes les femmes de la maison furent occupées à faire des mallesla duchesse prit à la hâte un habit de voyagele tout sans rien faire dire au comte; l'idée de se moquer un peu de lui la transportait de joie.
«Mes amisdit-elle aux domestiques rassemblésj'apprends que mon pauvre neveu va être condamné par contumace pour avoir eu l'audace de défendre sa a vie contre un furieux; c'était Giletti qui voulait le tuer. Chacun de vous a pu voir combien le caractère de Fabrice est doux et inoffensif. Justement indignée de cette injure atroceje pars pour Florence: je laisse à chacun de vous ses gages pendant dix ans; si vous êtes malheureuxécrivez-moiet tant que j'aurai un sequinil y aura quelque chose pour vous. »
La duchesse pensait exactement ce qu'elle disaitetà ses derniers motsles domestiques fondirent en larmes; elle aussi avait les yeux humides; elle ajouta d'une voix émue: -- «Priez Dieu pour moi et pour monseigneur Fabrice del Dongopremier grand vicaire du diocèsequi demain matin va être condamné aux galèresouce qui serait moins bêteà la peine de mort. »
Les larmes des domestiques redoublèrent et peu à peu se changèrent en cris à peu près séditieux; la duchesse monta dans son carrosse et se fit conduire au palais du prince. Malgré l'heure indueelle fit solliciter une audience par le général Fontanaaide de camp de service; elle n'était point en grand habit de cource qui jeta cet aide de camp dans une stupeur profonde. Quant au princeil ne fut point surpriset encore moins fâché de cette demande d'audience. Nous allons voir des larmes répandues par de beaux yeuxse dit-il en se frottant les mains. Elle vient demander grâce; enfin cette fière beauté va s'humilier! elle était aussi trop insupportable avec ses petits airs d'indépendance! Ces yeux si parlants semblaient toujours me direà la moindre chose qui la choquait: Naples ou Milan seraient un séjour bien autrement aimable que votre petite ville de Parme. A la vérité je ne règne pas sur Naples ou sur Milan; mais enfin cette grande dame vient me demander quelque chose qui dépend de moi uniquement et qu'elle brûle d'obtenir; j'ai toujours pensé que l'arrivé de ce neveu m'en ferait tirer pied ou aile.
Pendant que le prince souriait à ces pensées et se livrait à toutes ces prévisions agréablesil se promenait dans son grand cabinetà la porte duquel le général Fontana était resté debout et raide comme un soldat au port d'armes. Voyant les yeux brillants du princeet se rappelant l'habit de voyage de la duchesseil crut à la dissolution de la monarchie. Son ébahissement n'eut plus de bornes quand il entendit le prince lui dire:-- Priez Mme la duchesse d'attendre un petit quart d'heure. Le général aide de camp fit son demi-tour comme un soldat à la parade; le prince sourit encore: Fontana n'est pas accoutumése dit-ilà voir attendre cette fière duchesse: la figure étonnée avec laquelle il va lui parler du petit quart d'heure d'attente préparera le passage aux larmes touchantes que ce cabinet va voir répandre. Ce petit quart d'heure fut délicieux pour le princeil se promenait d'un pas ferme et égalil régnait. Il s'agit ici de ne rien dire qui ne soit parfaitement à sa place; quels que soient mes sentiments envers la duchesseil ne faut point oublier que c'est une des plus grandes dames de ma cour. Comment Louis XIV parlait-il aux princesses ses filles quand il avait lieu d'en être mécontent? et ses yeux s'arrêtèrent sur le portrait du grand roi.
Le plaisant de la chose c'est que le prince ne songea point à se demander s'il ferait grâce à Fabrice et quelle serait cette grâce. Enfinau bout de vingt minutesle fidèle Fontana se présenta de nouveau à la portemais sans rien dire.-- La duchesse Sanseverina peut entrercria le prince d'un air théâtral. Les larmes vont commencerse dit-iletcomme pour se préparer à un tel spectacleil tira son mouchoir.
Jamais la duchesse n'avait été aussi leste et aussi jolie; elle n'avait pas vingt-cinq ans. En voyant son petit pas léger et rapide effleurer à peine les tapisle pauvre aide de camp fut sur le point de perdre tout à fait la raison.
-- J'ai bien des pardons à demander à Votre Altesse Sérénissimedit la duchesse de sa petite voix légère et gaiej'ai pris la liberté de me présenter devant elle avec un habit qui n'est pas précisément convenablemais Votre Altesse m'a tellement accoutumée à ses bontés que j'ai osé espérer qu'elle voudrait bien m'accorder encore cette grâce.
La duchesse parlait assez lentementafin de se donner le temps de jouir de la figure du prince; elle était délicieuse à cause de l'étonnement profond et du reste de grands airs que la position de la tête et des bras accusait encore. Le prince était resté comme frappé de la foudre; de sa petite voix aigre et troubléeil s'écriait de temps à autre en articulant à peine: Comment! comment! La duchessecomme par respectaprès avoir fini son complimentlui laissa tout le temps de répondre; puis elle ajouta:
-- J'ose espérer que Votre Altesse Sérénissime daigne me pardonner l'incongruité de mon costume; maisen parlant ainsises yeux moqueurs brillaient d'un si vif éclat que le prince ne put le supporter; il regarda au plafondce qui chez lui était le dernier signe du plus extrême embarras.
-- Comment! comment! dit-il encore; puis il eut le bonheur de trouver une phrase: -- Madame la duchesse asseyez-vous donc; il avança lui-même un fauteuil et avec assez de grâce. La duchesse ne fut point insensible à cette politesseelle modéra la pétulance de son regard.
-- Comment! comment! répéta encore le prince en s'agitant dans son fauteuilsur lequel on eût dit qu'il ne pouvait trouver de position solide.
-- Je vais profiter de la fraîcheur de la nuit pour courir la postereprit la duchesseetcomme mon absence peut être de quelque duréeje n'ai point voulu sortir des états de Son Altesse Sérénissime sans la remercier de toutes les bontés que depuis cinq années elle a daigné avoir pour moi. A ces mots le prince comprit enfin; il devint pâle: c'était l'homme du monde qui souffrait le plus de se voir trompé dans ses prévisions; puis il prit un air de grandeur tout à fait digne du portrait de Louis XIV qui était sous ses yeux. A la bonne heurese dit la duchessevoilà un homme.
-- Et quel est le motif de ce départ subit? dit le prince d'un ton assez ferme.
-- J'avais ce projet depuis longtempsrépondit la duchesseet une petite insulte que l'on fait à Monsignore del Dongo que demain l'on va condamner à mort ou aux galèresme fait hâter mon départ.
-- Et dans quel ville allez-vous?
-- A Naplesje pense. Elle ajouta en se levant: Il ne me reste plus qu'à prendre congé de Votre Altesse Sérénissime et à la remercier très humblement de ses anciennes bontés. A son tourelle partait d'un air si ferme que le prince vit bien que dans deux secondes tout serait fini; l'éclat du départ ayant eu lieuil savait que tout arrangement était impossible; elle n'était pas femme à revenir sur ses démarches. Il courut après elle.
-- Mais vous savez bienmadame la duchesselui dit-il en lui prenant la mainque toujours je vous ai aiméeet d'une amitié à laquelle il ne tenait qu'à vous de donner un autre nom. Un meurtre a été commisc'est ce qu'on ne saurait nier; j'ai confié l'instruction du procès à mes meilleurs juges...
A ces motsla duchesse se releva de toute sa hauteur; toute apparence de respect et même d'urbanité disparut en un clin d'oeil: la femme outragée parut clairementet la femme outragée s'adressant à un être qu'elle sait de mauvaise foi. Ce fut avec l'expression de la colère la plus vive et même du méprisqu'elle dit au prince en pesant sur tous les mots:
-- Je quitte à jamais les états de Votre Altesse Sérénissimepour ne jamais entendre parler du fiscal Rassiet des autres infâmes assassins qui ont condamné à mort mon neveu et tant d'autres; si Votre Altesse Sérénissime ne veut pas mêler un sentiment d'amertume aux derniers instants que je passe auprès d'un prince poli et spirituel quand il n'est pas trompéje la prie très humblement de ne pas me rappeler l'idée de ces juges infâmes qui se vendent pour mille écus ou une croix.
L'accent admirable et surtout vrai avec lequel furent prononcées ces paroles fit tressaillir le prince; il craignit un instant de voir sa dignité compromise par une accusation encore plus directemais au total sa sensation finit bientôt par être de plaisir: il admirait la duchesse; l'ensemble de sa personne atteignit en ce moment une beauté sublime. Grand Dieu! qu'elle est bellese dit le prince; on doit passer quelque chose à une femme unique et telle que peut-être il n'en existe pas une seconde dans toute l'Italie... Eh bien! avec un peu de bonne politique il ne serait peut-être pas impossible d'en faire un jour ma maîtresse; il y a loin d'un tel être à cette poupée de marquise Balbiet qui encore chaque année vole au moins trois cent mille francs à mes pauvres sujets... Mais l'ai-je bien entendu? pensa-t-il tout à coup; elle a dit: condamné mon neveu et tant d'autres; alors la colère surnageaet ce fut avec une hauteur digne du rang suprême que le prince ditaprès un silence:-- Et que faudrait-il faire pour que madame ne partît point?
-- Quelque chose dont vous n'êtes pas capablerépliqua la duchesse avec l'accent de l'ironie la plus amère et du mépris le moins déguisé.
Le prince était hors de luimais il devait à l'habitude de son métier de souverain absolu la force de résister à un premier mouvement. Il faut avoir cette femmese dit-ilc'est ce que je me doispuis il faut la faire mourir par le mépris... Si elle sort de ce cabinetje ne la revois jamais. Maisivre de colère et de haine comme il l'était en ce momentoù trouver un mot qui pût satisfaire à la fois à ce qu'il se devait à lui-même et porter la duchesse à ne pas déserter sa cour à l'instant? On ne peutse dit-ilni répéter ni tourner en ridicule un gesteet il alla se placer entre la duchesse et la porte de son cabinet. Peu après il entendit gratter à cette porte.
-- Quel est le jean-sucres'écria-t-il en jurant de toute la force de ses poumonsquel est le jean-sucre qui vient ici m'apporter sa sotte présence? Le pauvre général Fontana montra sa figure pâle et totalement renverséeet ce fut avec l'air d'un homme à l'agonie qu'il prononça ces mots mal articulés: Son Excellence le comte Mosca sollicite l'honneur d'être introduit.
-- Qu'il entre! dit le prince en criant; et comme Mosca saluait:
-- Eh bien! lui dit-ilvoici Mme la duchesse Sanseverina qui prétend quitter Parme à l'instant pour aller s'établir à Napleset qui par-dessus le marché me dit des impertinences.
-- Comment! dit Mosca pâlissant.
-- Quoi! vous ne saviez pas ce projet de départ?
-- Pas la première parole; j'ai quitté madame à six heuresjoyeuse et contente.
Ce mot produisit sur le prince un effet incroyable. D'abord il regarda Mosca; sa pâleur croissante lui montra qu'il disait vrai et n'était point complice du coup de tête de la duchesse. En ce casse dit-ilje la perds pour toujours; plaisir et vengeance tout s'envole en même temps. A Naples elle fera des épigrammes avec son neveu Fabrice sur la grande colère du petit prince de Parme. Il regarda la duchesse; le plus violent mépris et la colère se disputaient son coeur; ses yeux étaient fixés en ce moment sur le comte Moscaet les contours si fins de cette belle bouche exprimaient le dédain le plus amer. Toute cette figure disait: vil courtisan! Ainsipensa le princeaprès l'avoir examinéeje perds ce moyen de la rappeler en ce pays. Encore en ce momentsi elle sort de ce cabinet elle est perdue pour moiDieu sait ce qu'elle dira de mes juges à Naples... Et avec cet esprit et cette force de persuasion divine que le ciel lui a donnéselle se fera croire de tout le monde. Je lui devrai la réputation d'un tyran ridicule qui se lève la nuit pour regarder sous son lit... Alorspar une manoeuvre adroite et comme cherchant à se promener pour diminuer son agitationle prince se plaça de nouveau devant la porte du cabinet; le comte était à sa droite à trois pas de distancepâledéfait et tellement tremblant qu'il fut obligé de chercher un appui sur le dos du fauteuil que la duchesse avait occupé au commencement de l'audienceet que le prince dans un mouvement de colère avait poussé au loin. Le comte était amoureux. Si la duchesse part je la suisse disait-il; mais voudra-t-elle de moi à sa suite? voilà la question.
A la gauche du princela duchesse deboutles bras croisés et serrés contre la poitrinele regardait avec une impertinence admirable; une pâleur complète et profonde avait succédé aux vives couleurs qui naguère animaient cette tête sublime.
Le princeau contraire des deux autres personnagesavait la figure rouge et l'air inquiet; sa main gauche jouait d'une façon convulsive avec la croix attachée au grand cordon de son ordre qu'il portait sous l'habit; de la main droite il se caressait le menton.
-- Que faut-il faire? dit-il au comtesans trop savoir ce qu'il faisait lui-même et entraîné par l'habitude de le consulter sur tout.
-- Je n'en sais rien en véritéAltesse Sérénissimerépondit le comte de l'air d'un homme qui rend le dernier soupir. Il pouvait à peine prononcer les mots de sa réponse. Le ton de cette voix donna au prince la première consolation que son orgueil blessé eût trouvée dans cette audienceet ce petit bonheur lui fournit une phrase heureuse pour son amour-propre.
-- Eh bien! dit-ilje suis le plus raisonnable des trois; je veux bien faire abstraction complète de ma position dans le monde. Je vais parler comme un amiet il ajoutaavec un beau sourire de condescendance bien imité des temps heureux de Louis XIVcomme on ami parlant à des amis : Madame la duchesseajouta-t-ilque faut-il faire pour vous faire oublier une résolution intempestive?
-- En véritéje n'en sais rienrépondit la duchesse avec un grand soupiren vérité je n'en sais rientant j'ai Parme en horreur. Il n'y avait nulle intention d'épigramme dans ce moton voyait que la sincérité même parlait par sa bouche.
Le comte se tourna vivement de son côté; l'âme du courtisan était scandalisée: puis il adressa au prince un regard suppliant. Avec beaucoup de dignité et de sang-froid le prince laissa passer un moment; puis s'adressant au comte:
-- Je voisdit-ilque votre charmante amie est tout à fait hors d'elle-même; c'est tout simpleelle adore son neveu. Etse tournant vers la duchesseil ajoutaavec le regard le plus galant et en même temps de l'air que l'on prend pour citer le mot d'une comédie: Que faut-il faire pour plaire à ces beaux yeux?
La duchesse avait eu le temps de réfléchir; d'un ton ferme et lentet comme si elle eût dicté son ultimatumelle répondit:
-- Son Altesse m'écrirait une lettre gracieusecomme elle sait si bien les faire; elle me dirait quen'étant point convaincue de la culpabilité de Fabrice del Dongopremier grand vicaire de l'archevêqueelle ne signera point la sentence quand on viendra la lui présenteret que cette procédure injuste n'aura aucune suite à l'avenir.
-- Comment injuste! s'écria le prince en rougissant jusqu'au blanc des yeuxet reprenant sa colère.
-- Ce n'est pas tout! répliqua la duchesse avec une fierté romaine; dès ce soiretajouta-t-elle en regardant la penduleil est déjà onze heures et un quart; dès ce soir Son Altesse Sérénissime enverra dire à la marquise Raversi qu'elle lui conseille d'aller à la campagne pour se délasser des fatigues qu'a dû lui causer un certain procès dont elle parlait dans son salon au commencement de la soirée. Le duc se promenait dans son cabinet comme un homme furieux.
-- Vit-on jamais une telle femme?... s'écriait-il; elle me manque de respect.
La duchesse répondit avec une grâce parfaite:
-- De la vie je n'ai eu l'idée de manquer de respect à Son Altesse Sérénissime: Son Altesse a eu l'extrême condescendance de dire qu'elle parlait comme un ami à des amis. Je n'aidu resteaucune envie de rester à Parmeajouta-t-elle en regardant le comte avec le dernier mépris. Ce regard décida le princejusqu'ici fort incertainquoique ces paroles eussent semblé annoncer un engagement; il se moquait fort des paroles.
Il y eut encore quelques mots d'échangésmais enfin le comte Mosca reçut l'ordre d'écrire le billet gracieux sollicité par la duchesse. Il omit la phrase: cette procédure injuste n'aura aucune suite a l'avenir. Il suffitse dit le comteque le prince promette de ne point signer la sentence qui lui sera présentée. Le prince le remercia d'un coup d'oeil en signant.
Le comte eut grand tortle prince était fatigué et eût tout signé; il croyait se bien tirer de la scèneet toute l'affaire était dominée à ses yeux par ces mots: «Si la duchesse partje trouverai ma cour ennuyeuse avant huit jours. » Le comte remarqua que le maître corrigeait la date et mettait celle du lendemain. Il regarda la penduleelle marquait près de minuit. Le ministre ne vit dans cette date corrigée que l'envie pédantesque de faire preuve d'exactitude et de bon gouvernement. Quant à l'exil de la marquise Raversiil ne fit pas un pli; le prince avait un plaisir particulier à exiler les gens.
-- Général Fontanas'écria-t-il en entrouvrant la porte.
Le général parut avec une figure tellement étonnée et tellement curieusequ'il y eut échange d'un regard gai entre la duchesse et le comteet ce regard fit la paix.
-- Général Fontanadit le princevous allez monter dans ma voiture qui attend sous la colonnade; vous irez chez la marquise Raversivous vous ferez annoncer; si elle est au litvous ajouterez que vous venez de ma partetarrivé dans sa chambrevous direz ces précises paroleset non d'autres: «Madame la marquise RaversiSon Altesse Sérénissime vous engage à partir demainavant huit heures du matinpour votre château de Velleja; Son Altesse vous fera connaître quand vous pourrez revenir à Parme. »
Le prince chercha des yeux ceux de la duchesselaquellesans le remercier comme il s'y attendaitlui fit une révérence extrêmement respectueuse et sortit rapidement.
-- Quelle femme! dit le prince en se tournant vers le comte Mosca.
Celui-ciravi de l'exil de la marquise Raversi qui facilitait toutes ses actions comme ministreparla pendant une grosse demi-heure en courtisan consommé; il voulait consoler l'amour-propre du souverainet ne prit congé que lorsqu'il le vit bien convaincu que l'histoire anecdotique de Louis XIV n'avait pas de page plus belle que celle qu'il venait de fournir à ses historiens futurs.
En rentrant chez ellela duchesse ferma sa porteet dit qu'on n'admît personnepas même le comte. Elle voulait se trouver seule avec elle-mêmeet voir un peu quelle idée elle devait se former de la scène qui venait d'avoir lieu. Elle avait agi au hasard et pour se faire plaisir au moment même; mais à quelque démarche qu'elle se fût laissé entraîner elle y eût tenu avec fermeté. Elle ne se fût point blâmée en revenant au sang-froidencore moins repentie: tel était le caractère auquel elle devait d'être encore à trente-six ans la plus jolie femme de la cour.
Elle rêvait en ce moment à ce que Parme pouvait offrir d'agréablecomme elle eût fait au retour d'un long voyagetant de neuf heures à onze elle avait cru fermement quitter ce pays pour toujours.
Ce pauvre comte a fait une plaisante figure lorsqu'il a connu mon départ en présence du prince... Au faitc'est un homme aimable et d'un coeur bien rare! Il eût quitté ses ministères pour me suivre... Mais aussi pendant cinq années entières il n'a pas eu une distraction à me reprocher. Quelles femmes mariées à l'autel pourraient en dire autant à leur seigneur et maître? Il faut convenir qu'il n'est point importantpoint pédantil ne donne nullement l'envie de le tromper; devant moi il semble toujours avoir honte de sa puissance... Il faisait une drôle de figure en présence de son seigneur et maître; s'il était là je l'embrasserais... Mais pour rien au monde je ne me chargerais d'amuser un ministre qui a perdu son portefeuillec'est une maladie dont on ne guérit qu'à la mortet... qui fait mourir. Quel malheur ce serait d'être ministre jeune! Il faut que je le lui écrivec'est une de ces choses qu'il doit savoir officiellement avant de se brouiller avec son prince... Mais j'oubliais mes bons domestiques.
La duchesse sonna. Ses femmes étaient toujours occupées à faire des malles; la voiture était avancée sous le portique et on la chargeait; tous les domestiques qui n'avaient pas de travail à faire entouraient cette voitureles larmes aux yeux. La Chékinaqui dans les grandes occasions entrait seule chez la duchesselui apprit tous ces détails.
-- Fais-les monterdit la duchesse; un instant après elle passa dans la salle d'attente.
-- On m'a promisleur dit-elleque la sentence contre mon neveu ne serait pas signée par lesouverain (c'est ainsi qu'on parle en Italie); je suspens mon départ; nous verrons si mes ennemis auront le crédit de faire changer cette résolution.
Après un petit silenceles domestiques se mirent à crier: Vive madame la duchesse! et applaudirent avec fureur. La duchessequi était déjà dans la pièce voisinereparut comme une actrice applaudiefit une petite révérence pleine de grâce à ses gens et leur dit: Mes amisje vous remercie. Si elle eût dit un mottousen ce momenteussent marché contre le palais pour l'attaquer. Elle fit un signe à un postillonancien contrebandier et homme dévouéqui la suivit.
-- Tu vas t'habiller en paysan aisétu sortiras de Parme comme tu pourrastu loueras une sediola et tu iras aussi vite que possible à Bologne. Tu entreras à Bologne en promeneur et par la porte de Florenceet tu remettras à Fabricequi est au Pelegrinoun paquet que Chékina va te donner. Fabrice se cache et s'appelle là-bas M. Joseph Bossi; ne va pas le trahir par étourderien'aie pas l'air de le connaître; mes ennemis mettront peut-être des espions à tes trousses. Fabrice te renverra ici au bout de quelques heures ou de quelques jours: c'est surtout en revenant qu'il faut redoubler de précautions pour ne pas le trahir.
-- Ah! les gens de la marquise Raversi! s'écria le postillon; nous les attendonset si madame voulait ils seraient bientôt exterminés.
-- Un jour peut-être! mais gardez-vous sur votre tête de rien faire sans mon ordre.
C'était la copie du billet du prince que la duchesse voulait envoyer à Fabrice; elle ne put résister au plaisir de l'amuseret ajouta un mot sur la scène qui avait amené le billet; ce mot devint une lettre de dix pages. Elle fit rappeler le postillon.
-- Tu ne peux partirlui dit-ellequ'à quatre heuresà porte ouvrante.
-- Je comptais passer par le grand égoutj'aurais de l'eau jusqu'au mentonmais je passerais.
-- Nondit la duchesseje ne veux pas exposer à prendre la fièvre un de mes plus fidèles serviteurs. Connais-tu quelqu'un chez monseigneur l'archevêque?
-- Le second cocher est mon ami.
-- Voici une lettre pour ce saint prélat: introduis-toi sans bruit dans son palaisfais-toi conduire chez le valet de chambre; je ne voudrais pas qu'on réveillât monseigneur. S'il est déjà renfermé dans sa chambrepasse la nuit dans le palaisetcomme il est dans l'usage de se lever avec le jourdemain matinà quatre heuresfais-toi annoncer de ma partdemande sa bénédiction au saint archevêqueremets-lui le paquet que voiciet prends les lettres qu'il te donnera peut-être pour Bologne.
La duchesse adressait à l'archevêque l'original même du billet du prince; comme ce billet était relatif à son premier grand vicaireelle le priait de le déposer aux archives de l'archevêchéoù elle espérait que messieurs les grands vicaires et les chanoinescollègues de son neveuvoudraient bien en prendre connaissance; le tout sous la condition du plus profond secret.
La duchesse écrivait à monseigneur Landriani avec une familiarité qui devait charmer ce bon bourgeois; la signature seule avait trois lignes; la lettrefort amicaleétait suivie de ces mots: Angelina-Cornelia-Isola Valsera del Dongoduchesse Sanseverina.
Je n'en ai pas tant écritje pensese dit la duchesse en riantdepuis mon contrat de mariage avec le pauvre duc; mais on ne mène ces gens-là que par ces choseset aux yeux des bourgeois la caricature fait beauté. Elle ne put pas finir la soirée sans céder à la tentation d'écrire une lettre de persiflage au pauvre comte; elle lui annonçait officiellementpour sa gouvernedisait-elledans ses rapports avec les têtes couronnéesqu'elle ne se sentait pas capable d'amuser un ministre disgracié. «Le prince vous fait peur; quand vous ne pourrez plus le voirce serait donc à moi à vous faire peur? » Elle fit porter sur-le-champ cette lettre.
De son côtéle lendemain dès sept heures du matinle prince manda le comte Zurlaministre de l'intérieur.-- De nouveaului dit-ildonnez les ordres les plus sévères à tous les podestats pour qu'ils fassent arrêter le sieur Fabrice del Dongo. On nous annonce que peut-être il osera reparaître dans nos états. Ce fugitif se trouvant à Bologneoù il semble braver les poursuites de nos tribunauxplacez des sbires qui le connaissent personnellement1° dans les villages sur la route de Bologne à Parme; 2° aux environs du château de la duchesse Sanseverinaà Saccaet de sa maison de Castelnovo; 3° autour du château du comte Mosca. J'ose espérer de votre haute sagessemonsieur le comteque vous saurez dérober la connaissance de ces ordres de votre souverain à la pénétration du comte Mosca. Sachez que je veux que l'on arrête le sieur Fabrice del Dongo.
Dès que ce ministre fut sortiune porte secrète introduisit chez le prince le fiscal général Rassiqui s'avança plié en deux et saluant à chaque pas. La mine de ce coquin-là était à peindre; elle rendait justice à toute l'infamie de son rôleettandis que les mouvements rapides et désordonnés de ses yeux trahissaient la connaissance qu'il avait de ses méritesl'assurance arrogante et grimaçante de sa bouche montrait qu'il savait lutter contre le mépris.
Comme ce personnage va prendre une assez grande influence sur la destinée de Fabriceon peut en dire un mot. Il était grandil avait de beaux yeux fort intelligentsmais un visage abîmé par la petite vérole; pour de l'espritil en avaitet beaucoup et du plus fin; on lui accordait de posséder parfaitement la science du droitmais c'était surtout par l'esprit de ressource qu'il brillait. De quelque sens que pût se présenter une affaireil trouvait facilementet en peu d'instantsles moyens fort bien fondés en droit d'arriver à une condamnation ou à un acquittement; il était surtout le roi des finesses de procureur.
A cet hommeque de grandes monarchies eussent envié au prince de Parmeon ne connaissait qu'une passion: être en conversation intime avec de grands personnages et leur plaire par des bouffonneries. Peu lui importait que l'homme puissant rît de ce qu'il disaitou de sa propre personneou fît des plaisanteries révoltantes sur Mme Rassi; pourvu qu'il le vît rire et qu'on le traitât avec familiaritéil était content. Quelquefois le princene sachant plus comment abuser de la dignité de ce grand jugelui donnait des coups de pied; si les coups de pied lui faisaient malil se mettait à pleurer. Mais l'instinct de bouffonnerie était si puissant chez luiqu'on le voyait tous les jours préférer le salon d'un ministre qui le bafouaità son propre salon où il régnait despotiquement sur toutes les robes noires du pays. Le Rassi s'était surtout fait une position à parten ce qu'il était impossible au noble le plus insolent de pouvoir l'humilier; sa façon de se venger des injures qu'il essuyait toute la journée était de les raconter au princeauquel il s'était acquis le privilège de tout dire; il est vrai que souvent la réponse était un soufflet bien appliqué et qui faisait malmais il ne s'en formalisait aucunement. La présence de ce grand juge distrayait le prince dans ses moments de mauvaise humeuralors il s'amusait à l'outrager. On voit que Rassi était à peu près l'homme parfait à la cour: sans honneur et sans humeur.
-- Il faut du secret avant toutlui cria le prince sans le salueret le traitant tout à fait comme un cuistrelui qui était si poli avec tout le monde. De quand votre sentence est-elle datée?
-- Altesse Sérénissimed'hier matin.
-- De combien de juges est-elle signée?
-- De tous les cinq.
-- Et la peine?
-- Vingt ans de forteressecomme Votre Altesse Sérénissime me l'avait dit.
-- La peine de mort eût révoltédit le prince comme se parlant à soi-mêmec'est dommage! Quel effet sur cette femme! Mais c'est un del Dongoet ce nom est révéré dans Parmeà cause des trois archevêques presque successifs... Vous me dites vingt ans de forteresse?
-- OuiAltesse Sérénissimereprit le fiscal Rassi toujours debout et plié en deuxavecau préalableexcuse publique devant le portrait de Son Altesse Sérénissime; de plusjeûne au pain et à l'eau tous les vendredis et toutes les veilles des fêtes principalesle sujet étant d'une impiété notoire. Ceci pour l'avenir et pour casser le cou à sa fortune.
-- Ecrivezdit le prince: «Son Altesse Sérénissime ayant daigné écouter avec bonté les très humbles supplications de la marquise del Dongomère du coupableet de la duchesse Sanseverinasa tantelesquelles ont représenté qu'à l'époque du crime leur fils et neveu était fort jeune et d'ailleurs égaré par une folle passion conçue pour la femme du malheureux Gilettia bien voulumalgré l'horreur inspirée par un tel meurtrecommuer la peine à laquelle Fabrice del Dongo a été condamnéen celle de douze années de forteresse. »
-- Donnez que je signe.
-- Le prince signa et data de la veille; puisrendant la sentence à Rassiil lui dit: Ecrivez immédiatement au-dessous de ma signature: «La duchesse Sanseverina s'étant derechef jetée aux genoux de Son Altessele prince a permis que tous les jeudis le coupable ait une heure de promenade sur la plate-forme de la tour carrée vulgairement appelée tour Farnèse. »
-- Signez celadit le princeet surtout bouche closequoi que vous puissiez entendre annoncer par la ville. Vous direz au conseiller Dé Capitaniqui a voté pour deux ans de forteresse et qui a même péroré en faveur de cette opinion ridiculeque je l'engage à relire les lois et règlements. Derechefsilenceet bonsoir. Le fiscal Rassi fitavec beaucoup de lenteurtrois profondes révérences que le prince ne regarda pas.
Ceci se passait à sept heures du matin. Quelques heures plus tardla nouvelle de l'exil de la marquise Raversi se répandait dans la ville et dans les caféstout le monde parlait à la fois de ce grand événement. L'exil de la marquise chassa pour quelque temps de Parme cet implacable ennemi des petites villes et des petites coursl'ennui. Le général Fabio Contiqui s'était cru ministreprétexta une attaque de goutteet pendant plusieurs jours ne sortit point de sa forteresse. La bourgeoisie et par suite le petit peuple conclurentde ce qui se passaitqu'il était clair que le prince avait résolu de donner l'archevêché de Parme à Monsignore del Dongo. Les fins politiques de café allèrent même jusqu'à prétendre qu'on avait engagé le père Landrianil'archevêque actuelà feindre une maladie et à présenter sa démission; on lui accorderait une grosse pension sur la ferme du tabacils en étaient sûrs: ce bruit vint jusqu'à l'archevêque qui s'en alarma fortet pendant quelques jours son zèle pour notre héros en fut grandement paralysé. Deux mois aprèscette belle nouvelle se trouvait dans les journaux de Parisavec ce petit changementque c'était le comte de Moscaneveu de la duchesse de Sanseverinaqui allait être fait archevêque.
La marquise Raversi était furibonde dans son château de Velleja ; ce n'était point une femmelettede celles qui croient se venger en lançant des propos outrageants contre leurs ennemis. Dès le lendemain de sa disgrâcele chevalier Riscara et trois autres de ses amis se présentèrent au prince par son ordreet lui demandèrent la permission d'aller la voir à son château. L'Altesse reçut ces messieurs avec une grâce parfaiteet leur arrivée à Velleja fut une grande consolation pour la marquise. Avant la fin de la seconde semaineelle avait trente personnes dans son châteautous ceux que le ministère libéral devait porter aux places. Chaque soir la marquise tenait un conseil régulier avec les mieux informés de ses amis. Un jour qu'elle avait reçu beaucoup de lettres de Parme et de Bologneelle se retira de bonne heure: la femme de chambre favorite introduisit d'abord l'amant régnantle comte Baldijeune homme d'une admirable figure et fort insignifiant; et plus tardle chevalier Riscara son prédécesseur: celui-ci était un petit homme noir au physique et au moralquiayant commencé par être répétiteur de géométrie au collège des nobles à Parmese voyait maintenant conseiller d'état et chevalier de plusieurs ordres.
-- J'ai la bonne habitudedit la marquise à ces deux hommesde ne détruire jamais aucun papieret bien m'en prend; voici neuf lettres que la Sanseverina m'a écrites en différentes occasions. Vous allez partir tous les deux pour Gênesvous chercherez parmi les galériens un ex-notaire nommé Buraticomme le grand poète de Veniseou Durati. Vouscomte Baldiplacez-vous à mon bureau et écrivez ce que je vais vous dicter. «Une idée me vient et je t'écris ce mot. Je vais à ma chaumière près de Castelnovo; si tu veux venir passer douze heures avec moije serai bien heureuse: il n'y ace me semblepas grand danger après ce qui vient de se passer; les nuages s'éclaircissent. Cependant arrête-toi avant d'entrer dans Castelnovo; tu trouveras sur la route un de mes gensils t'aiment tous à la folie. Tu garderasbien entendule nom de Bossi pour ce petit voyage. On dit que tu as de la barbe comme le plus admirable capucinet l'on ne t'a vu à Parme qu'avec la figure décente d'un grand vicaire. »
-- Comprends-tuRiscara?
-- Parfaitement; mais le voyage à Gênes est un luxe inutile; je connais un homme dans Parme quià la véritén'est pas encore aux galèresmais qui ne peut manquer d'y arriver. Il contrefera admirablement l'écriture de la Sanseverina.
A ces motsle comte Baldi ouvrit démesurément ses yeux si beaux; il comprenait seulement.
-- Si tu connais ce digne personnage de Parmepour lequel tu espères de l'avancementdit la marquise à Riscaraapparemment qu'il te connaît aussi; sa maîtresseson confesseurson ami peuvent être vendus à la Sanseverina; j'aime mieux différer cette petite plaisanterie de quelques jourset ne m'exposer à aucun hasard. Partez dans deux heures comme de bons petits agneauxne voyez âme qui vive à Gênes et revenez bien vite. Le chevalier Riscara s'enfuit en riantet parlant du nez comme Polichinelle: Il faut préparer les paquetsdisait-il en courant d'une façon burlesque. Il voulait laisser Baldi seul avec la dame. Cinq jours aprèsRiscara ramena à la marquise son comte Baldi tout écorché: pour abréger de six lieueson lui avait fait passer une montagne à dos de mulet; il jurait qu'on ne le reprendrait plus à faire de grands voyages. Baldi remit à la marquise trois exemplaires de la lettre qu'elle lui avait dictéeet cinq ou six autres lettres de la même écriturecomposées par Riscaraet dont on pourrait peut-être tirer parti par la suite. L'une de ces lettres contenait de fort jolies plaisanteries sur les pleurs que le prince avait la nuitet sur la déplorable maigreur de la marquise Baldisa maîtresselaquelle laissaitdit-onla marque d'une pincette sur le coussin des bergères après s'y être assise un instant. On eût juré que toutes ces lettres étaient écrites de la main de Mme Sanseverina.
-- Maintenant je sais à n'en pas douterdit la marquiseque l'ami du coeurque le Fabrice est à Bologne ou dans les environs...
-- Je suis trop malades'écria le comte Baldi en l'interrompant; je demande en grâce d'être dispensé de ce second voyageou du moins je voudrais obtenir quelques jours de repos pour remettre ma santé.
-- Je vais plaider votre causedit Riscara; il se leva et parla bas à la marquise.
-- Eh bien! soitj'y consensrépondit-elle en souriant.
-- Rassurez-vousvous ne partirez pointdit la marquise à Baldi d'un air assez dédaigneux.
-- Mercis'écria celui-ci avec l'accent du coeur. En effetRiscara monta seul en chaise de poste. Il était à peine à Bologne depuis deux jourslorsqu'il aperçut dans une calèche Fabrice et la petite Marietta. Diable! se dit-ilil paraît que notre futur archevêque ne se gêne point; il faudra faire connaître ceci à la duchessequi en sera charmée. Riscara n'eut que la peine de suivre Fabrice pour savoir son logement; le lendemain matincelui-ci reçut par un courrier la lettre de fabrique génoise; il la trouva un peu courtemais du reste n'eut aucun soupçon. L'idée de revoir la duchesse et le comte le rendit fou de bonheuret quoi que pût dire Ludovicil prit un cheval à la poste et partit au galop. Sans s'en douteril était suivi à peu de distance par le chevalier Riscaraquien arrivantà six lieues de Parmeà la poste avant Castelnovoeut le plaisir de voir un grand attroupement dans la place devant la prison du lieu; on venait d'y conduire notre hérosreconnu à la postecomme il changeait de chevalpar deux sbires choisis et envoyés par le comte Zurla.
Les petits yeux du chevalier Riscara brillèrent de joie; il vérifia avec une patience exemplaire tout ce qui venait d'arriver dans ce petit villagepuis expédia un courrier à la marquise Raversi. Après quoicourant les rues comme pour voir l'église fort curieuseet ensuite pour chercher un tableau du Parmesan qu'on lui avait dit exister dans le paysil rencontra enfin le podestat qui s'empressa de rendre ses hommages à un conseiller d'état. Riscara eut l'air étonné qu'il n'eût pas envoyé sur-le-champ à la citadelle de Parme le conspirateur qu'il avait eu le bonheur de faire arrêter.
-- On pourrait craindreajouta Riscara d'un air froid que ses nombreux amis qui le cherchaient avant-hier pour favoriser son passage à travers les états de Son Altesse Sérénissimene rencontrent les gendarmes; ces rebelles étaient bien douze ou quinze à cheval.
-- Intelligenti pauca! s'écria le podestat d'un air malin.
Livre Second
Chapitre XV.
Deux heures plus tardle pauvre Fabricegarni de menottes et attaché par une longue chaîne à la sediola même dans laquelle on l'avait fait monterpartait pour la citadelle de Parmeescorté par huit gendarmes. Ceux-ci avaient l'ordre d'emmener avec eux tous les gendarmes stationnés dans les villages que le cortège devait traverser; le podestat lui-même suivait ce prisonnier d'importance. Sur les sept heures après midila sediolaescortée par tous les gamins de Parme et par trente gendarmestraversa la belle promenadepassa devant le petit palais qu'habitait la Fausta quelques mois auparavant et enfin se présenta à la porte extérieure de la citadelle à l'instant où le général Fabio Conti et sa fille allaient sortir. La voiture du gouverneur s'arrêta avant d'arriver au pont-levis pour laisser entrer la sediola à laquelle Fabrice était attaché; le général cria aussitôt que l'on fermât les portes de la citadelleet se hâta de descendre au bureau d'entrée pour voir un peu ce dont il s'agissait; il ne fut pas peu surpris quand il reconnut le prisonnierlequel était devenu tout raideattaché à sa sediola pendant une aussi longue route; quatre gendarmes l'avaient enlevé et le portaient au bureau d'écrou. J'ai donc en mon pouvoirse dit le vaniteux gouverneurce fameux Fabrice del Dongodont on dirait que depuis près d'un an la haute société de Parme a juré de s'occuper exclusivement!
Vingt fois le général l'avait rencontré à la courchez la duchesse et ailleurs; mais il se garda bien de témoigner qu'il le connaissait; il eût craint de se compromettre.
-- Que l'on dressecria-t-il au commis de la prisonun procès-verbal fort circonstancié de la remise qui m'est faite du prisonnier par le digne podestat de Castelnovo.
Barbonele commispersonnage terrible par le volume de sa barbe et sa tournure martialeprit un air plus important que de coutumeon eût dit un geôlier allemand. Croyant savoir que c'était surtout la duchesse Sanseverina qui avait empêché son maîtrele gouverneurde devenir ministre de la guerreil fut d'une insolence plus qu'ordinaire envers le prisonnier; il lui adressait la parole en l'appelant voice qui est en Italie la façon de parler aux domestiques.
-- Je suis prélat de la sainte Eglise romainelui dit Fabrice avec fermetéet grand vicaire de ce diocèse; ma naissance seule me donne droit aux égards.
-- Je n'en sais rien! répliqua le commis avec impertinence; prouvez vos assertions en exhibant les brevets qui vous donnent droit à ces titres fort respectables. Fabrice n'avait point de brevets et ne répondit pas. Le général Fabio Contidebout à côté de son commisle regardait écrire sans lever les yeux sur le prisonnier afin de n'être pas obligé de dire qu'il était réellement Fabrice del Dongo.
Tout à coup Clélia Contiqui attendait en voiture entendit un tapage effroyable dans le corps de garde. Le commis Barbone faisant une description insolente et fort longue de la personne du prisonnierlui ordonna d'ouvrir ses vêtementsafin que l'on pût vérifier et constater le nombre et l'état des égratignures reçues lors de l'affaire Giletti.
-- Je ne puisdit Fabrice souriant amèrement; je me trouve hors d'état d'obéir aux ordres de monsieurles menottes m'en empêchent!
-- Quoi! s'écria le général d'un air naïfle prisonnier a des menottes! dans l'intérieur de la forteresse! cela est contre les règlementsil faut un ordre ad hoc ; ôtez-lui les menottes.
Fabrice le regarda. Voilà un plaisant jésuite! pensa-t-il; il y a une heure qu'il me voit ces menottes qui me gênent horriblementet il fait l'étonné!
Les menottes furent ôtées par les gendarmes; ils venaient d'apprendre que Fabrice était neveu de la duchesse Sanseverinaet se hâtèrent de lui montrer une politesse mielleuse qui faisait contraste avec la grossièreté du commis; celui-ci en parut piqué et dit à Fabrice qui restait immobile:
-- Allons donc! dépêchons! montrez-nous ces égratignures que vous avez reçues du pauvre Gilettilors de l'assassinat. D'un sautFabrice s'élança sur le commiset lui donna un soufflet telque le Barbone tomba de sa chaise sur les jambes du général. Les gendarmes s'emparèrent des bras de Fabrice qui restait immobile; le général lui-même et deux gendarmes qui étaient à ses côtés se hâtèrent de relever le commis dont la figure saignait abondamment. Deux gendarmes plus éloignés coururent fermer la porte du bureaudans l'idée que le prisonnier cherchait à s'évader. Le brigadier qui les commandait pensa que le jeune del Dongo ne pouvait pas tenter une fuite bien sérieusepuisque enfin il se trouvait dans l'intérieur de la citadelle; toutefois il s'approcha de la fenêtre pour empêcher le désordreet par un instinct de gendarme. Vis-à-vis de cette fenêtre ouverteet à deux passe trouvait arrêtée la voiture du général: Clélia s'était blottie dans le fondafin de ne pas être témoin de la triste scène qui se passait au bureau; lorsqu'elle entendit tout ce bruitelle regarda.
-- Que se passe-t-il? dit-elle au brigadier.
-- Mademoisellec'est le jeune Fabrice del Dongo qui vient d'appliquer un fier soufflet à cet insolent de Barbone!
-- Quoi! c'est M. del Dongo qu'on amène en prison?
-- Eh sans doutedit le brigadier; c'est à cause de la haute naissance de ce pauvre jeune homme que l'on fait tant de cérémonies; je croyais que mademoiselle était au fait. Clélia ne quitta plus la portière; quand les gendarmes qui entouraient la table s'écartaient un peuelle apercevait le prisonnier. Qui m'eût ditpensait-elleque je le reverrais pour la première fois dans cette triste situationquand je le rencontrai sur la route du lac de Côme?... Il me donna la main pour monter dans le carrosse de sa mère... Il se trouvait déjà avec la duchesse! Leurs amours avaient-ils commencé à cette époque?
Il faut apprendre au lecteur que dans le parti libéral dirigé par la marquise Raversi et le général Contion affectait de ne pas douter de la tendre liaison qui devait exister entre Fabrice et la duchesse. Le comte Moscaqu'on abhorraitétait pour sa duperie l'objet d'éternelles plaisanteries.
Ainsipensa Cléliale voilà prisonnier et prisonnier de ses ennemis! car au fondle comte Moscaquand on voudrait le croire un angeva se trouver ravi de cette capture.
Un accès de gros rire éclata dans le corps de garde.
-- Jacopodit-elle au brigadier d'une voix émue que se passe-t-il donc?
-- Le général a demandé avec vigueur au prisonnier pourquoi il avait frappé Barbone: Monsignore Fabrice a répondu froidement: il m'a appeléassassinqu'il montre les titres et brevets qui l'autorisent à me donner ce titre; et l'on rit.
Un geôlier qui savait écrire remplaça Barbone; Clélia vit sortir celui-ciqui essuyait avec son mouchoir le sang qui coulait en abondance de son affreuse figure: il jurait comme un païen: Ce f... Fabricedisait-il à très haute voixne mourra jamais que de ma main. Je volerai le bourreauetc.etc. Il s'était arrêté entre la fenêtre du bureau et la voiture du général pour regarder Fabriceet ses jurements redoublaient.
-- Passez votre cheminlui dit le brigadier; on ne jure point ainsi devant mademoiselle.
Barbone leva la tête pour regarder dans la voitureses yeux rencontrèrent ceux de Clélia à laquelle un cri d'horreur échappa; jamais elle n'avait vu d'aussi près une expression de figure tellement atroce. Il tuera Fabrice! se dit-elleil faut que je prévienne don Cesare. C'était son onclel'un des prêtres les plus respectables de la ville; le général Contison frèrelui avait fait avoir la place d'économe et de premier aumônier de la prison.
Le général remonta en voiture.
-- Veux-tu rentrer chez toidit-il à sa filleou m'attendre peut-être longtemps dans la cour du palais? il faut que j'aille rendre compte de tout ceci au souverain.
Fabrice sortait du bureau escorté par trois gendarmes; on le conduisait à la chambre qu'on lui avait destinée: Clélia regardait par la portièrele prisonnier était fort près d'elle. En ce moment elle répondit à la question de son père par ces mots: Je vous suivrai. Fabriceentendant prononcer ces paroles tout près de luileva les yeux et rencontra le regard de la jeune fille. Il fut frappé surtout de l'expression de mélancolie de sa figure. Comme elle est embelliepensa-t-ildepuis notre rencontre près de Côme! quelle expression de pensée profonde!... On a raison de la comparer à la duchessequelle physionomie angélique! Barbonele commis sanglantqui ne s'était pas placé près de la voiture sans intentionarrêta d'un geste les trois gendarmes qui conduisaient Fabriceetfaisant le tour de la voiture par derrièrepour arriver à la portière près de laquelle était le général:
-- Comme le prisonnier a fait acte de violence dans l'intérieur de la citadellelui dit-ilen vertu de l'article 157 du règlementn'y aurait-il pas lieu de lui appliquer les menottes pour trois jours?
-- Allez au diable! s'écria le généralque cette arrestation ne laissait pas d'embarrasser. Il s'agissait pour lui de ne pousser à bout ni la duchesse ni le comte Mosca: et d'ailleursdans quel sens le comte allait-il prendre cette affaire? au fondle meurtre d'un Giletti était une bagatelleet l'intrigue seule était parvenue à en faire quelque chose.
Durant ce court dialogueFabrice était superbe au milieu de ces gendarmesc'était bien la mine la plus fière et la plus noble; ses traits fins et délicatset le sourire de mépris qui errait sur ses lèvresfaisaient un charmant contraste avec les apparences grossières des gendarmes qui l'entouraient. Mais tout cela ne formait pour ainsi dire que la partie extérieure de sa physionomie; il était ravi de la céleste beauté de Cléliaet son oeil trahissait toute sa surprise. Elleprofondément pensiven'avait pas songé à retirer la tête de la portière; il la salua avec le demi- sourire le plus respectueux; puisaprès un instant:
-- Il me semblemademoisellelui dit-ilqu'autrefoisprès d'un lacj'ai déjà eu l'honneur de vous rencontrer avec accompagnement de gendarmes.
Clélia rougit et fut tellement interdite qu'elle ne trouva aucune parole pour répondre. Quel air noble au milieu de ces êtres grossiers! se disait-elle au moment où Fabrice lui adressa la parole. La profonde pitiéet nous dirons presque l'attendrissement où elle était plongéelui ôtèrent la présence d'esprit nécessaire pour trouver un mot quelconqueelle s'aperçut de son silence et rougit encore davantage. En ce moment on tirait avec violence les verrous de la grande porte de la citadellela voiture de Son Excellence n'attendait-elle pas depuis une minute au moins? Le bruit fut si violent sous cette voûtequequand même Clélia aurait trouvé quelque mot pour répondreFabrice n'aurait pu entendre ses paroles.
Emportée par les chevaux qui avaient pris le galop aussitôt après le pont-levisClélia se disait: Il m'aura trouvée bien ridicule! Puis tout à coup elle ajouta: non pas seulement ridicule; il aura cru voir en moi une âme basseil aura pensé que je ne répondais pas à son salut parce qu'il est prisonnier et moi fille du gouverneur.
Cette idée fut du désespoir pour cette jeune fille qui avait l'âme élevée. Ce qui rend mon procédé tout à fait avilissantajouta-t-ellec'est que jadisquand nous nous rencontrâmes pour la première foisaussi avec accompagnement de gendarmescomme il le ditc'était moi qui me trouvais prisonnièreet lui me rendait service et me tirait d'un fort grand embarras... Ouiil faut en convenirmon procédé est completc'est à la fois de la grossièreté et de l'ingratitude. Hélas! le pauvre jeune homme! maintenant qu'il est dans le malheur tout le monde va se montrer ingrat envers lui. Il m'avait bien dit alors: Vous souviendrez-vous de mon nom à Parme? Combien il me méprise à l'heure qu'il est! Un mot poli était si facile à dire! Il faut l'avouerouima conduite a été atroce avec lui. Jadissans l'offre généreuse de la voiture de sa mèrej'aurais dû suivre les gendarmes à pied dans la poussièreouce qui est bien pis monter en croupe derrière un de ces gens-là; c'était alors mon père qui était arrêté et moi sans défense! Ouimon procédé est complet. Et combien un être comme lui a dû le sentir vivement! Quel contraste entre sa physionomie si noble et mon procédé! Quelle noblesse! quelle sérénité! Comme il avait l'air d'un héros entouré de ses vils ennemis! Je comprends maintenant la passion de la duchesse: puisqu'il est ainsi au milieu d'un événement contrariant et qui peut avoir des suites affreusesquel ne doit-il pas paraître lorsque son âme est heureuse!
Le carrosse du gouverneur de la citadelle resta plus d'une heure et demi dans la cour du palaiset toutefois lorsque le général descendit de chez le princeClélia ne trouva point qu'il y fût resté trop longtemps.
-- Quelle est la volonté de Son Altesse? demanda Clélia.
-- Sa parole a dit: la prison! et son regard: la mort!
-- La mort! Grand Dieu! s'écria Clélia.
-- Allonstais-toi! reprit le général avec humeur; que je suis sot de répondre à un enfant!
Pendant ce tempsFabrice montait les trois cent quatre-vingts marches qui conduisaient à la tour Farnèsenouvelle prison bâtie sur la plate-forme de la grosse tourà une élévation prodigieuse. Il ne songea pas une seule foisdistinctement du moinsau grand changement qui venait de s'opérer dans son sort. Quel regard! se disait-il; que de choses il exprimait! quelle profonde pitié! Elle avait l'air de dire: la vie est un tel tissu de malheurs! Ne vous affligez point trop de ce qui vous arrive! est-ce que nous ne sommes point ici-bas pour être infortunés? Comme ses yeux si beaux restaient attachés sur moimême quand les chevaux s'avançaient avec tant de bruit sous la voûte!
Fabrice oubliait complètement d'être malheureux.
Clélia suivit son père dans plusieurs salons; au commencement de la soiréepersonne ne savait encore la nouvelle de l'arrestation du grand coupablecar ce fut le nom que les courtisans donnèrent deux heures plus tard à ce pauvre jeune homme imprudent.
On remarqua ce soir-là plus d'animation que de coutume dans la figure de Clélia; orl'animationl'air de prendre part à ce qui l'environnaitétaient surtout ce qui manquait à cette belle personne. Quand on comparait sa beauté à celle de la duchessec'était surtout cet air de n'être émue par riencette façon d'être comme au-dessus de toutes chosesqui faisaient pencher la balance en faveur de sa rivale. En Angleterreen Francepays de vanitéon eût été probablement d'un avis tout opposé. Clélia Conti était une jeune fille encore un peu trop svelte que l'on pouvait comparer aux belles figures du Guide; nous ne dissimulerons point quesuivant les données de la beauté grecqueon eût pu reprocher à cette tête des traits un peu marquéspar exempleles lèvres remplies de la grâce la plus touchante étaient un peu fortes.
L'admirable singularité de cette figure dans laquelle éclataient les grâces naïves et l'empreinte céleste de l'âme la plus noblec'est quebien que de la plus rare et de la plus singulière beautéelle ne ressemblait en aucune façon aux têtes de statues grecques. La duchesse avait au contraire un peu trop de la beauté connue de l'idéalet sa tête vraiment lombarde rappelait le sourire voluptueux et la tendre mélancolie des belles Hérodiades de Léonard de Vinci. Autant la duchesse était sémillantepétillante d'esprit et de malices'attachant avec passionsi l'on peut parler ainsià tous les sujets que le courant de la conversation amenait devant les yeux de son âmeautant Clélia se montrait calme et lente à s'émouvoirsoit par mépris de ce qui l'entouraitsoit par regret de quelque chimère absente. Longtemps on avait cru qu'elle finirait par embrasser la vie religieuse. A vingt ans on lui voyait de la répugnance à aller au balet si elle y suivait son pèrece n'était que par obéissance et pour ne pas nuire aux intérêts de son ambition.
Il me sera donc impossiblerépétait trop souvent l'âme vulgaire du généralle ciel m'ayant donné pour fille la plus belle personne des états de notre souverainet la plus vertueused'en tirer quelque parti pour l'avancement de ma fortune! Ma vie est trop isoléeje n'ai qu'elle au mondeet il me faut de toute nécessité une famille qui m'étaie dans le mondeet qui me donne un certain nombre de salonsoù mon mérite et surtout mon aptitude au ministère soient posés comme bases inattaquables de tout raisonnement politique. Eh bien! ma fille si bellesi sagesi pieuseprend de l'humeur dès qu'un jeune homme bien établi à la cour entreprend de lui faire agréer ses hommages. Ce prétendant est-il éconduitson caractère devient moins sombreet je la vois presque gaiejusqu'à ce qu'un autre épouseur se mette sur les rangs. Le plus bel homme de la courle comte Baldis'est présenté et a déplu: l'homme le plus riche des états de Son Altessele marquis Crescenzilui a succédéelle prétend qu'il ferait son malheur.
Décidémentdisait d'autres fois le généralles yeux de ma fille sont plus beaux que ceux de la duchesseen cela surtout qu'en de rares occasions ils sont susceptibles d'une expression plus profonde; mais cette expression magnifiquequand est-ce qu'on la lui voit? Jamais dans un salon où elle pourrait lui faire honneurmais bien à la promenadeseule avec moioù elle se laissera attendrirpar exemplepar le malheur de quelque manant hideux. Conserve quelque souvenir de ce regard sublimelui dis-je quelquefoispour les salons où nous paraîtrons ce soir. Point: daigne-t-elle me suivre dans le mondesa figure noble et pure offre l'expression assez hautaine et peu encourageante de l'obéissance passive. Le général n'épargnait aucune démarchecomme on voitpour se trouver un gendre convenablemais il disait vrai.
Les courtisansqui n'ont rien à regarder dans leur âmesont attentifs à tout: ils avaient remarqué que c'était surtout dans ces jours où Clélia ne pouvait prendre sur elle de s'élancer hors de ses chères rêveries et de feindre de l'intérêt pour quelque chose que la duchesse aimait à s'arrêter auprès d'elle et cherchait à la faire parler. Clélia avait des cheveux blonds cendrésse détachantpar un effet très douxsur des joues d'un coloris finmais en général un peu trop pâle. La forme seule du front eût pu annoncer à un observateur attentif que cet air si noblecette démarche tellement au-dessus des grâces vulgairestenaient à une profonde incurie pour tout ce qui est vulgaire. C'était l'absence et non pas l'impossibilité de l'intérêt pour quelque chose. Depuis que son père était gouverneur de la citadelleClélia se trouvait heureuseou du moins exempte de chagrinsdans son appartement si élevé. Le nombre effroyable de marches qu'il fallait monter pour arriver à ce palais du gouverneursitué sur l'esplanade de la grosse touréloignait les visites ennuyeuseset Cléliapar cette raison matériellejouissait de la liberté du couvent; c'était presque là tout l'idéal de bonheur quedans un tempselle avait songé à demander à la vie religieuse. Elle était saisie d'une sorte d'horreur à la seule pensée de mettre sa chère solitude et ses pensées intimes à la disposition d'un jeune hommeque le titre de mari autoriserait à troubler toute cette vie intérieure. Si par la solitude elle n'atteignait pas au bonheurdu moins elle était parvenue à éviter les sensations trop douloureuses.
Le jour où Fabrice fut conduit à la forteressela duchesse rencontra Clélia à la soirée du ministre de l'intérieurcomte Zurla; tout le monde faisait cercle autour d'elles: ce soir-làla beauté de Clélia l'emportait sur celle de la duchesse. Les yeux de la jeune fille avaient une expression si singulière et si profonde qu'ils en étaient presque indiscrets: il y avait de la pitiéil y avait aussi de l'indignation et de la colère dans ses regards. La gaieté et les idées brillantes de la duchesse semblaient jeter Clélia dans des moments de douleur allant jusqu'à l'horreur. Quels vont être les cris et les gémissements de la pauvre femmese disait-ellelorsqu'elle va savoir que son amantce jeune homme d'un si grand coeur et d'une physionomie si noblevient d'être jeté en prison! Et ces regards du souverain qui le condamnent à mort! O pouvoir absoluquand cesseras-tu de peser sur l'Italie! O âmes vénales et basses! Et je suis fille d'un geôlier! et je n'ai point démenti ce noble caractère en ne daignant pas répondre à Fabrice! et autrefois il fut mon bienfaiteur! Que pense-t-il de moi à cette heureseul dans sa chambre et en tête à tête avec sa petite lampe? Révoltée par cette idéeClélia jetait des regards d'horreur sur la magnifique illumination des salons du ministre de l'intérieur.
Jamaisse disait-on dans le cercle de courtisans qui se formait autour des deux beautés à la modeet qui cherchait à se mêler à leur conversationjamais elles ne se sont parlé d'un air si animé et en même temps si intime. La duchessetoujours attentive à conjurer les haines excitées par le premier ministreaurait-elle songé à quelque grand mariage en faveur de la Clélia? Cette conjecture était appuyée sur une circonstance qui jusque-là ne s'était jamais présentée à l'observation de la cour: les yeux de la jeune fille avaient plus de feuet mêmesi l'on peut ainsi direplus de passion que ceux de la belle duchesse. Celle-cide son côtéétait étonnéeetl'on peut dire à sa gloireravie des grâces si nouvelles qu'elle découvrait dans la jeune solitaire; depuis une heure elle la regardait avec un plaisir assez rarement senti à la vue d'une rivale. Mais que se passe-t-il donc? se demandait la duchesse; jamais Clélia n'a été aussi belleet l'on peut dire aussi touchante: son coeur aurait- il parlé?... Mais en ce cas-làcertesc'est de l'amour malheureuxil y a de la sombre douleur au fond de cette animation si nouvelle... Mais l'amour malheureux se tait! S'agirait-il de ramener un inconstant par un succès dans le monde? Et la duchesse regardait avec attention les jeunes gens qui les environnaient. Elle ne voyait nulle part d'expression singulièrec'était toujours de la fatuité plus ou moins contente. Mais il y a du miracle icise disait la duchessepiquée de ne pas deviner. Où est le comte Moscacet être si fin? Nonje ne me trompe pointClélia me regarde avec attention et comme si j'étais pour elle l'objet d'un intérêt tout nouveau. Est-ce l'effet de quelque ordre donné par son pèrece vil courtisan? Je croyais cette âme noble et jeune incapable de se ravaler à des intérêts d'argent. Le général Fabio Conti aurait-il quelque demande décisive à faire au comte?
Vers les dix heuresun ami de la duchesse s'approcha et lui dit deux mots à voix basse; elle pâlit excessivement; Clélia lui prit la main et osa la lui serrer.
-- Je vous remercie et je vous comprends maintenant... vous avez une belle âme! dit la duchessefaisant effort sur elle-même; elle eut à peine la force de prononcer ce peu de mots. Elle adressa beaucoup de sourires à la maîtresse de la maison qui se leva pour l'accompagner jusqu'à la porte du dernier salon: ces honneurs n'étaient dus qu'à des princesses de sang et faisaient pour la duchesse un cruel contresens avec sa position présente. Aussi elle sourit beaucoup à la comtesse Zurlamais malgré des efforts inouïs ne put jamais lui adresser un seul mot.
Les yeux de Clélia se remplirent de larmes en voyant passer la duchesse au milieu de ces salons peuplés alors de ce qu'il y avait de plus brillant dans la société. Que va devenir cette pauvre femmese dit-ellequand elle se trouvera seule dans sa voiture? Ce serait une indiscrétion à moi de m'offrir pour l'accompagner! je n'ose... Combien le pauvre prisonnierassis dans quelque affreuse chambretête à tête avec sa petite lampeserait consolé pourtant s'il savait qu'il est aimé à ce point! Quelle solitude affreuse que celle dans laquelle on l'a plongé! et nousnous sommes ici dans ces salons si brillants! quelle horreur! Y aurait-il un moyen de lui faire parvenir un mot? Grand Dieu! ce serait trahir mon père; sa situation est si délicate entre les deux partis! Que devient-il s'il s'expose à la haine passionnée de la duchesse qui dispose de la volonté du premier ministrelequel est le maître dans les trois quarts des affaires! D'un autre côté le prince s'occupe sans cesse de ce qui se passe à la forteresseet il n'entend pas raillerie sur ce sujet; la peur rend cruel... Dans tous les casFabrice (Clélia ne disait plus M. del Dongo) est bien autrement à plaindre!... il s'agit pour lui de bien autre chose que du danger de perdre une place lucrative!... Et la duchesse!... Quelle horrible passion que l'amour!... et cependant tous ces menteurs du monde en parlent comme d'une source de bonheur! On plaint les femmes âgées parce qu'elles ne peuvent plus ressentir ou inspirer de l'amour!... Jamais je n'oublierai ce que je viens de voir; quel changement subit! Comme les yeux de la duchessesi beauxsi radieuxsont devenus morneséteintsaprès le mot fatal que le marquis N... est venu lui dire!... Il faut que Fabrice soit bien digne d'être aimé!...
Au milieu de ces réflexions fort sérieuses et qui occupaient toute l'âme de Cléliales propos complimenteurs qui l'entouraient toujours lui semblèrent plus désagréables encore que de coutume. Pour s'en délivrerelle s'approcha d'une fenêtre ouverte et à demi voilée par un rideau de taffetas; elle espérait que personne n'aurait la hardiesse de la suivre dans cette sorte de retraite. Cette fenêtre donnait sur un petit bois d'orangers en pleine terre: à la véritéchaque hiver on était obligé de les recouvrir d'un toit. Clélia respirait avec délices le parfum de ces fleurset ce plaisir semblait rendre un peu de calme à son âme... Je lui ai trouvé l'air fort noblepensa-t-elle; mais inspirer une telle passion à une femme si distinguée!... Elle a eu la gloire de refuser les hommages du princeet si elle eût daigné le vouloirelle eût été la reine de ces états... Mon père dit que la passion du souverain allait jusqu'à l'épouser si jamais il fût devenu libre!... Et cet amour pour Fabrice dure depuis si longtemps! car il y a bien cinq ans que nous les rencontrâmes près du lac de Côme!... Ouiil y a cinq ansse dit-elle après un instant de réflexion. J'en fus frappée même alorsoù tant de choses passaient inaperçues devant mes yeux d'enfant! Comme ces deux dames semblaient admirer Fabrice!...
Clélia remarqua avec joie qu'aucun des jeunes gens qui lui parlaient avec tant d'empressement n'avait osé se rapprocher du balcon. L'un d'euxle marquis Crescenziavait fait quelques pas dans ce senspuis s'était arrêté auprès d'une table de jeu. Si au moinsse disait-ellesous ma petite fenêtre du palais de la forteressela seule qui ait de l'ombrej'avais la vue de jolis orangerstels que ceux-cimes idées seraient moins tristes! mais pour toute perspective les énormes pierres de taille de la tour Farnèse... Ah! s'écria-t-elle en faisant un mouvementc'est peut-être là qu'on l'aura placé! Qu'il me tarde de pouvoir parler à don Cesare! il sera moins sévère que le général. Mon père ne me dira rien certainement en rentrant à la forteressemais je saurai tout par don Cesare... J'ai de l'argentje pourrais acheter quelques orangers quiplacés sous la fenêtre de ma volièrem'empêcheraient de voir ce gros mur de la tour Farnèse. Combien il va m'être plus odieux encore maintenant que je connais l'une des personnes qu'il cache à la lumière!... Ouic'est bien la troisième fois que je l'ai vu; une fois à la courau bal du jour de naissance de la princesse; aujourd'huientouré de trois gendarmespendant que cet horrible Barbone sollicitait les menottes contre luiet enfin près du lac de Côme... Il y a bien cinq ans de cela; quel air de mauvais garnement il avait alors! quels yeux il faisait aux gendarmeset quels regards singuliers sa mère et sa tante lui adressaient! Certainement il y avait ce jour-là quelque secretquelque chose de particulier entre eux; dans le tempsj'eus l'idée que lui aussi avait peur des gendarmes... Clélia tressaillit; mais que j'étais ignorante! Sans doutedéjà dans ce tempsla duchesse avait de l'intérêt pour lui... Comme il nous fit rire au bout de quelques momentsquand ces damesmalgré leur préoccupation évidentese furent un peu accoutumées à la présence d'une étrangère!... et ce soir j'ai pu ne pas répondre au mot qu'il m'a adressé!... O ignorance et timidité! combien souvent vous ressemblez à ce qu'il y a de plus noir! Et je suis ainsi à vingt ans passés!... J'avais bien raison de songer au cloître; réellement je ne suis faite que pour la retraite! Digne fille d'un geôlier! se sera-t-il dit. Il me mépriseetdès qu'il pourra écrire à la duchesseil parlera de mon manque d'égardet la duchesse me croira une petite fille bien fausse; car enfin ce soir elle a pu me croire remplie de sensibilité pour son malheur.
Clélia s'aperçut que quelqu'un s'approchait et apparemment dans le dessein de se placer à côté d'elle au balcon de fer de cette fenêtre; elle en fut contrariée quoiqu'elle se fît des reproches; les rêveries auxquelles on l'arrachait n'étaient point sans quelque douceur. Voila un importun que je vais joliment recevoir! pensa-t-elle. Elle tournait la tête avec un regard altierlorsqu'elle aperçut la figure timide de l'archevêque qui s'approchait du balcon par de petits mouvements insensibles. Ce saint homme n'a point d'usagepensa Clélia; pourquoi venir troubler une pauvre fille telle que moi? Ma tranquillité est tout ce que je possède. Elle le saluait avec respectmais aussi d'un air hautainlorsque le prélat lui dit:
-- Mademoisellesavez-vous l'horrible nouvelle?
Les yeux de la jeune fille avaient déjà pris une tout autre expression; maissuivant les instructions cent fois répétées de son pèreelle répondit avec un air d'ignorance que le langage de ses yeux contredisait hautement:
-- Je n'ai rien apprisMonseigneur.
-- Mon premier grand vicairele pauvre Fabrice del Dongoqui est coupable comme moi de la mort de ce brigand de Gilettia été enlevé à Bologne où il vivait sous le nom supposé de Joseph Bossi; on l'a renfermé dans votre citadelle; il y est arrivé enchaîné à la voiture même qui le portait. Une sorte de geôlier nommé Barbonequi jadis eut sa grâce après avoir assassiné un de ses frèresa voulu faire éprouver une violence personnelle à Fabrice; mais mon jeune ami n'est point homme à souffrir une insulte. Il a jeté à ses pieds son infâme adversairesur quoi on l'a descendu dans un cachot à vingt pieds sous terreaprès lui avoir mis les menottes.
-- Les menottesnon.
-- Ah! vous savez quelque chose! s'écria l'archevêqueet les traits du vieillard perdirent de leur profonde expression de découragement; maisavant touton peut approcher de ce balcon et nous interrompre: seriez-vous assez charitable pour remettre vous-même à don Cesare mon anneau pastoral que voici?
La jeune fille avait pris l'anneaumais ne savait où le placer pour ne pas courir la chance de le perdre.
-- Mettez-le au poucedit l'archevêque; et il le plaça lui-même. Puis-je compter que vous remettrez cet anneau?
-- Ouimonseigneur.
-- Voulez-vous me promettre le secret sur ce que je vais ajoutermême dans le cas où vous ne trouveriez pas convenable d'accéder à ma demande?
-- Mais ouiMonseigneurrépondit la jeune fille toute tremblante en voyant l'air sombre et sérieux que le vieillard avait pris tout à coup...
Notre respectable archevêqueajouta-t-ellene peut que me donner des ordres dignes de lui et de moi.
-- Dites à don Cesare que je lui recommande mon fils adoptif: je sais que les sbires qui l'ont enlevé ne lui ont pas donné le temps de prendre son bréviaireje prie don Cesare de lui faire tenir le sienet si monsieur votre oncle veut envoyer demain à l'archevêchéje me charge de remplacer le livre par lui donné à Fabrice. Je prie don Cesare de faire tenir également l'anneau que porte cette jolie mainà M. del Dongo. L'archevêque fut interrompu par le général Fabio Conti qui venait prendre sa fille pour la conduire à sa voiture; il y eut là un petit moment de conversationqui ne fut pas dépourvu d'adresse de la part du prélat. Sans parler en aucune façon du nouveau prisonnieril s'arrangea de façon à ce que le courant du discours pût amener convenablement dans sa bouche certaines maximes morales et politiques; par exemple: Il y a des moments de crise dans la vie des cours qui décident pour longtemps de l'existence des plus grands personnages; il y aurait une imprudence notable à changer en haine personnelle l'état d'éloignement politique qui est souvent le résultat fort simple de positions opposées. L'archevêquese laissant un peu emporter par le profond chagrin que lui causait une arrestation si imprévuealla jusqu'à dire qu'il fallait assurément conserver les positions dont on jouissaitmais qu'il y aurait une imprudence bien gratuite à s'attirer pour la suite des haines furibondes en se prêtant à de certaines choses que l'on n'oublie point.
Quand le général fut dans son carrosse avec sa fille:
-- Ceci peut s'appeler des menaceslui dit-il... des menaces à un homme de ma sorte! Il n'y eut pas d'autres paroles échangées entre le père et la fille pendant vingt minutes.
En recevant l'anneau pastoral de l'archevêqueClélia s'était bien promis de parler à son pèrelorsqu'elle serait en voituredu petit service que le prélat lui demandait. Mais après le mot menaces prononcé avec colèreelle se tint pour assurée que son père intercepterait la commission; elle recouvrait cet anneau de la main gauche et le serrait avec passion. Durant tout le temps que l'on mit pour aller du ministère de l'intérieur à la citadelleelle se demanda s'il serait criminel à elle de ne pas parler à son père. Elle était fort pieusefort timoréeet son coeursi tranquille d'ordinairebattait avec une violence inaccoutumée mais enfin le qui vive de la sentinelle placée sur le rempart au-dessus de la porte retentit à l'approche de la voitureavant que Clélia eût trouvé les termes convenables pour disposer son père à ne pas refuser tant elle avait peur d'être refusée! En montant les trois cent soixante marches qui conduisaient au palais du gouverneurClélia ne trouva rien.
Elle se hâta de parler à son onclequi la gronda et refusa de se prêter à rien.
Livre Second
Chapitre XVI.
-- Eh bien! s'écria le généralen apercevant son frère don Cesarevoilà la duchesse qui va dépenser cent mille écus pour se moquer de moi et faire sauver le prisonnier!
Mais pour le momentnous sommes obligés de laisser Fabrice dans sa prisontout au faîte de la citadelle de Parme; on le garde bienet nous l'y retrouverons peut-être un peu changé. Nous allons nous occuper avant tout de la couroù des intrigues fort compliquéeset surtout les passions d'une femme malheureuse vont décider de son sort. En montant les trois cent quatre-vingt-dix marches de sa prison à la tour Farnèsesous les yeux du gouverneurFabricequi avait tant redouté ce momenttrouva qu'il n'avait pas le temps de songer au malheur.
En rentrant chez elle après la soirée du comte Zurlala duchesse renvoya ses femmes d'un geste; puisse laissant tomber tout habillée sur son lit: Fabrices'écria-t-elle à haute voixest au pouvoir de ses ennemiset peut-être à cause de moi ils lui donneront du poison! Comment peindre le moment de désespoir qui suivit cet exposé de la situationchez une femme aussi peu raisonnableaussi esclave de la sensation présenteetsans se l'avoueréperdument amoureuse du jeune prisonnier? Ce furent des cris inarticulésdes transports de ragedes mouvements convulsifsmais pas une larme. Elle renvoyait ses femmes pour les cacherelle pensait qu'elle allait éclater en sanglots dès qu'elle se trouverait seule; mais les larmesce premier soulagement des grandes douleurslui manquèrent tout à fait. La colèrel'indignationle sentiment d'infériorité vis-à-vis du princedominaient trop cette âme altière.
-- Suis-je assez humiliée! s'écriait-elle à chaque instant; on m'outrageetbien pluson expose la vie de Fabrice! et je ne me vengerai pas! Halte-làmon prince! vous me tuezsoitvous en avez le pouvoir; mais ensuite moi j'aurai votre vie. Hélas! pauvre Fabriceà quoi cela te servira-t-il? Quelle différence avec ce jour où je voulus quitter Parme! et pourtant alors je me croyais malheureuse... quel aveuglement! J'allais briser toutes les habitudes d'une vie agréable: hélas! sans le savoirje touchais à un événement qui allait à jamais décider de mon sort. Sipar ses infâmes habitudes de plate courtisaneriele comte n'eût supprimé le mot procédure injuste dans ce fatal billet que m'accordait la vanité du princenous étions sauvés. J'avais eu le bonheur plus que l'adresseil faut en convenirde mettre en jeu son amour-propre au sujet de sa chère ville de Parme. Alors je menaçais de partiralors j'étais libre! Grand Dieu! suis-je assez esclave! Maintenant me voici clouée dans ce cloaque infâmeet Fabrice enchaîné dans la citadelledans cette citadelle qui pour tant de gens distingués a été l'antichambre de la mort! et je ne puis plus tenir ce tigre en respect par la crainte de me voir quitter son repaire!
Il a trop d'esprit pour ne pas sentir que je ne m'éloignerai jamais de la tour infâme où mon coeur est enchaîné. Maintenant la vanité piquée de cet homme peut lui suggérer les idées les plus singulières; leur cruauté bizarre ne ferait que piquer au jeu son étonnante vanité. S'il revient à ses anciens propos de fade galanteries'il me dit: Agréez les hommages de votre esclaveou Fabrice périt: eh bien! la vieille histoire de Judith... Ouimais si ce n'est qu'un suicide pour moic'est un assassin pour Fabrice; le benêt de successeurnotre prince royalet l'infâme bourreau Rassi font pendre Fabrice comme mon complice.
La duchesse jeta des cris: cette alternative dont elle ne voyait aucun moyen de sortir torturait ce coeur malheureux. Sa tête troublée ne voyait aucune autre probabilité dans l'avenir. Pendant dix minutes elle s'agita comme une insensée; enfin un sommeil d'accablement remplaça pour quelques instants cet état horriblela vie était épuisée. Quelques minutes aprèselle se réveilla en sursautet se trouva assise sur son lit; il lui semblait qu'en sa présence le prince voulait faire couper la tête à Fabrice. Quels yeux égarés la duchesse ne jeta-t-elle pas autour d'elle! Quand enfin elle se fut convaincue qu'elle n'avait sous les yeux ni le prince ni Fabriceelle retomba sur son litet fut sur le point de s'évanouir. Sa faiblesse physique était telle qu'elle ne se sentait pas la force de changer de position. Grand Dieu! si je pouvais mourir! se dit-elle... Mais quelle lâcheté! moi abandonner Fabrice dans le malheur! Je m'égare... Voyonsrevenons au vrai; envisageons de sang-froid l'exécrable position où je me suis plongée comme à plaisir. Quelle funeste étourderie! venir habiter la cour d'un prince absolu! un tyran qui connaît toutes ses victimes! chacun de leurs regards lui semble une bravade pour son pouvoir. Hélas! c'est ce que ni le comte ni moi nous ne vîmes lorsque je quittai Milan: je pensais aux grâces d'une cour aimable; quelque chose d'inférieuril est vraimais quelque chose dans le genre des beaux jours du prince Eugène!
De loin nous ne nous faisions pas d'idée de ce que c'est que l'autorité d'un despote qui connaît de vue tous ses sujets. La forme extérieure du despotisme est la même que celle des autres gouvernements: il y a des jugespar exemplemais ce sont des Rassi; le monstreil ne trouverait rien d'extraordinaire à faire pendre son père si le prince le lui ordonnait... il appellerait cela son devoir... Séduire Rassi! malheureuse que je suis! je n'en possède aucun moyen. Que puis-je lui offrir? cent mille francs peut-être! et l'on prétend quelors du dernier coup de poignard auquel la colère du ciel envers ce malheureux pays l'a fait échapperle prince lui a envoyé dix mille sequins d'or dans une cassette! D'ailleurs quelle somme d'argent pourrait le séduire? Cette âme de bouequi n'a jamais vu que du mépris dans les regards des hommesa le plaisir ici d'y voir maintenant de la crainteet même du respect; il peut devenir ministre de la policeet pourquoi pas? Alors les trois quarts des habitants du pays seront ses bas courtisanset trembleront devant luiaussi servilement que lui-même tremble devant le souverain.
Puisque je ne peux fuir ce lieu détestéil faut que j'y sois utile à Fabrice: vivre seulesolitairedésespérée! que puis-je alors pour Fabrice? Allonsmarchemalheureuse femmefais ton devoir; va dans le mondefeins de ne plus penser à Fabrice... Feindre de t'oubliercher ange!
A ce motla duchesse fondit en larmes; enfinelle pouvait pleurer. Après une heure accordée à la faiblesse humaineelle vit avec un peu de consolation que ses idées commençaient à s'éclaircir. Avoir le tapis magiquese dit-elleenlever Fabrice de la citadelleet me réfugier avec lui dans quelque pays heureuxoù nous ne puissions être poursuivisParis par exemple. Nous y vivrions d'abord avec les douze cents francs que l'homme d'affaires de son père me fait passer avec une exactitude si plaisante. Je pourrais bien ramasser cent mille francs des débris de ma fortune! L'imagination de la duchesse passait en revue avec des moments d'inexprimables délices tous les détails de la vie qu'elle mènerait à trois cents lieues de Parme. Làse disait-elleil pourrait entrer au service sous un nom supposé... Placé dans un régiment de ces braves Françaisbientôt le jeune Valserra aurait une réputation; enfin il serait heureux.
Ces images fortunées rappelèrent une seconde fois les larmesmais celles-ci étaient de douces larmes. Le bonheur existait donc encore quelque part! Cet état dura longtemps; la pauvre femme avait horreur de revenir à la contemplation de l'affreuse réalité. Enfincomme l'aube du jour commençait à marquer d'une ligne blanche le sommet des arbres de son jardinelle se fit violence. Dans quelques heuresse dit-elleje serai sur le champ de bataille; il sera question d'agiret s'il m'arrive quelque chose d'irritantsi le prince s'avise de m'adresser quelque mot relatif à Fabriceje ne suis pas assurée de pouvoir garder tout mon sang-froid. Il faut donc ici et sans délai prendre des résolutions.
Si je suis déclarée criminelle d'EtatRassi fait saisir tout ce qui se trouve dans ce palais; le ler de ce moisle comte et moi nous avons brûlésuivant l'usagetous les papiers dont la police pourrait abuseret il est le ministre de la policevoilà le plaisant. J'ai trois diamants de quelque prix: demainFulgencemon ancien batelier de Griantapartira pour Genève où il les mettra en sûreté. Si jamais Fabrice s'échappe (grand Dieu! soyez-moi propice! et elle fit un signe de croix)l'incommensurable lâcheté du marquis del Dongo trouvera qu'il y a du péché à envoyer du pain à un homme poursuivi par un prince légitimealors il trouvera du moins mes diamantsil aura du pain.
Renvoyer le comte... me trouver seule avec luiaprès ce qui vient d'arriverc'est ce qui m'est impossible. Le pauvre homme! Il n'est point méchantau contraire; il n'est que faible. Cette âme vulgaire n'est point à la hauteur des nôtres. Pauvre Fabrice! que ne peux-tu être ici un instant avec moipour tenir conseil sur nos périls!
La prudence méticuleuse du comte gênerait tous mes projetset d'ailleurs il ne faut point l'entraîner dans ma perte... Car pourquoi la vanité de ce tyran ne me jetterait-elle pas en prison? J'aurai conspiré... quoi de plus facile à prouver? Si c'était à sa citadelle qu'il m'envoyât et que je pusse à force d'or parler à Fabricene fût-ce qu'un instantavec quel courage nous marcherions ensemble à la mort! Mais laissons ces folies; son Rassi lui conseillerait de finir avec moi par le poison; ma présence dans les ruesplacée sur une charrettepourrait émouvoir la sensibilité de ses chers Parmesans... Mais quoi! toujours le roman! Hélas! l'on doit pardonner ces folies à une pauvre femme dont le sort réel est si triste! Le vrai de tout cecic'est que le prince ne m'enverra point à la mort; mais rien de plus facile que de me jeter en prison et de m'y retenir; il fera cacher dans un coin de mon palais toutes sortes de papiers suspects comme on a fait pour ce pauvre L... Alors trois juges pas trop coquinscar il y aura ce qu'ils appellent des pièces probanteset une douzaine de faux témoins suffisent. Je puis donc être condamnée à mort comme ayant conspiré; et le princedans sa clémence infinieconsidérant qu'autrefois j'ai eu l'honneur d'être admise à sa courcommuera ma peine en dix ans de forteresse. Mais moipour ne point déchoir de ce caractère violent qui a fait dire tant de sottises à la marquise Raversi et à mes autres ennemisje m'empoisonnerai bravement. Du moins le public aura la bonté de le croire; mais je gage que le Rassi paraîtra dans mon cachot pour m'apporter galammentde la part du princeun petit flacon de strychnine ou de l'opium de Pérouse.
Ouiil faut me brouiller très ostensiblement avec le comtecar je ne veux pas l'entraîner dans ma pertece serait une infamie; le pauvre homme m'a aimée avec tant de candeur! Ma sottise a été de croire qu'il restait assez d'âme dans un courtisan véritable pour être capable d'amour. Très probablement le prince trouvera quelque prétexte pour me jeter en prison; il craindra que je ne pervertisse l'opinion publique relativement à Fabrice. Le comte est plein d'honneur; à l'instant il fera ce que les cuistres de cette courdans leur étonnement profondappelleront une folieil quittera la cour. J'ai bravé l'autorité du prince le soir du billetje puis m'attendre à tout de la part de sa vanité blessée: un homme né prince oublie-t-il jamais la sensation que je lui ai donnée ce soir-là? D'ailleurs le comte brouillé avec moi est en meilleure position pour être utile à Fabrice. Mais si le comteque ma résolution va mettre au désespoirse vengeait?... Voilàpar exempleune idée qui ne lui viendra jamais; il n'a point l'âme foncièrement basse du prince: le comte peuten gémissantcontresigner un décret infâmemais il a de l'honneur. Et puisde quoi se venger? de ce queaprès l'avoir aimé cinq anssans faire la moindre offense à son amourje lui dis: Cher comte! j'avais le bonheur de vous aimer; eh biencette flamme s'éteint; je ne vous aime plus! mais je connais le fond de votre coeurje garde pour vous une estime profondeet vous serez toujours le meilleur de mes amis.
Que peut répondre un galant homme à une déclaration aussi sincère?
Je prendrai un nouvel amantdu moins on le croira dans le monde. Je dirai à cet amant: Au fond le prince a raison de punir l'étourderie de Fabrice; mais le jour de sa fêtesans doute notre gracieux souverain lui rendra la liberté. Ainsi je gagne six mois. Le nouvel amant désigné par la prudence serait ce juge venducet infâme bourreauce Rassi... il se trouverait anobli et dans le faitje lui donnerais l'entrée de la bonne compagnie. Pardonnecher Fabrice! un tel effort est pour moi au-delà du possible. Quoi! ce monstreencore tout couvert du sang du comte P. et de D.! il me ferait évanouir d'horreur en s'approchant de moiou plutôt je saisirais un couteau et le plongerais dans son infâme coeur. Ne me demande pas des choses impossibles!
Ouisurtout oublier Fabrice! et pas l'ombre de colère contre le princereprendre ma gaieté ordinairequi paraîtra plus aimable à ces âmes fangeusespremièrementparce que j'aurai l'air de me soumettre de bonne grâce à leur souverain; en second lieuparce quebien loin de me moquer d'euxje serai attentive à faire ressortir leurs jolis petits mérites; par exempleje ferai compliment au comte Zurla sur la beauté de la plume blanche de son chapeau qu'il vient de faire venir de Lyon par un courrieret qui fait son bonheur.
Choisir un amant dans le parti de la Raversi... Si le comte s'en vace sera le parti ministériel; là sera le pouvoir. Ce sera un ami de la Raversi qui régnera sur la citadellecar le Fabio Conti arrivera au ministère. Comment le princehomme de bonne compagniehomme d'espritaccoutumé au travail charmant du comtepourra-t-il traiter d'affaires avec ce boeufavec ce roi des sots qui toute sa vie s'est occupé de ce problème capital: les soldats de Son Altesse doivent-ils porter sur leur habità la poitrinesept boutons ou bien neuf? Ce sont ces bêtes brutes fort jalouses de moiet voilà ce qui fait ton dangercher Fabrice! ce sont ces bêtes brutes qui vont décider de mon sort et du tien! Doncne pas souffrir que le comte donne sa démission! qu'il restedût-il subir des humiliations! il s'imagine toujours que donner sa démission est le plus grand sacrifice que puisse faire un premier ministre; et toutes les fois que son miroir lui dit qu'il vieillitil m'offre ce sacrifice: donc brouillerie complèteouiet réconciliation seulement dans le cas où il n'y aurait que ce moyen de l'empêcher de s'en aller. Assurémentje mettrai à son congé toute la bonne amitié possible; mais après l'omission courtisanesque des mots procédure injuste dans le billet du princeje sens que pour ne pas le haïr j'ai besoin de passer quelques mois sans le voir. Dans cette soirée décisiveje n'avais pas besoin de son esprit; il fallait seulement qu'il écrivît sous ma dictéeil n'avait qu'à écrire ce motque j'avais obtenu par mon caractère: ses habitudes de bas courtisan l'ont emporté. Il me disait le lendemain qu'il n'avait pu faire signer une absurdité par son princequ'il aurait fallu des lettres de grâce : ehbon Dieu! avec de telles gensavec des monstres de vanité et de rancune qu'on appelle des Farnèseon prend ce qu'on peut.
A cette idéetoute la colère de la duchesse se ranima. Le prince m'a trompéese disait-elleet avec quelle lâcheté!... Cet homme est sans excuse: il a de l'espritde la finessedu raisonnement; il n'y a de bas en lui que ses passions. Vingt fois le comte et moi nous l'avons remarquéson esprit ne devient vulgaire que lorsqu'il s'imagine qu'on a voulu l'offenser. Eh bien! le crime de Fabrice est étranger à la politiquec'est un petit assassinat comme on en compte cent par an dans ses heureux étatset le comte m'a juré qu'il a fait prendre les renseignements les plus exactset que Fabrice est innocent. Ce Giletti n'était point sans courage: se voyant à deux pas de la frontièreil eut tout à coup la tentation de se défaire d'un rival qui plaisait.
La duchesse s'arrêta longtemps pour examiner s'il était possible de croire à la culpabilité de Fabrice: non pas qu'elle trouvât que ce fût un bien gros péchéchez un gentilhomme du rang de son neveude se défaire de l'impertinence d'un historien; maisdans son désespoirelle commençait à sentir vaguement qu'elle allait être obligée de se battre pour prouver cette innocence de Fabrice. Nonse dit-elle enfinvoici une preuve décisive; il est comme le pauvre Pietranerail a toujours des armes dans toutes ses pochesetce jour-làil ne portait qu'un mauvais fusil à un coupet encoreemprunté à l'un des ouvriers.
Je hais le prince parce qu'il m'a trompéeet trompée de la façon la plus lâche; après son billet de pardonil a fait enlever le pauvre garçon à Bologneetc. Mais ce compte se réglera. Vers les cinq heures du matinla duchesseanéantie par ce long accès de désespoirsonna ses femmes; celles-ci jetèrent un cri. En l'apercevant sur son littoute habilléeavec ses diamantspâle comme ses draps et les yeux fermésil leur sembla la voir exposée sur un lit de parade après sa mort. Elles l'eussent crue tout à fait évanouiesi elles ne se fussent pas rappelé qu'elle venait de les sonner. Quelques larmes fort rares coulaient de temps à autre sur ses joues insensibles; ses femmes comprirent par un signe qu'elle voulait être mise au lit.
Deux fois après la soirée du ministre Zurlale comte s'était présenté chez la duchesse: toujours refuséil lui écrivit qu'il avait un conseil à lui demander pour lui-même: «Devait-il garder sa position après l'affront qu'on osait lui faire? » Le comte ajoutait: «Le jeune homme est innocent; mais fût-il coupabledevait-on l'arrêter sans m'en prévenir; moison protecteur déclaré? » La duchesse ne vit cette lettre que le lendemain.
Le comte n'avait pas de vertu; l'on peut même ajouter que ce que les libéraux entendent par vertu (chercher le bonheur du plus grand nombre) lui semblait une duperie; il se croyait obligé à chercher avant tout le bonheur du comte Mosca della Rovère; mais il était plein d'honneur et parfaitement sincère lorsqu'il parlait de sa démission. De la vie il n'avait dit un mensonge à la duchesse; celle-ci du reste ne fit pas la moindre attention à cette lettre; son partiet un parti bien pénibleétait prisfeindre d'oublier Fabrice ; après cet efforttout lui était indifférent.
Le lendemainsur le midile comtequi avait passé dix fois au palais Sanseverinaenfin fut admis; il fut atterré à la vue de la duchesse... Elle a quarante ans! se dit- ilet hier si brillante! si jeune!... Tout le monde me dit quedurant sa longue conversation avec la Clélia Contielle avait l'air aussi jeune et bien autrement séduisante.
La voixle ton de la duchesse étaient aussi étranges que l'aspect de sa personne. Ce tondépouillé de toute passionde tout intérêt humainde toute colèrefit pâlir le comte; il lui rappela la façon d'être d'un de ses amis quipeu de mois auparavantsur le point de mouriret ayant déjà reçu les sacrementsavait voulu l'entretenir.
Après quelques minutesla duchesse put lui parler. Elle le regardaet ses yeux restèrent éteints:
-- Séparons-nousmon cher comtelui dit-elle d'une voix faiblemais bien articuléeet qu'elle s'efforçait de rendre aimable; séparons-nousil le faut! Le ciel m'est témoin quedepuis cinq ansma conduite envers vous a été irréprochable. Vous m'avez donné une existence brillanteau lieu de l'ennui qui aurait été mon triste partage au château de Grianta; sans vous j'aurais rencontré la vieillesse quelques années plus tôt... De mon côtéma seule occupation a été de chercher à vous faire trouver le bonheur. C'est parce que je vous aime que je vous propose cette séparation à l'amiablecomme on dirait en France.
Le comte ne comprenait pas; elle fut obligée de répéter plusieurs fois. Il devint d'une pâleur mortelleetse jetant à genoux auprès de son litil dit tout ce que l'étonnement profondet ensuite le désespoir le plus vifpeuvent inspirer à un homme d'esprit passionnément amoureux. A chaque moment il offrait de donner sa démission et de suivre son amie dans quelque retraite à mille lieues de Parme.
-- Vous osez me parler de départet Fabrice est ici! s'écria-t-elle enfin en se soulevant à demi. Mais comme elle aperçut que ce nom de Fabrice faisait une impression pénibleelle ajouta après un moment de repos et en serrant légèrement la main du comte:-- Noncher amije ne vous dirai pas que je vous ai aimé avec cette passion et ces transports que l'on n'éprouve plusce me sembleaprès trente anset je suis déjà bien loin de cet âge. On vous aura dit que j'aimais Fabricecar je sais que le bruit en a couru dans cette cour méchante. (Ses yeux brillèrent pour la première fois dans cette conversationen prononçant ce mot méchante.) Je vous jure devant Dieuet sur la vie de Fabriceque jamais il ne s'est passé entre lui et moi la plus petite chose que n'eût pas pu souffrir l'oeil d'une tierce personne. Je ne vous dirai pas non plus que je l'aime exactement comme ferait une soeur; je l'aime d'instinctpour parler ainsi. J'aime en lui son courage si simple et si parfaitque l'on peut dire qu'il ne s'en aperçoit pas lui- même; je me souviens que ce genre d'admiration commença à son retour de Warterloo. Il était encore enfantmalgré ses dix-sept ans; sa grande inquiétude était de savoir si réellement il avait assisté à la batailleet dans le cas du ouis'il pouvait dire s'être battului qui n'avait marché à l'attaque d'aucune batterie ni d'aucune colonne ennemie. Ce fut pendant les graves discussions que nous avions ensemble sur ce sujet importantque je commençai à voir en lui une grâce parfaite. Sa grande âme se révélait à moi; que de savants mensonges eût étalésà sa placeun jeune homme bien élevé! Enfins'il n'est heureux je ne puis être heureuse. Tenezvoilà un mot qui peint bien l'état de mon coeur; si ce n'est la véritéc'est au moins tout ce que j'en vois. Le comteencouragé par ce ton de franchise et d'intimitévoulut lui baiser la main: elle la retira avec une sorte d'horreur. Les temps sont finislui dit-elle; je suis une femme de trente-sept ansje me trouve à la porte de la vieillessej'en ressens déjà tous les découragementset peut-être même suis-je voisine de la tombe. Ce moment est terribleà ce qu'on ditet pourtant il me semble que je le désire. J'éprouve le pire symptôme de la vieillesse: mon coeur est éteint par cet affreux malheurje ne puis plus aimer. Je ne vois plus en vouscher comteque l'ombre de quelqu'un qui me fut cher. Je dirai plusc'est la reconnaissance toute seule qui me fait vous tenir ce langage.
-- Que vais-je devenir? lui répétait le comtemoi qui sens que je vous suis attaché avec plus de passion que les premiers joursquand je vous voyais à la Scala!
-- Vous avouerai-je une chosecher amiparler d'amour m'ennuieet me semble indécent. Allonsdit-elle en essayant de souriremais en vaincourage! soyez homme d'esprithomme judicieuxhomme à ressources dans les occurrences. Soyez avec moi ce que vous êtes réellement aux yeux des indifférentsl'homme le plus habile et le plus grand politique que l'Italie ait produit depuis des siècles.
Le comte se leva et se promena en silence pendant quelques instants.
-- Impossiblechère amielui dit-il enfin: je suis en proie aux déchirements de la passion la plus violenteet vous me demandez d'interroger ma raison! Il n'y a plus de raison pour moi!
-- Ne parlons pas de passionje vous priedit-elle d'un ton sec; et ce fut pour la première foisaprès deux heures d'entretienque sa voix prit une expression quelconque. Le comteau désespoir lui-mêmechercha à la consoler.
-- Il m'a trompées'écriait-elle sans répondre en aucune façon aux raisons d'espérer que lui exposait le comte; il m'a trompée de la façon la plus lâche! Et sa pâleur mortelle cessa pour un instant; maismême dans ce moment d'excitation violentele comte remarqua qu'elle n'avait pas la force de soulever les bras.
Grand Dieu! serait-il possiblepensa-t-ilqu'elle ne fût que malade? En ce cas pourtant ce serait le début de quelque maladie fort grave. Alorsrempli d'inquiétudeil proposa de faire appeler le célèbre Rozarile premier médecin du pays et de l'Italie.
-- Vous voulez donc donner à un étranger le plaisir de connaître toute l'étendue de mon désespoir?... Est-ce là le conseil d'un traître ou d'un ami? Et elle le regarda avec des yeux étranges.
C'en est faitse dit-il avec désespoirelle n'a plus d'amour pour moiet bien pluselle ne me place plus même au rang des hommes d'honneur vulgaires.
-- Je vous diraiajouta le comte en parlant avec empressementque j'ai voulu avant tout avoir des détails sur l'arrestation qui nous met au désespoiret chose étrange! je ne sais encore rien de positif; j'ai fait interroger les gendarmes de la station voisineils ont vu arriver le prisonnier par la route de Castelnovoet ont reçu l'ordre de suivre sa sediola. J'ai réexpédié aussitôt Brunodont vous connaissez le zèle non moins que le dévouement; il a ordre de remonter de station en station pour savoir où et comment Fabrice a été arrêté.
En entendant prononcer ce nom de Fabricela duchesse fut saisie d'une légère convulsion.
-- Pardonnezmon amidit-elle au comte dès qu'elle put parler; ces détails m'intéressent fortdonnez-les-moi tousfaites-moi bien comprendre les plus petites circonstances.
-- Eh bien! madamereprit le comte en essayant un petit air de légèreté pour tenter de la distraire un peuj'ai envie d'envoyer un commis de confiance à Bruno et d'ordonner à celui-ci de pousser jusqu'à Bologne; c'est làpeut-êtrequ'on aura enlevé notre jeune ami. De quelle date est sa dernière lettre?
-- De mardiil y a cinq jours.
-- Avait-elle été ouverte à la poste?
-- Aucune trace d'ouverture. Il faut vous dire qu'elle était écrite sur du papier horrible; l'adresse est d'une main de femmeet cette adresse porte le nom d'une vieille blanchisseuse parente de ma femme de chambre. La blanchisseuse croit qu'il s'agit d'une affaire d'amouret la Chékina lui rembourse les ports de lettres sans y rien ajouter. Le comtequi avait pris tout à fait le ton d'un homme d'affairesessaya de découvriren discutant avec la duchessequel pouvait avoir été le jour de l'enlèvement à Bologne. Il s'aperçut alors seulementlui qui avait ordinairement tant de tactque c'était là le ton qu'il fallait prendre. Ces détails intéressaient la malheureuse femme et semblaient la distraire un peu. Si le comte n'eût pas été amoureuxil eût eu cette idée si simple dès son entrée dans la chambre. La duchesse le renvoya pour qu'il pût sans délai expédier de nouveaux ordres au fidèle Bruno. Comme on s'occupait en passant de la question de savoir s'il y avait eu sentence avant le moment où le prince avait signé le billet adressé à la duchessecelle-ci saisit avec une sorte d'empressement l'occasion de dire au comte: Je ne vous reprocherai point d'avoir omis les mots injuste procédure dans le billet que vous écrivîtes et qu'il signac'était l'instinct de courtisan qui vous prenait à la gorge; sans vous en doutervous préfériez l'intérêt de votre maître à celui de votre amie. Vous avez mis vos actions à mes ordrescher comteet cela depuis longtempsmais il n'est pas en votre pouvoir de changer votre nature; vous avez de grands talents pour être ministremais vous avez aussi l'instinct de ce métier. La suppression du mot injuste me perd; mais loin de moi de vous la reprocher en aucune façonce fut la faute de l'instinct et non pas celle de la volonté.
-- Rappelez-vousajouta-t-elle en changeant de ton et de l'air le plus impérieuxque je ne suis point trop affligée de l'enlèvement de Fabriceque je n'ai pas eu la moindre velléité de m'éloigner de ce pays-cique je suis remplie de respect pour le prince. Voilà ce que vous avez à direet voicimoice que je veux vous dire: Comme je compte seule diriger ma conduite à l'avenirje veux me séparer de vous à l'amiablec'est-à-dire en bonne et vieille amie. Comptez que j'ai soixante ans; la jeune femme est morte en moije ne puis plus m'exagérer rien au mondeje ne puis plus aimer. Mais je serais encore plus mal heureuse que je ne le suis s'il m'arrivait de compromettre votre destinée. Il peut entrer dans mes projets de me donner l'apparence d'avoir un jeune amantet je ne voudrais pas vous voir affligé. Je puis vous jurer sur le bonheur de Fabriceelle s'arrêta une demi-minute après ce motque jamais je ne vous ai fait une infidélité et cela en cinq années de temps. C'est bien longdit-elle; elle essaya de sourire; ses joues si pâles s'agitèrentmais ses lèvres ne purent se séparer. Je vous jure même que jamais je n'en ai eu le projet ni l'envie. Cela bien entendulaissez-moi.
Le comte sortitau désespoirdu palais Sanseverina: il voyait chez la duchesse l'intention bien arrêtée de se séparer de luiet jamais il n'avait été aussi éperdument amoureux. C'est là une de ces choses sur lesquelles je suis obligé de revenir souventparce qu'elles sont improbables hors de l'Italie. En rentrant chez luiil expédia jusqu'à six personnes différentes sur la route de Castelnovo et de Bologneet les chargea de lettres. Mais ce n'est pas toutse dit le malheureux comtele prince peut avoir la fantaisie de faire exécuter ce malheureux enfantet cela pour se venger du ton que la duchesse prit avec lui le jour de ce fatal billet. Je sentais que la duchesse passait une limite que l'on ne doit jamais franchiret c'est pour raccommoder les choses que j'ai eu la sottise incroyable de supprimer le mot procédure injustele seul qui liât le souverain... Mais bah! ces gens-là sont-ils liés par quelque chose? C'est là sans doute la plus grande faute de ma viej'ai mis au hasard tout ce qui peut en faire le prix pour moi: il s'agit de réparer cette étourderie à force d'activité et d'adresse; mais enfin si je ne puis rien obtenirmême en sacrifiant un peu de ma dignitéje plante là cet homme; avec ses rêves de haute politiqueavec ses idées de se faire roi constitutionnel de la Lombardienous verrons comment il me remplacera... Fabio Conti n'est qu'un sotle talent de Rassi se réduit à faire pendre légalement un homme qui déplaît au pouvoir.
Une fois cette résolution bien arrêtée de renoncer au ministère si les rigueurs à l'égard de Fabrice dépassaient celles d'une simple détentionle comte se dit: Si un caprice de la vanité de cet homme imprudemment bravée me coûte le bonheurdu moins l'honneur me restera... A propospuisque je me moque de mon portefeuilleje puis me permettre cent actions quice matin encorem'eussent semblé hors du possible. Par exempleje vais tenter tout ce qui est humainement faisable pour faire évader Fabrice... Grand Dieu! s'écria le comte en s'interrompant et ses yeux s'ouvrant à l'excès comme à la vue d'un bonheur imprévula duchesse ne m'a pas parlé d'évasionaurait-elle manqué de sincérité une fois en sa vieet la brouille ne serait-elle que le désir que je trahisse le prince? Ma foic'est fait!
L'oeil du comte avait reprit toute sa finesse satirique. Cet aimable fiscal Rassi est payé par le maître pour toutes les sentences qui nous déshonorent en Europe mais il n'est pas homme à refuser d'être payé par moi pour trahir les secrets du maître. Cet animal-là a une maîtresse et un confesseurmais la maîtresse est d'une trop vile espèce pour que je puisse lui parlerle lendemain elle raconterait l'entrevue à toutes les fruitières du voisinage. Le comteressuscité par cette lueur d'espoirétait déjà sur le chemin de la cathédrale; étonné de la légèreté de sa démarcheil sourit malgré son chagrin: Ce que c'estdit-ilque de n'être plus ministre! Cette cathédralecomme beaucoup d'églises en Italiesert de passage d'une rue à l'autrele comte vit de loin un des grands vicaires de l'archevêque qui traversait la nef.
-- Puisque je vous rencontrelui dit-ilvous serez assez bon pour épargner à ma goutte la fatigue mortelle de monter jusque chez monseigneur l'archevêque. Je lui aurais toutes les obligations du monde s'il voulait bien descendre jusqu'à la sacristie. L'archevêque fut ravi de ce messageil avait mille choses à dire au ministre au sujet de Fabrice. Mais le ministre devina que ces choses n'étaient que des phrases et ne voulut rien écouter.
-- Quel homme est-ce que Dugnanivicaire de Saint-Paul?
-- Un petit esprit et une grande ambitionrépondit l'archevêquepeu de scrupules et une extrême pauvretécar nous en avons des vices!
-- Tudieumonseigneur! s'écria le ministrevous peignez comme Tacite; et il prit congé de lui en riant. A peine de retour au ministèreil fit appeler l'abbé Dugnani.
-- Vous dirigez la conscience de mon excellent ami le fiscal général Rassin'aurait-il rien à me dire? Etsans autres paroles ou plus de cérémonieil renvoya le Dugnani.
Livre Second
Chapitre XVII.
Le comte se regardait comme hors du ministère. Voyons un peuse dit-ilcombien nous pourrons avoir de chevaux après ma disgrâcecar c'est ainsi qu'on appellera ma retraite. Le comte fit l'état de sa fortune: il était entré au ministère avec quatre-vingt mille francs de bien; à son grand étonnementil trouva quetout comptéson avoir actuel ne s'élevait pas à cinq cent mille francs: c'est vingt mille livres de rente tout au plusse dit-il. Il faut convenir que je suis un grand étourdi! Il n'y a pas un bourgeois à Parme qui ne me croie cent cinquante mille livres de rente; et le princesur ce sujetest plus bourgeois qu'un autre. Quand ils me verront dans la crotteils diront que je sais bien cacher ma fortune. Pardieus'écria-t-ilsi je suis encore ministre trois moisnous la verrons doublée cette fortune. Il trouva dans cette idée l'occasion d'écrire à la duchesseet la saisit avec avidité; mais pour se faire pardonner une lettre dans les termes où ils en étaientil remplit celle-ci de chiffres et de calculs. Nous n'aurons que vingt mille livres de rentelui dit-ilpour vivre tous trois à NaplesFabricevous et moi. Fabrice et moi nous aurons un cheval de selle à nous deux. Le ministre venait à peine d'envoyer sa lettrelorsqu'on annonça le fiscal général Rassi; il le reçut avec une hauteur qui frisait l'impertinence.
-- Commentmonsieurlui dit-ilvous faites enlever à Bologne un conspirateur que je protègede plus vous voulez lui couper le couet vous ne me dites rien! Savez-vous au moins le nom de mon successeur? Est-ce le général Contiou vous-même?
Le Rassi fut atterré; il avait trop peu d'habitude de la bonne compagnie pour deviner si le comte parlait sérieusement: il rougit beaucoupânonna quelques mots peu intelligibles; le comte le regardait et jouissait de son embarras. Tout à coup le Rassi se secoua et s'écria avec une aisance parfaite et de l'air de Figaro pris en flagrant délit par Almaviva:
-- Ma foimonsieur le comteje n'irai point par quatre chemins avec Votre Excellence: que me donnerez-vous pour répondre à toutes vos questions comme je ferais à celles de mon confesseur?
-- La croix de Saint-Paul (c'est l'ordre de Parme)ou de l'argentsi vous pouvez me fournir un prétexte pour vous en accorder.
-- J'aime mieux la croix de Saint-Paulparce qu'elle m'anoblit.
-- Commentcher fiscalvous faites encore quelque cas de notre pauvre noblesse?
-- Si j'étais né noblerépondit le Rassi avec toute l'impudence de son métierles parents des gens que j'ai fait pendre me haïraientmais ils ne me mépriseraient pas.
-- Eh bien! je vous sauverai du méprisdit le comteguérissez-moi de mon ignorance. Que comptez-vous faire de Fabrice?
-- Ma foile prince est fort embarrassé: il craint queséduit par les beaux yeux d'Armidepardonnez à ce langage un peu vifce sont les termes précis du souverain; il craint queséduit par de fort beaux yeux qui l'ont un peu touché lui- mêmevous ne le plantiez làet il n'y a que vous pour les affaires de Lombardie. Je vous dirai mêmeajouta Rassi en baissant la voixqu'il y a là une fière occasion pour vouset qui vaut bien la croix de Saint-Paul que vous me donnez. Le prince vous accorderaitcomme récompense nationaleune jolie terre valant six cent mille francs qu'il distrairait de son domaineou une gratification de trois cent mille francs écussi vous vouliez consentir à ne pas vous mêler du sort de Fabrice del Dongoou du moins à ne lui en parler qu'en public.
-- Je m'attendais à mieux que çadit le comte; ne pas me mêler de Fabrice c'est me brouiller avec la duchesse.
-- Eh bien! c'est encore ce que dit le prince: le fait est qu'il est horriblement monté contre Mme la duchesseentre nous soit dit; et il craint quepour dédommagement de la brouille avec cette dame aimablemaintenant que vous voilà veufvous ne lui demandiez la main de sa cousinela vieille princesse Isotalaquelle n'est âgée que de cinquante ans.
-- Il a deviné justes'écria le comtenotre maître est l'homme le plus fin de ses états.
Jamais le comte n'avait eu l'idée baroque d'épouser cette vieille princesse; rien ne fût allé plus mal à un homme que les cérémonies de cour ennuyaient à la mort.
Il se mit à jouer avec sa tabatière sur le marbre d'une petite table voisine de son fauteuil. Rassi vit dans ce geste d'embarras la possibilité d'une bonne aubaine; son oeil brilla.
-- De grâcemonsieur le comtes'écria-t-il si Votre Excellence veut accepterou la terre de six cent mille francsou la gratification en argentje la prie de ne point choisir d'autre négociateur que moi. Je me ferais fortajouta-t-il en baissant la voixde faire augmenter la gratification en argent ou même de faire joindre une forêt assez importante à la terre domaniale. Si Votre Excellence daignait mettre un peu de douceur et de ménagement dans sa façon de parler au prince de ce morveux qu'on a coffréon pourrait peut-être ériger en duché la terre que lui offrirait la reconnaissance nationale. Je le répète à Votre Excellence; le princepour le quart d'heureexècre la duchessemais il est fort embarrasséet même au point que j'ai cru parfois qu'il y avait quelque circonstance secrète qu'il n'osait pas m'avouer. Au fond on peut trouver ici une mine d'ormoi vous vendant ses secrets les plus intimes et fort librementcar on me croit votre ennemi juré. Au fonds'il est furieux contre la duchesseil croit aussiet comme nous tousque vous seul au monde pouvez conduire à bien toutes les démarches secrètes relatives au Milanais. Votre Excellence me permet-elle de lui répéter textuellement les paroles du souverain? dit le Rassi en s'échauffantil y a souvent une physionomie dans la position des motsqu'aucune traduction ne saurait rendreet vous pourrez y voir plus que je n'y vois.
-- Je permets toutdit le comte en continuantd'un air distraità frapper la table de marbre avec sa tabatière d'orje permets tout et je serai reconnaissant.
-- Donnez-moi des lettres de noblesse transmissibleindépendamment de la croixet je serai plus que satisfait. Quand je parle d'anoblissement au princeil me répond: Un coquin tel que toinoble? Il faudrait fermer boutique dès le lendemain; personne à Parme ne voudrait plus se faire anoblir. Pour en revenir à l'affaire du Milanaisle prince me disaitil n'y a pas trois jours: Il n'y a que ce fripon-là pour suivre le fil de nos intrigues; si je le chasse ou s'il suit la duchesseil vaut autant que je renonce à l'espoir de me voir un jour le chef libéral et adoré de toute l'Italie.
A ce mot le comte respira: Fabrice ne mourra passe dit-il.
De sa vie le Rassi n'avait pu arriver à une conversation intime avec le premier ministre: il était hors de lui de bonheur; il se voyait à la veille de pouvoir quitter ce nom de Rassidevenu dans le pays synonyme de tout ce qu'il y a de bas et de vil; le petit peuple donnait le nom de Rassiaux chiens enragés; depuis peu des soldats s'étaient battus en duel parce qu'un de leurs camarades les avait appelés Rassi. Enfin il ne se passait pas de semaine sans que ce malheureux nom ne vînt s'enchâsser dans quelque sonnet atroce. Son filsjeune et innocent écolier de seize ansétait chassé des caféssur son nom.
C'est le souvenir brûlant de tous ces agréments de sa position qui lui fit commettre une imprudence.
-- J'ai une terredit-il au comte en rapprochant sa chaise du fauteuil du ministreelle s'appelle Rivaje voudrais être baron Riva.
-- Pourquoi pas? dit le ministre. Rassi était hors de lui.
-- Eh bien! monsieur le comteje me permettrai d'être indiscretj'oserai deviner le but de vos désirsvous aspirez à la main de la princesse Isotaet c'est une noble ambition. Une fois parentvous êtes à l'abri de la disgrâcevous bouclez notre homme. Je ne vous cacherai pas qu'il a ce mariage avec la princesse Isota en horreur; mais si vos affaires étaient confiées à quelqu'un d'adroit et de bien payéon pourrait ne pas désespérer du succès.
-- Moimon cher baronj'en désespérais; je désavoue d'avance toutes les paroles que vous pourrez porter en mon nom; mais le jour où cette alliance illustre viendra enfin combler mes voeux et me donner une si haute position dans l'étatje vous offriraimoitrois cent mille francs de mon argentou bien je conseillerai au prince de vous accorder une marque de faveur que vous-même vous préférerez à cette somme d'argent.
Le lecteur trouve cette conversation longue; pourtant nous lui faisons grâce de plus de la moitié; elle se prolongea encore deux heures. Le Rassi sortit de chez le comte fou de bonheur; le comte resta avec de grandes espérances de sauver Fabriceet plus résolu que jamais à donner sa démission. Il trouvait que son crédit avait raison d'être renouvelé par la présence au pouvoir de gens tels que Rassi et le général Conti; il jouissait avec délices d'une possibilité qu'il venait d'entrevoir de se venger du prince: Il peut faire partir la duchesses'écriait-ilmais parbleu il renoncera à l'espoir d'être roi constitutionnel de la Lombardie. (Cette chimère était ridicule: le prince avait beaucoup d'espritmaisà force d'y rêveril en était devenu amoureux fou.)
Le comte ne se sentait pas de joie en courant chez la duchesse lui rendre compte de sa conversation avec le fiscal. Il trouva la porte fermée pour lui; le portier n'osait presque pas lui avouer cet ordre reçu de la bouche même de sa maîtresse. Le comte regagna tristement le palais du ministèrele malheur qu'il venait d'essuyer éclipsait en entier la joie que lui avait donnée sa conversation avec le confident du prince. N'ayant plus le coeur de s'occuper de rienle comte errait tristement dans sa galerie de tableauxquandun quart d'heure aprèsil reçut un billet ainsi conçu:
«Puisqu'il est vraicher et bon amique nous ne sommes plus qu'amisil faut ne venir me voir que trois fois par semaine. Dans quinze jours nous réduirons ces visitestoujours si chères à mon coeurà deux par mois. Si vous voulez me plairedonnez de la publicité à cette sorte de rupture; si vous vouliez me rendre presque tout l'amour que jadis j'eus pour vousvous feriez choix d'une nouvelle amie. Quant à moij'ai de grands projets de dissipation: je compte aller beaucoup dans le mondepeut-être même trouverai-je un homme d'esprit pour me faire oublier mes malheurs. Sans doute en qualité d'ami la première place dans mon coeur vous sera toujours réservée; mais je ne veux plus que l'on dise que mes démarches ont été dictées par votre sagesse; je veux surtout que l'on sache bien que j'ai perdu toute influence sur vos déterminations. En un motcher comtecroyez que vous serez toujours mon ami le plus chermais jamais autre chose. Ne gardezje vous prieaucune idée de retourtout est bien fini. Comptez à jamais sur mon amitié. »
Ce dernier trait fut trop fort pour le courage du comte: il fit une belle lettre au prince pour donner sa démission de tous ses emploiset il l'adressa à la duchesse avec prière de la faire parvenir au palais. Un instant aprèsil reçut sa démissiondéchirée en quatreetsur un des blancs du papierla duchesse avait daigné écrire: Nonmille fois non!
Il serait difficile de décrire le désespoir du pauvre ministre. Elle a raisonj'en conviensse disait-il à chaque instant; mon omission du mot procédure injuste est un affreux malheur; elle entraînera peut-être la mort de Fabriceet celle-ci amènera la mienne. Ce fut avec la mort dans l'âme que le comtequi ne voulait pas paraître au palais du souverain avant d'y être appeléécrivit de sa main le motu proprio qui nommait Rassi chevalier de l'ordre de Saint-Paul et lui conférait la noblesse transmissible; le comte y joignit un rapport d'une demi- pause qui exposait au prince les raisons d'état qui conseillaient cette mesure. Il trouva une sorte de joie mélancolique à faire de ces pièces deux belles copies qu'il adressa à la duchesse.
Il se perdait en suppositions; il cherchait à deviner quel serait à l'avenir le plan de conduite de la femme qu'il aimait. Elle n'en sait rien elle-mêmese disait-il; une seule chose reste certainec'est quepour rien au mondeelle ne manquerait aux résolutions qu'elle m'aurait une fois annoncées. Ce qui ajoutait encore à son malheurc'est qu'il ne pouvait parvenir à trouver la duchesse blâmable. Elle m'a fait une grâce en m'aimantelle cesse de m'aimer après une faute involontaireil est vraimais qui peut entraîner une conséquence horrible; je n'ai aucun droit de me plaindre. Le lendemain matinle comte sut que la duchesse avait recommencé à aller dans le monde; elle avait paru la veille au soir dans toutes les maisons qui recevaient. Que fût-il devenu s'il se fût rencontré avec elle dans le même salon? Comment lui parler? De quel ton lui adresser la parole? Et comment ne pas lui parler?
Le lendemain fut un jour funèbre; le bruit se répandait généralement que Fabrice allait être mis à mortla ville fut émue. On ajoutait que le princeayant égard à sa haute naissanceavait daigné décider qu'il aurait la tête tranchée.
-- C'est moi qui le tuese dit le comte; je ne puis plus prétendre à revoir jamais la duchesse. Malgré ce raisonnement assez simpleil ne put s'empêcher de passer trois fois à sa porte; à la véritépour n'être pas remarquéil alla chez elle à pied. Dans son désespoiril eut même le courage de lui écrire. Il avait fait appeler Rassi deux fois; le fiscal ne s'était point présenté. Le coquin me trahitse dit le comte.
Le lendemaintrois grandes nouvelles agitaient la haute société de Parmeet même la bourgeoisie. La mise à mort de Fabrice était plus que jamais certaine; etcomplément bien étrange de cette nouvellela duchesse ne paraissait point trop au désespoir. Selon les apparenceselle n'accordait que des regrets assez modérés à son jeune amant; toutefois elle profitait avec un art infini de la pâleur que venait de lui donner une indisposition assez gravequi était survenue en même temps que l'arrestation de Fabrice. Les bourgeois reconnaissaient bien à ces détails le coeur sec d'une grande dame de la cour. Par décence cependantet comme sacrifice aux mânes du jeune Fabriceelle avait rompu avec le comte Mosca. Quelle immoralité! s'écriaient les jansénistes de Parme. Mais déjà la duchessechose incroyable! paraissait disposée à écouter les cajoleries des plus beaux jeunes gens de la cour. On remarquaitentre autres singularitésqu'elle avait été fort gaie dans une conversation avec le comte Baldil'amant actuel de la Raversiet l'avait beaucoup plaisanté sur ses courses fréquentes au château de Velleja. La petite bourgeoisie et le peuple étaient indignés de la mort de Fabriceque ces bonnes gens attribuaient à la jalousie du comte Mosca. La société de la cour s'occupait aussi beaucoup du comtemais c'était pour s'en moquer. La troisième des grandes nouvelles que nous avons annoncées n'était autre en effet que la démission du comte; tout le monde se moquait d'un amant ridicule quià l'âge de cinquante-six anssacrifiait une position magnifique au chagrin d'être quitté par une femme sans coeur et quidepuis longtempslui préférait un jeune homme. Le seul archevêque eut l'espritou plutôt le coeurde deviner que l'honneur défendait au comte de rester premier ministre dans un pays où l'on allait couper la têteet sans le consulterà un jeune hommeson protégé. La nouvelle de la démission du comte eut l'effet de guérir de sa goutte le général Fabio Conticomme nous le dirons en son lieulorsque nous parlerons de la façon dont le pauvre Fabrice passait son temps à la citadellependant que toute la ville s'enquérait de l'heure de son supplice.
Le jour suivantle comte revit Brunocet agent fidèle qu'il avait expédié sur Bologne; le comte s'attendrit au moment où cet homme entrait dans son cabinet; sa vue lui rappelait l'état heureux où il se trouvait lorsqu'il l'avait envoyé à Bolognepresque d'accord avec la duchesse. Bruno arrivait de Bologne où il n'avait rien découvert; il n'avait pu trouver Ludovicque le podestat de Castelnovo avait gardé dans la prison de son village.
-- Je vais vous renvoyer à Bolognedit le comte à Bruno: la duchesse tiendra au triste plaisir de connaître les détails du malheur de Fabrice. Adressez-vous au brigadier de gendarmerie qui commande le poste de Castelnovo...
-- Mais non! s'écria le comte en s'interrompant; partez à l'instant même pour la Lombardieet distribuez de l'argent et en grande quantité à tous nos correspondants. Mon but est d'obtenir de tous ces gens-là des rapports de la nature la plus encourageante. Bruno ayant bien compris le but de sa missionse mit à écrire ses lettres de créance; comme le comte lui donnait ses dernières instructionsil reçut une lettre parfaitement faussemais fort bien écrite; on eût dit un ami écrivant à son ami pour lui demander un service. L'ami qui écrivait n'était autre que le prince. Ayant ouï parler de certains projets de retraiteil suppliait son amile comte Moscade garder le ministère; il le lui demandait au nom de l'amitié et des dangers de la patrie; et le lui ordonnait comme son maître. Il ajoutait que le roi de M *** venant de mettre à sa disposition deux cordons de son ordreil en gardait un pour luiet envoyait l'autre à son cher comte Mosca.
Cet animal-là fait mon malheur! s'écria le comte furieuxdevant Bruno stupéfaitet croit me séduire par ces mêmes phrases hypocrites que tant de fois nous avons arrangées ensemble pour prendre à la glu quelque sot. Il refusa l'ordre qu'on lui offraitet dans sa réponse parla de l'état de sa santé comme ne lui laissant que bien peu d'espérance de pouvoir s'acquitter longtemps encore des pénibles travaux du ministère. Le comte était furieux. Un instant après on annonça le fiscal Rassiqu'il traita comme un nègre.
-- Eh bien! parce que je vous ai fait noblevous commencez à faire l'insolent! Pourquoi n'être pas venu hier pour me remerciercomme c'était votre devoir étroitmonsieur le cuistre?
Le Rassi était bien au-dessus des injures; c'était sur ce ton-là qu'il était journellement reçu par le prince; mais il voulait être baron et se justifia avec esprit. Rien n'était plus facile.
-- Le prince m'a tenu cloué à une table hier toute la journée; je n'ai pu sortir du palais. Son Altesse m'a fait copier de ma mauvaise écriture de procureur une quantité de pièces diplomatiques tellement niaises et tellement bavardes que je croisen véritéque son but unique était de me retenir prisonnier. Quand enfin j'ai pu prendre congévers les cinq heuresmourant de faimil m'a donné l'ordre d'aller chez moi directementet de n'en pas sortir de la soirée. En effetj'ai vu deux de ses espions particuliersde moi bien connusse promener dans ma rue jusque sur le minuit. Ce matindès que je l'ai puj'ai fait venir une voiture qui m'a conduit jusqu'à la porte de la cathédrale. Je suis descendu de voiture très lentementpuisprenant le pas de coursej'ai traversé l'église et me voici. Votre Excellence est dans ce moment-ci l'homme du monde auquel je désire plaire avec le plus de passion.
-- Et moimonsieur le drôleje ne suis point dupe de tous ces contes plus ou moins bien bâtis! Vous avez refusé de me parler de Fabrice avant-hier; j'ai respecté vos scrupuleset vos serments touchant le secretquoique les serments pour un être tel que vous ne soient tout au plus que des moyens de défaite. Aujourd'huije veux la vérité: Qu'est-ce que ces bruits ridicules qui font condamner à mort ce jeune homme comme assassin du comédien Giletti!
-- Personne ne peut mieux rendre compte à Votre Excellence de ces bruitspuisque c'est moi-même qui les ai fait courir par ordre du souverain; etj'y pense! c'est peut-être pour m'empêcher de vous faire part de cet incident qu'hiertoute la journéeil m'a retenu prisonnier. Le princequi ne me croit pas un foune pouvait pas douter que je ne vinsse vous apporter ma croix et vous supplier de l'attacher à ma boutonnière.
-- Au fait! s'écria le ministreet pas de phrases.
-- Sans doute le prince voudrait bien tenir une sentence de mort contre M. del Dongomais il n'acomme vous le savez sans doutequ'une condamnation en vingt années de ferscommuée par luile lendemain même de la sentenceen douze années de forteresse avec jeûne au pain et à l'eau tous les vendrediset autres bamboches religieuses.
-- C'est parce que je savais cette condamnation à la prison seulementque j'étais effrayé des bruits d'exécution prochaine qui se répandent par la ville; je me souviens de la mort du comte Palanzasi bien escamotée par vous.
-- C'est alors que j'aurais dû avoir la croix! s'écria Rassi sans se déconcerter; il fallait serrer le bouton tandis que je le tenaiset que l'homme avait envie de cette mort. Je fus un nigaud alorset c'est armé de cette expérience que j'ose vous conseiller de ne pas m'imiter aujourd'hui. (Cette comparaison parut du plus mauvais goût à l'interlocuteurqui fut obligé de se retenir pour ne pas donner des coups de pied à Rassi.)
-- D'abordreprit celui-ci avec la logique d'un jurisconsulte et l'assurance parfaite d'un homme qu'aucune insulte ne peut offenserd'abord il ne peut être question de l'exécution du dit del Dongo; le prince n'oserait! les temps sont bien changés! et enfinmoinoble et espérant par vous de devenir baronje n'y donnerais pas les mains. Orce n'est que de moicomme le sait Votre Excellenceque l'exécuteur des hautes oeuvres peut recevoir des ordresetje vous le jurele chevalier Rassi n'en donnera jamais contre le sieur del Dongo.
-- Et vous ferez sagementdit le comte en le toisant d'un air sévère.
-- Distinguons! reprit le Rassi avec un sourire. Moi je ne suis que pour les morts officielleset si M. del Dongo vient à mourir d'une coliquen'allez pas me l'attribuer! Le prince est outréet je ne sais pourquoicontre la Sanseverina (trois jours auparavant le Rassi eût dit la duchessemaiscomme toute la villeil savait la rupture avec le premier ministre); le comte fut frappé de la suppression du titre dans une telle boucheet l'on peut juger du plaisir qu'elle lui fit; il lança au Rassi un regard chargé de la plus vive haine. Mon cher ange! se dit-il ensuiteje ne puis te montrer mon amour qu'en obéissant aveuglément à tes ordres.
-- Je vous avoueraidit-il au fiscalque je ne prends pas un intérêt bien passionné aux divers caprices de Mme la duchesse; toutefoiscomme elle m'avait présenté ce mauvais sujet de Fabricequi aurait bien dû rester à Napleset ne pas venir ici embrouiller nos affairesje tiens à ce qu'il ne soit pas mis à mort de mon tempset je veux bien vous donner ma parole que vous serez baron dans les huit jours qui suivront sa sortie de prison.
-- En ce casmonsieur le comteje ne serai baron que dans douze années révoluescar le prince est furieuxet sa haine contre la duchesse est tellement vivequ'il cherche à la cacher.
-- Son Altesse est bien bonne! qu'a-t-elle besoin de cacher sa hainepuisque son premier ministre ne protège plus la duchesse? Seulement je ne veux pas qu'on puisse m'accuser de vilenieni surtout de jalousie: c'est moi qui ai fait venir la duchesse en ce payset si Fabrice meurt en prisonvous ne serez pas baronmais vous serez peut-être poignardé. Mais laissons cette bagatelle: le fait est que j'ai fait le compte de ma fortune; à peine si j'ai trouvé vingt mille livres de rentesur quoi j'ai le projet d'adresser très humblement ma démission au souverain. J'ai quelque espoir d'être employé par le roi de Naples: cette grande ville m'offrira les distractions dont j'ai besoin en ce momentet que je ne puis trouver dans un trou tel que Parme; je ne resterais qu'autant que vous me feriez obtenir la main de la princesse Isotaetc.etc.; la conversation fut infinie dans ce sens. Comme Rassi se levaitle comte lui dit d'un air fort indifférent:
-- Vous savez qu'on a dit que Fabrice me trompaiten ce sens qu'il était un des amants de la duchesse; je n'accepte point ce bruitet pour le démentirje veux que vous fassiez passer cette bourse à Fabrice.
-- Mais monsieur le comtedit Rassi effrayéet regardant la bourseil y a là une somme énormeet les règlements...
-- Pour vousmon cherelle peut être énormereprit le comte de l'air du plus souverain mépris: un bourgeois tel que vousenvoyant de l'argent à son ami en prisoncroit se ruiner en lui donnant dix sequins: moije veuxque Fabrice reçoive ces six mille francset surtout que le château ne sache rien de cet envoi.
Comme le Rassi effrayé voulait répliquerle comte ferma la porte sur lui avec impatience. Ces gens-làse dit-ilne voient le pouvoir que derrière l'insolence. Cela ditce grand ministre se livra à une action tellement ridiculeque nous avons quelque peine à la rapporter; il courut prendre dans son bureau un portrait en miniature de la duchesseet le couvrit de baisers passionnés. Pardonmon cher anges'écriait-ilsi je n'ai pas jeté par la fenêtre et de mes propres mains ce cuistre qui ose parler de toi avec une nuance de familiaritémaissi j'agis avec cet excès de patiencec'est pour t'obéir! et il ne perdra rien pour attendre!
Après une longue conversation avec le portraitle comtequi se sentait le coeur mort dans la poitrineeut l'idée d'une action ridicule et s'y livra avec un empressement d'enfant. Il se fit donner un habit avec des plaqueset fut faire une visite à la vieille princesse Isota; de la vie il ne s'était présenté chez elle qu'à l'occasion du jour de l'an. Il la trouva entourée d'une quantité de chienset parée de tous ses atourset même avec des diamants comme si elle allait à la cour. Le comteayant témoigné quelque crainte de déranger les projets de Son Altessequi probablement allait sortirl'Altesse répondit au ministre qu'une princesse de Parme se devait à elle-même d'être toujours ainsi. Pour la première fois depuis son malheur le comte eut un mouvement de gaieté; j'ai bien fait de paraître icise dit-ilet dès aujourd'hui il faut faire ma déclaration. La princesse avait été ravie de voir arriver chez elle un homme aussi renommé par son esprit et un premier ministre; la pauvre vieille fille n'était guère accoutumée à de semblables visites. Le comte commença par une préface adroiterelative à l'immense distance qui séparera toujours d'un simple gentilhomme les membres d'une famille régnante.
-- Il faut faire une distinctiondit la princesse: la fille d'un roi de Francepar exemplen'a aucun espoir d'arriver jamais à la couronne; mais les choses ne vont point ainsi dans la famille de Parme. C'est pourquoi nous autres Farnèse nous devons toujours conserver une certaine dignité dans notre extérieur; et moipauvre princesse telle que vous me voyezje ne puis pas dire qu'il soit absolument impossible qu'un jour vous soyez mon premier ministre.
Cette idée par son imprévu baroque donna au pauvre comte un second instant de gaieté parfaite.
Au sortir de chez la princesse Isotaqui avait grandement rougi en recevant l'aveu de la passion du premier ministrecelui-ci rencontra un des fourriers du palais: le prince le faisait demander en toute hâte.
-- Je suis maladerépondit le ministreravi de pouvoir faire une malhonnêteté à son prince. Ah! ah! vous me poussez à bouts'écria-t-il avec fureuret puis vous voulez que je vous serve! mais sachezmon princequ'avoir reçu le pouvoir de la Providence ne suffit plus en ce siècle-ciil faut beaucoup d'esprit et un grand caractère pour réussir à être despote.
Après avoir renvoyé le fourrier du palais fort scandalisé de la parfaite santé de ce maladele comte trouva plaisant d'aller voir les deux hommes de la cour qui avaient le plus d'influence sur le général Fabio Conti. Ce qui surtout faisait frémir le ministre et lui ôtait tout couragec'est que le gouverneur de la citadelle était accusé de s'être défait jadis d'un capitaineson ennemi personnelau moyen de l'aquetta de Pérouse.
Le comte savait que depuis huit jours la duchesse avait répandu des sommes folles pour se ménager des intelligences à la citadelle; maissuivant luiil y avait peu d'espoir de succèstous les yeux étaient encore trop ouverts. Nous ne raconterons point au lecteur toutes les tentatives de corruption essayées par cette femme malheureuse: elle était au désespoiret des agents de toute sorte et parfaitement dévoués la secondaient. Mais il n'est peut-être qu'un seul genre d'affaires dont on s'acquitte parfaitement bien dans les petites cours despotiquesc'est la garde des prisonniers politiques. L'or de la duchesse ne produisit d'autre effet que de faire renvoyer de la citadelle huit ou dix hommes de tout grade.
Livre Second
Chapitre XVIII.
Ainsiavec un dévouement complet pour le prisonnierla duchesse et le premier ministre n'avaient pu faire pour lui que bien peu de chose. Le prince était en colèrela cour ainsi que le public étaient piqués contre Fabrice et ravis de lui voir arriver malheur; il avait été trop heureux. Malgré l'or jeté à pleines mainsla duchesse n'avait pu faire un pas dans le siège de la citadelle; il ne se passait pas de jour sans que la marquise Raversi ou le chevalier Riscara eussent quelque nouvel avis à communiquer au général Fabio Conti. On soutenait sa faiblesse.
Comme nous l'avons ditle jour de son emprisonnement Fabrice fut conduit d'abord au palais du gouverneur: C'est un joli petit bâtiment construit dans le siècle dernier sur les dessins de Vanvitelliqui le plaça à cent quatre-vingts pieds de hautsur la plate-forme de l'immense tour ronde. Des fenêtres de ce petit palaisisolé sur le dos de l'énorme tour comme la bosse d'un chameauFabrice découvrait la campagne et les Alpes fort au loin; il suivait de l'oeilau pied de la citadellele cours de la Parmasorte de torrentquitournant à droite à quatre lieues de la villeva se jeter dans le Pô. Par-delà la rive gauche de ce fleuvequi formait comme une suite d'immenses taches blanches au milieu des campagnes verdoyantesson oeil ravi apercevait distinctement chacun des sommets de l'immense mur que les Alpes forment au nord de l'Italie. Ces sommetstoujours couverts de neigemême au mois d'août où l'on était alorsdonnent comme une sorte de fraîcheur par souvenir au milieu de ces campagnes brûlantes; l'oeil en peut suivre les moindres détailset pourtant ils sont à plus de trente lieues de la citadelle de Parme. La vue si étendue du joli palais du gouverneur est interceptée vers un angle au midi par la tour Farnèsedans laquelle on préparait à la hâte une chambre pour Fabrice. Cette seconde tour comme le lecteur s'en souvient peut-êtrefut élevée sur la plate-forme de la grosse touren l'honneur d'un prince héréditaire quifort différent de l'Hippolyte fils de Théséen'avait point repoussé les politesses d'une jeune belle-mère. La princesse mourut en quelques heures; le fils du prince ne recouvra sa liberté que dix-sept ans plus tard en montant sur le trône à la mort de son père. Cette tour Farnèse oùaprès trois quarts d'heurel'on fit monter Fabricefort laide à l'extérieurest élevée d'une cinquantaine de pieds au-dessus de la plate-forme de la grosse tour et garnie d'une quantité de paratonnerres. Le prince mécontent de sa femmequi fit bâtir cette prison aperçue de toutes partseut la singulière prétention de persuader à ses sujets qu'elle existait depuis longues années: c'est pourquoi il lui imposa le nom de tour Farnèse. Il était défendu de parler de cette constructionet de toutes les parties de la ville de Parme et des plaines voisines on voyait parfaitement les maçons placer chacune des pierres qui composent cet édifice pentagone. Afin de prouver qu'elle était ancienneon plaça au-dessus de la porte de deux pieds de large et de quatre de hauteurpar laquelle on y entreun magnifique bas-relief qui représente Alexandre Farnèsele général célèbreforçant Henri IV à s'éloigner de Paris. Cette tour Farnèse placée en si belle vue se compose d'un rez-de-chaussée long de quarante pas au moinslarge à proportion et tout rempli de colonnes fort trapuescar cette pièce si démesurément vaste n'a pas plus de quinze pieds d'élévation. Elle est occupée par le corps de gardeetdu centrel'escalier s'élève en tournant autour d'une des colonnes: c'est un petit escalier en ferfort légerlarge de deux pieds à peine et construit en filigrane. Par cet escalier tremblant sous le poids des geôliers qui l'escortaientFabrice arriva à de vastes pièces de plus de vingt pieds de hautformant un magnifique premier étage. Elles furent jadis meublées avec le plus grand luxe pour le jeune prince qui y passa les dix- sept plus belles années de sa vie. A l'une des extrémités de cet appartementon fit voir au nouveau prisonnier une chapelle de la plus grande magnificence; les murs et la voûte sont entièrement revêtus de marbre noir; des colonnes noires aussi et de la plus noble proportion sont placées en lignes le long des murs noirssans les toucheret ces murs sont ornés d'une quantité de têtes de morts en marbre blancde proportions colossalesélégamment sculptées et placées sur deux os en sautoir. Voilà bien une invention de la haine qui ne peut tuerse dit Fabriceet quelle diable d'idée de me montrer cela!
Un escalier en fer et en filigrane fort légerégalement disposé autour d'une colonnedonne accès au second étage de cette prisonet c'est dans les chambres de ce second étagehautes de quinze pieds environ que depuis un an le général Fabio Conti faisait preuve de génie. D'abordsous sa directionl'on avait solidement grillé les fenêtres de ces chambres jadis occupées par les domestiques du prince et qui sont à plus de trente pieds des dalles de pierre formant la plate- forme de la grosse tour ronde. C'est par un corridor obscur placé au centre du bâtiment que l'on arrive à ces chambresqui toutes ont deux fenêtres; et dans ce corridor fort étroitFabrice remarqua trois portes de fer successives formées de barreaux énormes et s'élevant jusqu'à la voûte. Ce sont les planscoupes et élévations de toutes ces belles inventionsqui pendant deux ans avaient valu au général une audience de son maître chaque semaine. Un conspirateur placé dans l'une de ces chambres ne pourrait pas se plaindre à l'opinion d'être traité d'une façon inhumaineet pourtant ne saurait avoir de communication avec personne au mondeni faire un mouvement sans qu'on l'entendît. Le général avait fait placer dans chaque chambre de gros madriers de chêne formant comme des bancs de trois pieds de hautet c'était là son invention capitalecelle qui lui donnait des droits au ministère de la police. Sur ces bancs il avait fait établir une cabane en planchesfort sonorehaute de dix piedset qui ne touchait au mur que du côté des fenêtres. Des trois autres côtés il régnait un petit corridor de quatre pieds de largeentre le mur primitif de la prisoncomposé d'énormes pierres de tailleet les parois en planches de la cabane. Ces paroisformées de quatre doubles de planches de noyerchêne et sapinétaient solidement reliées par des boulons de fer et par des clous sans nombre.
Ce fut dans l'une de ces chambres construites depuis un anet chef-d'oeuvre du général Fabio Contilaquelle avait reçu le beau nom d'Obéissance passiveque Fabrice fut introduit. Il courut aux fenêtres; la vue qu'on avait de ces fenêtres grillées était sublime: un seul petit coin de l'horizon était cachévers le nord-estpar le toit en galerie du joli palais du gouverneurqui n'avait que deux étages; le rez-de-chaussée était occupé par les bureaux de l'état-major; et d'abord les yeux de Fabrice furent attirés vers une des fenêtres du second étageoù se trouvaientdans de jolies cagesune grande quantité d'oiseaux de toute sorte. Fabrice s'amusait à les entendre chanteret à les voir saluer les derniers rayons du crépuscule du soirtandis que les geôliers s'agitaient autour de lui. Cette fenêtre de la volière n'était pas à plus de vingt-cinq pieds de l'une des sienneset se trouvait à cinq ou six pieds en contrebasde façon qu'il plongeait sur les oiseaux.
Il y avait lune ce jour-làet au moment où Fabrice entrait dans sa prisonelle se levait majestueusement à l'horizon à droiteau-dessus de la chaîne des Alpesvers Trévise. Il n'était que huit heures et demie du soiret à l'autre extrémité de l'horizonau couchantun brillant crépuscule rouge orangé dessinait parfaitement les contours du mont Viso et des autres pics des Alpes qui remontent de Nice vers le mont Cenis et Turin; sans songer autrement à son malheurFabrice fut ému et ravi par ce spectacle sublime. C'est donc dans ce monde ravissant que vit Clélia Conti! avec son âme pensive et sérieuseelle doit jouir de cette vue plus qu'un autre; on est ici comme dans des montagnes solitaires à cent lieues de Parme. Ce ne fut qu'après avoir passé plus de deux heures à la fenêtreadmirant cet horizon qui parlait à son âmeet souvent aussi arrêtant sa vue sur le joli palais du gouverneur que Fabrice s'écria tout à coup: Mais ceci est-il une prison? est-ce là ce que j'ai tant redouté? Au lieu d'apercevoir à chaque pas des désagréments et des motifs d'aigreurnotre héros se laissait charmer par les douceurs de la prison.
Tout à coup son attention fut violemment rappelée à la réalité par un tapage épouvantable: sa chambre de boisassez semblable à une cage et surtout fort sonoreétait violemment ébranlée: des aboiements de chien et de petits cris aigus complétaient le bruit le plus singulier. Quoi donc si tôt pourrais-je m'échapper! pensa Fabrice. Un instant aprèsil riait comme jamais peut-être on n'a ri dans une prison. Par ordre du généralon avait fait monter en même temps que les geôliers un chien anglaisfort méchantpréposé à la garde des prisonniers d'importanceet qui devait passer la nuit dans l'espace si ingénieusement ménagé tout autour de la cage de Fabrice. Le chien et le geôlier devaient coucher dans l'intervalle de trois pieds ménagé entre les dalles de pierre du sol primitif de la chambre et le plancher en bois sur lequel le prisonnier ne pouvait faire un pas sans être entendu.
Orà l'arrivée de Fabricela chambre de l'Obéissance passive se trouvait occupée par une centaine de rats énormes qui prirent la fuite dans tous les sens. Le chiensorte d'épagneul croisé avec un fox anglaisn'était point beaumais en revancheil se montra fort alerte. On l'avait attaché sur le pavé en dalles de pierre au-dessous du plancher de la chambre de bois; mais lorsqu'il sentit passer les rats tout près de lui il fit des efforts si extraordinaires qu'il parvint à retirer la tête de son collier; alors advint cette bataille admirable et dont le tapage réveilla Fabrice lancé dans les rêveries des moins tristes. Les rats qui avaient pu se sauver du premier coup de dentse réfugiant dans la chambre de boisle chien monta après eux les six marches qui conduisaient du pavé en pierre à la cabane de Fabrice. Alors commença un tapage bien autrement épouvantable: la cabane était ébranlée jusqu'en ses fondements. Fabrice riait comme un fou et pleurait à force de rire: le geôlier Grillonon moins riantavait fermé la porte; le chiencourant après les ratsn'était gêné par aucun meublecar la chambre était absolument nue; il n'y avait pour gêner les bonds du chien chasseur qu'un poêle de fer dans un coin. Quand le chien eut triomphé de tous ses ennemisFabrice l'appelale caressaréussit à lui plaire: Si jamais celui-ci me voit sautant par-dessus quelque murse dit-ilil n'aboiera pas. Mais cette politique raffinée était une prétention de sa part: dans la situation d'esprit où il étaitil trouvait son bonheur à jouer avec ce chien. Par une bizarrerie à laquelle il ne réfléchissait pointune secrète joie régnait au fond de son âme.
Après qu'il se fut bien essoufflé à courir avec le chien:
-- Comment vous appelez-vousdit Fabrice au geôlier.
-- Grillopour servir Votre Excellence dans tout ce qui est permis par le règlement.
-- Eh bien! mon cher Grilloun nommé Giletti a voulu m'assassiner au milieu d'un grand cheminje me suis défendu et l'ai tué; je le tuerais encore si c'était à faire: mais je n'en veux pas moins mener joyeuse vietant que je serai votre hôte. Sollicitez l'autorisation de vos chefs et allez demander du linge au palais Sanseverina; de plusachetez-moi force nébieu d'Asti.
C'est un assez bon vin mousseux qu'on fabrique en Piémont dans la patrie d'Alfieri et qui est fort estimé surtout de la classe d'amateurs à laquelle appartiennent les geôliers. Huit ou dix de ces messieurs étaient occupés à transporter dans la chambre de bois de Fabrice quelques meubles antiques et fort dorés que l'on enlevait au premier étage dans l'appartement du prince; tous recueillirent religieusement dans leur pensée le mot en faveur du vin d'Asti. Quoi qu'on pût fairel'établissement de Fabrice pour cette première nuit fut pitoyable; mais il n'eut l'air choqué que de l'absence d'une bouteille de bon nébieu. -- Celui-là a l'air d'un bon enfant... dirent les geôliers en s'en allant... et il n'y a qu'une chose à désirerc'est que nos messieurs lui laissent passer de l'argent.
Quand il fut seul et un peu remis de tout ce tapage: Est-il possible que ce soit là la prisonse dit Fabrice en regardant cet immense horizon de Trévise au mont Visola chaîne si étendue des Alpesles pics couverts de neigeles étoilesetc.et une première nuit en prison encore! Je conçois que Clélia Conti se plaise dans cette solitude aérienne; on est ici à mille lieues au-dessus des petitesses et des méchancetés qui nous occupent là-bas. Si ces oiseaux qui sont là sous ma fenêtre lui appartiennentje la verrai... Rougira-t-elle en m'apercevant? Ce fut en discutant cette grande question que le prisonnier trouva le sommeil à une heure fort avancée de la nuit.
Dès le lendemain de cette nuitla première passée en prisonet durant laquelle il ne s'impatienta pas une seule foisFabrice fut réduit à faire la conversation avec Fox le chien anglais; Grillo le geôlier lui faisait bien toujours des yeux fort aimablesmais un ordre nouveau le rendait muetet il n'apportait ni linge ni nébieu.
Verrai-je Clélia? se dit Fabrice en s'éveillant. Mais ces oiseaux sont-ils à elle? Les oiseaux commençaient à jeter des petits cris et à chanteret à cette élévation c'était le seul bruit qui s'entendît dans les airs. Ce fut une sensation pleine de nouveauté et de plaisir pour Fabrice que ce vaste silence qui régnait à cette hauteur: il écoutait avec ravissement les petits gazouillements interrompus et si vifs par lesquels ses voisins les oiseaux saluaient le jour. S'ils lui appartiennentelle paraîtra un instant dans cette chambrelà sous ma fenêtre; et tout en examinant les immenses chaînes des Alpesvis-à-vis le premier étage desquelles la citadelle de Parme semblait s'élever comme un ouvrage avancéses regards revenaient à chaque instant aux magnifiques cages de citronnier et de bois d'acajou quigarnies de fils doréss'élevaient au milieu de la chambre fort claireservant de volière. Ce que Fabrice n'apprit que plus tardc'est que cette chambre était la seule du second étage du palais qui eût de l'ombre de onze heures à quatre; elle était abritée par la tour Farnèse.
Quel ne va pas être mon chagrinse dit Fabricesi au lieu de cette physionomie céleste et pensive que j'attends et qui rougira peut-être un peu si elle m'aperçoitje vois arriver la grosse figure de quelque femme de chambre bien communechargée par procuration de soigner les oiseaux! Mais si je vois Cléliadaignera-t- elle m'apercevoir? Ma foiil faut faire des indiscrétions pour être remarqué; ma situation doit avoir quelques privilèges; d'ailleurs nous sommes tous deux seuls ici et si loin du monde! Je suis un prisonnierapparemment ce que le général Conti et les autres misérables de cette espèce appellent un de leurs subordonnés... Mais elle a tant d'espritou pour mieux dire tant d'âmecomme le suppose le comteque peut-être à ce qu'il ditméprise-t-elle le métier de son père; de là viendrait sa mélancolie! Noble cause de tristesse! Mais après toutje ne suis point précisément un étranger pour elle. Avec quelle grâce pleine de modestie elle m'a salué hier soir! Je me souviens fort bien que lors de notre rencontre près de Côme je lui dis: Un jour je viendrai voir vos beaux tableaux de Parmevous souviendrez-vous de ce nom: Fabrice del Dongo? L'aura-t-elle oublié? elle était si jeune alors!
Mais à proposse dit Fabrice étonné en interrompant tout à coup le cours de ses penséesj'oublie d'être en colère! Serais-je un de ces grands courages comme l'antiquité en a montré quelques exemples au monde? Suis-je un héros sans m'en douter? Comment! moi qui avais tant de peur de la prisonj'y suiset je ne me souviens pas d'être triste! c'est bien le cas de dire que la peur a été cent fois pire que le mal. Quoi! j'ai besoin de me raisonner pour être affligé de cette prisonquicomme le dit Blanèspeut durer dix ans comme dix mois? Serait-ce l'étonnement de tout ce nouvel établissement qui me distrait de la peine que je devrais éprouver? Peut-être que cette bonne humeur indépendante de ma volonté et peu raisonnable cessera tout à couppeut-être en un instant je tomberai dans le noir malheur que je devrais éprouver.
Dans tous les casil est bien étonnant d'être en prison et de devoir se raisonner pour être triste! Ma foij'en reviens à ma suppositionpeut-être que j'ai un grand caractère.
Les rêveries de Fabrice furent interrompues par le menuisier de la citadellelequel venait prendre mesure d'abat-jour pour ses fenêtres; c'était la première fois que cette prison servaitet l'on avait oublié de la compléter en cette partie essentielle.
Ainsise dit Fabriceje vais être privé de cette vue sublimeet il cherchait à s'attrister de cette privation.
-- Mais quoi! s'écria-t-il tout à coup parlant au menuisier je ne verrai plus ces jolis oiseaux?
-- Ah! les oiseaux de mademoiselle! qu'elle aime tant! dit cet homme avec l'air de la bonté; cachéséclipsésanéantis comme tout le reste.
Parler était défendu au menuisier tout aussi strictement qu'aux geôliersmais cet homme avait pitié de la jeunesse du prisonnier: il lui apprit que ces abat-jour énormesplacés sur l'appui des deux fenêtreset s'éloignant du mur tout en s'élevantne devaient laisser aux détenus que la vue du ciel. On fait cela pour la moralelui dit-ilafin d'augmenter une tristesse salutaire et l'envie de se corriger dans l'âme des prisonniers; le généralajouta le menuisiera aussi inventé de leur retirer les vitreset de les faire remplacer à leurs fenêtres par du papier huilé.
Fabrice aima beaucoup le tour épigrammatique de cette conversationfort rare en Italie.
-- Je voudrais bien avoir un oiseau pour me désennuyerje les aime à la folie; achetez-en un de la femme de chambre de mademoiselle Clélia Conti.
-- Quoi! vous la connaissezs'écria le menuisierque vous dites si bien son nom?
-- Qui n'a pas ouï parler de cette beauté si célèbre? Mais j'ai eu l'honneur de la rencontrer plusieurs fois à la cour.
-- La pauvre demoiselle s'ennuie bien iciajouta le menuisier; elle passe sa vie là avec ses oiseaux. Ce matin elle vient de faire acheter de beaux orangers que l'on a placés par son ordre à la porte de la tour sous votre fenêtre; sans la corniche vous pourriez les voir. Il y avait dans cette réponse des mots bien précieux pour Fabriceil trouva une façon obligeante de donner quelque argent au menuisier.
-- Je fais deux fautes à la foislui dit cet hommeje parle à Votre Excellence et je reçois de l'argent. Après demainen revenant pour les abat-jourj'aurai un oiseau dans ma pocheet si je ne suis pas seulje ferai semblant de le laisser envoler; si je puis mêmeje vous apporterai un livre de prières: vous devez bien souffrir de ne pas pouvoir dire vos offices.
Ainsise dit Fabricedès qu'il fut seulces oiseaux sont à ellemais dans deux jours je ne les verrai plus! A cette penséeses regards prirent une teinte de malheur. Mais enfinà son inexprimable joieaprès une si longue attente et tant de regardsvers midi Clélia vint soigner ses oiseaux. Fabrice resta immobile et sans respirationil était debout contre les énormes barreaux de sa fenêtre et fort près. Il remarqua qu'elle ne levait pas les yeux sur luimais ses mouvements avaient l'air gênécomme ceux de quelqu'un qui se sent regardé. Quand elle l'aurait voulula pauvre fille n'aurait pas pu oublier le sourire si fin qu'elle avait vu errer sur les lèvres du prisonnierla veilleau moment où les gendarmes l'emmenaient du corps de garde.
Quoiquesuivant toute apparenceelle veillât sur ses actions avec le plus grand soinau moment où elle s'approcha de la fenêtre de la volièreelle rougit fort sensiblement. La première pensée de Fabricecollé contre les barreaux de fer de sa fenêtrefut de se livrer à l'enfantillage de frapper un peu avec la main sur ces barreauxce qui produirait un petit bruit; puis la seule idée de ce manque de délicatesse lui fit horreur. Je mériterais que pendant huit jours elle envoyât soigner ses oiseaux par sa femme de chambre. Cette idée délicate ne lui fût point venue à Naples ou à Novare.
Il la suivait ardemment des yeux: Certainementse disait-ilelle va s'en aller sans daigner jeter un regard sur cette pauvre fenêtreetpourtant elle est bien en face. Maisen revenant du fond de la chambre que Fabrice grâce à sa position plus élevée apercevait fort bienClélia ne put s'empêcher de le regarder du haut de l'oeiltout en marchantet c'en fut assez pour que Fabrice se crût autorisé à la saluer. Ne sommes-nous pas seuls au monde ici? se dit-il pour s'en donner le courage. Sur ce salutla jeune fille resta immobile et baissa les yeux; puis Fabrice les lui vit relever fort lentement; et évidemmenten faisant effort sur elle-mêmeelle salua le prisonnier avec le mouvement le plus grave et le plus distant mais elle ne put imposer silence à ses yeux; sans qu'elle le sût probablementils exprimèrent un instant la pitié la plus vive. Fabrice remarqua qu'elle rougissait tellement que la teinte rose s'étendait rapidement jusque sur le haut des épaulesdont la chaleur venait d'éloigneren arrivant à la volièreun châle de dentelle noire. Le regard involontaire par lequel Fabrice répondit à son salut redoubla le trouble de la jeune fille. Que cette pauvre femme serait heureusese disait-elle en pensant à la duchessesi un instant seulement elle pouvait le voir comme je le vois!
Fabrice avait eu quelque léger espoir de la saluer de nouveau à son départ; maispour éviter cette nouvelle politesseClélia fit une savante retraite par échelonsde cage en cagecomme sien finissantelle eût dû soigner les oiseaux placés le plus près de la porte. Elle sortit enfin; Fabrice restait immobile à regarder la porte par laquelle elle venait de disparaître; il était un autre homme.
Dès ce moment l'unique objet de ses pensées fut de savoir comment il pourrait parvenir à continuer de la voirmême quand on aurait posé cet horrible abat-jour devant la fenêtre qui donnait sur le palais du gouverneur.
La veille au soiravant de se coucheril s'était imposé l'ennui fort long de cacher la meilleure partie de l'or qu'il avaitdans plusieurs des trous de rats qui ornaient sa chambre de bois. Il fautce soirque je cache ma montre. N'ai-je pas entendu dire qu'avec de la patience et un ressort de montre ébréché on peut couper le bois et même le fer? Je pourrai donc scier cet abat-jour. Ce travail de cacher la montrequi dura deux grandes heuresne lui sembla point long; il songeait aux différents moyens de parvenir à son butet à ce qu'il savait faire en travaux de menuiserie. Si je sais m'y prendrese disait-ilje pourrai couper bien carrément un compartiment de la planche de chêne qui formera l'abat-jourvers la partie qui reposera sur l'appui de la fenêtre; j'ôterai et je remettrai ce morceau suivant les circonstances; je donnerai tout ce que je possède à Grillo afin qu'il veuille bien ne pas s'apercevoir de ce petit manège. Tout le bonheur de Fabrice était désormais attaché à la possibilité d'exécuter ce travailet il ne songeait à rien autre. Si je parviens seulement à la voirje suis heureux... Non passe dit-il; il faut aussi qu'elle voie que je la vois. Pendant toute la nuitil eut la tête remplie d'inventions de menuiserieet ne songea peut-être pas une seule fois à la cour de Parmeà la colère du princeetc.etc. Nous avouerons qu'il ne songea pas davantage à la douleur dans laquelle la duchesse devait être plongée. Il attendait avec impatience le lendemainmais le menuisier ne reparut plus: apparemment qu'il passait pour libéral dans la prison; on eut soin d'en envoyer un autre à mine rébarbativelequel ne répondit jamais que par un grognement de mauvais augure à toutes les choses agréables que l'esprit de Fabrice cherchait à lui adresser. Quelques-unes des nombreuses tentatives de la duchesse pour lier une correspondance avec Fabrice avaient été dépistées par les nombreux agents de la marquise Raversietpar ellele général Fabio Conti était journellement avertieffrayépiqué d'amour-propre. Toutes les huit heuressix soldats de garde se relevaient dans la grande salle aux cent colonnes du rez-de-chaussée; de plusle gouverneur établit un geôlier de garde à chacune des trois portes de fer successives du corridoret le pauvre Grillole seul qui vît le prisonnierfut condamné à ne sortir de la tour Farnèse que tous les huit joursce dont il se montra fort contrarié. Il fit sentir son humeur à Fabrice qui eut le bon esprit de ne répondre que par ces mots: Force nébieu d'Astimon amiet il lui donna de l'argent.
-- Eh bien! même celaqui nous console de tous les mauxs'écria Grillo indignéd'une voix à peine assez élevée pour être entendu du prisonnieron nous défend de le recevoir et je devrais le refusermais je le prends; du resteargent perdu; je ne puis rien vous dire sur rien. Allezil faut que vous soyez joliment coupabletoute la citadelle est sens dessus dessous à cause de vous; les belles menées de madame la duchesse ont déjà fait renvoyer trois d'entre nous.
L'abat-jour sera-t-il prêt avant midi? Telle fut la grande question qui fit battre le coeur de Fabrice pendant toute cette longue matinée; il comptait tous les quarts d'heure qui sonnaient à l'horloge de la citadelle. Enfincomme les trois quarts après onze heures sonnaientl'abat-jour n'était pas encore arrivé; Clélia reparut donnant des soins à ses oiseaux. La cruelle nécessité avait fait faire de si grands pas à l'audace de Fabriceet le danger de ne plus la voir lui semblait tellement au- dessus de toutqu'il osaen regardant Cléliafaire avec le doigt le geste de scier l'abat-jour; il est vrai qu'aussitôt après avoir aperçu ce geste si séditieux en prisonelle salua à demiet se retira.
Hé quoi! se dit Fabrice étonnéserait-elle assez déraisonnable pour voir une familiarité ridicule dans un geste dicté par la plus impérieuse nécessité? Je voulais la prier de daigner toujoursen soignant ses oiseauxregarder quelquefois la fenêtre de la prisonmême quand elle la trouvera masquée par un énorme volet de bois; je voulais lui indiquer que je ferai tout ce qui est humainement possible pour parvenir à la voir. Grand Dieu! est-ce qu'elle ne viendra pas demain à cause de ce geste indiscret? Cette craintequi troubla le sommeil de Fabricese vérifia complètement; le lendemain Clélia n'avait pas paru à trois heuresquand on acheva de poser devant les fenêtres de Fabrice les deux énormes abat-jour; les diverses pièces en avaient été élevéesà partir de l'esplanade de la grosse tourau moyen de cordes et de poulies attachées par-dehors aux barreaux de fer des fenêtres. Il est vrai quecachée derrière une persienne de son appartementClélia avait suivi avec angoisse tous les mouvements des ouvriers; elle avait fort bien vu la mortelle inquiétude de Fabricemais n'en avait pas moins eu le courage de tenir la promesse qu'elle s'était faite.
Clélia était une petite sectaire de libéralisme; dans sa première jeunesse elle avait pris au sérieux tous les propos de libéralisme qu'elle entendait dans la société de son pèrelequel ne songeait qu'à se faire une position; elle était partie de là pour prendre en mépris et presque en horreur le caractère flexible du courtisan: de là son antipathie pour le mariage. Depuis l'arrivée de Fabriceelle était bourrelée de remords: Voilàse disait-elleque mon indigne coeur se met du parti des gens qui veulent trahir mon père! il ose me faire le geste de scier une porte!... Maisse dit- elle aussitôt l'âme navréetoute la ville parle de sa mort prochaine! Demain peut être le jour fatal! avec les monstres qui nous gouvernentquelle chose au monde n'est pas possible! Quelle douceurquelle sérénité héroïque dans ces yeux qui peut-être vont se fermer! Dieu! quelles ne doivent pas être les angoisses de la duchesse! aussi on la dit tout à fait au désespoir. Moi j'irais poignarder le princecomme l'héroïque Charlotte Corday.
Pendant toute cette troisième journée de sa prison Fabrice fut outré de colèremais uniquement de ne pas avoir vu reparaître Clélia. Colère pour colèrej'aurais dû lui dire que je l'aimaiss'écriait-il; car il en était arrivé à cette découverte. Nonce n'est point par grandeur d'âme que je ne songe pas à la prison et que je fais mentir la prophétie de Blanèstant d'honneur ne m'appartient point. Malgré moi je songe à ce regard de douce pitié que Clélia laissa tomber sur moi lorsque les gendarmes m'emmenaient du corps de garde; ce regard a effacé toute ma vie passée. Qui m'eût dit que je trouverais des yeux si doux en un tel lieu! et au moment où j'avais les regards salis par la physionomie de Barbone et par celle de M. le général gouverneur.
Le ciel parut au milieu de ces êtres vils. Et comment faire pour ne pas aimer la beauté et chercher à la revoir? Nonce n'est point par grandeur d'âme que je suis indifférent à toutes les petites vexations dont la prison m'accable. L'imagination de Fabriceparcourant rapidement toutes les possibilitésarriva à celle d'être mis en liberté. Sans doute l'amitié de la duchesse fera des miracles pour moi. Eh bien! je ne la remercierais de la liberté que du bout des lèvres; ces lieux ne sont point de ceux où l'on revient! une fois hors de prisonséparés de sociétés comme nous le sommesje ne reverrais presque jamais Clélia! Etdans le faitquel mal me fait la prison? Si Clélia daignait ne pas m'accabler de sa colèrequ'aurais-je à demander au ciel?
Le soir de ce jour où il n'avait pas vu sa jolie voisineil eut une grande idée: avec la croix de fer du chapelet que l'on distribue à tous les prisonniers à leur entrée en prisonil commençaet avec succèsà percer l'abat-jour. C'est peut-être une imprudencese dit-il avant de commencer. Les menuisiers n'ont-ils pas dit devant moi quedès demainils seront remplacés par les ouvriers peintres? Que diront ceux-ci s'ils trouvent l'abat-jour de la fenêtre percé? Mais si je ne commets cette imprudencedemain je ne puis la voir. Quoi! par ma faute je resterais un jour sans la voir! et encore quand elle m'a quitté fâchée! L'imprudence de Fabrice fut récompensée; après quinze heures de travailil vit Cléliaetpar excès de bonheurcomme elle ne croyait point être aperçue de luielle resta longtemps immobile et le regard fixé sur cet immense abat-jour; il eut tout le temps de lire dans ses yeux les signes de la pitié la plus tendre. Sur la fin de la visite elle négligeait même évidemment les soins à donner à ses oiseauxpour rester des minutes entières immobile à contempler la fenêtre. Son âme était profondément troublée; elle songeait à la duchesse dont l'extrême malheur lui avait inspiré tant de pitiéet cependant elle commençait à la haïr. Elle ne comprenait rien à la profonde mélancolie qui s'emparait de son caractèreelle avait de l'humeur contre elle-même. Deux ou trois foispendant le cours de cette visiteFabrice eut l'impatience de chercher à ébranler l'abat-jour; il lui semblait qu'il n'était pas heureux tant qu'il ne pouvait pas témoigner à Clélia qu'il la voyait. Cependantse disait-ilsi elle savait que je l'aperçois avec autant de facilitétimide et réservée comme elle l'estsans doute elle se déroberait à mes regards.
Il fut bien plus heureux le lendemain (de quelles misères l'amour ne fait-il pas son bonheur!): pendant qu'elle regardait tristement l'immense abat-jouril parvint à faire passer un petit morceau de fil de fer par l'ouverture que la croix de fer avait pratiquéeet il lui fit des signes qu'elle comprit évidemmentdu moins dans ce sens qu'ils voulaient dire: je suis là et je vous vois.
Fabrice eut du malheur les jours suivants. Il voulait enlever à l'abat-jour colossal un morceau de planche grand comme la mainque l'on pourrait remettre à volonté et qui lui permettrait de voir et d'être vuc'est-à-dire de parlerpar signes du moinsde ce qui se passait dans son âme; mais il se trouva que le bruit de la petite scie fort imparfaite qu'il avait fabriquée avec le ressort de sa montre ébréché par la croixinquiétait Grillo qui venait passer de longues heures dans sa chambre. Il crut remarqueril est vraique la sévérité de Clélia semblait diminuer à mesure qu'augmentaient les difficultés matérielles qui s'opposaient à toute correspondance; Fabrice observa fort bien qu'elle n'affectait plus de baisser les yeux ou de regarder les oiseaux quand il essayait de lui donner signe de présence à l'aide de son chétif morceau de fil de fer; il avait le plaisir de voir qu'elle ne manquait jamais à paraître dans la volière au moment précis où onze heures trois quarts sonnaientet il eut presque la présomption de se croire la cause de cette exactitude si ponctuelle. Pourquoi? cette idée ne semble pas raisonnable; mais l'amour observe des nuances invisibles à l'oeil indifférentet en tire des conséquences infinies. Par exempledepuis que Clélia ne voyait plus le prisonnierpresque immédiatement en entrant dans la volièreelle levait les yeux vers sa fenêtre. C'était dans ces journées funèbres où personne dans Parme ne doutait que Fabrice ne fût bientôt mis à mort: lui seul l'ignorait; mais cette affreuse idée ne quittait plus Cléliaet comment se serait-elle fait des reproches du trop d'intérêt qu'elle portait à Fabrice? il allait périr! et pour la cause de la liberté! car il était trop absurde de mettre à mort un del Dongo pour un coup d'épée à un histrion. Il est vrai que cet aimable jeune homme était attaché à une autre femme! Clélia était profondément malheureuseet sans s'avouer bien précisément le genre d'intérêt qu'elle prenait à son sort: Certesse disait-ellesi on le conduit à la mortje m'enfuirai dans un couventet de la vie je ne reparaîtrai dans cette société de la courelle me fait horreur. Assassins polis!
Le huitième jour de la prison de Fabriceelle eut un bien grand sujet de honte: elle regardait fixementet absorbée dans ses tristes penséesl'abat-jour qui cachait la fenêtre du prisonnier; ce jour-là il n'avait encore donné aucun signe de présence: tout à coup un petit morceau d'abat-jourplus grand que la mainfut retiré par lui; il la regarda d'un air gaiet elle vit ses yeux qui la saluaient. Elle ne put soutenir cette épreuve inattendueelle se retourna rapidement vers ses oiseaux et se mit à les soigner; mais elle tremblait au point qu'elle versait l'eau qu'elle leur distribuaitet Fabrice pouvait voir parfaitement son émotion; elle ne put supporter cette situationet prit le parti de se sauver en courant.
Ce moment fut le plus beau de la vie de Fabricesans aucune comparaison. Avec quels transports il eût refusé la libertési on la lui eût offerte en cet instant!
Le lendemain fut le jour de grand désespoir de la duchesse. Tout le monde tenait pour sûr dans la ville que c'en était fait de Fabrice; Clélia n'eut pas le triste courage de lui montrer une dureté qui n'était pas dans son coeurelle passa une heure et demie à la volièreregarda tous ses signeset souvent lui réponditau moins par l'expression de l'intérêt le plus vif et le plus sincère; elle le quittait des instants pour lui cacher ses larmes. Sa coquetterie de femme sentait bien vivement l'imperfection du langage employé: si l'on se fût parléde combien de façons différentes n'eût-elle pas pu chercher à deviner quelle était précisément la nature des sentiments que Fabrice avait pour la duchesse! Clélia ne pouvait presque plus se faire d'illusionelle avait de la haine pour Mme Sanseverina.
Une nuit Fabrice vint à penser un peu sérieusement à sa tante: il fut étonnéil eut peine à reconnaître son imagele souvenir qu'il conservait d'elle avait totalement changé; pour luià cette heureelle avait cinquante ans.
-- Grand Dieu! s'écria-t-il avec enthousiasmeque je fus bien inspiré de ne pas lui dire que je l'aimais! II en était au point de ne presque plus pouvoir comprendre comment il l'avait trouvée si jolie. Sous ce rapportla petite Marietta lui faisait une impression de changement moins sensible: c'est que jamais il ne s'était figuré que son âme fût de quelque chose dans l'amour pour la Mariettatandis que souvent il avait cru que son âme tout entière appartenait à la duchesse. La duchesse d'A... et la Marietta lui faisaient l'effet maintenant de deux jeunes colombes dont tout le charme serait dans la faiblesse et dans l'innocencetandis que l'image sublime de Clélia Contien s'emparant de toute son âmeallait jusqu'à lui donner de la terreur. Il sentait trop bien que l'éternel bonheur de sa vie allait le forcer de compter avec la fille du gouverneuret qu'il était en son pouvoir de faire de lui le plus malheureux des hommes. Chaque jour il craignait mortellement de voir se terminer tout à couppar un caprice sans appel de sa volontécette sorte de vie singulière et délicieuse qu'il trouvait auprès d'elle; toutefoiselle avait déjà rempli de félicité les deux premiers mois de sa prison. C'était le temps oùdeux fois la semainele général Fabio Conti disait au prince: Je puis donner ma parole d'honneur à Votre Altesse que le prisonnier del Dongo ne parle à âme qui viveet passe sa vie dans l'accablement du plus profond désespoirou à dormir.
Clélia venait deux ou trois fois le jour voir ses oiseauxquelquefois pour des instants: si Fabrice ne l'eût pas tant aiméeil eût bien vu qu'il était aimé; mais il avait des doutes mortels à cet égard. Clélia avait fait placer un piano dans la volière. Tout en frappant les touchespour que le son de l'instrument pût rendre compte de sa présence et occupât les sentinelles qui se promenaient sous ses fenêtreselle répondait des yeux aux questions de Fabrice. Sur un seul sujet elle ne faisait jamais de réponseet même dans les grandes occasionsprenait la fuiteet quelquefois disparaissait pour une journée entière; c'était lorsque les signes de Fabrice indiquaient des sentiments dont il était trop difficile de ne pas comprendre l'aveu: elle était inexorable sur ce point.
Ainsiquoique étroitement resserré dans une assez petite cageFabrice avait une vie fort occupée; elle était employée tout entière à chercher la solution de ce problème si important: M'aime-t-elle? Le résultat de milliers d'observations sans cesse renouveléesmais aussi sans cesse mises en douteétait ceci: Tous ses gestes volontaires disent nonmais ce qui est involontaire dans le mouvement de ses yeux semble avouer qu'elle prend de l'amitié pour moi.
Clélia espérait bien ne jamais arriver à un aveuet c'est pour éloigner ce péril qu'elle avait repousséavec une colère excessiveune prière que Fabrice lui avait adressée plusieurs fois. La misère des ressources employées par le pauvre prisonnier aurait dûce sembleinspirer à Clélia plus de pitié. Il voulait correspondre avec elle au moyen de caractères qu'il traçait sur sa main avec un morceau de charbon dont il avait fait la précieuse découverte dans son poêle; il aurait formé les mots lettre à lettresuccessivement. Cette invention eût doublé les moyens de conversation en ce qu'elle eût permis de dire des choses précises. Sa fenêtre était éloignée de celle de Clélia d'environ vingt-cinq pieds; il eût été trop chanceux de se parler par-dessus la tête des sentinelles se promenant devant le palais du gouverneur. Fabrice doutait d'être aimé; s'il eût eu quelque expérience de l'amouril ne lui fût pas resté de doutes: mais jamais femme n'avait occupé son coeur; il n'avaitdu resteaucun soupçon d'un secret qui l'eût mis au désespoir s'il l'eût connu; il était grandement question du mariage de Clélia Conti avec le marquis Crescenzil'homme le plus riche de la cour.
Livre Second
Chapitre XIX.
L'ambition du général Fabio Contiexaltée jusqu'à la folie par les embarras qui venaient se placer au milieu de la carrière du premier ministre Moscaet qui semblaient annoncer sa chutel'avait porté à faire des scènes violentes à sa fille; il lui répétait sans cesseet avec colèrequ'elle cassait le cou à sa fortune si elle ne se déterminait enfin à faire un choix; à vingt ans passés il était temps de prendre un parti; cet état d'isolement crueldans lequel son obstination déraisonnable plongeait le généraldevait cesser à la finetc.etc.
C'était d'abord pour se soustraire à ces accès d'humeur de tous les instants que Clélia s'était réfugiée dans la volière; on n'y pouvait arriver que par un petit escalier de bois fort incommodeet dont la goutte faisait un obstacle sérieux pour le gouverneur.
Depuis quelques semainesl'âme de Clélia était tellement agitéeelle savait si peu elle-même ce qu'elle devait désirerquesans donner précisément une parole à son pèreelle s'était presque laissé engager. Dans un de ses accès de colèrele général s'était écrié qu'il saurait bien l'envoyer s'ennuyer dans le couvent le plus triste de Parmeet quelàil la laisserait se morfondre jusqu'à ce qu'elle daignât faire un choix.
-- Vous savez que notre maisonquoique fort anciennene réunit pas six mille livres de rentetandis que la fortune du marquis Crescenzi s'élève à plus de cent mille écus par an. Tout le monde à la cour s'accorde à lui reconnaître le caractère le plus doux; jamais il n'a donné de sujet de plainte à personne; il est fort bel hommejeunefort bien vu du princeet je dis qu'il faut être folle à lier pour repousser ses hommages. Si ce refus était le premierje pourrais peut-être le supporter; mais voici cinq ou six partiset des premiers de la courque vous refusezcomme une petite sotte que vous êtes. Et que deviendriez-vousje vous priesi j'étais mis à la demi-solde? quel triomphe pour mes ennemissi l'on me voyait logé dans quelque second étagemoi dont il a été si souvent question pour le ministre! Nonmorbleu! voici assez de temps que ma bonté me fait jouer le rôle d'un Cassandre. Vous allez me fournir quelque objection valable contre ce pauvre marquis Crescenziqui a la bonté d'être amoureux de vousde vouloir vous épouser sans dotet de vous assigner un douaire de trente mille livres de renteavec lequel du moins je pourrai me loger; vous allez me parler raisonnablementoumorbleu! vous l'épousez dans deux mois!...
Un seul mot de tout ce discours avait frappé Cléliac'était la menace d'être mise au couventet par conséquent éloignée de la citadelleet au moment encore où la vie de Fabrice semblait ne tenir qu'à un filcar il ne se passait pas de mois que le bruit de sa mort prochaine ne courût de nouveau à la ville et à la cour. Quelque raisonnement qu'elle se fîtelle ne put se déterminer à courir cette chance: Etre séparée de Fabriceet au moment où elle tremblait pour sa vie! c'était à ses yeux le plus grand des mauxc'en était du moins le plus immédiat.
Ce n'est pas quemême en n'étant pas éloignée de Fabriceson coeur trouvât la perspective du bonheur; elle le croyait aimé de la duchesseet son âme était déchirée par une jalousie mortelle. Sans cesse elle songeait aux avantages de cette femme si généralement admirée. L'extrême réserve qu'elle s'imposait envers Fabricele langage des signes dans lequel elle l'avait confinéde peur de tomber dans quelque indiscrétiontout semblait se réunir pour lui ôter les moyens d'arriver à quelque éclaircissement sur sa manière d'être avec la duchesse. Ainsichaque jourelle sentait plus cruellement l'affreux malheur d'avoir une rivale dans le coeur de Fabriceet chaque jour elle osait moins s'exposer au danger de lui donner l'occasion de dire toute la vérité sur ce qui se passait dans ce coeur. Mais quel charme cependant de l'entendre faire l'aveu de ses sentiments vrais! quel bonheur pour Clélia de pouvoir éclaircir les soupçons affreux qui empoisonnaient sa vie!
Fabrice était léger; à Naplesil avait la réputation de changer assez facilement de maîtresse. Malgré toute la réserve imposée au rôle d'une demoiselledepuis qu'elle était chanoinesse et qu'elle allait à la courCléliasans interroger jamaismais en écoutant avec attentionavait appris à connaître la réputation que s'étaient faite les jeunes gens qui avaient successivement recherché sa main; eh bien! Fabricecomparé à tous ces jeunes gensétait celui qui portait le plus de légèreté dans ses relations de coeur. Il était en prisonil s'ennuyaitil faisait la cour à l'unique femme à laquelle il pût parler; quoi de plus simple? quoi même de plus commun? et c'était ce qui désolait Clélia. Quand mêmepar une révélation complèteelle eût appris que Fabrice n'aimait plus la duchessequelle confiance pouvait-elle avoir dans ses paroles? quand même elle eût cru à la sincérité de ses discoursquelle confiance eût-elle pu avoir dans la durée de ses sentiments? Et enfinpour achever de porter le désespoir dans son coeurFabrice n'était-il pas déjà fort avancé dans la carrière ecclésiastique? n'était-il pas à la veille de se lier par des voeux éternels? Les plus grandes dignités ne l'attendaient- elles pas dans ce genre de vie? S'il me restait la moindre lueur de bon sensse disait la malheureuse Cléliane devrais-je pas prendre la fuite? ne devrais-je pas supplier mon père de m'enfermer dans quelque couvent fort éloigné? Et pour comble de misèrec'est précisément la crainte d'être éloignée de la citadelle et renfermée dans un couvent qui dirige toute ma conduite! C'est cette crainte qui me force à dissimulerqui m'oblige au hideux et déshonorant mensonge de feindre d'accepter les soins et les attentions publiques du marquis Crescenzi.
Le caractère de Clélia était profondément raisonnable; en toute sa vie elle n'avait pas eu à se reprocher une démarche inconsidéréeet sa conduite en cette occurrence était le comble de la déraison: on peut juger de ses souffrances!... Elles étaient d'autant plus cruelles qu'elle ne se faisait aucune illusion. Elle s'attachait à un homme qui était éperdument aimé de la plus belle femme de la courd'une femme quià tant de titresétait supérieure à elle Clélia! Et cet homme mêmeeût-il été libren'était pas capable d'un attachement sérieuxtandis qu'ellecomme elle le sentait trop bienn'aurait jamais qu'un seul attachement dans la vie.
C'était donc le coeur agité des plus affreux remords que tous les jours Clélia venait à la volière: portée en ce lieu comme malgré elleson inquiétude changeait d'objet et devenait moins cruelleles remords disparaissaient pour quelques instants; elle épiaitavec des battements de coeur indiciblesles moments où Fabrice pouvait ouvrir la sorte de vasistas par lui pratiqué dans l'immense abat- jour qui masquait sa fenêtre. Souvent la présence du geôlier Grillo dans sa chambre l'empêchait de s'entretenir par signes avec son amie.
Un soirsur les onze heuresFabrice entendit des bruits de la nature la plus étrange dans la citadelle: de nuiten se couchant sur la fenêtre et sortant la tête hors du vasistasil parvenait à distinguer les bruits un peu forts qu'on faisait dans le grand escalierdit des trois cents marcheslequel conduisait de la première cour dans l'intérieur de la tour rondeà l'esplanade en pierre sur laquelle on avait construit le palais du gouverneur et la prison Farnèse où il se trouvait.
Vers le milieu de son développementà cent quatre-vingts marches d'élévationcet escalier passait du côté méridional d'une vaste courau côté du nord; là se trouvait un pont en fer fort léger et fort étroitau milieu duquel était établi un portier. On relevait cet homme toutes les six heureset il était obligé de se lever et d'effacer le corps pour que l'on pût passer sur le pont qu'il gardaitet par lequel seul on pouvait parvenir au palais du gouverneur et à la tour Farnèse. Il suffisait de donner deux tours à un ressortdont le gouverneur portait la clef sur luipour précipiter ce pont de fer dans la courà une profondeur de plus de cent pieds; cette simple précaution prisecomme il n'y avait pas d'autre escalier dans toute la citadelleet que tous les soirs à minuit un adjudant rapportait chez le gouverneuret dans un cabinet auquel on entrait par sa chambreles cordes de tous les puitsil restait complètement inaccessible dans son palaiset il eût été également impossible à qui que ce fût d'arriver à la tour Farnèse. C'est ce que Fabrice avait parfaitement bien remarqué le jour de son entrée à la citadelleet ce que Grilloqui comme tous les geôliers aimait à vanter sa prisonlui avait plusieurs fois expliqué: ainsi il n'avait guère d'espoir de se sauver. Cependant il se souvenait d'une maxime de l'abbé Blanès: «L'amant songe plus souvent à arriver à sa maîtresse que le mari à garder sa femme; le prisonnier songe plus souvent à se sauverque le geôlier à fermer sa porte; doncquels que soient les obstaclesl'amant et le prisonnier doivent réussir. »
Ce soir-là Fabrice entendait fort distinctement un grand nombre d'hommes passer sur le pont en ferdit le pont de l'esclaveparce que jadis un esclave dalmate avait réussi à se sauveren précipitant le gardien du pont dans la cour.
On vient faire ici un enlèvementon va peut-être me mener pendre; mais il peut y avoir du désordreil s'agit d'en profiter. Il avait pris ses armesil retirait déjà de l'or de quelques-unes de ses cachetteslorsque tout à coup il s'arrêta.
-- L'homme est un plaisant animals'écria-t-ilil faut en convenir! Que dirait un spectateur invisible qui verrait mes préparatifs? Est-ce que par hasard je veux me sauver? Que deviendrais-je le lendemain du jour où je serais de retour à Parme? est-ce que je ne ferais pas tout au monde pour revenir auprès de Clélia? S'il y a du désordreprofitons-en pour me glisser dans le palais du gouverneur; peut-être je pourrai parler à Cléliapeut-être autorisé par le désordre j'oserai lui baiser la main. Le général Contifort défiant de sa natureet non moins vaniteuxfait garder son palais par cinq sentinellesune à chaque angle du bâtimentet une cinquième à la porte d'entréemais par bonheur la nuit est fort noire. A pas de loupFabrice alla vérifier ce que faisaient le geôlier Grillo et son chien: le geôlier était profondément endormi dans une peau de boeuf suspendue au plancher par quatre cordeset entourée d'un filet grossier; le chien Fox ouvrit les yeuxse levaet s'avança doucement vers Fabrice pour le caresser.
Notre prisonnier remonta légèrement les six marches qui conduisaient à sa cabane de bois; le bruit devenait tellement fort au pied de la tour Farnèseet précisément devant la portequ'il pensa que Grillo pourrait bien se réveiller. Fabricechargé de toutes ses armesprêt à agirse croyait réservé cette nuit-là aux grandes aventuresquand tout à coup il entendit commencer la plus belle symphonie du monde: c'était une sérénade que l'on donnait au général ou à sa fille. Il tomba dans un accès de rire fou: Et moi qui songeais déjà à donner des coups de dague! comme si une sérénade n'était pas une chose infiniment plus ordinaire qu'un enlèvement nécessitant la présence de quatre-vingts personnes dans une prison ou qu'une révolte! La musique était excellente et parut délicieuse à Fabricedont l'âme n'avait eu aucune distraction depuis tant de semaines; elle lui fit verser de bien douces larmes; dans son ravissementil adressait les discours les plus irrésistibles à la belle Clélia. Mais le lendemainà midiil la trouva d'une mélancolie tellement sombreelle était si pâleelle dirigeait sur lui des regards où il lisait quelquefois tant de colèrequ'il ne se sentit pas assez autorisé pour lui adresser une question sur la sérénade; il craignit d'être impoli.
Clélia avait grandement raison d'être tristec'était une sérénade que lui donnait le marquis Crescenzi; une démarche aussi publique était en quelque sorte l'annonce officielle du mariage. Jusqu'au jour même de la sérénadeet jusqu'à neuf heures du soirClélia avait fait la plus belle résistancemais elle avait eu la faiblesse de céder à la menace d'être envoyée immédiatement au couventqui lui avait été faite par son père.
Quoi! je ne le verrais plus! s'était-elle dit en pleurant. C'est en vain que sa raison avait ajouté: Je ne le verrais plus cet être qui fera mon malheur de toutes les façonsje ne verrais plus cet amant de la duchesseje ne verrais plus cet homme léger qui a eu dix maîtresses connues à Napleset les a toutes trahies; je ne verrais plus ce jeune ambitieux quis'il survit à la sentence qui pèse sur luiva s'engager dans les ordres sacrés! Ce serait un crime pour moi de le regarder encore lorsqu'il sera hors de cette citadelleet son inconstance naturelle m'en épargnera la tentation; carque suis-je pour lui? un prétexte pour passer moins ennuyeusement quelques heures de chacune de ses journées de prison. Au milieu de toutes ces injuresClélia vint à se souvenir du sourire avec lequel il regardait les gendarmes qui l'entouraient lorsqu'il sortait du bureau d'écrou pour monter à la tour Farnèse. Les larmes inondèrent ses yeux: Cher amique ne ferais-je pas pour toi! Tu me perdrasje le saistel est mon destin; je me perds moi-même d'une manière atroce en assistant ce soir à cette affreuse sérénade mais demainà midije reverrai tes yeux!
Ce fut précisément le lendemain de ce jour où Clélia avait fait de si grands sacrifices au jeune prisonnier qu'elle aimait d'une passion si vive; ce fut le lendemain de ce jour oùvoyant tous ses défautselle lui avait sacrifié sa vieque Fabrice fut désespéré de sa froideur. Si même en n'employant que le langage si imparfait des signes il eût fait la moindre violence à l'âme de Cléliaprobablement elle n'eût pu retenir ses larmeset Fabrice eût obtenu l'aveu de tout ce qu'elle sentait pour luimais il manquait d'audaceil avait une trop mortelle crainte d'offenser Cléliaelle pouvait le punir d'une peine trop sévère. En d'autres termesFabrice n'avait aucune expérience du genre d'émotion que donne une femme que l'on aime; c'était une sensation qu'il n'avait jamais éprouvéemême dans sa plus faible nuance. Il lui fallut huit joursaprès celui de la sérénadepour se remettre avec Clélia sur le pied accoutumé de bonne amitié. La pauvre fille s'armait de sévéritémourant de crainte de se trahiret il semblait à Fabrice que chaque jour il était moins bien avec elle.
Un jouret il y avait alors près de trois mois que Fabrice était en prison sans avoir eu aucune communication quelconque avec le dehorset pourtant sans se trouver malheureux; Grillo était resté fort tard le matin dans sa chambre; Fabrice ne savait comment le renvoyeril était au désespoir; enfin midi et demi avait déjà sonné lorsqu'il put ouvrir les deux petites trappes d'un pied de haut qu'il avait pratiquées à l'abat-jour fatal.
Clélia était debout à la fenêtre de la volièreles yeux fixés sur celle de Fabrice; ses traits contractés exprimaient le plus violent désespoir. A peine vit-elle Fabricequ'elle lui fit signe que tout était perdu: elle se précipita à son piano etfeignant de chanter un récitatif de l'opéra alors à la modeelle lui diten phrases interrompues par le désespoir et par la crainte d'être comprise par les sentinelles qui se promenaient sous la fenêtre.
«Grand Dieu! vous êtes encore en vie? Que ma reconnaissance est grande envers le Ciel! Barbonece geôlier dont vous punîtes l'insolence le jour de votre entrée iciavait disparuil n'était plus dans la citadelle; avant-hier soir il est rentréet depuis hier j'ai lieu de croire qu'il cherche à vous empoisonner. Il vient rôder dans la cuisine particulière du palais qui fournit vos repas. Je ne sais rien de sûrmais ma femme de chambre croit que cette figure atroce ne vient dans les cuisines du palais que dans le dessein de vous ôter la vie. Je mourais d'inquiétude ne vous voyant point paraîtreje vous croyais mort. Abstenez-vous de tout aliment jusqu'à nouvel avisje vais faire l'impossible pour vous faire parvenir quelque peu de chocolat. Dans tous les casce soir à neuf heuressi la bonté du Ciel veut que vous ayez un filou que vous puissiez former un ruban avec votre lingelaissez-le descendre de votre fenêtre sur les orangersj'y attacherai une corde que vous retirerez à vouset à l'aide de cette corde je vous ferai passer du pain et du chocolat. »
Fabrice avait conservé comme un trésor le morceau de charbon qu'il avait trouvé dans le poêle de sa chambre: il se hâta de profiter de l'émotion de Cléliaet d'écrire sur sa main une suite de lettres dont l'apparition successive formait ces mots:
«Je vous aimeet la vie ne m'est précieuse que parce que je vous vois; surtout envoyez-moi du papier et un crayon. »
Ainsi que Fabrice l'avait espérél'extrême terreur qu'il lisait dans les traits de Clélia empêcha la jeune fille de rompre l'entretien après ce mot si hardije vous aime; elle se contenta de témoigner beaucoup d'humeur. Fabrice eut l'esprit d'ajouter: Par le grand vent qu'il fait aujourd'huije n'entends que fort imparfaitement les avis que vous daignez me donner en chantantle son du piano couvre la voix. Qu'est-ce que c'estpar exempleque ce poison dont vous me parlez?
A ce motla terreur de la jeune fille reparut tout entière; elle se mit à la hâte à tracer de grandes lettres à l'encre sur les pages d'un livre qu'elle déchiraet Fabrice fut transporté de joie en voyant enfin établiaprès trois mois de soinsce moyen de correspondance qu'il avait si vainement sollicité. Il n'eut garde d'abandonner la petite ruse qui lui avait si bien réussiil aspirait à écrire des lettreset feignait à chaque instant de ne pas bien saisir les mots dont Clélia exposait successivement à ses yeux toutes les lettres.
Elle fut obligée de quitter la volière pour courir auprès de son père; elle craignait par-dessus tout qu'il ne vînt l'y chercher; son génie soupçonneux n'eût point été content du grand voisinage de la fenêtre de cette volière et de l'abat-jour qui masquait celle du prisonnier. Clélia elle-même avait eu l'idée quelques moments auparavantlorsque la non-apparition de Fabrice la plongeait dans une si mortelle inquiétudeque l'on pourrait jeter une petite pierre enveloppée d'un morceau de papier vers la partie supérieure de cet abat-jour; si le hasard voulait qu'en cet instant le geôlier chargé de la garde de Fabrice ne se trouvât pas dans sa chambrec'était un moyen de correspondance certain.
Notre prisonnier se hâta de construire une sorte de ruban avec du linge; et le soirun peu après neuf heuresil entendit fort bien de petits coups frappés sur les caisses des orangers qui se trouvaient sous sa fenêtre; il laissa glisser son ruban qui lui ramena une petite corde fort longueà l'aide de laquelle il retira d'abord une provision de chocolatet ensuiteà son inexprimable satisfactionun rouleau de papier et un crayon. Ce fut en vain qu'il tendit la corde ensuiteil ne reçut plus rien; apparemment que les sentinelles s'étaient rapprochées des orangers. Mais il était ivre de joie. Il se hâta d'écrire une lettre infinie à Clélia: à peine fut-elle terminée qu'il l'attacha à sa corde et la descendit. Pendant plus de trois heures il attendit vainement qu'on vînt la prendreet plusieurs fois la retira pour y faire des changements. Si Clélia ne voit pas ma lettre ce soirse disait-iltandis qu'elle est encore émue par ses idées de poisonpeut-être demain matin rejettera-t-elle bien loin l'idée de recevoir une lettre.
Le fait est que Clélia n'avait pu se dispenser de descendre à la ville avec son père: Fabrice en eut presque l'idée en entendantvers minuit et demi rentrer la voiture du général; il connaissait le pas des chevaux. Quelle ne fut pas sa joie lorsquequelques minutes après avoir entendu le général traverser l'esplanade et les sentinelles lui présenter les armesil sentit s'agiter la corde qu'il n'avait cessé de tenir autour du bras! On attachait un grand poids à cette cordedeux petites secousses lui donnèrent le signal de la retirer. Il eut assez de peine à faire passer au poids qu'il ramenait une corniche extrêmement saillante qui se trouvait sous sa fenêtre.
Cet objet qu'il avait eu tant de peine à faire remonterc'était une carafe remplie d'eau et enveloppée dans un châle. Ce fut avec délices que ce pauvre jeune hommequi vivait depuis si longtemps dans une solitude si complètecouvrit ce châle de ses baisers. Mais il faut renoncer à peindre son émotion lorsque enfinaprès tant de jours d'espérance vaineil découvrit un petit morceau de papier qui était attaché au châle par une épingle.
«Ne buvez que de cette eauvivez avec du chocolat; demain je ferai tout au monde pour vous faire parvenir du painje le marquerai de tous les côtés avec de petites croix tracées à l'encre. C'est affreux à diremais il faut que vous le sachiezpeut-être Barbone est-il chargé de vous empoisonner. Comment n'avez vous pas senti que le sujet que vous traitez dans votre lettre au crayon est fait pour me déplaire? Aussi je ne vous écrirais pas sans le danger extrême qui vous menace. Je viens de voir la duchesseelle se porte bien ainsi que le comtemais elle est fort maigrie; ne m'écrivez plus sur ce sujet: voudriez-vous me fâcher? »
Ce fut un grand effort de vertu chez Clélia que d'écrire l'avant-dernière ligne de ce billet. Tout le monde prétendaitdans la société de la courque Mme Sanseverina prenait beaucoup d'amitié pour le comte Baldice si bel hommel'ancien ami de la marquise Raversi. Ce qu'il y avait de sûrc'est qu'il s'était brouillé de la façon la plus scandaleuse avec cette marquise quipendant six anslui avait servi de mère et l'avait établi dans le monde.
Clélia avait été obligée de recommencer ce petit mot écrit à la hâteparce que dans la première rédaction il perçait quelque chose des nouvelles amours que la malignité publique supposait à la duchesse.
-- Quelle bassesse à moi! s'était-elle écriée: dire du mal à Fabrice de la femme qu'il aime!...
Le lendemain matinlongtemps avant le jourGrillo entra dans la chambre de Fabricey déposa un assez lourd paquetet disparut sans mot dire. Ce paquet contenait un pain assez grosgarni de tous les côtés de petites croix tracées à la plume: Fabrice les couvrit de baisers: il était amoureux. A côté du pain se trouvait un rouleau recouvert d'un grand nombre de doubles de papier; il renfermait six mille francs en sequins; enfinFabrice trouva un beau bréviaire tout neuf: une main qu'il commençait à connaître avait tracé ces mots à la marge:
«Le poison! Prendre garde à l'eauau vinà tout; vivre de chocolattâcher de faire manger par le chien le dîner auquel on ne touchera pas; il ne faut pas paraître méfiantl'ennemi chercherait un autre moyen. Pas d'étourderieau nom de Dieu! pas de légèreté! »
Fabrice se hâta d'enlever ces caractères chéris qui pouvaient compromettre Cléliaet de déchirer un grand nombre de feuillets du bréviaireà l'aide desquels il fit plusieurs alphabets; chaque lettre était proprement tracée avec du charbon écrasé délayé dans du vin. Ces alphabets se trouvèrent secs lorsqu'à onze heures trois quarts Clélia parut à deux pas en arrière de la fenêtre de la volière. La grande affaire maintenantse dit Fabricec'est qu'elle consente à en faire usage. Maispar bonheuril se trouva qu'elle avait beaucoup de choses à dire au jeune prisonnier sur la tentative d'empoisonnement: un chien des filles de service était mort pour avoir mangé un plat qui lui était destiné. Cléliabien loin de faire des objections contre l'usage des alphabetsen avait préparé un magnifique avec de l'encre. La conversation suivie par ce moyenassez incommode dans les premiers momentsne dura pas moins d'une heure et demiec'est-à-dire tout le temps que Clélia put rester à la volière. Deux ou trois foisFabrice se permettant des choses défendueselle ne répondit paset alla pendant un instant donner à ses oiseaux les soins nécessaires.
Fabrice avait obtenu quele soiren lui envoyant de l'eauelle lui ferait parvenir un des alphabets tracés par elle avec de l'encreet qui se voyait beaucoup mieux. Il ne manqua pas d'écrire une fort longue lettre dans laquelle il eut soin de ne point placer de choses tendresdu moins d'une façon qui pût offenser. Ce moyen lui réussit; sa lettre fut acceptée.
Le lendemaindans la conversation par les alphabetsClélia ne lui fit pas de reproches; elle lui apprit que le danger du poison diminuait; le Barbone avait été attaqué et presque assommé par les gens qui faisaient la cour aux filles de cuisine du palais du gouverneurprobablement il n'oserait plus reparaître dans les cuisines. Clélia lui avoua quepour luielle avait osé voler du contre-poison à son père; elle le lui envoyait: l'essentiel était de repousser à l'instant tout aliment auquel on trouverait une saveur extraordinaire.
Clélia avait fait beaucoup de questions à don Cesaresans pouvoir découvrir d'où provenaient les six cents sequins reçus par Fabrice; dans tous les casc'était un signe excellent; la sévérité diminuait.
Cet épisode du poison avança infiniment les affaires de notre prisonnier; toutefois jamais il ne put obtenir le moindre aveu qui ressemblât à de l'amourmais il avait le bonheur de vivre de la manière la plus intime avec Clélia. Tous les matinset souvent les soirsil y avait une longue conversation avec les alphabets; chaque soirà neuf heuresClélia acceptait une longue lettreet quelquefois y répondait par quelques mots; elle lui envoyait le journal et quelques livres; enfinGrillo avait été amadoué au point d'apporter à Fabrice du pain et du vinqui lui étaient remis journellement par la femme de chambre de Clélia. Le geôlier Grillo en avait conclu que le gouverneur n'était pas d'accord avec les gens qui avaient chargé Barbone d'empoisonner le jeune Monsignoreet il en était fort aiseainsi que tous ses camaradescar un proverbe s'était établi dans la prison: il suffit de regarder en face monsignore del Dongo pour qu'il vous donne de l'argent.
Fabrice était devenu fort pâle; le manque absolu d'exercice nuisait à sa santé; à cela prèsjamais il n'avait été aussi heureux. Le ton de la conversation était intimeet quelquefois fort gaientre Clélia et lui. Les seuls moments de la vie de Clélia qui ne fussent pas assiégés de prévisions funestes et de remords étaient ceux qu'elle passait à s'entretenir avec lui. Un jour elle eut l'imprudence de lui dire:
-- J'admire votre délicatesse; comme je suis la fille du gouverneurvous ne me parlez jamais du désir de recouvrer la liberté!
-- C'est que je me garde bien d'avoir un désir aussi absurdelui répondit Fabrice; une fois de retour à Parmecomment vous reverrais-je? et la vie me serait désormais insupportable si je ne pouvais vous dire tout ce que je pense... nonpas précisément tout ce que je pensevous y mettez bon ordre; mais enfinmalgré votre méchancetévivre sans vous voir tous les jours serait pour moi un bien autre supplice que cette prison! de la vie je ne fus aussi heureux!... N'est-il pas plaisant de voir que le bonheur m'attendait en prison?
-- Il y a bien des choses à dire sur cet article répondit Clélia d'un air qui devint tout à coup excessivement sérieux et presque sinistre.
-- Comment! s'écria Fabrice fort alarméserais-je exposé à perdre cette place si petite que j'ai pu gagner dans votre coeuret qui fait ma seule joie en ce monde?
-- Ouilui dit-ellej'ai tout lieu de croire que vous manquez de probité envers moiquoique passant d'ailleurs dans le monde pour fort galant homme; mais je ne veux pas traiter ce sujet aujourd'hui.
Cette ouverture singulière jeta beaucoup d'embarras dans leur conversationet souvent l'un et l'autre eurent les larmes aux yeux.
Le fiscal général Rassi aspirait toujours à changer de nom; il était bien las de celui qu'il s'était faitet voulait devenir baron Riva. Le comte Moscade son côtétravaillaitavec toute l'habileté dont il était capableà fortifier chez ce juge vendu la passion de la baronniecomme il cherchait à redoubler chez le prince la folle espérance de se faire roi constitutionnel de la Lombardie. C'étaient les seuls moyens qu'il eût pu inventer de retarder la mort de Fabrice.
Le prince disait à Rassi:
-- Quinze jours de désespoir et quinze jours d'espérancec'est par ce régime patiemment suivi que nous parviendrons à vaincre le caractère de cette femme altière; c'est par ces alternatives de douceur et de dureté que l'on arrive à dompter les chevaux les plus féroces. Appliquez le caustique ferme.
En effettous les quinze jours on voyait renaître dans Parme un nouveau bruit annonçant la mort prochaine de Fabrice. Ces propos plongeaient la malheureuse duchesse dans le dernier désespoir. Fidèle à la résolution de ne pas entraîner le comte dans sa ruineelle ne le voyait que deux fois par mois; mais elle était punie de sa cruauté envers ce pauvre homme par les alternatives continuelles de sombre désespoir où elle passait sa vie. En vain le comte Moscasurmontant la jalousie cruelle que lui inspiraient les assiduités du comte Baldice si bel hommeécrivait à la duchesse quand il ne pouvait la voiret lui donnait connaissance de tous les renseignements qu'il devait au zèle du futur baron Rivala duchesse aurait eu besoinpour pouvoir résister aux bruits atroces qui couraient sans cesse sur Fabrice de passer sa vie avec un homme d'esprit et de coeur tel que Mosca; la nullité du Baldila laissant à ses penséeslui donnait une façon d'exister affreuseet le comte ne pouvait parvenir à lui communiquer ses raisons d'espérer.
Au moyen de divers prétextes assez ingénieuxce ministre était parvenu à faire consentir le prince à ce que l'on déposât dans un château amiau centre même de la Lombardiedans les environs de Saronoles archives de toutes les intrigues fort compliquées au moyen desquelles Ranuce-Ernest IV nourrissait l'espérance archifolle de se faire roi constitutionnel de ce beau pays.
Plus de vingt de ces pièces fort compromettantes étaient de la main du prince ou signées par luiet dans le cas où la vie de Fabrice serait sérieusement menacéele comte avait le projet d'annoncer à Son Altesse qu'il allait livrer ces pièces à une grande puissance qui d'un mot pouvait l'anéantir.
Le comte Mosca se croyait sûr du futur baron Rivail ne craignait que le poison; la tentative de Barbone l'avait profondément alarméet à un tel point qu'il s'était déterminé à hasarder une démarche folle en apparence. Un matin il passa à la porte de la citadelleet fit appeler le général Fabio Conti qui descendit jusque sur le bastion au-dessus de la porte; làse promenant amicalement avec luiil n'hésita pas à lui direaprès une petite préface aigre-douce et convenable:
-- Si Fabrice périt d'une façon suspectecette mort pourra m'être attribuéeje passerai pour un jalouxce serait pour moi un ridicule abominable et que je suis résolu de ne pas accepter. Doncet pour m'en lavers'il périt de maladieje vous tuerai de ma main ; comptez là-dessus. Le général Fabio Conti fit une réponse magnifique et parla de sa bravouremais le regard du comte resta présent à sa pensée.
Peu de jours aprèset comme s'il se fût concerté avec le comtele fiscal Rassi se permit une imprudence bien singulière chez un tel homme. Le mépris public attaché à son nom qui servait de proverbe à la canaillele rendait malade depuis qu'il avait l'espoir fondé de pouvoir y échapper. Il adressa au général Fabio Conti une copie officielle de la sentence qui condamnait Fabrice à douze années de citadelle. D'après la loic'est ce qui aurait dû être fait dès le lendemain même de l'entrée de Fabrice en prison; mais ce qui était inouï à Parmedans ce pays de mesures secrètesc'est que la justice se permît une telle démarche sans l'ordre exprès du souverain. En effetcomment nourrir l'espoir de redoubler tous les quinze jours l'effroi de la duchesseet de dompter ce caractère altierselon le mot du princeune fois qu'une copie officielle de la sentence était sortie de la chancellerie de justice? La veille du jour où le général Fabio Conti reçut le pli officiel du fiscal Rassiil apprit que le commis Barbone avait été roué de coups en rentrant un peu tard à la citadelle; il en conclut qu'il n'était plus question en certain lieu de se défaire de Fabrice; etpar un trait de prudence qui sauva Rassi des suites immédiates de sa folieil ne parla point au princeà la première audience qu'il en obtintde la copie officielle de la sentence du prisonnier à lui transmise. Le comte avait découvertheureusement pour la tranquillité de la pauvre duchesseque la tentative gauche de Barbone n'avait été qu'une velléité de vengeance particulièreet il avait fait donner à ce commis l'avis dont on a parlé.
Fabrice fut bien agréablement surpris quandaprès cent trente-cinq jours de prison dans une cage assez étroitele bon aumônier don Cesare vint le chercher un jeudi pour le faire promener sur le donjon de la tour Farnèse: Fabrice n'y eut pas été dix minutes quesurpris par le grand airil se trouva mal.
Don Cesare prit prétexte de cet accident pour lui accorder une promenade d'une demi-heure tous les jours. Ce fut une sottise; ces promenades fréquentes eurent bientôt rendu à notre héros des forces dont il abusa.
Il y eut plusieurs sérénades; le ponctuel gouverneur ne les souffrait que parce qu'elles engageaient avec le marquis Crescenzi sa fille Cléliadont le caractère lui faisait peur: il sentait vaguement qu'il n'y avait nul point de contact entre elle et luiet craignait toujours de sa part quelque coup de tête. Elle pouvait s'enfuir au couventet il restait désarmé. Du restele général craignait que toute cette musiquedont les sons pouvaient pénétrer jusque dans les cachots les plus profondsréservés aux plus noirs libérauxne contînt des signaux. Les musiciens aussi lui donnaient de la jalousie par eux-mêmes; aussià peine la sérénade terminéeon les enfermait à clef dans les grandes salles basses du palais du gouverneurqui de jour servaient de bureaux pour l'état-majoret on ne leur ouvrait la porte que le lendemain matin au grand jour. C'était le gouverneur lui- même quiplacé sur le pont de l'esclaveles faisait fouiller en sa présence et leur rendait la liberténon sans leur répéter plusieurs fois qu'il ferait pendre à l'instant celui d'entre eux qui aurait l'audace de se charger de la moindre commission pour quelque prisonnier. Et l'on savait que dans sa peur de déplaire il était homme à tenir parolede façon que le marquis Crescenzi était obligé de payer triple ses musiciens fort choqués de cette nuit à passer en prison.
Tout ce que la duchesse put obtenir et à grand-peine de la pusillanimité de l'un de ces hommesce fut qu'il se chargerait d'une lettre pour la remettre au gouverneur. La lettre était adressée à Fabrice; on y déplorait la fatalité qui faisait que depuis plus de cinq mois qu'il était en prisonses amis du dehors n'avaient pu établir avec lui la moindre correspondance.
En entrant à la citadellele musicien gagné se jeta aux genoux du général Fabio Contiet lui avoua qu'un prêtreà lui inconnuavait tellement insisté pour le charger d'une lettre adressée au sieur del Dongoqu'il n'avait osé refuser; maisfidèle à son devoiril se hâtait de la remettre entre les mains de Son Excellence.
L'Excellence fut très flattée: elle connaissait les ressources dont la duchesse disposaitet avait grand-peur d'être mystifié. Dans sa joiele général alla présenter cette lettre au princequi fut ravi.
-- Ainsila fermeté de mon administration est parvenue à me venger! Cette femme hautaine souffre depuis cinq mois! Mais l'un de ces jours nous allons faire préparer un échafaudet sa folle imagination ne manquera pas de croire qu'il est destiné au petit del Dongo.
Livre Second
Chapitre XX.
Une nuitvers une heure du matinFabricecouché sur sa fenêtreavait passé la tête par le guichet pratiqué dans l'abat-jouret contemplait les étoiles et l'immense horizon dont on jouit du haut de la tour Farnèse. Ses yeuxerrant dans la campagne du côté du bas Pô et de Ferrareremarquèrent par hasard une lumière excessivement petitemais assez vivequi semblait partir du haut d'une tour. Cette lumière ne doit pas être aperçue de la plainese dit Fabricel'épaisseur de la tour l'empêche d'être vue d'en bas; ce sera quelque signal pour un point éloigné. Tout à coup il remarqua que cette lueur paraissait et disparaissait à des intervalles fort rapprochés. C'est quelque jeune fille qui parle à son amant du village voisin. Il compta neuf apparitions successives: Ceci est un Idit-il; en effetl'I est la neuvième lettre de l'alphabet. Il y eut ensuiteaprès un reposquatorze apparitions: Ceci est un N; puisencore après un reposune seule apparition: C'est un A; le mot est Ina.
Quelle ne fut pas sa joie et son étonnementquand les apparitions successivestoujours séparées par de petits reposvinrent compléter les mots suivants:
INA PENSA A TE.
Evidemment: Gina pense à toi!
Il répondit à l'instant par des apparitions successives de sa lampe au vasistas par lui pratiqué:
FABRICE T'AIME!
La correspondance continua jusqu'au jour. Cette nuit était la cent soixante- treizième de sa captivitéet on lui apprit que depuis quatre mois on faisait ces signaux toutes les nuits. Mais tout le monde pouvait les voir et les comprendre; on commença dès cette première nuit à établir des abréviations: trois apparitions se suivant très rapidement indiquaient la duchesse; quatrele prince; deuxle comte Mosca; deux apparitions rapides suivies de deux lentes voulaient dire évasion. On convint de suivre à l'avenir l'ancien alphabet alla Monacaquiafin de n'être pas deviné par des indiscretschange le numéro ordinaire des lettreset leur en donne d'arbitraires; Apar exempleporte le numéro 10; le Ble numéro 3; c'est-à-dire que trois éclipses successives de la lampe veulent dire Bdix éclipses successivesl'Aetc.; un moment d'obscurité fait la séparation des mots. On prit rendez-vous pour le lendemain à une heure après minuitet le lendemain la duchesse vint à cette tour qui était à un quart de lieue de la ville. Ses yeux se remplirent de larmes en voyant les signaux faits par ce Fabrice qu'elle avait cru mort si souvent. Elle lui dit elle-même par des apparitions de lampe: Je t'aimebon couragesantébon espoir! Exerce tes forces dans ta chambretu auras besoin de la force de tes bras. Je ne l'ai pas vuse disait la duchessedepuis le concert de la Faustalorsqu'il parut à la porte de mon salon habillé en chasseur. Qui m'eût dit alors le sort qui nous attendait!
La duchesse fit faire des signaux qui annonçaient à Fabrice que bientôt il serait délivréGR¬CE A LA BONTE DU PRINCE (ces signaux pouvaient être compris); puis elle revint à lui dire des tendresses; elle ne pouvait s'arracher d'auprès de lui! Les seules représentations de Ludovicquiparce qu'il avait été utile à Fabriceétait devenu son factotumpurent l'engagerlorsque le jour allait déjà paraîtreà discontinuer des signaux qui pouvaient attirer les regards de quelque méchant. Cette annonce plusieurs fois répétée d'une délivrance prochaine jeta Fabrice dans une profonde tristesse: Cléliala remarquant le lendemaincommit l'imprudence de lui en demander la causé.
-- Je me vois sur le point de donner un grave sujet de mécontentement à la duchesse.
-- Et que peut-elle exiger de vous que vous lui refusiez? s'écria Clélia transportée de la curiosité la plus vive.
-- Elle veut que je sorte d'icilui répondit-ilet c'est à quoi je ne consentirai jamais.
Clélia ne put répondreelle le regarda et fondit en larmes. S'il eût pu lui adresser la parole de prèspeut-être alors eût-il obtenu l'aveu de sentiments dont l'incertitude le plongeait souvent dans un profond découragement; il sentait vivement que la viesans l'amour de Cléliane pouvait être pour lui qu'une suite de chagrins amers ou d'ennuis insupportables. Il lui semblait que ce n'était plus la peine de vivre pour retrouver ces mêmes bonheurs qui lui semblaient intéressants avant d'avoir connu l'amouret quoique le suicide ne soit pas encore à la mode en Italieil y avait songé comme à une ressourcesi le destin le séparait de Clélia.
Le lendemain il reçut d'elle une fort longue lettre.
«Il fautmon amique vous sachiez la vérité: bien souventdepuis que vous êtes icil'on a cru à Parme que votre dernier jour était arrivé. Il est vrai que vous n'êtes condamné qu'à douze années de forteresse; mais il estpar malheurimpossible de douter qu'une haine toute-puissante ne s'attache à vous poursuivreet vingt fois j'ai tremblé que le poison ne vînt mettre fin à vos jours: saisissez donc tous les moyens possibles de sortir d'ici. Vous voyez que pour vous je manque aux devoirs les plus saints; jugez de l'imminence du danger par les choses que je me hasarde à vous dire et qui sont si déplacées dans ma bouche. S'il le faut absoluments'il n'est aucun autre moyen de salutfuyez. Chaque instant que vous passez dans cette forteresse peut mettre votre vie dans le plus grand péril; songez qu'il est un parti à la cour que la perspective d'un crime n'arrêta jamais dans ses desseins. Et ne voyez-vous pas tous les projets de ce parti sans cesse déjoués par l'habileté supérieure du comte Mosca? Oron a trouvé un moyen certain de l'exiler de Parmec'est le désespoir de la duchesse; et n'est-on pas trop certain d'amener ce désespoir par la mort d'un jeune prisonnier? Ce mot seulqui est sans réponsedoit vous faire juger de votre situation. Vous dites que vous avez de l'amitié pour moi: songez d'abord que des obstacles insurmontables s'opposent à ce que ce sentiment prenne jamais une certaine fixité entre nous. Nous nous serons rencontrés dans notre jeunessenous nous serons tendu une main secourable dans une période malheureuse; le destin m'aura placée en ce lieu de sévérité pour adoucir vos peinesmais je me ferais des reproches éternels si des illusionsque rien n'autorise et n'autorisera jamaisvous portaient à ne pas saisir toutes les occasions possibles de soustraire votre vie à un si affreux péril. J'ai perdu la paix de l'âme par la cruelle imprudence que j'ai commise en échangeant avec vous quelques signes de bonne amitié. Si nos jeux d'enfantavec des alphabetsvous conduisent à des illusions si peu fondées et qui peuvent vous être si fatalesce serait en vain que pour me justifier je me rappellerais la tentative de Barbone. Je vous aurais jeté moi-même dans un péril bien plus affreuxbien plus certainen croyant vous soustraire à un danger du moment; et mes imprudences sont à jamais impardonnables si elles ont fait naître des sentiments qui puissent vous porter à résister aux conseils de la duchesse. Voyez ce que vous m'obligez à vous répéter; sauvez-vousje vous l'ordonne... »
Cette lettre était fort longue; certains passagestels que le je vous l'ordonneque nous venons de transcrire donnèrent des moments d'espoir délicieux à l'amour de Fabrice. Il lui semblait que le fond des sentiments était assez tendresi les expressions étaient remarquablement prudentes. Dans d'autres instantsil payait la peine de sa complète ignorance en ce genre de guerre; il ne voyait que de la simple amitiéou même de l'humanité fort ordinairedans cette lettre de Clélia.
Au restetout ce qu'elle lui apprenait ne lui fit pas changer un instant de dessein: en supposant que les périls qu'elle lui peignait fussent bien réelsétait-ce trop que d'acheterpar quelques dangers du moment le bonheur de la voir tous les jours? Quelle vie mènerait-il quand il serait de nouveau réfugié à Bologne ou à Florence? caren se sauvant de la citadelleil ne pouvait pas même espérer la permission de vivre à Parme. Et mêmequand le prince changerait au point de le mettre en liberté (ce qui était si peu probablepuisque luiFabriceétait devenupour une faction puissanteun moyen de renverser le comte Mosca)quelle vie mènerait-il à Parmeséparé de Clélia par toute la haine qui divisait les deux partis? Une ou deux fois par moispeut-êtrele hasard les placerait dans les mêmes salons; maismême alorsquelle sorte de conversation pourrait-il avoir avec elle? Comment retrouver cette intimité parfaite dont chaque jour maintenant il jouissait pendant plusieurs heures? que serait la conversation de saloncomparée à celle qu'ils faisaient avec des alphabets? Etquand je devrais acheter cette vie de délices et cette chance unique de bonheur par quelques petits dangersoù serait le mal? Et ne serait-ce pas encore un bonheur que de trouver ainsi une faible occasion de lui donner une preuve de mon amour?
Fabrice ne vit dans la lettre de Clélia que l'occasion de lui demander une entrevue: c'était l'unique et constant objet de tous ses désirs; il ne lui avait parlé qu'une foiset encore un instantau moment de son entrée en prisonet il y avait alors de cela plus de deux cents jours.
Il se présentait un moyen facile de rencontrer Clélia: l'excellent abbé don Cesare accordait à Fabrice une demi-heure de promenade sur la terrasse de la tour Farnèse tous les jeudispendant le jour; mais les autres jours de la semainecette promenadequi pouvait être remarquée par tous les habitants de Parme et des environs et compromettre gravement le gouverneurn'avait lieu qu'à la tombée de la nuit. Pour monter sur la terrasse de la tour Farnèse il n'y avait d'autre escalier que celui du petit clocher dépendant de la chapelle si lugubrement décorée en marbre noir et blancet dont le lecteur se souvient peut-être. Grillo conduisait Fabrice à cette chapelleil lui ouvrait le petit escalier du clocher: son devoir eût été de l'y suivremaiscomme les soirées commençaient à être fraîchesle geôlier le laissait monter seull'enfermait à clef dans ce clocher qui communiquait à la terrasseet retournait se chauffer dans sa chambre. Eh bien! un soirClélia ne pourrait-elle pas se trouverescortée par sa femme de chambredans la chapelle de marbre noir?
Toute la longue lettre par laquelle Fabrice répondait à celle de Clélia était calculée pour obtenir cette entrevue. Du resteil lui faisait confidence avec une sincérité parfaiteet comme s'il se fût agi d'une autre personnede toutes les raisons qui le décidaient à ne pas quitter la citadelle.
Je m'exposerais chaque jour à la perspective de mille morts pour avoir le bonheur de vous parler à l'aide de nos alphabetsqui maintenant ne nous arrêtent pas un instantet vous voulez que je fasse la duperie de m'exiler à Parmeou peut-être à Bologne ou même à Florence! Vous voulez que je marche pour m'éloigner de vous! Sachez qu'un tel effort m'est impossible; c'est en vain que je vous donnerais ma paroleje ne pourrais la tenir.
Le résultat de cette demande de rendez-vous fut une absence de Cléliaqui ne dura pas moins de cinq jours; pendant cinq jours elle ne vint à la volière que dans les instants où elle savait que Fabrice ne pouvait pas faire usage de la petite ouverture pratiquée à l'abat-jour. Fabrice fut au désespoir; il conclut de cette absence quemalgré certains regards qui lui avaient fait concevoir de folles espérancesjamais il n'avait inspiré à Clélia d'autres sentiments que ceux d'une simple amitié. En ce casse disait-ilque m'importe la vie? que le prince me la fasse perdreil sera le bienvenu; raison de plus pour ne pas quitter la forteresse. Et c'était avec un profond sentiment de dégoût quetoutes les nuitsil répondait aux signaux de la petite lampe. La duchesse le crut tout à fait fou quand elle lutsur le bulletin des signaux que Ludovic lui apportait tous les matinsces mots étranges: je ne veux pas me sauver; je veux mourir ici!
Pendant ces cinq journéessi cruelles pour FabriceClélia était plus malheureuse que lui; elle avait eu cette idéesi poignante pour une âme généreuse: mon devoir est de m'enfuir dans un couventloin de la citadelle; quand Fabrice saura que je ne suis plus iciet je le lui ferai dire par Grillo et par tous les geôliersalors il se déterminera à une tentative d'évasion. Mais aller au couventc'était renoncer à jamais revoir Fabrice; et renoncer à le voir quand il donnait une preuve si évidente que les sentiments qui avaient pu autrefois le lier à la duchesse n'existaient plus maintenant! Quelle preuve d'amour plus touchante un jeune homme pouvait-il donner? Après sept longs mois de prisonqui avaient gravement altéré sa santéil refusait de reprendre sa liberté. Un être légertel que les discours des courtisans avaient dépeint Fabrice aux yeux de Cléliaeût sacrifié vingt maîtresses pour sortir un jour plus tôt de la citadelle; et que n'eût-il pas fait pour sortir d'une prison où chaque jour le poison pouvait mettre fin à sa vie!
Clélia manqua de courageelle commit la faute insigne de ne pas chercher un refuge dans un couventce qui en même temps lui eût donné un moyen tout naturel de rompre avec le marquis Crescenzi. Une fois cette faute commisecomment résister à ce jeune homme si aimablesi naturelsi tendrequi exposait sa vie à des périls affreux pour obtenir le simple bonheur de l'apercevoir d'une fenêtre à l'autre? Après cinq jours de combats affreuxentremêlés de moments de mépris pour elle-mêmeClélia se détermina à répondre à la lettre par laquelle Fabrice sollicitait le bonheur de lui parler dans la chapelle de marbre noir. A la vérité elle refusaitet en termes assez durs; mais de ce moment toute tranquillité fut perdue pour elleà chaque instant son imagination lui peignait Fabrice succombant aux atteintes du poison; elle venait six ou huit fois par jour à la volièreelle éprouvait le besoin passionné de s'assurer par ses yeux que Fabrice vivait.
S'il est encore à la forteressese disait-elles'il est exposé à toutes les horreurs que la faction Raversi trame peut-être contre lui dans le but de chasser le comte Moscac'est uniquement parce que j'ai eu la lâcheté de ne pas m'enfuir au couvent! Quel prétexte pour rester ici une fois qu'il eût été certain que je m'en étais éloignée à jamais?
Cette fille si timide à la fois et si hautaine en vint à courir la chance d'un refus de la part du geôlier Grillo; bien pluselle s'exposa à tous les commentaires que cet homme pourrait se permettre sur la singularité de sa conduite. Elle descendit à ce degré d'humiliation de le faire appeleret de lui dire d'une voix tremblante et qui trahissait tout son secretque sous peu de jours Fabrice allait obtenir sa libertéque la duchesse Sanseverina se livrait dans cet espoir aux démarches les plus activesque souvent il était nécessaire d'avoir à l'instant même la réponse du prisonnier à de certaines propositions qui étaient faiteset qu'elle l'engageaitlui Grilloà permettre à Fabrice de pratiquer une ouverture dans l'abat-jour qui masquait sa fenêtreafin qu'elle pût lui communiquer par signes les avis qu'elle recevait plusieurs fois la journée de Mme Sanseverina.
Grillo sourit et lui donna l'assurance de son respect et de son obéissance. Clélia lui sut un gré infini de ce qu'il n'ajoutait aucune parole; il était évident qu'il savait fort bien tout ce qui se passait depuis plusieurs mois.
A peine ce geôlier fut-il hors de chez elle que Clélia fit le signal dont elle était convenue pour appeler Fabrice dans les grandes occasions; elle lui avoua tout ce qu'elle venait de faire. Vous voulez périr par le poisonajouta-t-elle: j'espère avoir le courage un de ces jours de quitter mon pèreet de m'enfuir dans quelque couvent lointain; voilà l'obligation que je vous aurai; alors j'espère que vous ne résisterez plus aux plans qui peuvent vous être proposés pour vous tirer d'ici; tant que vous y êtesj'ai des moments affreux et déraisonnables; de la vie je n'ai contribué au malheur de personneet il me semble que je suis cause que vous mourrez. Une pareille idée que j'aurais au sujet d'un parfait inconnu me mettrait au désespoirjugez de ce que j'éprouve quand je viens à me figurer qu'un amidont la déraison me donne de graves sujets de plaintesmais qu'enfin je vois tous les jours depuis si longtempsest en proie dans ce moment même aux douleurs de la mort. Quelquefois je sens le besoin de savoir de vous-même que vous vivez.
C'est pour me soustraire à cette affreuse douleur que je viens de m'abaisser jusqu'à demander une grâce à un subalterne qui pouvait me la refuseret qui peut encore me trahir. Au resteje serais peut-être heureuse qu'il vînt me dénoncer à mon pèreà l'instant je partirais pour le couventje ne serais plus la complice bien involontaire de vos cruelles folies. Maiscroyez-moiceci ne peut durer longtempsvous obéirez aux ordres de la duchesse. Etes-vous satisfaitami cruel? c'est moi qui vous sollicite de trahir mon père! Appelez Grilloet faites-lui un cadeau.
Fabrice était tellement amoureuxla plus simple expression de la volonté de Clélia le plongeait dans une telle crainteque même cette étrange communication ne fut point pour lui la certitude d'être aimé. Il appela Grillo auquel il paya généreusement les complaisances passéeset quant à l'aveniril lui dit que pour chaque jour qu'il lui permettrait de faire usage de l'ouverture pratiquée dans l'abat-jouril recevrait un sequin. Grillo fut enchanté de ces conditions.
-- Je vais vous parler le coeur sur la mainmonseigneur: voulez-vous vous soumettre à manger votre dîner froid tous les jours? il est un moyen bien simple d'éviter le poison. Mais je vous demande la plus profonde discrétionun geôlier doit tout voir et ne rien devineretc.etc. Au lieu d'un chien j'en aurai plusieurset vous-même vous leur ferez goûter de tous les plats dont vous aurez le projet de manger; quant au vinje vous donnerai du mienet vous ne toucherez qu'aux bouteilles dont j'aurai bu. Mais si Votre Excellence veut me perdre à jamaisil suffit qu'elle fasse confidence de ces détails même à Mlle Clélia; les femmes sont toujours femmes; si demain elle se brouille avec vousaprès-demainpour se vengerelle raconte toute cette invention à son pèredont la plus douce joie serait d'avoir de quoi faire pendre un geôlier. Après Barbonec'est peut-être l'être le plus méchant de la forteresseet c'est là ce qui fait le vrai danger de votre position; il sait manier le poisonsoyez-en sûret il ne me pardonnerait pas cette idée d'avoir trois ou quatre petits chiens.
Il y eut une nouvelle sérénade. Maintenant Grillo répondait à toutes les questions de Fabrice; il s'était bien promis toutefois d'être prudentet de ne point trahir Mlle Cléliaquiselon luitout en étant sur le point d'épouser le marquis Crescenzil'homme le plus riche des états de Parmen'en faisait pas moins l'amourautant que les murs de la prison le permettaientavec l'aimable monsignore del Dongo. Il répondait aux dernières questions de celui-ci sur la sérénadelorsqu'il eut l'étourderie d'ajouter: On pense qu'il l'épousera bientôt. On peut juger de l'effet de ce simple mot sur Fabrice. La nuit il ne répondit aux signaux de la lampe que pour annoncer qu'il était malade. Le lendemain matindès les dix heuresClélia ayant paru à la volièreil lui demandaavec un ton de politesse cérémonieuse bien nouveau entre euxpourquoi elle ne lui avait pas dit tout simplement qu'elle aimait le marquis Crescenziet qu'elle était sur le point de l'épouser.
-- C'est que rien de tout cela n'est vrairépondit Clélia avec impatience. Il est véritable aussi que le reste de sa réponse fut moins net: Fabrice le lui fit remarquer et profita de l'occasion pour renouveler la demande d'une entrevue. Cléliaqui voyait sa bonne foi mise en doute l'accorda presque aussitôttout en lui faisant observer qu'elle se déshonorait à jamais aux yeux de Grillo. Le soirquand la nuit fut faiteelle parutaccompagnée de sa femme de chambredans la chapelle de marbre noir; elle s'arrêta au milieuà côté de la lampe de veille; la femme de chambre et Grillo retournèrent à trente pas auprès de la porte. Cléliatoute tremblanteavait préparé un beau discours: son but était de ne point faire d'aveu compromettantmais la logique de la passion est pressante; le profond intérêt qu'elle met à savoir la vérité ne lui permet point de garder de vains ménagementsen même temps que l'extrême dévouement qu'elle sent pour ce qu'elle aime lui ôte la crainte d'offenser. Fabrice fut d'abord ébloui de la beauté de Cléliadepuis près de huit mois il n'avait vu d'aussi près que des geôliers. Mais le nom du marquis Crescenzi lui rendit toute sa fureurelle augmenta quand il vit clairement que Clélia ne répondait qu'avec des ménagements prudents; Clélia elle-même comprit qu'elle augmentait les soupçons au lieu de les dissiper. Cette sensation fut trop cruelle pour elle.
-- Serez-vous bien heureuxlui dit-elle avec une sorte de colère et les larmes aux yeuxde m'avoir fait passer par-dessus tout ce que je me dois à moi-même? Jusqu'au 3 août de l'année passéeje n'avais éprouvé que de l'éloignement pour les hommes qui avaient cherché à me plaire. J'avais un mépris sans bornes et probablement exagéré pour le caractère des courtisanstout ce qui était heureux à cette cour me déplaisait. Je trouvai au contraire des qualités singulières à un prisonnier qui le 3 août fut amené dans cette citadelle. J'éprouvaid'abord sans m'en rendre compte tous les tourments de la jalousie. Les grâces d'une femme charmanteet de moi bien connueétaient des coups de poignard pour mon coeurparce que je croyaiset je crois encore un peuque ce prisonnier lui était attaché. Bientôt les persécutions du marquis Crescenziqui avait demandé ma mainredoublèrent; il est fort riche et nous n'avons aucune fortune; je les repoussais avec une grande liberté d'espritlorsque mon père prononça le mot fatal de couvent; je compris que si je quittais la citadelle je ne pourrais plus veiller sur la vie du prisonnier dont le sort m'intéressait. Le chef-d'oeuvre de mes précautions avait été que jusqu'à ce moment il ne se doutât en aucune façon des affreux dangers qui menaçaient sa vie. Je m'étais bien promis de ne jamais trahir ni mon père ni mon secret; mais cette femme d'une activité admirabled'un esprit supérieurd'une volonté terriblequi protège ce prisonnierlui offrità ce que je supposedes moyens d'évasionil les repoussa et voulut me persuader qu'il se refusait à quitter la citadelle pour ne pas s'éloigner de moi. Alors je fis une grande fauteje combattis pendant cinq joursj'aurais dû à l'instant me réfugier au couvent et quitter la forteresse: cette démarche m'offrait un moyen bien simple de rompre avec le marquis Crescenzi. Je n'eus point le courage de quitter la forteresse et je suis une fille perdue; je me suis attachée à un homme léger: je sais quelle a été sa conduite à Naples; et quelle raison aurais-je de croire qu'il aura changé de caractère? Enfermé dans une prison sévèreil a fait la cour à la seule femme qu'il pût voirelle a été une distraction pour son ennui. Comme il ne pouvait lui parler qu'avec de certaines difficultéscet amusement a pris la fausse apparence d'une passion. Ce prisonnier s'étant fait un nom dans le monde par son courageil s'imagine prouver que son amour est mieux qu'un simple goût passageren s'exposant à d'assez grands périls pour continuer à voir la personne qu'il croit aimer. Mais dès qu'il sera dans une grande villeentouré de nouveau des séductions de la sociétéil sera de nouveau ce qu'il a toujours étéun homme du monde adonné aux dissipationsà la galanterieet sa pauvre compagne de prison finira ses jours dans un couventoubliée de cet être légeret avec le mortel regret de lui avoir fait un aveu.
Ce discours historiquedont nous ne donnons que les principaux traitsfut comme on le pense bienvingt fois interrompu par Fabrice. Il était éperdument amoureuxaussi il était parfaitement convaincu qu'il n'avait jamais aimé avant d'avoir vu Cléliaet que la destinée de sa vie était de ne vivre que pour elle.
Le lecteur se figure sans doute les belles choses qu'il disaitlorsque la femme de chambre avertit sa maîtresse que onze heures et demie venaient de sonneret que le général pouvait rentrer à tout moment; la séparation fut cruelle.
-- Je vous vois peut-être pour la dernière foisdit Clélia au prisonnier: une mesure qui est dans l'intérêt évident de la cabale Raversi peut vous fournir une cruelle façon de prouver que vous n'êtes pas inconstant. Clélia quitta Fabrice étouffée par ses sanglotset mourant de honte de ne pouvoir les dérober entièrement à sa femme de chambre ni surtout au geôlier Grillo. Une seconde conversation n'était possible que lorsque le général annoncerait devoir passer la soirée dans le monde; et comme depuis la prison de Fabriceet l'intérêt qu'elle inspirait à la curiosité du courtisanil avait trouvé prudent de se donner un accès de goutte presque continuelses courses à la villesoumises aux exigences d'une politique savantene se décidaient qu'au moment de monter en voiture.
Depuis cette soirée dans la chapelle de marbrela vie de Fabrice fut une suite de transports de joie. De grands obstaclesil est vraisemblaient encore s'opposer à son bonheur; mais enfin il avait cette joie suprême et peu espérée d'être aimé par l'être divin qui occupait toutes ses pensées.
La troisième journée après cette entrevueles signaux de la lampe finirent de fort bonne heureà peu près sur le minuit; à l'instant où ils se terminaientFabrice eut presque la tête cassée par une grosse balle de plomb quilancée dans la partie supérieure de l'abat-jour de sa fenêtrevint briser ses vitres de papier et tomba dans sa chambre.
Cette fort grosse balle n'était point aussi pesante à beaucoup près que l'annonçait son volume; Fabrice réussit facilement à l'ouvrir et trouva une lettre de la duchesse. Par l'entremise de l'archevêque qu'elle flattait avec soinelle avait gagné un soldat de la garnison de la citadelle. Cet hommefrondeur adroittrompait les soldats placés en sentinelle aux angles et à la porte du palais du gouverneur ou s'arrangeait avec eux.
«Il faut te sauver avec des cordes: je frémis en te donnant cet avis étrangej'hésite depuis plus de deux mois entiers à te dire cette parole; mais l'avenir officiel se rembrunit chaque jouret l'on peut s'attendre à ce qu'il y a de pis. A proposrecommence à l'instant les signaux avec ta lampepour nous prouver que tu as reçu cette lettre dangereuse; marque PB et G à la monacac'est-à-dire quatredouze et deux; je ne respirerai pas jusqu'à ce que j'aie vu ce signal; je suis à la touron répondra par N et Osept et cinq. La réponse reçuene fais plus aucun signalet occupe-toi uniquement à comprendre ma lettre. »
Fabrice se hâta d'obéiret fit les signaux convenus qui furent suivis des réponses annoncéespuis il continua la lecture de la lettre.
«On peut s'attendre à ce qu'il y a de pis; c'est ce que m'ont déclaré les trois hommes dans lesquels j'ai le plus de confianceaprès que je leur ai fait jurer sur l'Evangile de me dire la véritéquelque cruelle qu'elle pût être pour moi. Le premier de ces hommes menaça le chirurgien dénonciateur à Ferrare de tomber sur lui avec un couteau ouvert à la main; le second te dit à ton retour de Belgiratequ'il aurait été plus strictement prudent de donner un coup de pistolet au valet de chambre qui arrivait en chantant dans le bois et conduisant en laisse un beau cheval un peu maigre; tu ne connais pas le troisièmec'est un voleur de grand chemin de mes amishomme d'exécution s'il en futet qui autant de courage que toi; c'est pourquoi surtout je lui ai demandé de me déclarer ce que tu devais faire. Tous les trois m'ont ditsans savoir chacun que j'eusse consulté les deux autresqu'il vaut mieux s'exposer à se casser le cou que de passer encore onze années et quatre mois dans la crainte continuelle d'un poison fort probable.
«Il faut pendant un mois t'exercer dans ta chambre à monter et descendre au moyen d'une corde nouée. Ensuiteun jour de fête où la garnison de la citadelle aura reçu une gratification de vintu tenteras la grande entreprise. Tu auras trois cordes en soie et chanvrede la grosseur d'une plume de cygnela première de quatre-vingts pieds pour descendre les trente-cinq pieds qu'il y a de ta fenêtre au bois d'orangersla seconde de trois cents piedset c'est là la difficulté à cause du poidspour descendre les cent quatre-vingts pieds qu'a de hauteur le mur de la grosse tour; une troisième de trente pieds te servira à descendre le rempart. Je passe ma vie à étudier le grand mur à l'orientc'est-à-dire du côté de Ferrare: une fente causée par un tremblement de terre a été remplie au moyen d'un contrefort qui forme plan incliné. Mon voleur de grand chemin m'assure qu'il se ferait fort de descendre de ce côté-là sans trop de difficulté et sous peine seulement de quelques écorchuresen se laissant glisser sur le plan incliné formé par ce contrefort. L'espace vertical n'est que de vingt-huit pieds tout à fait au bas; ce côté est le moins bien gardé. »
«Cependantà tout prendremon voleurqui trois fois s'est sauvé de prisonet que tu aimerais si tu le connaissaisquoiqu'il exècre les gens de ta caste; mon voleur de grand chemindis-jeagile et leste comme toipense qu'il aimerait mieux descendre par le côté du couchantexactement vis-à-vis le petit palais occupé jadis par la Faustade vous bien connu. Ce qui le déciderait pour ce côtéc'est que la muraillequoique très peu inclinéeest presque constamment garnie de broussailles; il y a des brins de boisgros comme le petit doigtqui peuvent fort bien écorcher si l'on n'y prend gardemais quiaussisont excellents pour se retenir. Encore ce matinje regardais ce côté du couchant avec une excellente lunette; la place à choisirc'est précisément au-dessous d'une pierre neuve que l'on a placée à la balustrade d'en hautil y a deux ou trois ans. Verticalement au- dessous de cette pierretu trouveras d'abord un espace nu d'une vingtaine de pieds; il faut aller là très lentement (tu sens si mon coeur frémit en te donnant ces instructions terriblesmais le courage consiste à savoir choisir le moindre malsi affreux qu'il soit encore); après l'espace nutu trouveras quatre-vingts ou quatre- vingt-dix pieds de broussailles fort grandesoù l'on voit voler des oiseauxpuis un espace de trente pieds qui n'a que des herbesdes violiers et des pariétaires. Ensuiteen approchant de terrevingt pieds de broussailleset enfin vingt-cinq ou trente pieds récemment éparvérés. »
«Ce qui me déciderait pour ce côtéc'est que là se trouve verticalementau- dessous de la pierre neuve de la balustrade d'en hautune cabane en bois bâtie par un soldat dans son jardinet que le capitaine du génie employé à la forteresse veut le forcer à démolir; elle a dix-sept pieds de hautelle est couverte en chaumeet le toit touche au grand mur de la citadelle. C'est ce toit qui me tente; dans le cas affreux d'un accidentil amortirait la chute. Une fois arrivé làtu es dans l'enceinte des remparts assez négligemment gardés; si l'on t'arrêtait làtire des coups de pistolet et défends-toi quelques minutes. Ton ami de Ferrare et un autre homme de coeurcelui que j'appelle le voleur de grand cheminauront des échelleset n'hésiteront pas à escalader ce rempart assez baset à voler à ton secours. »
«Le rempart n'a que vingt-trois pieds de hautet un fort grand talus. Je serai au pied de ce dernier mur avec bon nombre de gens armés. »
«J'ai l'espoir de te faire parvenir cinq ou six lettres par la même voie que celle-ci. Je répéterai sans cesse les mêmes choses en d'autres termesafin que nous soyons bien d'accord. Tu devines de quel coeur je te dis que l'homme du coup de pistolet au valet de chambrequiaprès toutest le meilleur des êtres et se meurt de repentirpense que tu en seras quitte pour un bras cassé. Le voleur de grand cheminqui a plus d'expérience de ces sortes d'expéditionspense quesi tu veux descendre fort lentementet surtout sans te presserta liberté ne te coûtera que des écorchures. La grande difficultéc'est d'avoir des cordes; c'est à quoi aussi je pense uniquement depuis quinze jours que cette grande idée occupe tous mes instants. »
«Je ne réponds pas à cette foliela seule chose sans esprit que tu aies dite de ta vie: «Je ne veux pas me sauver! » L'homme du coup de pistolet au valet de chambre s'écria que l'ennui t'avait rendu fou. Je ne te cacherai point que nous redoutons un fort imminent danger qui peut-être fera hâter le jour de ta fuite. Pour t'annoncer ce dangerla lampe dira plusieurs fois de suite: Le feu a pris au château! »
«Tu répondras: »
«Mes livres sont-ils brûlés? »
Cette lettre contenait encore cinq ou six pages de détails; elle était écrite en caractères microscopiques sur du papier très fin.
-- Tout cela est fort beau et fort bien inventése dit Fabrice; je dois une reconnaissance éternelle au comte et à la duchesse; ils croiront peut-être que j'ai eu peurmais je ne me sauverai point. Est-ce que jamais l'on se sauva d'un lieu où l'on est au comble du bonheurpour aller se jeter dans un exil affreux où tout manquera jusqu'à l'air pour respirer? Que ferais-je au bout d'un mois que je serais à Florence? je prendrais un déguisement pour venir rôder auprès de la porte de cette forteresseet tâcher d'épier un regard!
Le lendemainFabrice eut peur; il était à sa fenêtre vers les onze heuresregardant le magnifique paysage et attendant l'instant heureux où il pourrait voir Clélialorsque Grillo entra hors d'haleine dans sa chambre:
-- Et vite! vite! monseigneurjetez-vous sur votre litfaites semblant d'être malade; voici trois juges qui montent! Ils vont vous interroger: réfléchissez bien avant de parler; ils viennent pour vous entortiller.
En disant ces paroles Grillo se hâtait de fermer la petite trappe de l'abat-jourpoussait Fabrice sur son litet jetait sur lui deux ou trois manteaux.
-- Dites que vous souffrez beaucoup et parlez peusurtout faites répéter les questions pour réfléchir.
Les trois juges entrèrent. Trois échappés des galèresse dit Fabrice en voyant ces physionomies basseset non pas trois juges; ils avaient de longues robes noires. Ils saluèrent gravementet occupèrentsans mot direles trois chaises qui étaient dans la chambre.
-- Monsieur Fabrice del Dongodit le plus âgénous sommes peinés de la triste mission que nous venons remplir auprès de vous. Nous sommes ici pour vous annoncer le décès de Son Excellence M. le marquis del Dongovotre pèresecond grand majordome major du royaume lombardo-vénitienchevalier grand- croix des ordres deetc.etc.etc. Fabrice fondit en larmes; le juge continua.
-- Madame la marquise del Dongovotre mèrevous fait part de cette nouvelle par une lettre missive; mais comme elle a joint au fait des réflexions inconvenantespar un arrêt d'hierla cour de justice a décidé que sa lettre vous serait communiquée seulement par extraitet c'est cet extrait que M. le greffier Bona va vous lire.
Cette lecture terminéele juge s'approcha de Fabrice toujours couchéet lui fit suivre sur la lettre de sa mère les passages dont on venait de lire les copies. Fabrice vit dans la lettre les mots emprisonnement injustepunition cruelle pour un crime qui n'en est pas unet comprit ce qui avait motivé la visite des juges. Du reste dans son mépris pour des magistrats sans probitéil ne leur dit exactement que ces paroles:
-- Je suis malademessieursje me meurs de langueuret vous m'excuserez si je ne puis me lever.
Les juges sortisFabrice pleura encore beaucouppuis il se dit: Suis-je hypocrite? il me semblait que je ne l'aimais point.
Ce jour-là et les suivantsClélia fut fort triste; elle l'appela plusieurs foismais eut à peine le courage de lui dire quelques paroles. Le matin du cinquième jour qui suivit la première entrevueelle lui dit que dans la soirée elle viendrait à la chapelle de marbre.
-- Je ne puis vous adresser que peu de motslui dit-elle en entrant. Elle était tellement tremblante qu'elle avait besoin de s'appuyer sur sa femme de chambre. Après l'avoir renvoyée à l'entrée de la chapelle: -- Vous allez me donner votre parole d'honneurajouta-t-elle d'une voix à peine intelligiblevous allez me donner votre parole d'honneur d'obéir à la duchesseet de tenter de fuir le jour qu'elle vous l'ordonnera et de la façon qu'elle vous l'indiqueraou demain matin je me réfugie dans un couventet je vous jure ici que de la vie je ne vous adresserai la parole.
Fabrice resta muet.
-- Promettezdit Clélia les larmes aux yeux et comme hors d'elle-mêmeou bien nous nous parlons ici pour la dernière fois. La vie que vous m'avez faite est affreuse: vous êtes ici à cause de moi et chaque jour peut être le dernier de votre existence. En ce moment Clélia était si faible qu'elle fut obligée de chercher un appui sur un énorme fauteuil placé jadis au milieu de la chapellepour l'usage du prince prisonnier; elle était sur le point de se trouver mal.
-- Que faut-il promettre? dit Fabrice d'un air accablé.
-- Vous le savez.
-- Je jure donc de me précipiter sciemment dans un malheur affreuxet de me condamner à vivre loin de tout ce que j'aime au monde.
-- Promettez des choses précises.
-- Je jure d'obéir à la duchesseet de prendre la fuite le jour qu'elle le voudra et comme elle le voudra. Et que deviendrai-je une fois loin de vous?
-- Jurez de vous sauverquoi qu'il puisse arriver.
-- Comment! êtes-vous décidée à épouser le marquis Crescenzi dès que je n'y serai plus?
-- O Dieu! quelle âme me croyez-vous?... Mais jurezou je n'aurai plus un seul instant la paix de l'âme.
-- Eh bien! je jure de me sauver d'ici le jour que Mme Sanseverina l'ordonneraet quoi qu'il puisse arriver d'ici là.
Ce serment obtenuClélia était si faible qu'elle fut obligée de se retirer après avoir remercié Fabrice.
-- Tout était prêt pour ma fuite demain matinlui dit-ellesi vous vous étiez obstiné à rester. Je vous aurais vu en cet instant pour la dernière fois de ma viej'en avais fait le voeu à la Madone. Maintenantdès que je pourrai sortir de ma chambrej'irai examiner le mur terrible au-dessous de la pierre neuve de la balustrade.
Le lendemainil la trouva pâle au point de lui faire une vive peine. Elle lui dit de la fenêtre de la volière:
-- Ne nous faisons point illusioncher ami; comme il y a du péché dans notre amitiéje ne doute pas qu'il ne nous arrive malheur. Vous serez découvert en cherchant à prendre la fuiteet perdu à jamaissi ce n'est pis; toutefois il faut satisfaire à la prudence humaineelle nous ordonne de tout tenter. Il vous faut pour descendre en dehors de la grosse tour une corde solide de plus de deux cents pieds de longueur. Quelques soins que je me donne depuis que je sais le projet de la duchesseje n'ai pu me procurer que des cordes formant à peine ensemble une cinquantaine de pieds. Par un ordre du jour du gouverneurtoutes les cordes que l'on voit dans la forteresse sont brûléeset tous les soirs on enlève les cordes des puitssi faibles d'ailleurs que souvent elles cassent en remontant leur léger fardeau. Mais priez Dieu qu'il me pardonneje trahis mon pèreet je travaillefille dénaturéeà lui donner un chagrin mortel. Priez Dieu pour moiet si votre vie est sauvéefaites le voeu d'en consacrer tous les instants à sa gloire.
Voici une idée qui m'est venue: dans huit jours je sortirai de la citadelle pour assister aux noces d'une des soeurs du marquis Crescenzi. Je rentrerai le soir comme il est convenablemais je ferai tout au monde pour ne rentrer que fort tardet peut-être Barbone n'osera-t-il pas m'examiner de trop près. A cette noce de la soeur du marquis se trouveront les plus grandes dames de la couret sans doute Mme Sanseverina. Au nom de Dieu! faites qu'une de ces dames me remette un paquet de cordes bien serréespas trop grosseset réduites au plus petit volume. Dussé-je m'exposer à mille mortsj'emploierai les moyens même les plus dangereux pour introduire ce paquet de cordes dans la citadelleau méprishélas! de tout mes devoirs. Si mon père en a connaissance je ne vous reverrai jamais; mais quelle que soit la destinée qui m'attendje serai heureuse dans les bornes d'une amitié de soeur si je puis contribuer à vous sauver.
Le soir mêmepar la correspondance de nuit au moyen de la lampeFabrice donna avis à la duchesse de l'occasion unique qu'il y aurait de faire entrer dans la citadelle une quantité de cordes suffisante. Mais il la suppliait de garder le secret même envers le comtece qui parut bizarre. Il est foupensa la duchessela prison l'a changéil prend les choses au tragique. Le lendemainune balle de plomblancée par le frondeurapporta au prisonnier l'annonce du plus grand péril possible: la personne qui se chargeait de faire entrer les cordeslui disait-onlui sauvait positivement et exactement la vie. Fabrice se hâta de donner cette nouvelle à Clélia. Cette balle de plomb apportait aussi à Fabrice une vue fort exacte du mur du couchant par lequel il devait descendre du haut de la grosse tour dans l'espace compris entre les bastions; de ce lieuil était assez facile ensuite de se sauverles remparts n'ayant que vingt-trois pieds de haut et étant assez négligemment gardés. Sur le revers du plan était écrit d'une petite écriture fine un sonnet magnifique: une âme généreuse exhortait Fabrice à prendre la fuiteet à ne pas laisser avilir son âme et dépérir son corps par les onze années de captivité qu'il avait encore à subir.
Ici un détail nécessaire et qui explique en partie le courage qu'eut la duchesse de conseiller à Fabrice une fuite si dangereusenous oblige d'interrompre pour un instant l'histoire de cette entreprise hardie.
Comme tous les partis qui ne sont point au pouvoirle parti Raversi n'était pas fort uni. Le chevalier Riscara détestait le fiscal Rassi qu'il accusait de lui avoir fait perdre un procès important dans lequelà la véritélui Riscara avait tort. Par Riscarale prince reçut un avis anonyme qui l'avertissait qu'une expédition de la sentence de Fabrice avait été adressée officiellement au gouverneur de la citadelle. La marquise Raversicet habile chef de partifut excessivement contrariée de cette fausse démarcheet en fit aussitôt donner avis à son amile fiscal général; elle trouvait fort simple qu'il voulût tirer quelque chose du ministre Moscatant que Mosca était au pouvoir. Rassi se présenta intrépidement au palaispensant bien qu'il en serait quitte pour quelques coups de pied; le prince ne pouvait se passer d'un jurisconsulte habileet Rassi avait fait exiler comme libéraux un juge et un avocatles seuls hommes du pays qui eussent pu prendre sa place.
Le prince hors de lui le chargea d'injures et avançait sur lui pour le battre.
-- Eh bienc'est une distraction de commisrépondit Rassi du plus grand sang- froid; la chose est prescrite par la loielle aurait dû être faite le lendemain de l'écrou du sieur del Dongo à la citadelle. Le commis plein de zèle a cru avoir fait un oubliet m'aura fait signer la lettre d'envoi comme une chose de forme.
-- Et tu prétends me faire croire des mensonges aussi mal bâtis? s'écria le prince furieux; dis plutôt que tu t'es vendu à ce fripon de Moscaet c'est pour cela qu'il t'a donné la croix. Mais parbleutu n'en seras pas quitte pour des coups: je te ferai mettre en jugementje te révoquerai honteusement.
-- Je vous défie de me faire mettre en jugement! répondit Rassi avec assuranceil savait que c'était un sûr moyen de calmer le prince: la loi est pour moiet vous n'avez pas un second Rassi pour savoir l'éluder. Vous ne me révoquerez pasparce qu'il est des moments où votre caractère est sévèrevous avez soif de sang alorsmais en même temps vous tenez à conserver l'estime des Italiens raisonnables; cette estime est un sine qua non pour votre ambition. Enfinvous me rappellerez au premier acte de sévérité dont votre caractère vous fera un besoinetcomme à l'ordinaireje vous procurerai une sentence bien régulière rendue par des juges timides et assez honnêtes genset qui satisfera vos passions. Trouvez un autre homme dans vos états aussi utile que moi!
Cela ditRassi s'enfuit; il en avait été quitte pour un coup de règle bien appliqué et cinq ou six coups de pied. En sortant du palaisil partit pour sa terre de Riva; il avait quelque crainte d'un coup de poignard dans le premier mouvement de colèremais il ne doutait pas non plus qu'avant quinze jours un courrier ne le rappelât dans la capitale. Il employa le temps qu'il passa à la campagne à organiser un moyen de correspondance sûr avec le comte Mosca; il était amoureux fou du titre de baronet pensait que le prince faisait trop de cas de cette chose jadis sublimela noblessepour la lui conférer jamais; tandis que le comtetrès fier de sa naissancen'estimait que la noblesse prouvée par des titres avant l'an 1400.
Le fiscal général ne s'était point trompé dans ses prévisions: il y avait à peine huit jours qu'il était à sa terrelorsqu'un ami du princequi y vint par hasardlui conseilla de retourner à Parme sans délai; le prince le reçut en riantprit ensuite un air fort sérieuxet lui fit jurer sur l'Evangile qu'il garderait le secret sur ce qu'il allait lui confier; Rassi jura d'un grand sérieuxet le princel'oeil enflammé de haines'écria qu'il ne serait pas le maître chez lui tant que Fabrice del Dongo serait en vie.
-- Je ne puisajouta-t-ilni chasser la duchesse ni souffrir sa présence; ses regards me bravent et m'empêchent de vivre.
Après avoir laissé le prince s'expliquer bien au longluiRassijouant l'extrême embarrass'écria enfin:
-- Votre Altesse sera obéiesans doutemais la chose est d'une horrible difficulté: il n'y a pas d'apparence de condamner un del Dongo à mort pour le meurtre d'un Giletti; c'est déjà un tour de force étonnant que d'avoir tiré de cela douze années de citadelle. De plusje soupçonne la duchesse d'avoir découvert trois des paysans qui travaillaient à la fouille de Sanguigna et qui se trouvaient hors du fossé au moment où ce brigand de Giletti attaqua del Dongo.
-- Et où sont ces témoins? dit le prince irrité.
-- Cachés en Piémontje suppose. Il faudrait une conspiration contre la vie de Votre Altesse...
-- Ce moyen a ses dangersdit le princecela fait songer à la chose.
-- Mais pourtantdit Rassi avec une feinte innocencevoilà tout mon arsenal officiel.
-- Reste le poison...
-- Mais qui le donnera? Sera-ce cet imbécile de Conti?
-- Maisà ce qu'on ditce ne serait pas son coup d'essai...
-- Il faudrait le mettre en colèrereprit Rassi; et d'ailleurslorsqu'il expédia le capitaineil n'avait pas trente anset il était amoureux et infiniment moins pusillanime que de nos jours. Sans doutetout doit céder à la raison d'Etat; maisainsi pris au dépourvu et à la première vueje ne voispour exécuter les ordres du souverainqu'un nommé Barbonecommis-greffier de la prisonet que le sieur del Dongo renversa d'un soufflet le jour qu'il y entra.
Une fois le prince mis à son aisela conversation fut infinie; il la termina en accordant à son fiscal général un délai d'un mois; le Rassi en voulait deux. Le lendemainil reçut une gratification secrète de mille sequins. Pendant trois jours il réfléchit; le quatrième il revint à son raisonnementqui lui semblait évident: le seul comte Mosca aura le coeur de me tenir parole parce queen me faisant baronil ne me donne pas ce qu'il estime; secondoen l'avertissantje me sauve probablement un crime pour lequel je suis à peu près payé d'avance; tertioje venge les premiers coups humiliants qu'ait reçus le chevalier Rassi. La nuit suivanteil communiqua au comte Mosca toute sa conversation avec le prince.
Le comte faisait en secret la cour à la duchesse; il est bien vrai qu'il ne la voyait toujours chez elle qu'une ou deux fois par moismais presque toutes les semaines et quand il savait faire naître les occasions de parler de Fabricela duchesseaccompagnée de Chékinavenait dans la soirée avancéepasser quelques instants dans le jardin du comte. Elle savait tromper même son cocherqui lui était dévoué et qui la croyait en visite dans une maison voisine.
On peut penser si le comteayant reçu la terrible confidence du fiscalfit aussitôt à la duchesse le signal convenu. Quoique l'on fût au milieu de la nuitelle le fit prier par la Chékina de passer à l'instant chez elle. Le comteravi comme un amoureux de cette apparence d'intimitéhésitait cependant à tout dire à la duchesse; il craignait de la voir devenir folle de douleur.
Après avoir cherché des demi-mots pour mitiger l'annonce fataleil finit cependant par lui tout dire; il n'était pas en son pouvoir de garder un secret qu'elle lui demandait. Depuis neuf mois le malheur extrême avait eu une grande influence sur cette âme ardenteelle l'avait fortifiéeet la duchesse ne s'emporta point en sanglots ou en plaintes.
Le lendemain soir elle fit faire à Fabrice le signal du grand péril.
Le feu a pris au château.
Il répondit fort bien.
Mes livres sont-ils brulés?
La même nuit elle eut le bonheur de lui faire parvenir une lettre dans une balle de plomb. Ce fut huit jours après qu'eut lieu le mariage de la soeur du marquis Crescenzioù la duchesse commit une énorme imprudence dont nous rendrons compte en son lieu.
Livre Second
Chapitre XXI.
A l'époque de ses malheurs il y avait déjà près d'une année que la duchesse avait fait une rencontre singulière: un jour qu'elle avait la lunacomme on dit dans le payselle était allée à l'improvistesur le soirà son château de Saccasitué au- delà de Colornosur la colline qui domine le Pô. Elle se plaisait à embellir cette terre; elle aimait la vaste forêt qui couronne la colline et touche au château; elle s'occupait à y faire tracer des sentiers dans des directions pittoresques.
-- Vous vous ferez enlever par les brigandsbelle duchesselui disait un jour le prince; il est impossible qu'une forêt où l'on sait que vous vous promenezreste déserte. Le prince jetait un regard sur le comte dont il prétendait émoustiller la jalousie.
-- Je n'ai pas de craintesAltesse Sérénissimerépondit la duchesse d'un air ingénuquand je me promène dans mes bois; je me rassure par cette pensée: je n'ai fait de mal à personnequi pourrait me haïr? Ce propos fut trouvé hardiil rappelait les injures proférées par les libéraux du paysgens fort insolents.
Le jour de la promenade dont nous parlonsle propos du prince revint à l'esprit de la duchesseen remarquant un homme fort mal vêtu qui la suivait de loin à travers le bois. A un détour imprévu que fit la duchesse en continuant sa promenadecet inconnu se trouva tellement près d'elle qu'elle eut peur. Dans le premier mouvement elle appela son garde-chasse qu'elle avait laissé à mille pas de làdans le parterre de fleurs tout près du château. L'inconnu eut le temps de s'approcher d'elle et se jeta à ses pieds. Il était jeunefort bel hommemais horriblement mal mis; ses habits avaient des déchirures d'un pied de longmais ses yeux respiraient le feu d'une âme ardente.
-- Je suis condamné à mortje suis le médecin Ferrante Pallaje meurs de faim ainsi que mes cinq enfants.
La duchesse avait remarqué qu'il était horriblement maigre; mais ses yeux étaient tellement beaux et remplis d'une exaltation si tendrequ'ils lui ôtèrent l'idée du crime. Pallagipensa-t-elleaurait bien dû donner de tels yeux au saint Jean dans le désert qu'il vient de placer à la cathédrale. L'idée de saint Jean lui était suggérée par l'incroyable maigreur de Ferrante. La duchesse lui donna trois sequins qu'elle avait dans sa bourses'excusant de lui offrir si peu sur ce qu'elle venait de payer un compte à son jardinier. Ferrante la remercia avec effusion. -- Hélaslui dit-ilautrefois j'habitais les villesje voyais des femmes élégantes; depuis qu'en remplissant mes devoirs de citoyen je me suis fait condamner à mortje vis dans les boiset je vous suivaisnon pour vous demander l'aumône ou vous volermais comme un sauvage fasciné par une angélique beauté. Il y a si longtemps que je n'ai vu deux belles mains blanches!
-- Levez-vous donclui dit la duchesse; car il était resté à genoux.
-- Permettez que je reste ainsilui dit Ferrante; cette position me prouve que je ne suis pas occupé actuellement à voleret elle me tranquillise; car vous saurez que je vole pour vivre depuis que l'on m'empêche d'exercer ma profession. Mais dans ce moment-ci je ne suis qu'un simple mortel qui adore la sublime beauté. La duchesse comprit qu'il était un peu foumais elle n'eut point peur; elle voyait dans les yeux de cet homme qu'il avait une âme ardente et bonneet d'ailleurs elle ne haïssait pas les physionomies extraordinaires.
-- Je suis donc médecinet je faisais la cour à la femme de l'apothicaire Sarasine de Parme: il nous a surpris et l'a chasséeainsi que trois enfants qu'il soupçonnait avec raison être de moi et non de lui. J'en ai eu deux depuis. La mère et les cinq enfants vivent dans la dernière misèreau fond d'une sorte de cabane construite de mes mains à une lieue d'icidans le bois. Car je dois me préserver des gendarmeset la pauvre femme ne veut pas se séparer de moi. Je fus condamné à mortet fort justement: je conspirais. J'exècre le princequi est un tyran. Je ne pris pas la fuite faute d'argent. Mes malheurs sont bien plus grandset j'aurais dû mille fois me tuer; je n'aime plus la malheureuse femme qui m'a donné ces cinq enfants et s'est perdue pour moi; j'en aime une autre. Mais si je me tueles cinq enfants et la mère mourront littéralement de faim. Cet homme avait l'accent de la sincérité.
-- Mais comment vivez-vous? lui dit la duchesse attendrie.
-- La mère des enfants file; la fille aînée est nourrie dans une ferme de libérauxoù elle garde les moutons; moije vole sur la route de Plaisance à Gênes.
-- Comment accordez-vous le vol avec vos principes libéraux?
-- Je tiens note des gens que je voleet si jamais j'ai quelque choseje leur rendrai les sommes volées. J'estime qu'un tribun du peuple tel que moi exécute un travail quià raison de son dangervaut bien cent francs par mois; ainsi je me garde bien de prendre plus de douze cents francs par an.
Je me trompeje vole quelque petite somme au-delàcar je fais face par ce moyen aux frais d'impression de mes ouvrages.
-- Quels ouvrages?
-- La... aura-t-elle jamais une chambre et un budget?
-- Quoi! dit la duchesse étonnéec'est vousmonsieurqui êtes l'un des plus grands poètes du sièclele fameux Ferrante Palla!
-- Fameux peut-êtremais fort malheureuxc'est sûr.
-- Et un homme de votre talentmonsieurest obligé de voler pour vivre!
-- C'est peut-être pour cela que j'ai quelque talent. Jusqu'ici tous nos auteurs qui se sont fait connaître étaient des gens payés par le gouvernement ou par le culte qu'ils voulaient saper. Moiprimoj'expose ma vie; secundosongezmadameaux réflexions qui m'agitent lorsque je vais voler! Suis-je dans le vraime dis-je? La place de tribun rend-elle des services valant réellement cent francs par mois? J'ai deux chemisesl'habit que vous voyezquelques mauvaises armeset je suis sûr de finir par la corde: j'ose croire que je suis désintéressé. Je serais heureux sans ce fatal amour qui ne me laisse plus trouver que malheur auprès de la mère de mes enfants. La pauvreté me pèse comme laide: j'aime les beaux habitsles mains blanches...
Il regardait celles de la duchesse de telle sorte que la peur la saisit.
-- Adieumonsieurlui dit-elle: puis-je vous être bonne à quelque chose à Parme?
-- Pensez quelquefois à cette question: son emploi est de réveiller les coeurs et de les empêcher de s'endormir dans ce faux bonheur tout matériel que donnent les monarchies. Le service qu'il rend à ses concitoyens vaut-il cent francs par mois?... Mon malheur est d'aimerdit-il d'un air fort douxet depuis près de deux ans mon âme n'est occupée que de vousmais jusqu'ici je vous avais vue sans vous faire peur. Et il prit la fuite avec une rapidité prodigieuse qui étonna la duchesse et la rassura. Les gendarmes auraient de la peine à l'atteindrepensa-t-elle; en effetil est fou.
Il est foului dirent ses gens; nous savons tous depuis longtemps que le pauvre homme est amoureux de madame; quand madame est ici nous le voyons errer dans les parties les plus élevées du boiset dès que madame est partieil ne manque pas de venir s'asseoir aux mêmes endroits où elle s'est arrêtée; il ramasse curieusement les fleurs qui ont pu tomber de son bouquet et les conserve longtemps attachées à son mauvais chapeau.
-- Et vous ne m'avez jamais parlé de ces foliesdit la duchesse presque du ton du reproche.
-- Nous craignions que madame ne le dît au ministre Mosca. Le pauvre Ferrante est si bon enfant! ça n'a jamais fait de mal à personneet parce qu'il aime notre Napoléonon l'a condamné à mort.
Elle ne dit mot au ministre de cette rencontreet comme depuis quatre ans c'était le premier secret qu'elle lui faisaitdix fois elle fut obligée de s'arrêter court au milieu d'une phrase. Elle revint à Sacca avec de l'or. Ferrante ne se montra point. Elle revint quinze jours plus tard: Ferranteaprès l'avoir suivie quelque temps en gambadant dans le bois à cent pas de distancefondit sur elle avec la rapidité de l'épervieret se précipita à ses genoux comme la première fois.
-- Où étiez-vous il y a quinze jours?
-- Dans la montagne au-delà de Novipour voler des muletiers qui revenaient de Milan où ils avaient vendu de l'huile.
-- Acceptez cette bourse.
Ferrante ouvrit la boursey prit un sequin qu'il baisa et qu'il mit dans son seinpuis la rendit.
-- Vous me rendez cette bourse et vous volez!
-- Sans doute; mon institution est tellejamais je ne dois avoir plus de cent francs; ormaintenantla mère de mes enfants a quatre-vingts francs et moi j'en ai vingt- cinqje suis en faute de cinq francset si l'on me pendait en ce moment j'aurais des remords. J'ai pris ce sequin parce qu'il vient de vous et que je vous aime.
L'intonation de ce mot fort simple fut parfaite. Il aime réellementse dit la duchesse.
Ce jour-làil avait l'air tout à fait égaré. Il dit qu'il y avait à Parme des gens qui lui devaient six cents francset qu'avec cette somme il réparerait sa cabane où maintenant ses pauvres petits enfants s'enrhumaient.
-- Mais je vous ferai l'avance de ces six cents francsdit la duchesse tout émue.
-- Mais alorsmoihomme publicle parti contraire ne pourra-t-il pas me calomnieret dire que je me vends?
La duchesse attendrie lui offrit une cachette à Parme s'il voulait lui jurer que pour le moment il n'exercerait point sa magistrature dans cette villeque surtout il n'exécuterait aucun des arrêts de mort quedisait-ilil avait in petto.
-- Et si l'on me pend par suite de mon imprudencedit gravement Ferrantetous ces coquinssi nuisibles au peuplevivront de longues annéeset à qui la faute? Que me dira mon père en me recevant là-haut?
La duchesse lui parla beaucoup de ses petits enfants à qui l'humidité pouvait causer des maladies mortelles; il finit par accepter l'offre de la cachette à Parme.
Le duc Sanseverinadans la seule demi-journée qu'il eût passée à Parme depuis son mariageavait montré à la duchesse une cachette fort singulière qui existe à l'angle méridional du palais de ce nom. Le mur de façadequi date du moyen âgea huit pieds d'épaisseur; on l'a creusé en dedanset là se trouve une cachette de vingt pieds de hautmais de deux seulement de largeur. C'est tout à côté que l'on admire ce réservoir d'eau cité dans tous les voyagesfameux ouvrage du douzième sièclepratiqué lors du siège de Parme par l'empereur Sigismondet qui plus tard fut compris dans l'enceinte du palais Sanseverina.
On entre dans la cachette en faisant mouvoir une énorme pierre sur un axe de fer placé vers le centre du bloc. La duchesse était si profondément touchée de la folie du Ferrante et du sort de ses enfantspour lesquels il refusait obstinément tout cadeau ayant une valeurqu'elle lui permit de faire usage de cette cachette pendant assez longtemps. Elle le revit un mois aprèstoujours dans les bois de Saccaet comme ce jour-là il était un peu plus calmeil lui récita un de ses sonnets qui lui sembla égal ou supérieur à tout ce qu'on a fait de plus beau en Italie depuis deux siècles. Ferrante obtint plusieurs entrevues; mais son amour s'exaltadevint importunet la duchesse s'aperçut que cette passion suivait les lois de tous les amours que l'on met dans la possibilité de concevoir une lueur d'espérance. Elle le renvoya dans ses boislui défendit de lui adresser la parole: il obéit à l'instant et avec une douceur parfaite. Les choses en étaient à ce point quand Fabrice fut arrêté. Trois jours aprèsà la tombée de la nuitun capucin se présenta à la porte du palais Sanseverina; il avaitdisait-ilun secret important à communiquer à la maîtresse du logis. Elle était si malheureuse qu'elle fit entrer: c'était Ferrante.-- Il se passe ici une nouvelle iniquité dont le tribun du peuple doit prendre connaissancelui dit cet homme fou d'amour. D'autre partagissant comme simple particulierajouta-t-ilje ne puis donner à madame la duchesse Sanseverina que ma vieet je la lui apporte.
Ce dévouement si sincère de la part d'un voleur et d'un fou toucha vivement la duchesse. Elle parla longtemps à cet homme qui passait pour le plus grand poète du nord de l'Italieet pleura beaucoup. Voilà un homme qui comprend mon coeurse disait-elle. Le lendemain il reparut toujours à l'Ave Mariadéguisé en domestique et portant livrée.
-- Je n'ai point quitté Parme; j'ai entendu dire une horreur que ma bouche ne répétera point; mais me voici. Songezmadameà ce que vous refusez! L'être que vous voyez n'est pas une poupée de courc'est un homme! Il était à genoux en prononçant ces paroles d'un air à leur donner de la valeur. Hierje me suis ditajouta-t-il: Elle a pleuré en ma présence; donc elle est un peu moins malheureuse!
-- Maismonsieursongez donc quels dangers vous environnenton vous arrêtera dans cette ville!
-- Le tribun vous dira: Madamequ'est-ce que la vie quand le devoir parle? L'homme malheureuxet qui a la douleur de ne plus sentir de passion pour la vertu depuis qu'il est brûlé par l'amourajoutera: Madame la duchesseFabriceun homme de coeurva périr peut-être; ne repoussez pas un autre homme de coeur qui s'offre à vous! Voici un corps de fer et une âme qui ne craint au monde que de vous déplaire.
-- Si vous me parlez encore de vos sentimentsje vous ferme ma porte à jamais.
La duchesse eut bien l'idéece soir-làd'annoncer à Ferrante qu'elle ferait une petite pension à ses enfants mais elle eut peur qu'il ne partît de là pour se tuer.
A peine fut-il sorti queremplie de pressentiments funesteselle se dit: Moi aussi je puis mouriret plût à Dieu qu'il en fût ainsiet bientôt! si je trouvais un homme digne de ce nom à qui recommander mon pauvre Fabrice.
Une idée saisit la duchesse: elle prit un morceau de papier et reconnutpar un écrit auquel elle mêla le peu de mots de droit qu'elle savaitqu'elle avait reçu du sieur Ferrante Palla la somme de 25 000 francssous l'expresse condition de payer chaque année une rente viagère de 1 500 francs à la dame Sarasine et à ses cinq enfants. La duchesse ajouta: De plus je lègue une rente viagère de 300 francs à chacun de ses cinq enfantssous la condition que Ferrante Palla donnera des soins comme médecin à mon neveu Fabrice del Dongoet sera pour lui un frère. Je l'en prie. Elle signaantidata d'un an et serra ce papier.
Deux jours après Ferrante reparut. C'était au moment où toute la ville était agitée par le bruit de la prochaine exécution de Fabrice. Cette triste cérémonie aurait-elle lieu dans la citadelle ou sous les arbres de la promenade publique? Plusieurs hommes du peuple allèrent se promener ce soir-là devant la porte de la citadellepour tâcher de voir si l'on dressait l'échafaud: ce spectacle avait ému Ferrante. Il trouva la duchesse noyée dans les larmeset hors d'état de parler; elle le salua de la main et lui montra un siège.
Ferrantedéguisé ce jour-là en capucinétait superbe; au lieu de s'asseoir il se mit à genoux et pria Dieu dévotement à demi-voix. Dans un moment où la duchesse semblait un peu plus calmesans se déranger de sa positionil interrompit un instant sa prière pour dire ces mots: De nouveau il offre sa vie.
-- Songez à ce que vous ditess'écria la duchesseavec cet oeil hagard quiaprès les sanglotsannonce que la colère prend le dessus sur l'attendrissement.
-- Il offre sa vie pour mettre obstacle au sort de Fabriceou pour le venger.
-- Il y a telle occurrencerépliqua la duchesseoù je pourrais accepter le sacrifice de votre vie.
Elle le regardait avec une attention sévère. Un éclair de joie brilla dans son regard; il se leva rapidement et tendit les bras vers le ciel. La duchesse alla se munir d'un papier caché dans le secret d'une grande armoire de noyer.-- Lisezdit-elle à Ferrante. C'était la donation en faveur de ses enfantsdont nous avons parlé.
Les larmes et les sanglots empêchaient Ferrante de lire la fin; il tomba à genoux.
-- Rendez-moi ce papierdit la duchesseetdevant luielle le brûla à la bougie.
Il ne faut pasajouta-t-elleque mon nom paraisse si vous êtes pris et exécutécar il y va de votre tête.
-- Ma joie est de mourir en nuisant au tyranune bien plus grande joie de mourir pour vous. Cela posé et bien comprisdaignez ne plus faire mention de ce détail d'argentj'y verrais un doute injurieux.
-- Si vous êtes compromisje puis l'être aussirepartit la duchesseet Fabrice après moi: c'est pour celaet non pas parce que je doute de votre bravoureque j'exige que l'homme qui me perce le coeur soit empoisonné et non tué. Par la même raison importante pour moije vous ordonne de faire tout au monde pour vous sauver.
-- J'exécuterai fidèlementponctuellement et prudemment. Je prévoismadame la duchesseque ma vengeance sera mêlée à la vôtre: il en serait autrementque j'obéirais encore fidèlementponctuellement et prudemment. Je puis ne pas réussirmais j'emploierai toute ma force d'homme.
-- Il s'agit d'empoisonner le meurtrier de Fabrice.
-- Je l'avais devinéet depuis vingt-sept mois que je mène cette vie errante et abominablej'ai souvent songé à une pareille action pour mon compte.
-- Si je suis découverte et condamnée comme complicepoursuivit la duchesse d'un ton de fiertéje ne veux point que l'on puisse m'imputer de vous avoir séduit. Je vous ordonne de ne plus chercher à me voir avant l'époque de notre vengeance: il ne s'agit point de le mettre à mort avant que je vous en aie donné le signal. Sa mort en cet instantpar exempleme serait funeste loin de m'être utile. Probablement sa mort ne devra avoir lieu que dans plusieurs moismais elle aura lieu. J'exige qu'il meure par le poisonet j'aimerais mieux le laisser vivre que de le voir atteint d'un coup de feu. Pour des intérêts que je ne veux pas vous expliquerj'exige que votre vie soit sauvée.
Ferrante était ravi de ce ton d'autorité que la duchesse prenait avec lui: ses yeux brillaient d'une profonde joie. Ainsi que nous l'avons ditil était horriblement maigre; mais on voyait qu'il avait été fort beau dans sa première jeunesseet il croyait être encore ce qu'il avait été jadis. Suis-je fouse dit-ilou bien la duchesse veut-elle un jourquand je lui aurai donné cette preuve de dévouementfaire de moi l'homme le plus heureux? Et dans le faitpourquoi pas? Est-ce que je ne vaux point cette poupée de comte Mosca quidans l'occasionn'a rien pu pour ellepas même faire évader monsignore Fabrice?
-- Je puis vouloir sa mort dès demaincontinua la duchessetoujours du même air d'autorité. Vous connaissez cet immense réservoir d'eau qui est au coin du palaistout près de la cachette que vous avez occupée quelquefois; il est un moyen secret de faire couler toute cette eau dans la rue: hé bien! ce sera là le signal de ma vengeance. Vous verrezsi vous êtes à Parmeou vous entendrez diresi vous habitez les boisque le grand réservoir du palais Sanseverina a crevé. Agissez aussitôtmais par le poisonet surtout n'exposez votre vie que le moins possible. Que jamais personne ne sache que j'ai trempé dans cette affaire.
-- Les paroles sont inutilesrépondit Ferrante avec un enthousiasme mal contenu: je suis déjà fixé sur les moyens que j'emploierai. La vie de cet homme me devient plus odieuse qu'elle n'étaitpuisque je n'oserai vous revoir tant qu'il vivra. J'attendrai le signal du réservoir crevé dans la rue. Il salua brusquement et partit. La duchesse le regardait marcher.
Quand il fut dans l'autre chambreelle le rappela.
-- Ferrante! s'écria-t-elle; homme sublime!
Il rentracomme impatient d'être retenu; sa figure était superbe en cet instant.
-- Et vos enfants?
-- Madameils seront plus riches que moi; vous leur accordez peut-être quelque petite pension.
-- Tenezlui dit la duchesse en lui remettant une sorte de gros étui en bois d'oliviervoici tous les diamants qui me restent; ils valent cinquante mille francs.
-- Ahmadame! vous m'humiliez!... dit Ferrante avec un mouvement d'horreur; et sa figure changea du tout au tout.
-- Je ne vous reverrai jamais avant l'action: prenezje le veuxajouta la duchesse avec un air de hauteur qui atterra Ferrante; il mit l'étui dans sa poche et sortit.
La porte avait été refermée par lui. La duchesse le rappela de nouveau; il rentra d'un air inquiet: la duchesse était debout au milieu du salon; elle se jeta dans ses bras. Au bout d'un instantFerrante s'évanouit presque de bonheur; la duchesse se dégagea de ses embrassementset des yeux lui montra la porte.
-- Voilà le seul homme qui m'ait comprisese dit-ellec'est ainsi qu'en eût agi Fabrices'il eût pu m'entendre.
Il y avait deux choses dans le caractère de la duchesseelle voulait toujours ce qu'elle avait voulu une fois; elle ne remettait jamais en délibération ce qui avait été une fois décidé. Elle citait à ce propos un mot de son premier maril'aimable général Pietranera: quelle insolence envers moi-même! disait-il; pourquoi croirai- je avoir plus d'esprit aujourd'hui que lorsque je pris ce parti?
De ce momentune sorte de gaieté reparut dans le caractère de la duchesse. Avant la fatale résolutionà chaque pas que faisait son esprità chaque chose nouvelle qu'elle voyaitelle avait le sentiment de son infériorité envers le princede sa faiblesse et de sa duperie; le princesuivant ellel'avait lâchement trompéeet le comte Moscapar suite de son génie courtisanesquequoique innocemmentavait secondé le prince. Dès que la vengeance fut résolueelle sentit sa forcechaque pas de son esprit lui donnait du bonheur. Je croirais assez que le bonheur immoral qu'on trouve à se venger en Italie tient à la force d'imagination de ce peuple; les gens des autres pays ne pardonnent pas à proprement parlerils oublient.
La duchesse ne revit Palla que vers les derniers temps de la prison de Fabrice. Comme on l'a deviné peut-êtrece fut lui qui donna l'idée de l'évasion: il existait dans les boisà deux lieues de Saccaune tour du moyen âgeà demi ruinéeet haute de plus de cent pieds; avant de parler une seconde fois de fuite à la duchesseFerrante la supplia d'envoyer Ludovicavec des hommes sûrsdisposer une suite d'échelles auprès de cette tour. En présence de la duchesse il y monta avec les échelleset en descendit avec une simple corde nouée; il renouvela trois fois l'expériencepuis il expliqua de nouveau son idée. Huit jours aprèsLudovic voulut aussi descendre de cette vieille tour avec une corde nouée: ce fut alors que la duchesse communiqua cette idée à Fabrice.
Dans les derniers jours qui précédèrent cette tentativequi pouvait amener la mort du prisonnieret de plus d'une façonla duchesse ne pouvait trouver un instant de repos qu'autant qu'elle avait Ferrante à ses côtés; le courage de cet homme électrisait le sien; mais l'on sent bien qu'elle devait cacher au comte ce voisinage singulier. Elle craignaitnon pas qu'il se révoltâtmais elle eût été affligée de ses objectionsqui eussent redoublé ses inquiétudes. Quoi! prendre pour conseiller intime un fou reconnu comme telet condamné à mort! Etajoutait la duchessese parlant à elle-mêmeun homme quipar la suitepouvait faire de si étranges choses! Ferrante se trouvait dans le salon de la duchesse au moment où le comte vint lui donner connaissance de la conversation que le prince avait eue avec Rassi; etlorsque le comte fut sortielle eut beaucoup à faire pour empêcher Ferrante de marcher sur-le-champ à l'exécution d'un affreux dessein!
-- Je suis fort maintenant! s'écriait ce fou; je n'ai plus de doute sur la légitimité de l'action!
-- Maisdans le moment de colère qui suivra inévitablementFabrice serait mis à mort!
-- Mais ainsi on lui épargnerait le péril de cette descente: elle est possiblefacile mêmeajoutait-il; mais l'expérience manque à ce jeune homme.
On célébra le mariage de la soeur du marquis Crescenziet ce fut à la fête donnée dans cette occasion que la duchesse rencontra Cléliaet put lui parler sans donner de soupçons aux observateurs de bonne compagnie. La duchesse elle-même remit à Clélia le paquet de cordes dans le jardinoù ces dames étaient allées respirer un instant. Ces cordesfabriquées avec le plus grand soinmi-parties de chanvre et de soieavec des noeudsétaient fort menues et assez flexibles; Ludovic avait éprouvé leur soliditéetdans toutes leurs partieselles pouvaient porter sans se rompre un poids de huit quintaux. On les avait comprimées de façon à en former plusieurs paquets de la forme d'un volume in-quarto; Clélia s'en emparaet promit à la duchesse que tout ce qui était humainement possible serait accompli pour faire arriver ces paquets jusqu'à la tour Farnèse.
-- Mais je crains la timidité de votre caractère; et d'ailleursajouta poliment la duchessequel intérêt peut vous inspirer un inconnu?
-- M. del Dongo est malheureuxet je vous promets que par moi il sera sauvé!
Mais la duchessene comptant que fort médiocrement sur la présence d'esprit d'une jeune personne de vingt ansavait pris d'autres précautions dont elle se garda bien de faire part à la fille du gouverneur. Comme il était naturel de le supposerce gouverneur se trouvait à la fête donnée pour le mariage de la soeur du marquis Crescenzi. La duchesse se dit quesi elle lui faisait donner un fort narcotiqueon pourrait croire dans le premier moment qu'il s'agissait d'une attaque d'apoplexieet alorsau lieu de le placer dans sa voiture pour le ramener à la citadelleon pourraitavec un peu d'adressefaire prévaloir l'avis de se servir d'une litièrequi se trouverait par hasard dans la maison où se donnait la fête. Là se rencontreraient aussi des hommes intelligentsvêtus en ouvriers employés pour la fêteet quidans le trouble générals'offriraient obligeamment pour transporter le malade jusqu'à son palais si élevé. Ces hommesdirigés par Ludovicportaient une assez grande quantité de cordesadroitement cachées sous leurs habits. On voit que la duchesse avait réellement l'esprit égaré depuis qu'elle songeait sérieusement à la fuite de Fabrice. Le péril de cet être chéri était trop fort pour son âmeet surtout durait trop longtemps. Par excès de précautionselle faillit faire manquer cette fuiteainsi qu'on va le voir. Tout s'exécuta comme elle l'avait projeté avec cette seule différence que le narcotique produisit un effet trop puissant; tout le monde crutet même les gens de l'artque le général avait une attaque d'apoplexie.
Par bonheurCléliaau désespoirne se douta en aucune façon de la tentative si criminelle de la duchesse. Le désordre fut tel au moment de l'entrée à la citadelle de la litière où le généralà demi-mortétait enferméque Ludovic et ses gens passèrent sans objection; ils ne furent fouillés que pour la bonne forme au pont de l'Esclave. Quand ils eurent transporté le général jusqu'à son liton les conduisit à l'officeoù les domestiques les traitèrent fort bien; mais après ce repasqui ne finit que fort près du matinon leur expliqua que l'usage de la prison exigeait que pour le reste de la nuitils fussent enfermés à clef dans les salles basses du palais; le lendemain au jour ils seraient mis en liberté par le lieutenant du gouverneur.
Ces hommes avaient trouvé le moyen de remettre à Ludovic les cordes dont ils s'étaient chargésmais Ludovic eut beaucoup de peine à obtenir un instant d'attention de Clélia. A la findans un moment où elle passait d'une chambre à une autreil lui fit voir qu'il déposait des paquets de corde dans l'angle obscur d'un des salons du premier étage. Clélia fut profondément frappée de cette circonstance étrange: aussitôt elle conçut d'atroces soupçons.
-- Qui êtes-vous? dit-elle à Ludovic.
Etsur la réponse fort ambiguÎ; de celui-cielle ajouta:
-- Je devrais vous faire arrêter; vous ou les vôtres vous avez empoisonné mon père!... Avouez à l'instant quelle est la nature du poison dont vous avez fait usageafin que le médecin de la citadelle puisse administrer les remèdes convenables; avouez à l'instantou bienvous et vos complicesjamais vous ne sortirez de cette citadelle!
-- Mademoiselle a tort de s'alarmerrépondit Ludovicavec une grâce et une politesse parfaites; il ne s'agit nullement de poison; on a eu l'imprudence d'administrer au général une dose de laudanumet il paraît que le domestique chargé de ce crime a mis dans le verre quelques gouttes de trop; nous en aurons un remords éternel; mais mademoiselle peut croire quegrâce au cielil n'existe aucune sorte de danger: M. le gouverneur doit être traité pour avoir prispar erreurune trop forte dose de laudanum; maisj'ai l'honneur de le répéter à mademoisellele laquais chargé du crime ne faisait point usage de poisons véritablescomme Barbonelorsqu'il voulut empoisonner monseigneur Fabrice. On n'a point prétendu se venger du péril qu'a couru monseigneur Fabrice; on n'a confié à ce laquais maladroit qu'une fiole où il y avait du laudanumj'en fais serment à mademoiselle! Mais il est bien entendu quesi j'étais interrogé officiellementje nierais tout.
D'ailleurssi mademoiselle parle à qui que ce soit de laudanum et de poisonfût- ce à l'excellent don CesareFabrice est tué de la main de mademoiselle. Elle rend à jamais impossibles tous les projets de fuite; et mademoiselle sait mieux que moi que ce n'est pas avec du simple laudanum que l'on veut empoisonner monseigneur; elle sait aussi que quelqu'un n'a accordé qu'un mois de délai pour ce crimeet qu'il y a déjà plus d'une semaine que l'ordre fatal a été reçu. Ainsisi elle me fait arrêterou si seulement elle dit un mot à don Cesare ou à tout autreelle retarde toutes nos entreprises de bien plus d'un moiset j'ai raison de dire qu'elle tue de sa main monseigneur Fabrice.
Clélia était épouvantée de l'étrange tranquillité de Ludovic.
Ainsime voilà en dialogue réglése disait-elleavec l'empoisonneur de mon pèreet qui emploie des tournures polies pour me parler! Et c'est l'amour qui m'a conduite à tous ces crimes!...
Le remords lui laissait à peine la force de parler; elle dit à Ludovic:
-- Je vais vous enfermer à clef dans ce salon. Je cours apprendre au médecin qu'il ne s'agit que de laudanum; maisgrand Dieu! comment lui dirai-je que je l'ai appris moi-même? Je reviens ensuite vous délivrer.
Maisdit Clélia revenant en courant d'auprès de la porteFabrice savait-il quelque chose du laudanum?
-- Mon Dieu nonmademoiselleil n'y eût jamais consenti. Et puisà quoi bon faire une confidence inutile? nous agissons avec la prudence la plus stricte. Il s'agit de sauver la vie à monseigneurqui sera empoisonné d'ici à trois semaines; l'ordre en a été donné par quelqu'un qui d'ordinaire ne trouve point d'obstacle à ses volontés; etpour tout dire à mademoiselleon prétend que c'est le terrible fiscal général Rassi qui a reçu cette commission.
Clélia s'enfuit épouvantée: elle comptait tellement sur la parfaite probité de don Cesarequ'en employant certaine précautionelle osa lui dire qu'on avait administré au général du laudanumet pas autre chose. Sans répondresans questionnerdon Cesare courut au médecin.
Clélia revint au salonoù elle avait enfermé Ludovic dans l'intention de le presser de questions sur le laudanum. Elle ne l'y trouva plus: il avait réussi à s'échapper. Elle vit sur une table une bourse remplie de sequinset une petite boîte renfermant diverses sortes de poisons. La vue de ces poisons la fit frémir. Qui me ditpensa-t-elleque l'on n'a donné que du laudanum à mon pèreet que la duchesse n'a pas voulu se venger de la tentative de Barbone?
-- Grand Dieu! s'écria-t-elleme voici en rapport avec les empoisonneurs de mon père! Et je les laisse s'échapper! Et peut-être cet hommemis à la questioneût avoué autre chose que du laudanum!
Aussitôt Clélia tomba à genoux fondant en larmeset pria la Madone avec ferveur.
Pendant ce tempsle médecin de la citadellefort étonné de l'avis qu'il recevait de don Cesareet d'après lequel il n'avait affaire qu'à du laudanumdonna les remèdes convenables qui bientôt firent disparaître les symptômes les plus alarmants. Le général revint un peu à lui comme le jour commençait à paraître. Sa première action marquant de la connaissance fut de charger d'injures le colonel commandant en second la citadelleet qui s'était avisé de donner quelques ordres les plus simples du monde pendant que le général n'avait pas sa connaissance.
Le gouverneur se mit ensuite dans une fort grande colère contre une fille de cuisine quien lui apportant un bouillons'avisa de prononcer le mot d'apoplexie.
-- Est-ce que je suis d'âges'écria-t-ilà avoir des apoplexies? Il n'y a que mes ennemis acharnés qui puissent se plaire à répandre de tels bruits. Et d'ailleursest- ce que j'ai été saignépour que la calomnie elle-même ose parler d'apoplexie?
Fabricetout occupé des préparatifs de sa fuitene put concevoir les bruits étranges qui remplissaient la citadelle au moment où l'on y rapportait le gouverneur à demi mort. D'abord il eut quelque idée que sa sentence était changéeet qu'on venait le mettre à mort. Voyant ensuite que personne ne se présentait dans sa chambreil pensa que Clélia avait été trahiequ'à sa rentrée dans la forteresse on lui avait enlevé les cordes que probablement elle rapportaitet qu'enfin ses projets de fuite étaient désormais impossibles. Le lendemainà l'aube du jouril vit entrer dans sa chambre un homme à lui inconnuquisans dire moty déposa un panier de fruits: sous les fruits était cachée la lettre suivante:
«Pénétrée des remords les plus vifs par ce qui a été faitnon pasgrâce au cielde mon consentementmais à l'occasion d'une idée que j'avais euej'ai fait voeu à la très sainte Vierge que sipar l'effet de sa sainte intercessionmon père est sauvéjamais je n'opposerai un refus à ses ordres; j'épouserai le marquis aussitôt que j'en serai requise par luiet jamais je ne vous reverrai. Toutefoisje crois qu'il est de mon devoir d'achever ce qui a été commencé. Dimanche prochainau retour de la messe où l'on vous conduira à ma demande (songez à préparer votre âmevous pouvez vous tuer dans la difficile entreprise); au retour de la messedis-jeretardez le plus possible votre rentrée dans votre chambre; vous y trouverez ce qui vous est nécessaire pour l'entreprise méditée. Si vous périssezj'aurai l'âme navrée! Pourrez-vous m'accuser d'avoir contribué à votre mort? La duchesse elle- même ne m'a-t-elle pas répété à diverses reprises que la faction Raversi l'emporte? on veut lier le prince par une cruauté qui le sépare à jamais du comte Mosca. La duchessefondant en larmesm'a juré qu'il ne reste que cette ressource: vous périssez si vous ne tentez rien. Je ne puis plus vous regarderj'en ai fait le voeu; mais si dimanchevers le soirvous me voyez entièrement vêtue de noirà la fenêtre accoutuméece sera le signal que la nuit suivante tout sera disposé autant qu'il est possible à mes faibles moyens. Après onze heurespeut- être seulement à minuit ou une heureune petite lampe paraîtra à ma fenêtrece sera l'instant décisif; recommandez-vous à votre saint patronprenez en hâte les habits de prêtre dont vous êtes pourvuet marchez. »
«AdieuFabriceje serai en prièreet répandant les larmes les plus amèresvous pouvez le croirependant que vous courrez de si grands dangers. Si vous périssezje ne vous survivrai point; grand Dieu! qu'est-ce que je dis? mais si vous réussissezje ne vous reverrai jamais. Dimancheaprès la messevous trouverez dans votre prison l'argentles poisonsles cordesenvoyés par cette femme terrible qui vous aime avec passionet qui m'a répété jusqu'à trois fois qu'il fallait prendre ce parti. Dieu vous sauve et la sainte Madone! »
Fabio Conti était un geôlier toujours inquiettoujours malheureuxvoyant toujours en songe quelqu'un de ses prisonniers lui échapper: il était abhorré de tout ce qui était dans la citadelle; mais le malheur inspirant les mêmes résolutions à tous les hommesles pauvres prisonniersceux-là mêmes qui étaient enchaînés dans des cachots hauts de trois piedslarges de trois pieds et de huit pieds de longueur et où ils ne pouvaient se tenir debout ou assistous les prisonniersmême ceux-làdis-jeeurent l'idée de faire chanter à leur frais un Te Deum lorsqu'ils surent que leur gouverneur était hors de danger. Deux ou trois de ces malheureux firent des sonnets en l'honneur de Fabio Conti. O effet du malheur sur ces hommes! Que celui qui les blâme soit conduit par sa destinée à passer un an dans un cachot haut de trois piedsavec huit onces de pain par jour et jeûnant les vendredis.
Cléliaqui ne quittait la chambre de son père que pour aller prier dans la chapelledit que le gouverneur avait décidé que les réjouissances n'auraient lieu que le dimanche. Le matin de ce dimancheFabrice assista à la messe et au Te Deum ; le soir il y eut feu d'artificeet dans les salles basses du château l'on distribua aux soldats une quantité de vin quadruple de celle que le gouverneur avait accordée; une main inconnue avait même envoyé plusieurs tonneaux d'eau-de- vie que les soldats défoncèrent. La générosité des soldats qui s'enivraient ne voulut pas que les cinq soldats qui faisaient faction comme sentinelles autour du palais souffrissent de leur position; à mesure qu'ils arrivaient à leurs guéritesun domestique affidé leur donnait du vinet l'on ne sait par quelle main ceux qui furent placés en sentinelle à minuit et pendant le reste de la nuit reçurent aussi un verre d'eau-de-vieet l'on oubliait à chaque fois la bouteille auprès de la guérite (comme il a été prouvé au procès qui suivit).
Le désordre dura plus longtemps que Clélia ne l'avait penséet ce ne fut que vers une heure que Fabricequidepuis plus de huit joursavait scié deux barreaux de sa fenêtrecelle qui ne donnait pas vers la volièrecommença à démonter l'abat- jour; il travaillait presque sur la tête des sentinelles qui gardaient le palais du gouverneurils n'entendirent rien. Il avait fait quelques nouveaux noeuds seulement à l'immense corde nécessaire pour descendre de cette terrible hauteur de cent quatre-vingts pieds. Il arrangea cette corde en bandoulière autour de son corps: elle le gênait beaucoupson volume étant énorme; les noeuds l'empêchaient de former masseet elle s'écartait à plus de dix-huit pouces du corps. Voilà le grand obstaclese dit Fabrice.
Cette corde arrangée tant bien que malFabrice prit celle avec laquelle il comptait descendre les trente-cinq pieds qui séparaient sa fenêtre de l'esplanade où était le palais du gouverneur. Mais comme pourtantquelque enivrées que fussent les sentinellesil ne pouvait pas descendre exactement sur leurs têtesil sortitcomme nous l'avons ditpar la seconde fenêtre de sa chambrecelle qui avait jour sur le toit d'une sorte de vaste corps de garde. Par une bizarrerie de maladedès que le général Fabio Conti avait pu parleril avait fait monter deux cents soldats dans cet ancien corps de garde abandonné depuis un siècle. Il disait qu'après l'avoir empoisonné on voulait l'assassiner dans son litet ces deux cents soldats devaient le garder. On peut juger de l'effet que cette mesure imprévue produisit sur le coeur de Clélia: cette fille pieuse sentait fort bien jusqu'à quel point elle trahissait son pèreet un père qui venait d'être presque empoisonné dans l'intérêt du prisonnier qu'elle aimait. Elle vit presque dans l'arrivée imprévue de ces deux cents hommes un arrêt de la Providence qui lui défendait d'aller plus avant et de rendre la liberté à Fabrice.
Mais tout le monde dans Parme parlait de la mort prochaine du prisonnier. On avait encore traité ce triste sujet à la fête même donnée à l'occasion du mariage de la signora Giulia Crescenzi. Puisque pour une pareille vétilleun coup d'épée maladroit donné à un comédienun homme de la naissance de Fabrice n'était pas mis en liberté au bout de neuf mois de prison et avec la protection du premier ministrec'est qu'il y avait de la politique dans son affaire. Alorsinutile de s'occuper davantage de luiavait-on dit; s'il ne convenait pas au pouvoir de le faire mourir en place publiqueil mourrait bientôt de maladie. Un ouvrier serrurier qui avait été appelé au palais du général Fabio Conti parla de Fabrice comme d'un prisonnier expédié depuis longtemps et dont on taisait la mort par politique. Le mot de cet homme décida Clélia.
Livre Second
Chapitre XXII.
Dans la journée Fabrice fut attaqué par quelques réflexions sérieuses et désagréablesmais à mesure qu'il entendait sonner les heures qui le rapprochaient du moment de l'actionil se sentait allègre et dispos. La duchesse lui avait écrit qu'il serait surpris par le grand airet qu'à peine hors de sa prison il se trouverait dans l'impossibilité de marcher; dans ce cas il valait mieux pourtant s'exposer à être repris que se précipiter du haut d'un mur de cent quatre-vingts pieds. Si ce malheur m'arrivedisait Fabriceje me coucherai contre le parapetje dormirai une heurepuis je recommencerai; puisque je l'ai juré à Cléliaj'aime mieux tomber du haut d'un rempartsi élevé qu'il soitque d'être toujours à faire des réflexions sur le goût du pain que je mange. Quelles horribles douleurs ne doit-on pas éprouver avant la finquand on meurt empoisonné! Fabio Conti n'y cherchera pas de façonsil me fera donner de l'arsenic avec lequel il tue les rats de sa citadelle.
Vers le minuit un de ces brouillards épais et blancs que le Pô jette quelquefois sur ses rives s'étendit d'abord sur la villeet ensuite gagna l'esplanade et les bastions au milieu desquels s'élève la grosse tour de la citadelle. Fabrice crut voir que du parapet de la plate-formeon n'apercevait plus les petits acacias qui environnaient les jardins établis par les soldats au pied du mur de cent quatre-vingts pieds. Voilà qui est excellentpensa-t-il.
Un peu après que minuit et demi eut sonnéle signal de la petite lampe parut à la fenêtre de la volière. Fabrice était prêt à agir; il fit un signe de croixpuis attacha à son lit la petite corde destinée à lui faire descendre les trente-cinq pieds qui le séparaient de la plate-forme où était le palais. Il arriva sans encombre sur le toit du corps de garde occupé depuis la veille par les deux cents hommes de renfort dont nous avons parlé. Par malheur les soldatsà minuit trois quarts qu'il était alorsn'étaient pas encore endormis; pendant qu'il marchait à pas de loup sur le toit de grosses tuiles creusesFabrice les entendait qui disaient que le diable était sur le toitet qu'il fallait essayer de le tuer d'un coup de fusil. Quelques voix prétendaient que ce souhait était d'une grande impiétéd'autres disaient que si l'on tirait un coup de fusil sans tuer quelque chosele gouverneur les mettrait tous en prison pour avoir alarmé la garnison inutilement. Toute cette belle discussion faisait que Fabrice se hâtait le plus possible en marchant sur le toit et qu'il faisait beaucoup plus de bruit. Le fait est qu'au moment oùpendu à sa cordeil passa devant les fenêtrespar bonheur à quatre ou cinq pieds de distance à cause de l'avance du toitelles étaient hérissées de baïonnettes. Quelques-uns ont prétendu que Fabrice toujours fou eut l'idée de jouer le rôle du diableet qu'il jeta à ces soldats une poignée de sequins. Ce qui est sûrc'est qu'il avait semé des sequins sur le plancher de sa chambreet il en sema aussi sur la plate-forme dans son trajet de la tour Farnèse au parapetafin de se donner la chance de distraire les soldats qui auraient pu se mettre à le poursuivre.
Arrivé sur la plate-forme et entouré de sentinelles qui ordinairement criaient tous les quarts d'heure une phrase entière: Tout est bien autour de mon posteil dirigea ses pas vers le parapet du couchant et chercha la pierre neuve.
Ce qui paraît incroyable et pourrait faire douter du fait si le résultat n'avait eu pour témoin une ville entièrec'est que les sentinelles placées le long du parapet n'aient pas vu et arrêté Fabrice; à la véritéle brouillard dont nous avons parlé commençait à monteret Fabrice a dit que lorsqu'il était sur la plate-formele brouillard lui semblait arrivé déjà jusqu'à moitié de la tour Farnèse. Mais ce brouillard n'était point épaiset il apercevait fort bien les sentinelles dont quelques-unes se promenaient. Il ajoutait quepoussé comme par une force surnaturelleil alla se placer hardiment entre deux sentinelles assez voisines. Il défit tranquillement la grande corde qu'il avait autour du corps et qui s'embrouilla deux fois; il lui fallut beaucoup de temps pour la débrouiller et l'étendre sur le parapet. Il entendait les soldats parler de tous les côtésbien résolu à poignarder le premier qui s'avancerait vers lui. Je n'étais nullement troubléajoutait-ilil me semblait que j'accomplissais une cérémonie.
Il attacha sa corde enfin débrouillée à une ouverture pratiquée dans le parapet pour l'écoulement des eauxil monta sur ce même parapetet pria Dieu avec ferveur; puiscomme un héros des temps de chevalerieil pensa un instant à Clélia. Combien je suis différentse dit-ildu Fabrice léger et libertin qui entra ici il y a neuf mois! Enfin il se mit à descendre cette étonnante hauteur. Il agissait mécaniquementdit-ilet comme il eût fait en plein jourdescendant devant des amispour gagner un pari. Vers le milieu de la hauteuril sentit tout à coup ses bras perdre leur force; il croit même qu'il lâcha la corde un instant; mais bientôt il la reprit; peut-êtredit-ilil se retint aux broussailles sur lesquelles il glissait et qui l'écorchaient. Il éprouvait de temps à autre une douleur atroce entre les épauleselle allait jusqu'à lui ôter la respiration. Il y avait un mouvement d'ondulation fort incommode; il était renvoyé sans cesse de la corde aux broussailles. Il fut touché par plusieurs oiseaux assez gros qu'il réveillait et qui se jetaient sur lui en s'envolant. Les premières fois il crut être atteint par des gens descendant de la citadelle par la même voie que lui pour le poursuivreet il s'apprêtait à se défendre. Enfin il arriva au bas de la grosse tour sans autre inconvénient que d'avoir les mains en sang. Il raconte que depuis le milieu de la tourle talus qu'elle forme lui fut fort utile; il frottait le mur en descendantet les plantes qui croissaient entre les pierres le retenaient beaucoup. En arrivant en bas dans les jardins des soldats il tomba sur un acacia quivu d'en hautlui semblait avoir quatre ou cinq pieds de hauteuret qui en avait réellement quinze ou vingt. Un ivrogne qui se trouvait là endormi le prit pour un voleur. En tombant de cet arbreFabrice se démit presque le bras gauche. Il se mit à fuir vers le rempartmaisà ce qu'il ditses jambes lui semblaient comme du coton; il n'avait plus aucune force. Malgré le périlil s'assit et but un peu d'eau-de-vie qui lui restait. Il s'endormit quelques minutes au point de ne plus savoir où il était; en se réveillant il ne pouvait comprendre commentse trouvant dans sa chambreil voyait des arbres. Enfin la terrible vérité revint à sa mémoire. Aussitôt il marcha vers le rempart; il y monta par un grand escalier. La sentinellequi était placée tout prèsronflait dans sa guérite. Il trouva une pièce de canon gisant dans l'herbe; il y attacha sa troisième corde; elle se trouva un peu trop courteet il tomba dans un fossé bourbeux où il pouvait y avoir un pied d'eau. Pendant qu'il se relevait et cherchait à se reconnaîtreil se sentit saisi par deux hommes: il eut peur un instant; mais bientôt il entendit prononcer près de son oreille et à voix basse: Ah! monsignore! monsignore! Il comprit vaguement que ces hommes appartenaient à la duchesse; aussitôt il s'évanouit profondément. Quelque temps après il sentit qu'il était porté par des hommes qui marchaient en silence et fort vite; puis on s'arrêtace qui lui donna beaucoup d'inquiétude. Mais il n'avait ni la force de parler ni celle d'ouvrir les yeux; il sentait qu'on le serrait; tout à coup il reconnut le parfum des vêtements de la duchesse. Ce parfum le ranima; il ouvrit les yeux; il put prononcer les mots: Ah! chère amie! puis il s'évanouit de nouveau profondément.
Le fidèle Brunoavec une escouade de gens de police dévoués au comteétait en réserve à deux cents pas; le comte lui-même était caché dans une petite maison tout près du lieu où la duchesse attendait. Il n'eût pas hésités'il l'eût falluà mettre l'épée à la main avec quelques officiers à demi-soldeses amis intimes; il se regardait comme obligé de sauver la vie à Fabricequi lui semblait grandement exposéet qui jadis eût eu sa grâce signée du princesi lui Mosca n'eût eu la sottise de vouloir éviter une sottise écrite au souverain.
Depuis minuit la duchesseentourée d'hommes armés jusqu'aux dentserrait dans un profond silence devant les remparts de la citadelle; elle ne pouvait rester en placeelle pensait qu'elle aurait à combattre pour enlever Fabrice à des gens qui le poursuivraient. Cette imagination ardente avait pris cent précautionstrop longues à détailler iciet d'une imprudence incroyable. On a calculé que plus de quatre-vingts agents étaient sur pied cette nuit-làs'attendant à se battre pour quelque chose d'extraordinaire. Par bonheurFerrante et Ludovic étaient à la tête de tout celaet le ministre de la police n'était pas hostile; mais le comte lui-même remarqua que la duchesse ne fut trahie par personneet qu'il ne sut rien comme ministre.
La duchesse perdit la tête absolument en revoyant Fabrice; elle le serrait convulsivement dans ses braspuis fut au désespoir en se voyant couverte de sang: c'était celui des mains de Fabrice; elle le crut dangereusement blessé. Aidée d'un de ses genselle lui ôtait son habit pour le panserlorsque Ludovicquipar bonheurse trouvait làmit d'autorité la duchesse et Fabrice dans une des petites voitures qui étaient cachées dans un jardin près de la porte de la villeet l'on partit ventre à terre pour aller passer le Pô près de Sacca. Ferranteavec vingt hommes bien armésfaisait l'arrière-gardeet avait promis sur sa tête d'arrêter la poursuite. Le comteseul et à piedne quitta les environs de la citadelle que deux heures plus tardquand il vit que rien ne bougeait. Me voici en haute trahison! se disait-il ivre de joie.
Ludovic eut l'idée excellente de placer dans une voiture un jeune chirurgien attaché à la maison de la duchesseet qui avait beaucoup de la tournure de Fabrice.
-- Prenez la fuitelui dit-ildu côté de Bologne; soyez fort maladroittâchez de vous faire arrêter; alors coupez-vous dans vos réponseset enfin avouez que vous êtes Fabrice del Dongo; surtout gagnez du temps. Mettez de l'adresse à être maladroitvous en serez quitte pour un mois de prisonet madame vous donnera 50 sequins.
-- Est-ce qu'on songe à l'argent quand on sert madame?
Il partitet fut arrêté quelques heures plus tardce qui causa une joie bien plaisante au général Fabio Conti et à Rassiquiavec le danger de Fabricevoyait s'envoler sa baronnie.
L'évasion ne fut connue à la citadelle que sur les six heures du matinet ce ne fut qu'à dix qu'on osa en instruire le prince. La duchesse avait été si bien servie quemalgré le profond sommeil de Fabricequ'elle prenait pour un évanouissement mortelce qui fit que trois fois elle fit arrêter la voitureelle passait le Pô dans une barque comme quatre heures sonnaient. Il y avait des relais sur la rive gauche; on fit encore deux lieues avec une extrême rapiditépuis on fut arrêté plus d'une heure pour la vérification des passeports. La duchesse en avait de toutes les sortes pour elle et pour Fabrice; mais elle était folle ce jour-làelle s'avisa de donner dix napoléons au commis de la police autrichienneet de lui prendre la main en fondant en larmes. Ce commisfort effrayérecommença l'examen. On prit la poste; la duchesse payait d'une façon si extravaganteque partout elle excitait les soupçons en ce pays où tout étranger est suspect. Ludovic lui vint encore en aide; il dit que Mme la duchesse était folle de douleurà cause de la fièvre continue du jeune comte Moscafils du premier ministre de Parmequ'elle emmenait avec elle consulter les médecins de Pavie.
Ce ne fut qu'à dix lieues par delà le Pô que le prisonnier se réveilla tout à faitil avait une épaule luxée et force écorchures. La duchesse avait encore des façons si extraordinaires que le maître d'une auberge de villageoù l'on dînacrut avoir affaire à une princesse du sang impérialet allait lui faire rendre les honneurs qu'il croyait lui être duslorsque Ludovic dit à cet homme que la princesse le ferait immanquablement mettre en prison s'il s'avisait de faire sonner les cloches.
Enfinsur les six heures du soiron arriva au territoire piémontais. Là seulement Fabrice était en toute sûreté; on le conduisit dans un petit village écarté de la grande route; on pansa ses mainset il dormit encore quelques heures.
Ce fut dans ce village que la duchesse se livra à une action non seulement horrible aux yeux de la moralemais qui fut encore bien funeste à la tranquillité du reste de sa vie. Quelques semaines avant l'évasion de Fabriceet un jour que tout Parme était allé à la porte de la citadelle pour tâcher de voir dans la cour l'échafaud qu'on dressait en son honneurla duchesse avait montré à Ludovicdevenu le factotum de sa maisonle secret au moyen duquel on faisait sortir d'un petit cadre de ferfort bien cachéune des pierres formant le fond du fameux réservoir d'eau du palais Sanseverinaouvrage du treizième siècleet dont nous avons parlé. Pendant que Fabrice dormait dans la trattoria de ce petit villagela duchesse fit appeler Ludovic; il la crut devenue folletant les regards qu'elle lui lançait étaient singuliers.
-- Vous devez vous attendrelui dit-elleque je vais vous donner quelques milliers de francs: eh bien! non; je vous connaisvous êtes un poètevous auriez bientôt mangé cet argent. Je vous donne la petite terre de la Ricciardaà une lieue de Casal-Maggiore. Ludovic se jeta à ses pieds fou de joieet protestant avec l'accent du coeur que ce n'était point pour gagner de l'argent qu'il avait contribué à sauver monsignore Fabrice; qu'il l'avait toujours aimé d'une façon particulière depuis qu'il avait eu l'honneur de le conduire une fois en sa qualité de troisième cocher de madame. Quand cet hommequi réellement avait du coeurcrut avoir assez occupé de lui une aussi grande dameil prit congé; mais elleavec des yeux étincelantslui dit:
-- Restez.
Elle se promenait sans mot dire dans cette chambre de cabaretregardant de temps à autre Ludovic avec des yeux incroyables. Enfin cet hommevoyant que cette étrange promenade ne prenait point de fincrut devoir adresser la parole à sa maîtresse.
-- Madame m'a fait un don tellement exagérétellement au-dessus de tout ce qu'un pauvre homme tel que moi pouvait s'imaginertellement supérieur surtout aux faibles services que j'ai eu l'honneur de rendreque je crois en conscience ne pas pouvoir garder sa terre de la Ricciarda. J'ai l'honneur de rendre cette terre à madameet de la prier de m'accorder une pension de quatre cents francs.
-- Combien de fois en votre vielui dit-elle avec la hauteur la plus sombrecombien de fois avez-vous ouï dire que j'avais déserté un projet une fois énoncé par moi?
Après cette phrasela duchesse se promena encore durant quelques minutes; puiss'arrêtant tout à coupelle s'écria:
-- C'est par hasard et parce qu'il a su plaire à cette petite filleque la vie de Fabrice a été sauvée! S'il n'avait été aimableil mourait. Est-ce que vous pourrez me nier cela? dit-elle en marchant sur Ludovic avec des yeux où éclatait la plus sombre fureur. Ludovic recula de quelques pas et la crut follece qui lui donna de vives inquiétudes pour la propriété de sa terre de la Ricciarda.
-- Eh bien! reprit la duchesse du ton le plus doux et le plus gaiet changée du tout au toutje veux que mes bons habitants de Sacca aient une journée folle et de laquelle ils se souviennent longtemps. Vous allez retourner à Saccaavez-vous quelque objection? Pensez-vous courir quelque danger?
-- Peu de chosemadame: aucun des habitants de Sacca ne dira jamais que j'étais de la suite de monsignore Fabrice. D'ailleurssi j'ose le dire à madameje brûle de voir ma terre de la Ricciarda: il me semble si drôle d'être propriétaire!
-- Ta gaieté me plaît. Le fermier de la Ricciarda me doitje pensetrois ou quatre ans de son fermage: je lui fais cadeau de la moitié de ce qu'il me doitet l'autre moitié de tous ces arréragesje te la donnemais à cette condition: tu vas aller à Saccatu diras qu'après-demain est le jour de la fête d'une de mes patronnesetle soir qui suivra ton arrivéetu feras illuminer mon château de la façon la plus splendide. N'épargne ni argent ni peine: songe qu'il s'agit du plus grand bonheur de ma vie. De longue main j'ai préparé cette illumination; depuis plus de trois ans j'ai réuni dans les caves du château tout ce qui peut servir à cette noble fête; j'ai donné en dépôt au jardinier toutes les pièces d'artifice nécessaires pour un feu magnifique: tu le feras tirer sur la terrasse qui regarde le Pô. J'ai quatre-vingt-neuf grands tonneaux de vin dans mes cavestu feras établir quatre-vingt-neuf fontaines de vin dans mon parc. Si le lendemain il reste une bouteille de vin qui ne soit pas bueje dirai que tu n'aimes pas Fabrice. Quand les fontaines de vinl'illumination et le feu d'artifice seront bien en traintu t'esquiveras prudemmentcar il est possibleet c'est mon espoirqu'à Parme toutes ces belles choses-là paraissent une insolence.
-- C'est ce qui n'est pas possibleseulement c'est sûr; comme il est certain aussi que le fiscal Rassiqui a signé la sentence de monsignoreen crèvera de rage. Et même... ajouta Ludovic avec timiditési madame voulait faire plus de plaisir à son pauvre serviteur que de lui donner la moitié des arrérages de la Ricciardaelle me permettrait de faire une petite plaisanterie à ce Rassi...
-- Tu es un brave homme! s'écria la duchesse avec transportmais je te défends absolument de rien faire à Rassi; j'ai le projet de le faire pendre en publicplus tard. Quant à toitâche de ne pas te faire arrêter à Saccatout serait gâté si je te perdais.
-- Moimadame! Quand j'aurai dit que je fête une des patronnes de madamesi la police envoyait trente gendarmes pour déranger quelque chosesoyez sûre qu'avant d'être arrivés à la croix rouge qui est au milieu du villagepas un d'eux ne serait à cheval. Ils ne se mouchent pas du coudenon les habitants de Sacca; tous contrebandiers finis et qui adorent madame.
-- Enfinreprit la duchesse d'un air singulièrement dégagési je donne du vin à mes braves gens de Saccaje veux inonder les habitants de Parmele même soir où mon château sera illuminéprends le meilleur cheval de mon écuriecours à mon palaisà Parmeet ouvre le réservoir.
-- Ah! l'excellente idée qu'a madame! s'écria Ludovicriant comme un foudu vin aux braves gens de Saccade l'eau aux bourgeois de Parme qui étaient si sûrsles misérablesque monsignore Fabrice allait être empoisonné comme le pauvre L...
La joie de Ludovic n'en finissait point; la duchesse regardait avec complaisance ses rires fous; il répétait sans cesse: Du vin aux gens de Sacca et de l'eau à ceux de Parme! Madame sait sans doute mieux que moi que lorsqu'on vida imprudemment le réservoiril y a une vingtaine d'annéesil y eut jusqu'à un pied d'eau dans plusieurs des rues de Parme.
-- Et de l'eau aux gens de Parmerépliqua la duchesse en riant. La promenade devant la citadelle eût été remplie de monde si l'on eût coupé le cou à Fabrice... Tout le monde l'appelle le grand coupable... Maissurtoutfais cela avec adresseque jamais personne vivante ne sache que cette inondation a été faite par toini ordonnée par moi. Fabricele comte lui-mêmedoivent ignorer cette folle plaisanterie... Mais j'oubliais les pauvres de Sacca; va-t'en écrire une lettre à mon homme d'affairesque je signerai; tu lui diras que pour la fête de ma sainte patronne il distribue cent sequins aux pauvres de Sacca et qu'il t'obéisse en tout pour l'illuminationle feu d'artifice et le vin; que le lendemain surtout il ne reste pas une bouteille pleine dans mes caves.
-- L'homme d'affaires de madame ne se trouvera embarrassé qu'en un point: depuis cinq ans que madame a le châteauelle n'a pas laissé dix pauvres dans Sacca.
-- Et de l'eau pour les gens de Parme! reprit la duchesse en chantant. Comment exécuteras-tu cette plaisanterie?
-- Mon plan est tout fait: je pars de Sacca sur les neuf heuresà dix et demie mon cheval est à l'auberge des Trois Ganachessur la route de Casal-Maggiore et de ma terre de la Ricciarda; à onze heures je suis dans ma chambre au palaiset à onze heures et un quart de l'eau pour les gens de Parmeet plus qu'ils n'en voudrontpour boire à la santé du grand coupable. Dix minutes plus tard je sors de la ville par la route de Bologne. Je faisen passantun profond salut à la citadelleque le courage de monsignore et l'esprit de madame viennent de déshonorer; je prends un sentier dans la campagnede moi bien connuet je fais mon entrée à la Ricciarda.
Ludovic leva les yeux sur la duchesse et fut effrayé: elle regardait fixement la muraille nue à six pas d'elle etil faut en convenirson regard était atroce. Ah! ma pauvre terre! pensa Ludovic; le fait est qu'elle est folle! La duchesse le regarda et devina sa pensée.
-- Ah! monsieur Ludovic le grand poètevous voulez une donation par écrit: courez me chercher une feuille de papier. Ludovic ne se fit pas répéter cet ordreet la duchesse écrivit de sa main une longue reconnaissance antidatée d'un anet par laquelle elle déclarait avoir reçude Ludovic San-Micheli la somme de 80 000 francset lui avoir donné en gage la terre de la Ricciarda. Si après douze mois révolus la duchesse n'avait pas rendu lesdits 80 000 francs à Ludovicla terre de la Ricciarda resterait sa propriété.
Il est beause disait la duchessede donner à un serviteur fidèle le tiers à peu près de ce qui me reste pour moi-même.
-- Ah ça! dit la duchesse à Ludovicaprès la plaisanterie du réservoirje ne te donne que deux jours pour te réjouir à Casal-Maggiore. Pour que la vente soit valabledis que c'est une affaire qui remonte à plus d'un an. Reviens me rejoindre à Belgirateet cela sans le moindre délai; Fabrice ira peut-être en Angleterre où tu le suivras.
Le lendemain de bonne heure la duchesse et Fabrice étaient à Belgirate.
On s'établit dans ce village enchanteur; mais un chagrin mortel attendait la duchesse sur ce beau lac. Fabrice était entièrement changé; dès les premiers moments où il s'était réveillé de son sommeilen quelque sorte léthargiqueaprès sa fuitela duchesse s'était aperçue qu'il se passait en lui quelque chose d'extraordinaire. Le sentiment profond par lui caché avec beaucoup de soin était assez bizarrece n'était rien moins que ceci: il était au désespoir d'être hors de prison. Il se gardait bien d'avouer cette cause de sa tristesseelle eût amené des questions auxquelles il ne voulait pas répondre.
-- Mais quoi! lui disait la duchesse étonnéecette horrible sensation lorsque la faim te forçait à te nourrirpour ne pas tomberd'un de ces mets détestables fournis par la cuisine de la prisoncette sensationy a-t-il ici quelque goût singulierest-ce que je m'empoisonne en cet instantcette sensation ne te fait pas horreur?
-- Je pensais à la mortrépondait Fabricecomme je suppose qu'y pensent les soldats: c'était une chose possible que je pensais bien éviter par mon adresse.
Ainsi quelle inquiétudequelle douleur pour la duchesse! Cet être adorésingulierviforiginalétait désormais sous ses yeux en proie à une rêverie profonde; il préférait la solitude même au plaisir de parler de toutes choseset à coeur ouvertà la meilleure amie qu'il eût au monde. Toujours il était bonempresséreconnaissant auprès de la duchesseil eût comme jadis donné cent fois sa vie pour elle; mais son âme était ailleurs. On faisait souvent quatre ou cinq lieues sur ce lac sublime sans se dire une parole. La conversationl'échange de pensées froides désormais possible entre euxeût peut-être semblé agréable à d'autres: mais eux se souvenaient encorela duchesse surtoutde ce qu'était leur conversation avant ce fatal combat avec Giletti qui les avait séparés. Fabrice devait à la duchesse l'histoire des neuf mois passés dans une horrible prisonet il se trouvait que sur ce séjour il n'avait à dire que des paroles brèves et incomplètes.
Voilà ce qui devait arriver tôt ou tardse disait la duchesse avec une tristesse sombre. Le chagrin m'a vieillieou bien il aime réellementet je n'ai plus que la seconde place dans son coeur. Avilieatterrée par ce plus grand des chagrins possiblesla duchesse se disait quelquefois: Si le ciel voulait que Ferrante fût devenu tout à fait fou ou manquât de courageil me semble que je serais moins malheureuse. Dès ce moment ce demi-remords empoisonna l'estime que la duchesse avait pour son propre caractère. Ainsise disait-elle avec amertumeje me repens d'une résolution prise: Je ne suis donc plus une del Dongo!
Le ciel l'a voulureprenait-elle: Fabrice est amoureuxet de quel droit voudrais-je qu'il ne fût pas amoureux? Une seule parole d'amour véritable a-t-elle jamais été échangée entre nous?
Cette idée si raisonnable lui ôta le sommeilet enfin ce qui montrait que la vieillesse et l'affaiblissement de l'âme étaient arrivées pour elle avec la perspective d'une illustre vengeanceelle était cent fois plus malheureuse à Belgirate qu'à Parme. Quant à la personne qui pouvait causer l'étrange rêverie de Fabriceil n'était guère possible d'avoir des doutes raisonnables: Clélia Conticette fille si pieuseavait trahi son père puisqu'elle avait consenti à enivrer la garnisonet jamais Fabrice ne parlait de Clélia! Maisajoutait la duchesse se frappant la poitrine avec désespoirsi la garnison n'eût pas été enivréetoutes mes inventionstous mes soins devenaient inutiles; ainsi c'est elle qui l'a sauvé!
C'était avec une extrême difficulté que la duchesse obtenait de Fabrice des détails sur les événements de cette nuitquise disait la duchesseautrefois eût formé entre nous le sujet d'un entretien sans cesse renaissant! Dans ces temps fortunésil eût parlé tout un jour et avec une verve et une gaieté sans cesse renaissantes sur la moindre bagatelle que je m'avisais de mettre en avant.
Comme il fallait tout prévoirla duchesse avait établi Fabrice au port de Locarnoville suisse à l'extrémité du lac Majeur. Tous les jours elle allait le prendre en bateau pour de longues promenades sur le lac. Eh bien! une fois qu'elle s'avisa de monter chez luielle trouva sa chambre tapissée d'une quantité de vues de la ville de Parme qu'il avait fait venir de Milan ou de Parme mêmepays qu'il aurait dû tenir en abomination. Son petit salonchangé en atelierétait encombré de tout l'appareil d'un peintre à l'aquarelleet elle le trouva finissant une troisième vue de la tour Farnèse et du palais du gouverneur.
-- Il ne te manque pluslui dit-elle d'un air piquéque de faire de souvenir le portrait de cet aimable gouverneur qui voulait seulement t'empoisonner. Mais j'y songecontinua la duchessetu devrais lui écrire une lettre d'excuses d'avoir pris la liberté de te sauver et de donner un ridicule à sa citadelle.
La pauvre femme ne croyait pas dire si vrai: à peine arrivé en lieu de sûretéle premier soin de Fabrice avait été d'écrire au général Fabio Conti une lettre parfaitement polie et dans un certain sens bien ridicule; il lui demandait pardon de s'être sauvéalléguant pour excuse qu'il avait pu croire que certain subalterne de la prison avait été chargé de lui administrer du poison. Peu lui importait ce qu'il écrivaitFabrice espérait que les yeux de Clélia verraient cette lettreet sa figure était couverte de larmes en l'écrivant. Il la termina par une phrase bien plaisante: il osait dire quese trouvant en libertésouvent il lui arrivait de regretter sa petite chambre de la tour Farnèse. C'était là la pensée capitale de sa lettreil espérait que Clélia la comprendrait. Dans son humeur écrivanteet dans l'espoir d'être lu par quelqu'unFabrice adressa des remerciements à don Cesarece bon aumônier qui lui avait prêté des livres de théologie. Quelques jours plus tardFabrice engagea le petit libraire de Locarno à faire le voyage de Milanoù ce libraireami du célèbre bibliomane Reinaacheta les plus magnifiques éditions qu'il pût trouver des ouvrages prêtés par don Cesare. Le bon aumônier reçut ces livres et une belle lettre qui lui disait quedans des moments d'impatiencepeut- être pardonnables à un pauvre prisonnieron avait chargé les marges de ces livres de notes ridicules. On le suppliait en conséquence de les remplacer dans sa bibliothèque par les volumes que la plus vive reconnaissance se permettait de lui présenter.
Fabrice était bien bon de donner le simple nom de notes aux griffonnages infinis dont il avait chargé les marges d'un exemplaire in-folio des oeuvres de saint Jérôme. Dans l'espoir qu'il pourrait renvoyer ce livre au bon aumônieret l'échanger contre un autreil avait écrit jour par jour sur les marges un journal fort exact de tout ce qui lui arrivait en prison; les grands événements n'étaient autre chose que des extases d'amour divin (ce mot divin en remplaçait un autre qu'on n'osait écrire). Tantôt cet amour divin conduisait le prisonnier à un profond désespoird'autres fois une voix entendue à travers les airs rendait quelque espérance et causait des transports de bonheur. Tout celaheureusementétait écrit avec une encre de prisonformée de vinde chocolat et de suieet don Cesare n'avait fait qu'y jeter un coup d'oeil en replaçant dans sa bibliothèque le volume de saint Jérôme. S'il en avait suivi les margesil aurait vu qu'un jour le prisonnierse croyant empoisonnése félicitait de mourir à moins de quarante pas de distance de ce qu'il avait aimé le mieux dans ce monde. Mais un autre oeil que celui du bon aumônier avait lu cette page depuis la fuite. Cette belle idée: Mourir près de ce qu'on aime! exprimée de cent façons différentesétait suivie d'un sonnet où l'on voyait que l'âme séparéeaprès des tourments atrocesde ce corps fragile qu'elle avait habité pendant vingt-trois anspoussée par cet instinct de bonheur naturel à tout ce qui exista une foisne remonterait pas au ciel se mêler aux choeurs des anges aussitôt qu'elle serait libre et dans le cas où le jugement terrible lui accorderait le pardon de ses péchés mais queplus heureuse après la mort qu'elle n'avait été durant la vieelle irait à quelques pas de la prisonoù si longtemps elle avait gémise réunir à tout ce qu'elle avait aimé au monde. Et ainsidisait le dernier vers du sonnetj'aurai trouvé mon paradis sur la terre.
Quoiqu'on ne parlât de Fabrice à la citadelle de Parme que comme d'un traître infâme qui avait violé les devoirs les plus sacréstoutefois le bon prêtre don Cesare fut ravi par la vue des beaux livres qu'un inconnu lui faisait parvenir; car Fabrice avait eu l'attention de n'écrire que quelques jours après l'envoide peur que son nom ne fît renvoyer tout le paquet avec indignation. Don Cesare ne parla point de cette attention à son frèrequi entrait en fureur au seul nom de Fabrice; mais depuis la fuite de ce dernieril avait repris toute son ancienne intimité avec son aimable nièce; et comme il lui avait enseigné jadis quelques mots de latinil lui fit voir les beaux ouvrages qu'il recevait. Tel avait été l'espoir du voyageur. Tout à coup Clélia rougit extrêmementelle venait de reconnaître l'écriture de Fabrice. De grands morceaux fort étroits de papier jaune étaient placés en guise de signets en divers endroits du volume. Et comme il est vrai de dire qu'au milieu des plats intérêts d'argentet de la froideur décolorée des pensées vulgaires qui remplissent notre vieles démarches inspirées par une vraie passion manquent rarement de produire leur effet; comme si une divinité propice prenait le soin de les conduire par la mainCléliaguidée par cet instinct et par la pensée d'une seule chose au mondedemanda à son oncle de comparer l'ancien exemplaire de saint Jérôme avec celui qu'il venait de recevoir. Comment dire son ravissement au milieu de la sombre tristesse où l'absence de Fabrice l'avait plongéelorsqu'elle trouva sur les marges de l'ancien saint Jérôme le sonnet dont nous avons parléet les mémoiresjour par jourde l'amour qu'on avait senti pour elle!
Dès le premier jour elle sut le sonnet par coeur; elle le chantaitappuyée sur sa fenêtredevant la fenêtre désormais solitaireoù elle avait vu si souvent une petite ouverture se démasquer dans l'abat-jour. Cet abat-jour avait été démonté pour être placé sur le bureau du tribunal et servir de pièce de conviction dans un procès ridicule que Rassi instruisait contre Fabriceaccusé du crime de s'être sauvéou comme disait le fiscal en riant lui-mêmede s'être dérobé à la clémence d'un prince magnanime!
Chacune des démarches de Clélia était pour elle l'objet d'un vif remordset depuis qu'elle était malheureuse les remords étaient plus vifs. Elle cherchait à apaiser un peu les reproches qu'elle s'adressaiten se rappelant le voeu de ne jamais revoir Fabricefait par elle à la Madone lors du demi-empoisonnement du généralet depuis chaque jour renouvelé. Son père avait été malade de l'évasion de Fabriceetde plusil avait été sur le point de perdre sa placelorsque le princedans sa colèredestitua tous les geôliers de la tour Farnèseet les fit passer comme prisonniers dans la prison de la ville. Le général avait été sauvé en partie par l'intercession du comte Moscaqui aimait mieux le voir enfermé au sommet de sa citadelleque rival actif et intrigant dans les cercles de la cour.
Ce fut pendant les quinze jours que dura l'incertitude relativement à la disgrâce du général Fabio Contiréellement maladeque Clélia eut le courage d'exécuter le sacrifice qu'elle avait annoncé à Fabrice. Elle avait eu l'esprit d'être malade le jour des réjouissances généralesqui fut aussi celui de la fuite du prisonnier comme le lecteur s'en souvient peut-être; elle fut malade aussi le lendemaineten un motsut si bien se conduirequ'à l'exception de geôlier Grillochargé spécialement de la garde de Fabricepersonne n'eut de soupçons sur sa complicitéet Grillo se tut.
Mais aussitôt que Clélia n'eut plus d'inquiétudes de ce côtéelle fut plus cruellement agitée encore par ses justes remords. Quelle raison au mondese disait-ellepeut diminuer le crime d'une fille qui trahit son père?
Un soiraprès une journée passée presque tout entière à la chapelle et dans les larmeselle pria son oncledon Cesarede l'accompagner chez le généraldont les accès de fureur l'effrayaient d'autant plusqu'à tout propos il y mêlait des imprécations contre Fabricecet abominable traître.
Arrivée en présence de son pèreelle eut le courage de lui dire que si toujours elle avait refusé de donner la main au marquis Crescenzic'est qu'elle ne sentait aucune inclination pour luiet qu'elle était assurée de ne point trouver le bonheur dans cette union. A ces motsle général entra en fureur; et Clélia eut assez de peine à reprendre la parole. Elle ajouta que si son pèreséduit par la grande fortune du marquiscroyait devoir lui donner l'ordre précis de l'épouserelle était prête à obéir. Le général fut tout étonné de cette conclusionà laquelle il était loin de s'attendre; il finit pourtant par s'en réjouir. Ainsidit-il à son frèreje ne serai pas réduit à loger dans un second étagesi ce polisson de Fabrice me fait perdre ma place par son mauvais procédé.
Le comte Mosca ne manquait pas de se montrer profondément scandalisé de l'évasion de ce mauvais sujet de Fabriceet répétait dans l'occasion la phrase inventée par Rassi sur le plat procédé de ce jeune hommefort vulgaire d'ailleursqui s'était soustrait à la clémence du prince. Cette phrase spirituelleconsacrée par la bonne compagniene prit point dans le peuple. Laissé à son bon senset tout en croyant Fabrice fort coupableil admirait la résolution qu'il avait fallu pour se lancer d'un mur si haut. Pas un être de la cour n'admira ce courage. Quant à la policefort humiliée de cet échecelle avait découvert officiellement qu'une troupe de vingt soldats gagnés par les distributions d'argent de la duchessecette femme si atrocement ingrateet dont on ne prononçait plus le nom qu'avec un soupiravaient tendu à Fabrice quatre échelles liées ensembleet de quarante-cinq pieds de longueur chacune: Fabrice ayant tendu une corde qu'on avait liée aux échelles n'avait eu que le mérite fort vulgaire d'attirer ces échelles à lui. Quelques libéraux connus par leur imprudenceet entre autre le médecin C ***agent payé directement par le princeajoutaientmais en se compromettantque cette police atroce avait eu la barbarie de faire fusiller huit des malheureux soldats qui avaient facilité la fuite de cet ingrat Fabrice. Alors il fut blâmé même des libéraux véritablescomme ayant causé par son imprudence la mort de huit pauvres soldats. C'est ainsi que les petits despotismes réduisent à rien la valeur de l'opinion [Tr. J. F. M. 31.].
Livre Second
Chapitre XXIII.
Au milieu de ce déchaînement généralle seul archevêque Landriani se montra fidèle à la cause de son jeune ami; il osait répétermême à la cour de la princessela maxime de droit suivant laquelledans tout procèsil faut réserver une oreille pure de tout préjugé pour entendre les justifications d'un absent.
Dès le lendemain de l'évasion de Fabriceplusieurs personnes avaient reçu un sonnet assez médiocre qui célébrait cette fuite comme une des belles actions du siècleet comparait Fabrice à un ange arrivant sur la terre les ailes étendues. Le surlendemain soirtout Parme répétait un sonnet sublime. C'était le monologue de Fabrice se laissant glisser le long de la cordeet jugeant les divers incidents de sa vie. Ce sonnet lui donna rang dans l'opinion par deux vers magnifiquestous les connaisseurs reconnurent le style de Ferrante Palla.
Mais ici il me faudrait chercher le style épique: où trouver des couleurs pour peindre les torrents d'indignation qui tout à coup submergèrent tous les coeurs bien pensantslorsqu'on apprit l'effroyable insolence de cette illumination du château de Sacca? Il n'y eut qu'un cri contre la duchesse; même les libéraux véritables trouvèrent que c'était compromettre d'une façon barbare les pauvres suspects retenus dans les diverses prisonset exaspérer inutilement le coeur du souverain. Le comte Mosca déclara qu'il ne restait plus qu'une ressource aux anciens amis de la duchessec'était de l'oublier. Le concert d'exécration fut donc unanime: un étranger passant par la ville eût été frappé de l'énergie de l'opinion publique. Mais en ce pays où l'on sait apprécier le plaisir de la vengeancel'illumination de Sacca et la fête admirable donnée dans le parc à plus de six mille paysans eurent un immense succès. Tout le monde répétait à Parme que la duchesse avait fait distribuer mille sequins à ses paysans; on expliquait ainsi l'accueil un peu dur fait à une trentaine de gendarmes que la police avait eu la nigauderie d'envoyer dans ce petit villagetrente-six heures après la soirée sublime et l'ivresse générale qui l'avait suivie. Les gendarmesaccueillis à coups de pierresavaient pris la fuiteet deux d'entre euxtombés de chevalavaient été jetés dans le Pô.
Quant à la rupture du grand réservoir d'eau du palais Sanseverinaelle avait passé à peu près inaperçue: c'était pendant la nuit que quelques rues avaient été plus ou moins inondéesle lendemain on eût dit qu'il avait plu. Ludovic avait eu soin de briser les vitres d'une fenêtre du palaisde façon que l'entrée des voleurs était expliquée.
On avait même trouvé une petite échelle. Le seul comte Mosca reconnut le génie de son amie.
Fabrice était parfaitement décidé à revenir à Parme aussitôt qu'il le pourrait; il envoya Ludovic porter une longue lettre à l'archevêqueet ce fidèle serviteur revint mettre à la poste au premier village du Piémontà Sannazaroau couchant de Pavieune épître latine que le digne prélat adressait à son jeune protégé. Nous ajouterons un détail quicomme plusieurs autres sans doutefera longueur dans les pays où l'on n'a plus besoin de précautions. Le nom de Fabrice del Dongo n'était jamais écrit; toutes les lettres qui lui étaient destinées étaient adressées à Ludovic San Michelià Locarno en Suisseou à Belgirate en Piémont. L'enveloppe était faite d'un papier grossierle cachet mal appliquél'adresse à peine lisibleet quelquefois ornée de recommandations dignes d'une cuisinière; toutes les lettres étaient datées de Naples six jours avant la date véritable.
Du village piémontais de Sannazaroprès de PavieLudovic retourna en toute hâte à Parme: il était chargé d'une mission à laquelle Fabrice mettait la plus grande importance; il ne s'agissait de rien moins que de faire parvenir à Clélia Conti un mouchoir de soie sur lequel était imprimé un sonnet de Pétrarque. Il est vrai qu'un mot était changé à ce sonnet; Clélia le trouva sur sa table deux jours après avoir reçu les remerciements du marquis Crescenzi qui se disait le plus heureux des hommeset il n'est pas besoin de dire quelle impression cette marque d'un souvenir toujours constant produisit sur son coeur.
Ludovic devait chercher à se procurer tous les détails possibles sur ce qui se passait à la citadelle. Ce fut lui qui apprit à Fabrice la triste nouvelle que le mariage du marquis Crescenzi semblait désormais une chose décidée; il ne se passait presque pas de journée sans qu'il donnât une fête à Cléliadans l'intérieur de la citadelle. Une preuve décisive du mariage c'est que ce marquisimmensément riche et par conséquent fort avarecomme c'est l'usage parmi les gens opulents du nord de l'Italiefaisait des préparatifs immenseset pourtant il épousait une fille sans dot. Il est vrai que la vanité du général Fabio Contifort choquée de cette remarquela première qui se fût présentée à l'esprit de tous ses compatriotesvenait d'acheter une terre de plus de 300 000 francset cette terrelui qui n'avait rienil l'avait payée comptantapparemment des deniers du marquis. Aussi le général avait-il déclaré qu'il donnait cette terre en mariage à sa fille. Mais les frais d'acte et autresmontant à plus de 12 000 francssemblèrent une dépense fort ridicule au marquis Crescenziêtre éminemment logique. De son côté il faisait fabriquer à Lyon des tentures magnifiques de couleursfort bien agencées et calculées par l'agrément de l'oeilpar le célèbre Pallagipeintre de Bologne. Ces tenturesdont chacune contenait une partie prise dans les armes de la famille Crescenziquicomme l'univers le saitdescend du fameux Crescentiusconsul de Rome en 985devaient meubler les dix-sept salons qui formaient le rez-de-chaussée du palais du marquis. Les tenturesles pendules et les lustres rendus à Parme coûtèrent plus de 350 000 francs; le prix des glaces nouvellesajoutées à celles que la maison possédait déjàs'éleva à 200 000 francs. A l'exception de deux salonsouvrages célèbres du Parmesanle grand peintre du pays après le divin Corrègetoutes les pièces du premier et du second étage étaient maintenant occupées par les peintres célèbres de Florencede Rome et de Milanqui les ornaient de peintures à fresque. Fokelbergle grand sculpteur suédois; Tenerani de Romeet Marchesi de Milantravaillaient depuis un an à dix bas reliefs représentant autant de belles actions de Crescentiusce véritable grand homme. La plupart des plafondspeints à fresqueoffraient aussi quelque allusion à sa vie. On admirait généralement le plafond où Hayezde Milanavait représenté Crescentius reçu dans les Champs-Elysées par François Sforce; Laurent le Magnifiquele roi Robertle tribun Cola di RienziMachiavelle Dante et les autres grands hommes du moyen âge. L'admiration pour ces âmes d'élite est supposée faire épigramme contre les gens au pouvoir.
Tous ces détails magnifiques occupaient exclusivement l'attention de la noblesse et des bourgeois de Parmeet percèrent le coeur de notre héros lorsqu'il les lut racontésavec une admiration naïvedans une longue lettre de plus de vingt pages que Ludovic avait dictée à un douanier de Casal-Maggiore.
Et moi je suis si pauvre! se disait Fabricequatre mille livres de rente en tout et pour tout! c'est vraiment une insolence à moi d'oser être amoureux de Clélia Contipour qui se font tous ces miracles.
Un seul article de la longue lettre de Ludovicmais celui-là écrit de sa mauvaise écritureannonçait à son maître qu'il avait rencontré le soiret dans l'état d'un homme qui se cachele pauvre Grillo son ancien geôlierqui avait été mis en prisonpuis relâché. Cet homme lui avait demandé un sequin par charitéet Ludovic lui en avait donné quatre au nom de la duchesse. Les anciens geôliers récemment mis en libertéau nombre de douzese préparaient à donner une fête à coups de couteau (un trattamento di cortellate ) aux nouveaux geôliers leurs successeurssi jamais ils parvenaient à les rencontrer hors de la citadelle. Grillo avait dit que presque tous les jours il y avait sérénade à la forteresseque mademoiselle Clélia Conti était fort pâlesouvent maladeet autres choses semblables. Ce mot ridicule fit que Ludovic reçutcourrier par courrierl'ordre de revenir à Locarno. Il revintet les détails qu'il donna de vive voix furent encore plus tristes pour Fabrice.
On peut juger de l'amabilité dont celui-ci était pour la pauvre duchesse; il eût souffert mille morts plutôt que de prononcer devant elle le nom de Clélia Conti. La duchesse abhorrait Parme; etpour Fabricetout ce qui rappelait cette ville était à la fois sublime et attendrissant.
La duchesse avait moins que jamais oublié sa vengeance; elle était si heureuse avant l'incident de la mort de Giletti! et maintenantquel était son sort! elle vivait dans l'attente d'un événement affreux dont elle se serait bien gardée de dire un mot à Fabriceelle qui autrefoislors de son arrangement avec Ferrantecroyait tant réjouir Fabrice en lui apprenant qu'un jour il serait vengé.
On peut se faire quelque idée maintenant de l'agrément des entretiens de Fabrice avec la duchesse: un silence morne régnait presque toujours entre eux. Pour augmenter les agréments de leurs relationsla duchesse avait cédé à la tentation de jouer un mauvais tour à ce neveu trop chéri. Le comte lui écrivait presque tous les jours; apparemment il envoyait des courriers comme du temps de leurs amourscar ses lettres portaient toujours le timbre de quelque petite ville de la Suisse. Le pauvre homme se torturait l'esprit pour ne pas parler trop ouvertement de sa tendresseet pour construire des lettres amusantesà peine si on les parcourait d'un oeil distrait. Que faithélas! la fidélité d'un amant estiméquand on a le coeur percé par la froideur de celui qu'on lui préfère?
En deux mois de temps la duchesse ne lui répondit qu'une fois et ce fut pour l'engager à sonder le terrain auprès de la princesseet à voir simalgré l'insolence du feu d'artificeon recevrait avec plaisir une lettre d'elle duchesse. La lettre qu'il devait présenters'il le jugeait à proposdemandait la place de chevalier d'honneur de la princessedevenue vacante depuis peupour le marquis Crescenziet désirait qu'elle lui fût accordée en considération de son mariage. La lettre de la duchesse était un chef-d'oeuvre: c'était le respect le plus tendre et le mieux exprimé; on n'avait pas admis dans ce style courtisanesque le moindre mot dont les conséquencesmême les plus éloignéespussent n'être pas agréables à la princesse. Aussi la réponse respirait-elle une amitié tendre et que l'absence met à la torture.
«Mon fils et moilui disait la princessen'avons pas eu une soirée un peu passable depuis votre départ si brusque. Ma chère duchesse ne se souvient donc plus que c'est elle qui m'a fait rendre une voix consultative dans la nomination des officiers de ma maison? »
«Elle se croit donc obligée de me donner des motifs pour la place du marquiscomme si son désir exprimé n'était pas pour moi le premier des motifs? Le marquis aura la placesi je puis quelque chose; et il y en aura toujours une dans mon coeuret la premièrepour mon aimable duchesse. Mon fils se sert absolument des mêmes expressionsun peu fortes pourtant dans la bouche d'un grand garçon de vingt et un anset vous demande des échantillons de minéraux de la vallée d'Ortavoisine de Belgirate. Vous pouvez adresser vos lettresque j'espère fréquentesau comtequi vous déteste toujours et que j'aime surtout à cause de ces sentiments. L'archevêque aussi vous est resté fidèle. Nous espérons tous vous revoir un jour: rappelez-vous qu'il le faut. La marquise Ghislerima grande maîtressese dispose à quitter ce monde pour un meilleur: la pauvre femme m'a fait bien du mal; elle me déplaît encore en s'en allant mal à propos; sa maladie me fait penser au nom que j'eusse mis autrefois avec tant de plaisir à la place du siensi toutefois j'eusse pu obtenir ce sacrifice de l'indépendance de cette femme unique quien nous fuyanta emporté avec elle toute la joie de ma petite couretc.etc. »
C'était donc avec la conscience d'avoir cherché à hâterautant qu'il était en ellele mariage qui mettait Fabrice au désespoirque la duchesse le voyait tous les jours. Aussi passaient-ils quelquefois quatre ou cinq heures à voguer ensemble sur le lacsans se dire un seul mot. La bienveillance était entière et parfaite du côté de Fabrice; mais il pensait à d'autres choseset son âme naïve et simple ne lui fournissait rien à dire. La duchesse le voyaitet c'était son supplice.
Nous avons oublié de raconter en son lieu que la duchesse avait pris une maison à Belgiratevillage charmantet qui tient tout ce que son nom promet (voir un beau tournant du lac). De la porte-fenêtre de son salonla duchesse pouvait mettre le pied dans sa barque. Elle en avait pris une fort ordinaireet pour laquelle quatre rameurs eussent suffi; elle en engagea douzeet s'arrangea de façon à avoir un homme de chacun des villages situés aux environs de Belgirate. La troisième ou quatrième fois qu'elle se trouva au milieu du lac avec tous ces hommes bien choisiselle fit arrêter le mouvement des rames.
-- Je vous considère tous comme des amisleur dit-elleet je veux vous confier un secret. Mon neveu Fabrice s'est sauvé de prison; et peut-êtrepar trahisonon cherchera à le reprendrequoiqu'il soit sur votre lacpays de franchise. Ayez l'oreille au guetet prévenez-moi de tout ce que vous apprendrez. Je vous autorise à entrer dans ma chambre le jour et la nuit.
Les rameurs répondirent avec enthousiasme; elle savait se faire aimer. Mais elle ne pensait pas qu'il fût question de reprendre Fabrice: c'était pour elle qu'étaient tous ces soins etavant l'ordre fatal d'ouvrir le réservoir du palais Sanseverinaelle n'y eût pas songé.
Sa prudence l'avait aussi engagée à prendre un appartement au port de Locarno pour Fabrice; tous les jours il venait la voirou elle-même allait en Suisse. On peut juger de l'agrément de leurs perpétuels tête-à-tête par ce détail: La marquise et ses filles vinrent les voir deux foiset la présence de ces étrangères leur fit plaisir; carmalgré les liens du sangon peut appeler étrangère une personne qui ne sait rien de nos intérêts les plus cherset que l'on ne voit qu'une fois par an.
La duchesse se trouvait un soir à Locarnochez Fabriceavec la marquise et ses deux filles. L'archiprêtre du pays et le curé étaient venus présenter leurs respects à ces dames: l'archiprêtrequi était intéressé dans une maison de commerceet se tenait fort au courant des nouvelless'avisa de dire:
-- Le prince de Parme est mort!
La duchesse pâlit extrêmement; elle eut à peine le courage de dire:
-- Donne-t-on des détails?
-- Nonrépondit l'archiprêtre; la nouvelle se borne à dire la mortqui est certaine.
La duchesse regarda Fabrice. J'ai fait cela pour luise dit-elle; j'aurais fait mille fois piset le voilà qui est là devant moi indifférent et songeant à une autre! Il était au-dessus des forces de la duchesse de supporter cette affreuse pensée; elle tomba dans un profond évanouissement. Tout le monde s'empressa pour la secourir; maisen revenant à elleelle remarqua que Fabrice se donnait moins de mouvement que l'archiprêtre et le curé; il rêvait comme à l'ordinaire.
-- Il pense à retourner à Parmese dit la duchesseet peut-être à rompre le mariage de Clélia avec le marquis; mais je saurai l'empêcher. Puisse souvenant de la présence des deux prêtreselle se hâta d'ajouter:
-- C'était un grand princeet qui a été bien calomnié! C'est une perte immense pour nous!
Les deux prêtres prirent congéet la duchessepour être seuleannonça qu'elle allait se mettre au lit.
-- Sans doutese disait-ellela prudence m'ordonne d'attendre un mois ou deux avant de retourner à Parme; mais je sens que je n'aurai jamais cette patience; je souffre trop ici. Cette rêverie continuellece silence de Fabricesont pour mon coeur un spectacle intolérable. Qui me l'eût dit que je m'ennuierais en me promenant sur ce lac charmanten tête à tête avec luiet au moment où j'ai fait pour le venger plus que je ne puis lui dire! Après un tel spectaclela mort n'est rien. C'est maintenant que je paie les transports de bonheur et de joie enfantine que je trouvais dans mon palais à Parme lorsque j'y reçus Fabrice revenant de Naples. Si j'eusse dit un mottout était finiet peut-être quelié avec moiil n'eût pas songé à cette petite Clélia; mais ce mot me faisait une répugnance horrible. Maintenant elle l'emporte sur moi. Quoi de plus simple? elle a vingt ans; et moichangée par les soucismaladej'ai le double de son âge!... Il faut mouriril faut finir! Une femme de quarante ans n'est plus quelque chose que pour les hommes qui l'ont aimée dans sa jeunesse! Maintenant je ne trouverai plus que des jouissances de vanité; et cela vaut-il la peine de vivre? Raison de plus pour aller à Parmeet pour m'amuser. Si les choses tournaient d'une certaine façonon m'ôterait la vie. Eh bien! où est le mal? Je ferai une mort magnifiqueetavant que de finirmais seulement alorsje dirai à Fabrice: Ingrat! c'est pour toi!... Ouije ne puis trouver d'occupation pour ce peu de vie qui me reste qu'à Parme; j'y ferai la grande dame. Quel bonheur si je pouvais être sensible maintenant à toutes ces distinctions qui autrefois faisaient le malheur de la Raversi! Alorspour voir mon bonheurj'avais besoin de regarder dans les yeux de l'envie... Ma vanité a un bonheur; à l'exception du comte peut-êtrepersonne n'aura pu deviner quel a été l'événement qui a mis fin à la vie de mon coeur... J'aimerai Fabriceje serai dévouée à sa fortunemais il ne faut pas qu'il rompe le mariage de la Cléliaet qu'il finisse par l'épouser... Noncela ne sera pas!
La duchesse en était là de son triste monologue lorsqu'elle entendit un grand bruit dans la maison.
-- Bon! se dit-ellevoilà qu'on vient m'arrêter; Ferrante se sera laissé prendreil aura parlé. Eh bien tant mieux! je vais avoir une occupationje vais leur disputer ma tête. Mais primoil ne faut pas se laisser prendre.
La duchesseà demi vêtues'enfuit au fond de son jardin: elle songeait déjà à passer par-dessus un petit mur et à se sauver dans la campagne; mais elle vit qu'on entrait dans sa chambre. Elle reconnut Brunol'homme de confiance du comte: il était seul avec sa femme de chambre. Elle s'approcha de la porte-fenêtre. Cet homme parlait à la femme de chambre des blessures qu'il avait reçues. La duchesse rentra chez elleBruno se jeta presque à ses piedsla conjurant de ne pas dire au comte l'heure ridicule à laquelle il arrivait.
-- Aussitôt la mort du princeajouta-t-ilM. le comte a donné l'ordreà toutes les postesde ne pas fournir de chevaux aux sujets des états de Parme. En conséquenceje suis allé jusqu'au Pô avec les chevaux de la maison; mais au sortir de la barquema voiture a été renverséebriséeabîméeet j'ai eu des contusions si graves que je n'ai pu monter à chevalcomme c'était mon devoir.
-- Eh bien! dit la duchesseil est trois heures du matin: je dirai que vous êtes arrivé à midi; vous n'allez pas me contredire.
-- Je reconnais bien les bontés de madame.
La politique dans une oeuvre littérairec'est un coup de pistolet au milieu d'un concertquelque chose de grossier et auquel pourtant il n'est pas possible de refuser son attention.
Nous allons parler de fort vilaines choseset quepour plus d'une raisonnous voudrions taire; mais nous sommes forcés d'en venir à des événements qui sont de notre domainepuisqu'ils ont pour théâtre le coeur des personnages.
-- Maisgrand Dieu! comment est mort ce grand prince? dit la duchesse à Bruno.
-- Il était à la chasse des oiseaux de passagedans les maraisle long du Pôà deux lieues de Sacca. Il est tombé dans un trou caché par une touffe d'herbe: il était tout en sueuret le froid l'a saisi; on l'a transporté dans une maison isoléeoù il est mort au bout de quelques heures. D'autres prétendent que MM. Catena et Borone sont morts aussiet que tout l'accident provient des casseroles de cuivre du paysan chez lequel on est entréqui étaient remplies de vert-de-gris. On a déjeuné chez cet homme. Enfinles têtes exaltéesles jacobinsqui racontent ce qu'ils désirentparlent de poison. Je sais que mon ami Totofourrier de la couraurait péri sans les soins généreux d'un manant qui paraissait avoir de grandes connaissances en médecineet lui a fait faire des remèdes fort singuliers. Mais on ne parle déjà plus de cette mort du prince: au faitc'était un homme cruel. Lorsque je suis partile peuple se rassemblait pour massacrer le fiscal général Rassi: on voulait aussi aller mettre le feu aux portes de la citadellepour tâcher de faire sauver les prisonniers. Mais on prétendait que Fabio Conti tirerait ses canons. D'autres assuraient que les canonniers de la citadelle avaient jeté de l'eau sur leur poudre et ne voulaient pas massacrer leurs concitoyens. Mais voici qui est bien plus intéressant: tandis que le chirurgien de Sandolaro arrangeait mon pauvre brasun homme est arrivé de Parmequi a dit que le peuple ayant trouvé dans les rues Barbonece fameux commis de la citadellel'a assomméet ensuite on est allé le pendre à l'arbre de la promenade qui est le plus voisin de la citadelle. Le peuple était en marche pour aller briser cette belle statue du prince qui est dans les jardins de la cour. Mais M. le comte a pris un bataillon de la gardel'a rangé devant la statueet a fait dire au peuple qu'aucun de ceux qui entreraient dans les jardins n'en sortirait vivantet le peuple avait peur. Mais ce qui est bien singulieret que cet homme arrivant de Parmeet qui est un ancien gendarmem'a répété plusieurs foisc'est que M. le comte a donné des coups de pied au général P...commandant la garde du princeet l'a fait conduire hors du jardin par deux fusiliersaprès lui avoir arraché ses épaulettes.
-- Je reconnais bien là le comtes'écria la duchesse avec un transport de joie qu'elle n'eût pas prévu une minute auparavant: il ne souffrira jamais qu'on outrage notre princesse; et quant au général P...par dévouement pour ses maîtres légitimesil n'a jamais voulu servir l'usurpateurtandis que le comtemoins délicata fait toutes les campagnes d'Espagnece qu'on lui a souvent reproché à la cour.
La duchesse avait ouvert la lettre du comtemais en interrompait la lecture pour faire cent questions à Bruno.
La lettre était bien plaisante; le comte employait les termes les plus lugubreset cependant la joie la plus vive éclatait à chaque mot; il évitait les détails sur le genre de mort du princeet finissait sa lettre par ces mots:
«Tu vas revenir sans doutemon cher ange! mais je te conseille d'attendre un jour ou deux le courrier que la princesse t'enverraà ce que j'espèreaujourd'hui ou demain; il faut que ton retour soit magnifique comme ton départ a été hardi. Quant au grand criminel qui est auprès de toije compte bien le faire juger par douze juges appelés de toutes les parties de cet état. Maispour faire punir ce monstre-là comme il le mériteil faut d'abord que je puisse faire des papillotes avec la première sentencesi elle existe. »
Le comte avait rouvert sa lettre:
«Voici bien une autre affaire: je viens de faire distribuer des cartouches aux deux bataillons de la garde; je vais me battre et mériter de mon mieux ce surnom de Cruel dont les libéraux m'ont gratifié depuis si longtemps. Cette vieille momie de général P... a osé parler dans la caserne d'entrer en pourparlers avec le peuple à demi révolté. Je t'écris du milieu de la rue; je vais au palaisoù l'on ne pénétrera que sur mon cadavre. Adieu! Si je meursce sera en t'adorant quand mêmeainsi que j'ai vécu! N'oublie pas de faire prendre 300 000 francs déposés en ton nom chez D...à Lyon. »
«Voilà ce pauvre diable de Rassi pâle comme la mortet sans perruque; tu n'as pas d'idée de cette figure! Le peuple veut absolument le pendre; ce serait un grand tort qu'on lui feraitil mérite d'être écartelé. Il se réfugiait à mon palaiset m'a couru après dans la rue; je ne sais trop qu'en faire... je ne veux pas le conduire au palais du princece serait faire éclater la révolte de ce côté. F... verra si je l'aime; mon premier mot à Rassi a été: Il me faut la sentence contre M. del Dongoet toutes les copies que vous pouvez en avoiret dites à tous ces juges iniquesqui sont cause de cette révolteque je les ferai tous pendreainsi que vousmon cher amis'ils soufflent un mot de cette sentencequi n'a jamais existé. Au nom de Fabricej'envoie une compagnie de grenadiers à l'archevêque. Adieucher ange! mon palais va être brûléet je perdrai les charmants portraits que j'ai de toi. Je cours au palais pour faire destituer cet infâme général P...qui fait des siennes; il flatte bassement le peuplecomme autrefois il flattait le feu prince. Tous ces généraux ont une peur du diable; je vaisje croisme faire nommer général en chef. »
La duchesse eut la malice de ne pas envoyer réveiller Fabrice; elle se sentait pour le comte un accès d'admiration qui ressemblait fort à de l'amour. Toutes réflexions faitesse dit-elleil faut que je l'épouse. Elle le lui écrivit aussitôtet fit partir un de ses gens. Cette nuitla duchesse n'eut pas le temps d'être malheureuse.
Le lendemainsur le midielle vit une barque montée par dix rameurs et qui fendait rapidement les eaux du lac; Fabrice et elle reconnurent bientôt un homme portant la livrée du prince de Parme: c'était en effet un de ses courriers quiavant de descendre à terrecria à la duchesse:-- La révolte est apaisée! Ce courrier lui remit plusieurs lettres du comteune lettre admirable de la princesse et une ordonnance du prince Ranuce-Ernest Vsur parcheminqui la nommait duchesse de San Giovanni et grande maîtresse de la princesse douairière. Ce jeune princesavant en minéralogieet qu'elle croyait un imbécileavait eu l'esprit de lui écrire un petit billet; mais il y avait de l'amour à la fin. Le billet commençait ainsi:
«Le comte ditmadame la duchessequ'il est content de moi; le fait est que j'ai essuyé quelques coups de fusil à ses côtés et que mon cheval a été touché: à voir le bruit qu'on fait pour si peu de choseje désire vivement assister à une vraie bataillemais que ce ne soit pas contre mes sujets. Je dois tout au comte; tous mes générauxqui n'ont pas fait la guerrese sont conduits comme des lièvres; je crois que deux ou trois se sont enfuis jusqu'à Bologne. Depuis qu'un grand et déplorable événement m'a donné le pouvoirje n'ai point signé d'ordonnance qui m'ait été aussi agréable que celle qui vous nomme grande maîtresse de ma mère. Ma mère et moinous nous sommes souvenus qu'un jour vous admiriez la belle vue que l'on a du palazzeto de San Giovanniqui jadis appartint à Pétrarquedu moins on le dit; ma mère a voulu vous donner cette petite terre; et moine sachant que vous donneret n'osant vous offrir tout ce qui vous appartientje vous ai faite duchesse dans mon pays; je ne sais si vous êtes assez savante pour savoir que Sanseverina est un titre romain. Je viens de donner le grand cordon de mon ordre à notre digne archevêquequi a déployé une fermeté bien rare chez les hommes de soixante-dix ans. Vous ne m'en voudrez pas d'avoir rappelé toutes les dames exilées. On me dit que je ne dois plus signerdorénavantqu'après avoir écrit les mots votre affectionné : je suis fâché que l'on me fasse prodiguer une assurance qui n'est complètement vraie que quand je vous écris.
«Votre affectionné
«RANUCE-ERNEST. »
Qui n'eût ditd'après ce langageque la duchesse allait jouir de la plus haute faveur? Toutefois elle trouva quelque chose de fort singulier dans d'autres lettres du comtequ'elle reçut deux heures plus tard. Il ne s'expliquait point autrementmais lui conseillait de retarder de quelques jours son retour à Parmeet d'écrire à la princesse qu'elle était fort indisposée. La duchesse et Fabrice n'en partirent pas moins pour Parme aussitôt après dîner. Le but de la duchesseque toutefois elle ne s'avouait pasétait de presser le mariage du marquis Crescenzi: Fabricede son côtéfit la route dans des transports de bonheur fouset qui semblèrent ridicules à sa tante. Il avait l'espoir de revoir bientôt Clélia; il comptait bien l'enlevermême malgré elles'il n'y avait que ce moyen de rompre son mariage.
Le voyage de la duchesse et de son neveu fut très gai. A une poste avant ParmeFabrice s'arrêta un instant pour reprendre l'habit ecclésiastique; d'ordinaire il était vêtu comme un homme en deuil. Quand il rentra dans la chambre de la duchesse:
-- Je trouve quelque chose de louche et d'inexplicablelui dit-elledans les lettres du comte. Si tu m'en croyaistu passerais ici quelques heures; je t'enverrai un courrier dès que j'aurai parlé à ce grand ministre.
Ce fut avec beaucoup de peine que Fabrice se rendit à cet avis raisonnable. Des transports de joie dignes d'un enfant de quinze ans marquèrent la réception que le comte fit à la duchessequ'il appelait sa femme. Il fut longtemps sans vouloir parler politiqueetquand enfin on en vint à la triste raison:
-- Tu as fort bien fait d'empêcher Fabrice d'arriver officiellement; nous sommes ici en pleine réaction. Devine un peu le collègue que le prince m'a donné comme ministre de la justice! c'est Rassima chèreRassique j'ai traité comme un gueux qu'il estle jour de nos grandes affaires. A proposje t'avertis qu'on a supprimé tout ce qui s'est passé ici. Si tu lis notre gazettetu verras qu'un commis de la citadellenommé Barboneest mort d'une chute de voiture. Quant aux soixante et tant de coquins que j'ai fait tuer à coups de balleslorsqu'ils attaquaient la statue du prince dans les jardinsils se portent fort bienseulement ils sont en voyage. Le comte Zurlaministre de l'intérieurest allé lui-même à la demeure de chacun de ces héros malheureuxet a remis quinze sequins à leurs familles ou à leurs amisavec ordre de dire que le défunt était en voyageet menace très expresse de la prisonsi l'on s'avisait de faire entendre qu'il avait été tué. Un homme de mon propre ministèreles affaires étrangèresa été envoyé en mission auprès des journalistes de Milan et de Turinafin qu'on ne parle pas du malheureux événementc'est le mot consacré; cet homme doit pousser jusqu'à Paris et Londresafin de démentir dans tous les journauxet presque officiellementtout ce qu'on pourrait dire de nos troubles. Un autre agent s'est acheminé vers Bologne et Florence. J'ai haussé les épaules.
Mais le plaisantà mon âgec'est que j'ai eu un moment d'enthousiasme en parlant aux soldats de la garde et arrachant les épaulettes de ce pleutre de général P... En cet instant j'aurais donné ma viesans balancerpour le prince; j'avoue maintenant que c'eût été une façon bien bête de finir. Aujourd'huile princetout bon jeune homme qu'il estdonnerait cent écus pour que je mourusse de maladie; il n'ose pas encore me demander ma démission mais nous nous parlons le plus rarement possibleet je lui envoie une quantité de petits rapports par écritcomme je le pratiquais avec le feu princeaprès la prison de Fabrice. A proposje n'ai point fait des papillotes avec la sentence signée contre luipar la grande raison que ce coquin de Rassi ne me l'a point remise. Vous avez donc fort bien fait d'empêcher Fabrice d'arriver ici officiellement. La sentence est toujours exécutoire; je ne crois pas pourtant que le Rassi osât faire arrêter notre neveu aujourd'huimais il est possible qu'il l'ose dans quinze jours. Si Fabrice veut absolument rentrer en villequ'il vienne loger chez moi.
-- Mais la cause de tout ceci? s'écria la duchesse étonnée.
-- On a persuadé au prince que je me donne des airs de dictateur et de sauveur de la patrieet que je veux le mener comme un enfant; qui plus esten parlant de luij'aurais prononcé le mot fatal: cet enfant. Le fait peut être vraij'étais exalté ce jour-là: par exempleje le voyais un grand hommeparce qu'il n'avait point trop de peur au milieu des premiers coups de fusil qu'il entendît de sa vie. Il ne manque point d'espritil a même un meilleur ton que son père: enfinje ne saurais trop le répéterle fond du coeur est honnête et bon; mais ce coeur sincère et jeune se crispe quand on lui raconte un tour de friponet croit qu'il faut avoir l'âme bien noire soi-même pour apercevoir de telles choses: songez à l'éducation qu'il a reçue!...
-- Votre Excellence devait songer qu'un jour il serait le maîtreet placer un homme d'esprit auprès de lui.
-- D'abordnous avons l'exemple de l'abbé de Condillacquiappelé par le marquis de Felinomon prédécesseurne fit de son élève que le roi des nigauds. Il allait à la processioneten 1796il ne sut pas traiter avec le général Bonapartequi eût triplé l'étendue de ses états. En second lieuje n'ai jamais cru rester ministre dix ans de suite. Maintenant que je suis désabusé de toutet cela depuis un moisje veux réunir un millionavant de laisser à elle-même cette pétaudière que j'ai sauvée. Sans moiParme eût été république pendant deux moisavec le poète Ferrante Palla pour dictateur.
Ce mot fit rougir la duchesse. Le comte ignorait tout.
-- Nous allons retomber dans la monarchie ordinaire du dix-huitième siècle: le confesseur et la maîtresse. Au fondle prince n'aime que la minéralogieet peut- être vousmadame. Depuis qu'il règneson valet de chambre dont je viens de faire le frère capitainece frère a neuf mois de servicece valet de chambredis-jeest allé lui fourrer dans la tête qu'il doit être plus heureux qu'un autre parce que son profil va se trouver sur les écus. A la suite de cette belle idée est arrivé l'ennui.
Maintenant il lui faut un aide de campremède à l'ennui. Eh bien! quand il m'offrirait ce fameux million qui nous est nécessaire pour bien vivre à Naples ou à Parisje ne voudrais pas être son remède de l'ennuiet passer chaque jour quatre ou cinq heures avec Son Altesse. D'ailleurscomme j'ai plus d'esprit que luiau bout d'un mois il me prendrait pour un monstre.
Le feu prince était méchant et envieuxmais il avait fait la guerre et commandé des corps d'arméece qui lui avait donné de la tenue; on trouvait en lui l'étoffe d'un princeet je pouvais être ministre bon ou mauvais. Avec cet honnête homme de fils candide et vraiment bonje suis forcé d'être un intrigant. Me voici le rival de la dernière femmelette du châteauet rival fort inférieurcar je mépriserai cent détails nécessaires. Par exempleil y a trois joursune de ces femmes qui distribuent les serviettes blanches tous les matins dans les appartements a eu l'idée de faire perdre au prince la clef d'un de ses bureaux anglais. Sur quoi Son Altesse a refusé de s'occuper de toutes les affaires dont les papiers se trouvent dans ce bureau; à la vérité pour vingt francs on peut faire détacher les planches qui en forment le fondou employer de fausses clefs; mais Ranuce-Ernest V m'a dit que ce serait donner de mauvaises habitudes au serrurier de la cour.
Jusqu'ici il lui a été absolument impossible de garder trois jours de suite la même volonté. S'il fût né monsieur le marquis un telavec de la fortunece jeune prince eût été un des hommes les plus estimables de sa courune sorte de Louis XVI; mais commentavec sa naïveté pieuseva-t-il résister à toutes les savantes embûches dont il est entouré? Aussi le salon de votre ennemie la Raversi est plus puissant que jamais; on y a découvert que moiqui ai fait tirer sur le peupleet qui étais résolu à tuer trois mille hommes s'il le fallaitplutôt que de laisser outrager la statue du prince qui avait été mon maîtreje suis un libéral enragéje voulais faire signer une constitutionet cent absurdités pareilles. Avec ces propos de républiqueles fous nous empêcheraient de jouir de la meilleure des monarchies... Enfinmadamevous êtes la seule personne du parti libéral actuel dont mes ennemis me font le chefsur le compte de qui le prince ne se soit pas expliqué en termes désobligeants; l'archevêquetoujours parfaitement honnête hommepour avoir parlé en termes raisonnables de ce que j'ai fait le jour malheureuxest en pleine disgrâce.
Le lendemain du jour qui ne s'appelait pas encore malheureuxquand il était encore vrai que la révolte avait existéle prince dit à l'archevêque quepour que vous n'eussiez pas à prendre un titre inférieur en m'épousantil me ferait duc. Aujourd'hui je crois que c'est Rassianobli par moi lorsqu'il me vendait les secrets du feu princequi va être fait comte. En présence d'un tel avancement je jouerai le rôle d'un nigaud.
-- Et le pauvre prince se mettra dans la crotte.
-- Sans doute: mais au fond il est le maîtrequalité quien moins de quinze joursfait disparaître le ridicule. Ainsichère duchessefaisons comme au jeu de tric-tracallons-nous-en.
-- Mais nous ne serons guère riches.
-- Au fondni vous ni moi n'avons besoin de luxe. Si vous me donnez à Naples une place dans une loge à San Carlo et un chevalje suis plus que satisfait; ce ne sera jamais le plus ou moins de luxe qui nous donnera un rang à vous et à moic'est le plaisir que les gens d'esprit du pays pourront trouver peut-être à venir prendre une tasse de thé chez vous.
-- Maisreprit la duchesseque serait-il arrivéle jour malheureuxsi vous vous étiez tenu à l'écart comme j'espère que vous le ferez à l'avenir?
-- Les troupes fraternisaient avec le peupleil y avait trois jours de massacre et d'incendie (car il faut cent ans à ce pays pour que la république n'y soit pas une absurdité)puis quinze jours de pillagejusqu'à ce que deux ou trois régiments fournis par l'étranger fussent venus mettre le holà. Ferrante Palla était au milieu du peupleplein de courage et furibond comme à l'ordinaire; il avait sans doute une douzaine d'amis qui agissaient de concert avec luice dont Rassi fera une superbe conspiration. Ce qu'il y a de sûrc'est queporteur d'un habit d'un délabrement incroyable! il distribuait l'or à pleines mains.
La duchesseémerveillée de toutes ces nouvellesse hâta d'aller remercier la princesse.
Au moment de son entrée dans la chambrela dame d'atours lui remit la petite clef d'or que l'on porte à la ceintureet qui est la marque de l'autorité suprême dans la partie du palais qui dépend de la princesse. Clara Paolina se hâta de faire sortir tout le monde; etune fois seule avec son amiepersista pendant quelques instants à ne s'expliquer qu'à demi. La duchesse ne comprenait pas trop ce que tout cela voulait direet ne répondait qu'avec beaucoup de réserve. Enfinla princesse fondit en larmesetse jetant dans les bras de la duchesses'écria: Les temps de mon malheur vont recommencer: mon fils me traitera plus mal que ne l'a fait son père!
-- C'est ce que j'empêcherairépliqua vivement la duchesse. Mais d'abord j'ai besoincontinua-t-elleque Votre Altesse Sérénissime daigne accepter ici l'hommage de toute ma reconnaissance et de mon profond respect.
-- Que voulez-vous dire? s'écria la princesse remplie d'inquiétudeet craignant une démission.
-- C'est que toutes les fois que Votre Altesse Sérénissime me permettra de tourner à droite le menton tremblant de ce magot qui est sur sa cheminéeelle me permettra aussi d'appeler les choses par leur vrai nom.
-- N'est-ce que çama chère duchesse? s'écria Clara Paolina en se levantet courant elle-même mettre le magot en bonne position; parlez donc en toute libertémadame la grande maîtressedit-elle avec un ton de voix charmant.
-- Madamereprit celle-ciVotre Altesse a parfaitement vu la position; nous couronsvous et moiles plus grands dangers; la sentence contre Fabrice n'est point révoquée; par conséquentle jour où l'on voudra se défaire de moi et vous outrageron le remet en prison. Notre position est aussi mauvaise que jamais. Quant à moi personnellementj'épouse le comteet nous allons nous établir à Naples ou à Paris. Le dernier trait d'ingratitude dont le comte est victime en ce momentl'a entièrement dégoûté des affaires etsauf l'intérêt de Votre Altesse Sérénissimeje ne lui conseillerais de rester dans ce gâchis qu'autant que le prince lui donnerait une somme énorme. Je demanderai à Votre Altesse la permission de lui expliquer que le comtequi avait 130 000 francs en arrivant aux affairespossède à peine aujourd'hui 20 000 livres de rente. C'était en vain que depuis longtemps je le pressais de songer à sa fortune. Pendant mon absenceil a cherché querelle aux fermiers généraux du princequi étaient des fripons; le comte les a remplacés par d'autres fripons qui lui ont donné 800 000 francs.
-- Comment! s'écria la princesse étonnéemon Dieu! que je suis fâchée de cela!
-- Madamerépliqua la duchesse d'un très grand sang-froidfaut-il retourner le nez du magot à gauche?
-- Mon Dieunons'écria la princesse; mais je suis fâchée qu'un homme du caractère du comte ait songé à ce genre de gain.
-- Sans ce volil était méprisé de tous les honnêtes gens.
-- Grand Dieu! est-il possible!
-- Madamereprit la duchesseexcepté mon amile marquis Crescenziqui a 3 ou 400 000 livres de rentetout le monde vole ici; et comment ne volerait-on pas dans un pays où la reconnaissance des plus grands services ne dure pas tout à fait un mois? Il n'y a donc de réel et de survivant à la disgrâce que l'argent. Je vais me permettremadamedes vérités terribles.
-- Je vous les permetsmoidit la princesse avec un profond soupiret pourtant elles me sont cruellement désagréables.
-- Eh bien! madamele prince votre filsparfaitement honnête hommepeut vous rendre bien plus malheureuse que ne fit son père; le feu prince avait du caractère à peu près comme tout le monde. Notre souverain actuel n'est pas sûr de vouloir la même chose trois jours de suite; par conséquentpour qu'on puisse être sûr de luiil faut vivre continuellement avec lui et ne le laisser parler à personne. Comme cette vérité n'est pas bien difficile à devinerle nouveau parti ultradirigé par ces deux bonnes têtesRassi et la marquise Raversiva chercher à donner une maîtresse au prince. Cette maîtresse aura la permission de faire sa fortune et de distribuer quelques places subalternesmais elle devra répondre au parti de la constante volonté du maître.
Moipour être bien établie à la cour de Votre Altessej'ai besoin que le Rassi soit exilé et conspué; je veuxde plusque Fabrice soit jugé par les juges les plus honnêtes que l'on pourra trouver: si ces messieurs reconnaissentcomme je l'espèrequ'il est innocentil sera naturel d'accorder à monsieur l'archevêque que Fabrice soit son coadjuteur avec future succession. Si j'échouele comte et moi nous nous retirons; alorsje laisse en partant ce conseil à Votre Altesse Sérénissime: elle ne doit jamais pardonner à Rassiet jamais non plus sortir des états de son fils. De prèsce bon fils ne lui fera pas de mal sérieux.
-- J'ai suivi vos raisonnements avec toute l'attention requiserépondit la princesse en souriant; faudra-t-il donc que je me charge du soin de donner une maîtresse à mon fils?
-- Non pasmadamemais faites d'abord que votre salon soit le seul où il s'amuse.
La conversation fut infinie dans ce sensles écailles tombaient des yeux de l'innocente et spirituelle princesse.
Un courrier de la duchesse alla dire à Fabrice qu'il pouvait entrer en villemais en se cachant. On l'aperçut à peine: il passait sa vie déguisé en paysan dans la baraque en bois d'un marchand de marronsétabli vis-à-vis de la porte de la citadellesous les arbres de la promenade.
Livre Second
Chapitre XXIV.
La duchesse organisa des soirées charmantes au palaisqui n'avait jamais vu tant de gaieté; jamais elle ne fut plus aimable que cet hiveret pourtant elle vécut au milieu des plus grands dangers; mais aussipendant cette saison critiqueil ne lui arriva pas deux fois de songer avec un certain degré de malheur à l'étrange changement de Fabrice. Le jeune prince venait de fort bonne heure aux soirées aimables de sa mèrequi lui disait toujours:
-- Allez-vous-en donc gouverner; je parie qu'il y a sur votre bureau plus de vingt rapports qui attendent un oui ou un nonet je ne veux pas que l'Europe m'accuse de faire de vous un roi fainéant pour régner à votre place.
Ces avis avaient le désavantage de se présenter toujours dans les moments les plus inopportunsc'est-à-dire quand Son Altesseayant vaincu sa timiditéprenait part à quelque charade en action qui l'amusait fort. Deux fois la semaine il y avait des parties de campagne oùsous prétexte de conquérir au nouveau souverain l'affection de son peuplela princesse admettait les plus jolies femmes de la bourgeoisie. La duchessequi était l'âme de cette cour joyeuseespérait que ces belles bourgeoisesqui toutes voyaient avec une envie mortelle la haute fortune du bourgeois Rassiraconteraient au prince quelqu'une des friponneries sans nombre de ce ministre. Orentre autres idées enfantinesle prince prétendait avoir un ministère moral.
Rassi avait trop de sens pour ne pas sentir combien ces soirées brillantes de la cour de la princessedirigées par son ennemieétaient dangereuses pour lui. Il n'avait pas voulu remettre au comte Mosca la sentence fort légale rendue contre Fabrice; il fallait donc que la duchesse ou lui disparussent de la cour.
Le jour de ce mouvement populairedont maintenant il était de bon ton de nier l'existenceon avait distribué de l'argent au peuple. Rassi partit de là: plus mal mis encore que de coutumeil monta dans les maisons les plus misérables de la villeet passa des heures entières en conversation réglée avec leurs pauvres habitants. Il fut bien récompensé de tant de soins: après quinze jours de ce genre de vie il eut la certitude que Ferrante Palla avait été le chef secret de l'insurrectionet bien plusque cet êtrepauvre toute sa vie comme un grand poèteavait fait vendre huit ou dix diamants à Gênes.
On citait entre autres cinq pierres de prix qui valaient réellement plus de 40 000 francset quedix jours avant la mort du princeon avait laissées pour 35 000 francsparce quedisait-onon avait besoin d'argent.
Comment peindre les transports de joie du ministre de la justice à cette découverte? Il s'apercevait que tous les jours on lui donnait des ridicules à la cour de la princesse douairièreet plusieurs fois le princeparlant d'affaires avec luilui avait ri au nez avec toute la naïveté de la jeunesse. Il faut avouer que le Rassi avait des habitudes singulièrement plébéiennes: par exempledès qu'une discussion l'intéressaitil croisait les jambes et prenait son soulier dans la main; si l'intérêt croissaitil étalait son mouchoir de coton rouge sur sa jambeetc.etc. Le prince avait beaucoup ri de la plaisanterie d'une des plus jolies femmes de la bourgeoisiequisachant d'ailleurs qu'elle avait la jambe fort bien faites'était mise à imiter ce geste élégant du ministre de la justice.
Rassi sollicita une audience extraordinaire et dit au prince:
-- Votre Altesse voudrait-elle donner cent mille francs pour savoir au juste quel a été le genre de mort de son auguste père? avec cette sommela justice serait mise à même de saisir les coupabless'il y en a.
La réponse du prince ne pouvait être douteuse.
A quelque temps de làla Chékina avertit la duchesse qu'on lui avait offert une grosse somme pour laisser examiner les diamants de sa maîtresse par un orfèvre; elle avait refusé avec indignation. La duchesse la gronda d'avoir refusé; età huit jours de làla Chékina eut des diamants à montrer. Le jour pris pour cette exhibition des diamantsle comte Mosca plaça deux hommes sûrs auprès de chacun des orfèvres de Parmeet sur le minuit il vint dire à la duchesse que l'orfèvre curieux n'était autre que le frère de Rassi. La duchessequi était fort gaie ce soir-là (on jouait au palais une comédie dell'artec'est-à-dire où chaque personnage invente le dialogue à mesure qu'il le ditle plan seul de la comédie est affiché dans la coulisse)la duchessequi jouait un rôleavait pour amoureux dans la pièce le comte Baldil'ancien ami de la marquise Raversiqui était présente. Le princel'homme le plus timide de ses étatsmais fort joli garçon et doué du coeur le plus tendreétudiait le rôle du comte Baldiet voulait le jouer à la seconde représentation.
-- J'ai bien peu de tempsdit la duchesse au comteje parais à la première scène du second acte; passons dans la salle des gardes.
Làau milieu de vingt gardes du corpstous fort éveillés et fort attentifs aux discours du premier ministre et de la grande maîtressela duchesse dit en riant à son ami:
-- Vous me grondez toujours quand je dis des secrets inutilement. C'est par moi que fut appelé au trône Ernest V; il s'agissait de venger Fabriceque j'aimais alors bien plus qu'aujourd'huiquoique toujours fort innocemment. Je sais bien que vous ne croyez guère à cette innocencemais peu importepuisque vous m'aimez malgré mes crimes. Eh bien! voici un crime véritable: j'ai donné tous mes diamants à une espèce de fou fort intéressantnommé Ferrante Pallaje l'ai même embrassé pour qu'il fît périr l'homme qui voulait faire empoisonner Fabrice. Où est le mal?
-- Ah! voilà donc où Ferrante avait pris de l'argent pour son émeute! dit le comteun peu stupéfait; et vous me racontez tout cela dans la salle des gardes!
-- C'est que je suis presséeet voici le Rassi sur les traces du crime. Il est bien vrai que je n'ai jamais parlé d'insurrectioncar j'abhorre les jacobins. Réfléchissez là- dessuset dites-moi votre avis après la pièce.
-- Je vous dirai tout de suite qu'il faut inspirer de l'amour au prince... Mais en tout bien tout honneurau moins!
On appelait la duchesse pour son entrée en scèneelle s'enfuit.
Quelques jours aprèsla duchesse reçut par la poste une grande lettre ridiculesignée du nom d'une ancienne femme de chambre à elle; cette femme demandait à être employée à la courmais la duchesse avait reconnu du premier coup d'oeil que ce n'était ni son écriture ni son style. En ouvrant la feuille pour lire la seconde pagela duchesse vit tomber à ses pieds une petite image miraculeuse de la Madonepliée dans une feuille imprimée d'un vieux livre. Après avoir jeté un coup d'oeil sur l'imagela duchesse lut quelques lignes de la vieille feuille imprimée. Ses yeux brillèrentet elle y trouvait ces mots:
Le tribun a pris cent francs par moisnon plus; avec le reste on voulut ranimer le feu sacré dans des âmes qui se trouvèrent glacées par l'égoïsme. Le renard est sur mes tracesc'est pourquoi je n'ai pas cherché à voir une dernière fois l'être adoré. Je me suis ditelle n'aime pas la républiqueelle qui m'est supérieure par l'esprit autant que par les grâces et la beauté. D'ailleurscomment faire une république sans républicains? Est-ce que je me tromperais? Dans six moisje parcourraile microscope à la mainet à piedles petites villes d'Amériqueje verrai si je dois encore aimer la seule rivale que vous ayez dans mon coeur. Si vous recevez cette lettremadame la baronneet qu'aucun oeil profane ne l'ait lue avant vousfaites briser un des jeunes frênes plantés à vingt pas de l'endroit où j'osai vous parler pour la première fois. Alors je ferai enterrersous le grand buis du jardin que vous remarquâtes une fois en mes jours heureuxune boîte où se trouveront de ces choses qui font calomnier les gens de mon opinion. Certesje me fusse bien gardé d'écrire si le renard n'était sur mes traceset ne pouvait arriver à cet être céleste; voir le buis dans quinze jours. »
Puisqu'il a une imprimerie à ses ordresse dit la duchessebientôt nous aurons un recueil de sonnetsDieu sait le nom qu'il m'y donnera!
La coquetterie de la duchesse voulut faire un essai; pendant huit jours elle fut indisposéeet la cour n'eut plus de jolies soirées. La princessefort scandalisée de tout ce que la peur qu'elle avait de son fils l'obligeait de faire dès les premiers moments de son veuvagealla passer ces huit jours dans un couvent attenant à l'église où le feu prince était inhumé. Cette interruption des soirées jeta sur les bras du prince une masse énorme de loisiret porta un échec notable au crédit du ministre de la justice. Ernest V comprit tout l'ennui qui le menaçait si la duchesse quittait la courou seulement cessait d'y répandre la joie. Les soirées recommencèrentet le prince se montra de plus en plus intéressé par les comédies dell'arte. Il avait le projet de prendre un rôlemais n'osait avouer cette ambition. Un jourrougissant beaucoupil dit à la duchesse: Pourquoi ne jouerais-je pas moi aussi?
-- Nous sommes tous ici aux ordres de Votre Altesse; si elle daigne m'en donner l'ordreje ferai arranger le plan d'une comédietoutes les scènes brillantes du rôle de Votre Altesse seront avec moiet comme les premiers jours tout le monde hésite un peusi Votre Altesse veut me regarder avec quelque attentionje lui dirai les réponses qu'elle doit faire. Tout fut arrangé et avec une adresse infinie. Le prince fort timide avait honte d'être timide; les soins que se donna la duchesse pour ne pas faire souffrir cette timidité innée firent une impression profonde sur le jeune souverain.
Le jour de son débutle spectacle commença une demi-heure plus tôt qu'à l'ordinaireet il n'y avait dans le salonau moment où l'on passa dans la salle de spectacleque huit ou dix femmes âgées. Ces figures-là n'imposaient guère au princeet d'ailleursélevées à Munich dans les vrais principes monarchiqueselles applaudissaient toujours. Usant de son autorité comme grande maîtressela duchesse ferma à clef la porte par laquelle le vulgaire des courtisans entrait au spectacle. Le princequi avait de l'esprit littéraire et une belle figurese tira fort bien de ses premières scènes; il répétait avec intelligence les phrases qu'il lisait dans les yeux de la duchesseou qu'elle lui indiquait à demi-voix. Dans un moment où les rares spectateurs applaudissaient de toutes leurs forcesla duchesse fit un signela porte d'honneur fut ouverteet la salle de spectacle occupée en un instant par toutes les jolies femmes de la courquitrouvant au prince une figure charmante et l'air fort heureuxse mirent à applaudir; le prince rougit de bonheur. Il jouait le rôle d'un amoureux de la duchesse. Bien loin d'avoir à lui suggérer des parolesbientôt elle fut obligée de l'engager à abréger les scènes; il parlait d'amour avec un enthousiasme qui souvent embarrassait l'actrice; ses répliques duraient cinq minutes. La duchesse n'était plus cette beauté éblouissante de l'année précédente; la prison de Fabriceetbien plus encorele séjour sur le lac Majeur avec Fabricedevenu morose et silencieuxavait donné dix ans de plus à la belle Gina. Ses traits s'étaient marquésils avaient plus d'esprit et moins de jeunesse.
Ils n'avaient plus que bien rarement l'enjouement du premier âge; mais à la scèneavec du rouge et tous les secours que l'art fournit aux actriceselle était encore la plus jolie femme de la cour. Les tirades passionnéesdébitées par le princedonnèrent l'éveil aux courtisans; tous se disaient ce soir-là: Voici la Balbi de ce nouveau règne. Le comte se révolta intérieurement. La pièce finiela duchesse dit au prince devant toute la cour:
-- Votre Altesse joue trop bien; on va dire que vous êtes amoureux d'une femme de trente-huit ansce qui fera manquer mon établissement avec le comte. Ainsije ne jouerai plus avec Votre Altesseà moins que le prince ne me jure de m'adresser la parole comme il le ferait à une femme d'un certain âgeà Mme la marquise Raversipar exemple.
On répéta trois fois la même pièce; le prince était fou de bonheur; maisun soiril parut fort soucieux.
-- Ou je me trompe fortdit la grande maîtresse à sa princesseou le Rassi cherche à nous jouer quelque tour; je conseillerais à Votre Altesse d'indiquer un spectacle pour demain; le prince jouera maletdans son désespoiril vous dira quelque chose.
Le prince joua fort mal en effet; on l'entendait à peineet il ne savait plus terminer ses phrases. A la fin du premier acteil avait presque les larmes aux yeux; la duchesse se tenait auprès de luimais froide et immobile. Le princese trouvant un instant seul avec elledans le foyer des acteursalla fermer la porte.
-- Jamaislui dit-ilje ne pourrai jouer le second et le troisième acte; je ne veux pas absolument être applaudi par complaisance; les applaudissements qu'on me donnait ce soir me fendaient le coeur. Donnez-moi un conseilque faut-il faire?
-- Je vais m'avancer sur la scènefaire une profonde révérence à Son Altesseune autre au publiccomme un véritable directeur de comédieet dire que l'acteur qui jouait le rôle de Léliose trouvant subitement indisposéle spectacle se terminera par quelques morceaux de musique. Le comte Rusca et la petite Ghisolfi seront ravis de pouvoir montrer à une aussi brillante assemblée leurs petites voix aigrelettes.
Le prince prit la main de la duchesseet la baisa avec transport.
-- Que n'êtes-vous un hommelui dit-ilvous me donneriez un bon conseil: Rassi vient de déposer sur mon bureau cent quatre-vingt-deux dépositions contre les prétendus assassins de mon père. Outre les dépositionsil y a un acte d'accusation de plus de deux cents pages; il me faut lire tout celaetde plusj'ai donné ma parole de n'en rien dire au comte. Ceci mène tout droit à des supplices; déjà il veut que je fasse enlever en Franceprès d'AntibesFerrante Pallace grand poète que j'admire tant. Il est là sous le nom de Poncet.
-- Le jour où vous ferez pendre un libéralRassi sera lié au ministère par des chaînes de feret c'est ce qu'il veut avant tout; mais Votre Altesse ne pourra plus annoncer une promenade deux heures à l'avance. Je ne parlerai ni à la princesseni au comte du cri de douleur qui vient de vous échapper; maiscomme d'après mon serment je ne dois avoir aucun secret pour la princesseje serais heureuse si Votre Altesse voulait dire à sa mère les mêmes choses qui lui sont échappées avec moi.
Cette idée fit diversion à la douleur d'acteur chuté qui accablait le souverain.
-- Eh bien! allez avertir ma mèreje me rends dans son grand cabinet.
Le prince quitta les coulissestraversa le salon par lequel on arrivait au théâtrerenvoya d'un air dur le grand chambellan et l'aide de camp de service qui le suivaient; de son côté la princesse quitta précipitamment le spectacle; arrivée dans le grand cabinetla grande maîtresse fit une profonde révérence à la mère et au filset les laissa seuls. On peut juger de l'agitation de la cource sont là les choses qui la rendent si amusante. Au bout d'une heure le prince lui-même se présenta à la porte du cabinet et appela la duchesse; la princesse était en larmesson fils avait une physionomie tout altérée.
Voici des gens faibles qui ont de l'humeurse dit la grande maîtresseet qui cherchent un prétexte pour se fâcher contre quelqu'un. D'abord la mère et le fils se disputèrent la parole pour raconter les détails à la duchessequi dans ses réponses eut grand soin de ne mettre en avant aucune idée. Pendant deux mortelles heures les trois acteurs de cette scène ennuyeuse ne sortirent pas des rôles que nous venons d'indiquer. Le prince alla chercher lui-même les deux énormes portefeuilles que Rassi avait déposés sur son bureau; en sortant du grand cabinet de sa mèreil trouva toute la cour qui attendait.-- Allez-vous-enlaissez-moi tranquille! s'écria-t-ild'un ton fort impoli et qu'on ne lui avait jamais vu. Le prince ne voulait pas être aperçu portant lui-même les deux portefeuillesun prince ne doit rien porter. Les courtisans disparurent en un clin d'oeil. En repassant le prince ne trouva plus que les valets de chambre qui éteignaient les bougies; il les renvoya avec fureurainsi que le pauvre Fontanaaide de camp de servicequi avait eu la gaucherie de resterpar zèle.
-- Tout le monde prend à tâche de m'impatienter ce soirdit-il avec humeur à la duchessecomme il rentrait dans le cabinet; il lui croyait beaucoup d'esprit et il était furieux de ce qu'elle s'obstinait évidemment à ne pas ouvrir un avis. Ellede son côtéétait résolue à ne rien dire qu'autant qu'on lui demanderait son avis bien expressément. Il s'écoula encore une grosse demi-heure avant que le princequi avait le sentiment de sa dignitése déterminât à lui dire: -- Maismadamevous ne dites rien.
-- Je suis ici pour servir la princesseet oublier bien vite ce qu'on dit devant moi.
-- Eh bien! madamedit le prince en rougissant beaucoupje vous ordonne de me donner votre avis.
-- On punit les crimes pour empêcher qu'ils ne se renouvellent. Le feu prince a-t-il été empoisonné? C'est ce qui est fort douteux; a-t-il été empoisonné par les jacobins? c'est ce que Rassi voudrait bien prouvercar alors il devient pour Votre Altesse un instrument nécessaire à tout jamais. Dans ce casVotre Altessequi commence son règnepeut se promettre bien des soirées comme celle-ci. Vos sujets disent généralementce qui est de toute véritéque Votre Altesse a de la bonté dans le caractère; tant qu'elle n'aura pas fait pendre quelque libéralelle jouira de cette réputationet bien certainement personne ne songera à lui préparer du poison.
-- Votre conclusion est évidentes'écria la princesse avec humeur; vous ne voulez pas que l'on punisse les assassins de mon mari!
-- C'est qu'apparemmentmadameje suis liée à eux par une tendre amitié.
La duchesse voyait dans les yeux du prince qu'il la croyait parfaitement d'accord avec sa mère pour lui dicter un plan de conduite. Il y eut entre les deux femmes une succession assez rapide d'aigres repartiesà la suite desquelles la duchesse protesta qu'elle ne dirait plus une seule paroleet elle fut fidèle à sa résolution; mais le princeaprès une longue discussion avec sa mèrelui ordonna de nouveau de dire son avis.
-- C'est ce que je jure à Vos Altesses de ne point faire!
-- Mais c'est un véritable enfantillage! s'écria le prince.
-- Je vous prie de parlermadame la duchessedit la princesse d'un air digne.
-- C'est ce dont je vous supplie de me dispensermadame; mais Votre Altesseajouta la duchesse en s'adressant au princelit parfaitement le français; pour calmer nos esprits agitésvoudrait-elle nous lire une fable de La Fontaine?
La princesse trouva ce nous fort insolentmais elle eut l'air à la fois étonné et amuséquand la grande maîtressequi était allée du plus grand sang-froid ouvrir la bibliothèquerevint avec un volume des Fables de La Fontaine; elle le feuilleta quelques instantspuis dit au princeen le lui présentant:
Je supplie Votre Altesse de lire toute la fable.
LE JARDINIER ET SON SEIGNEUR
Un amateur de jardinage
Demi-bourgeoisdemi-manant
Possédait en certain village
Un jardin assez propreet le clos attenant.
Il avait de plant vif fermé cette étendue:
Là croissaient à plaisir l'oseille et la laitue
De quoi faire à Margot pour sa fête un bouquet
Peu de jasmin d'Espagne et force serpolet.
Cette félicité par un lièvre troublée
Fit qu'au seigneur du bourg notre homme se plaignit.
Ce maudit animal vient prendre sa goulée
Soir et matindit-ilet des pièges se rit;
Les pierresles bâtons y perdent leur crédit:
Il est sorcierje crois. -- Sorcier! je l'en défie
Repartit le seigneur: fût-il diableMiraut
En dépit de ses toursl'attrapera bientôt.
Je vous en déferaibonhommesur ma vie
-- Et quand?-- Et dès demainsans tarder plus longtemps.
La partie ainsi faiteil vient avec ses gens.
-- «àdéjeunonsdit-il: vos poulets sont-ils tendres?
L'embarras des chasseurs succède au déjeuner.
Chacun s'anime et se prépare;
Les trompes et les cors font un tel tintamarre
Que le bonhomme est étonné.
Le pis fut que l'on mit en piteux équipage
Le pauvre potager. Adieu planchescarreaux;
Adieu chicorée et poireaux;
Adieu de quoi mettre au potage.
Le bonhomme disait: Ce sont là jeux de prince.
Mais on le laissait dire; et les chiens et les gens
Firent plus de dégât en une heure de temps
Que n'en auraient fait en cent ans
Tous les lièvres de la province.
Petits princesvidez vos débats entre vous;
De recourir aux rois vous serez de grands fous.
Il ne les faut jamais engager dans vos guerres
Ni les faire entrer sur vos terres.
Cette lecture fut suivie d'un long silence. Le prince se promenait dans le cabinetaprès être allé lui-même remettre le volume à sa place.
-- Eh bien! madamedit la princessedaignerez-vous parler?
-- Non pascertesmadame! tant que Son Altesse ne m'aura pas nommée ministre; en parlant icije courrais risque de perdre ma place de grande maîtresse.
Nouveau silence d'un gros quart d'heure; enfin la princesse songea au rôle que joua jadis Marie de Médicismère de Louis XIII: tous les jours précédentsla grande maîtresse avait fait lire par la lectrice l'excellente Histoire de Louis XIIIde M. Bazin. La princessequoique fort piquéepensa que la duchesse pourrait fort bien quitter le payset alors Rassiqui lui faisait une peur affreusepourrait bien imiter Richelieu et la faire exiler par son fils. Dans ce momentla princesse eût donné tout au monde pour humilier sa grande maîtresse; mais elle ne pouvait: elle se levaet vintavec un sourire un peu exagéréprendre la main de la duchesse et lui dire:
-- Allonsmadameprouvez-moi votre amitié en parlant.
-- Eh bien; deux mots sans plus: brûlerdans la cheminée que voilàtous les papiers réunis par cette vipère de Rassiet ne jamais lui avouer qu'on les a brûlés.
Elle ajouta tout baset d'un air familierà l'oreille de la princesse.
-- Rassi peut être Richelieu!
-- Maisdiable! ces papiers me coûtent plus de quatre-vingt mille francs! s'écria le prince fâché.
-- Mon princerépliqua la duchesse avec énergievoilà ce qu'il en coûte d'employer des scélérats de basse naissance. Plût à Dieu que vous pussiez perdre un millionet ne jamais prêter créance aux bas coquins qui ont empêché votre père de dormir pendant les six dernières années de son règne.
Le mot basse naissance avait plu extrêmement à la princessequi trouvait que le comte et son amie avaient une estime trop exclusive pour l'esprittoujours un peu cousin germain du jacobinisme.
Durant le court moment de profond silencerempli par les réflexions de la princessel'horloge du château sonna trois heures. La princesse se levafit une profonde révérence à son filset lui dit;-- Ma santé ne me permet pas de prolonger davantage la discussion. Jamais de ministre de basse naissance ; vous ne m'ôterez pas de l'idée que votre Rassi vous a volé la moitié de l'argent qu'il vous a fait dépenser en espionnage. La princesse prit deux bougies dans les flambeaux et les plaça dans la cheminéede façon à ne pas les éteindre; puiss'approchant de son filselle ajouta:-- La fable de La Fontaine l'emportedans mon espritsur le juste désir de venger un époux. Votre Altesse veut-elle me permettre de brûler ces écritures? Le prince restait immobile.
Sa physionomie est vraiment stupidese dit la duchesse; le comte a raison: le feu prince ne nous eût pas fait veiller jusqu'à trois heures du matinavant de prendre un parti.
La princessetoujours deboutajouta:
-- Ce petit procureur serait bien fiers'il savait que ses paperassesremplies de mensongeset arrangées pour procurer son avancementont fait passer la nuit aux deux plus grands personnages de l'état.
Le prince se jeta sur un des portefeuilles comme un furieuxet en vida tout le contenu dans la cheminée. La masse des papiers fut sur le point d'étouffer les deux bougies; l'appartement se remplit de fumée. La princesse vit dans les yeux de son fils qu'il était tenté de saisir une carafe et de sauver ces papiersqui lui coûtaient quatre-vingt mille francs.
-- Ouvrez donc la fenêtre! cria-t-elle à la duchesse avec humeur. La duchesse se hâta d'obéir; aussitôt tous les papiers s'enflammèrent à la fois; il se fit un grand bruit dans la cheminéeet bientôt il fut évident qu'elle avait pris feu.
Le prince avait l'âme petite pour toutes les choses d'argent; il crut voir son palais en flammeset toutes les richesses qu'il contenait détruites; il courut à la fenêtre et appela la garde d'une voix toute changée. Les soldats en tumulte étant accourus dans la cour à la voix du princeil revint près de la cheminée qui attirait l'air de la fenêtre ouverte avec un bruit réellement effrayant; il s'impatientajurafit deux ou trois tours dans le cabinet comme un homme hors de luietenfinsortit en courant.
La princesse et sa grande maîtresse restèrent deboutl'une vis-à-vis de l'autreet gardant un profond silence.
-- La colère va-t-elle recommencer? se dit la duchesse; ma foimon procès est gagné. Et elle se disposait à être fort impertinente dans ses répliquesquand une pensée l'illumina; elle vit le second portefeuille intact. Nonmon procès n'est gagné qu'à moitié! Elle dit à la princessed'un air assez froid:
-- Madame m'ordonne-t-elle de brûler le reste de ces papiers?
-- Et où les brûlerez-vous? dit la princesse avec humeur.
-- Dans la cheminée du salon; en les y jetant l'un après l'autreil n'y a pas de danger.
La duchesse plaça sous son bras le portefeuille regorgeant de papiersprit une bougie et passa dans le salon voisin. Elle prit le temps de voir que ce portefeuille était celui des dépositionsmit dans son châle cinq ou six liasses de papiersbrûla le reste avec beaucoup de soinpuis disparut sans prendre congé de la princesse.
-- Voici une bonne impertinencese dit-elle en riant; mais elle a faillipar ses affectations de veuve inconsolableme faire perdre la tête sur un échafaud.
En entendant le bruit de la voiture de la duchessela princesse fut outrée contre sa grande maîtresse.
Malgré l'heure induela duchesse fit appeler le comte; il était au feu du châteaumais parut bientôt avec la nouvelle que tout était fini.-- Ce petit prince a réellement montré beaucoup de courageet je lui en ai fait mon compliment avec effusion.
-- Examinez bien vite ces dépositionset brûlons-les au plus tôt.
Le comte lut et pâlit.
-- Ma foiils arrivaient bien près de la vérité; cette procédure est fort adroitement faiteils sont tout à fait sur les traces de Ferrante Palla; ets'il parlenous avons un rôle difficile.
-- Mais il ne parlera pass'écria la duchesse; c'est un homme d'honneur celui-là: brûlonsbrûlons.
-- Pas encore. Permettez-moi de prendre les noms de douze ou quinze témoins dangereuxet que je me permettrai de faire enleversi jamais le Rassi veut recommencer.
-- Je rappellerai à Votre Excellence que le prince a donné sa parole de ne rien dire à son ministre de la justice de notre expédition nocturne.
-- Par pusillanimitéet de peur d'une scèneil la tiendra.
-- Maintenantmon amivoici une nuit qui avance beaucoup notre mariage; je n'aurais pas voulu vous apporter en dot un procès criminelet encore pour un péché que me fit commettre mon intérêt pour un autre.
Le comte était amoureuxlui prit la main s'exclama; il avait les larmes aux yeux.
-- Avant de partirdonnez-moi des conseils sur la conduite que je dois tenir avec la princesse; je suis excédée de fatiguej'ai joué une heure la comédie sur le théâtreet cinq heures dans le cabinet.
-- Vous vous êtes assez vengée des propos aigrelets de la princessequi n'étaient que de la faiblessepar l'impertinence de votre sortie. Reprenez demain avec elle sur le ton que vous aviez ce matin; le Rassi n'est pas encore en prison ou exilénous n'avons pas encore déchiré la sentence de Fabrice.
Vous demandiez à la princesse de prendre une décisionce qui donne toujours de l'humeur aux princes et même aux premiers ministres; enfin vous êtes sa grande maîtressec'est-à-dire sa petite servante. Par un retourqui est immanquable chez les gens faiblesdans trois jours le Rassi sera plus en faveur que jamais; il va chercher à faire prendre quelqu'un: tant qu'il n'a pas compromis le princeil n'est sûr de rien.
Il y a eu un homme blessé à l'incendie de cette nuit; c'est un tailleurqui ama foimontré une intrépidité extraordinaire. Demainje vais engager le prince à s'appuyer sur mon braset à venir avec moi faire une visite au tailleur; je serai armé jusqu'aux dents et j'aurai l'oeil au guet; d'ailleurs ce jeune prince n'est point encore haï. Moije veux l'accoutumer à se promener dans les ruesc'est un tour que je joue au Rassiqui certainement va me succéderet ne pourra plus permettre de telles imprudences. En revenant de chez le tailleurje ferai passer le prince devant la statue de son père; il remarquera les coups de pierre qui ont cassé le jupon à la romaine dont le nigaud de statuaire l'a affublé; etenfinle prince aura bien peu d'esprit si de lui-même il ne fait pas cette réflexion: Voilà ce qu'on gagne à faire prendre des jacobins. A quoi je répliquerai: Il faut en pendre dix mille ou pas un: la Saint-Barthélemy a détruit les protestants en France.
Demainchère amieavant ma promenadefaites-vous annoncer chez le princeet dites-lui: Hier soirj'ai fait auprès de vous le service de ministreje vous ai donné des conseilsetpar vos ordresj'ai encouru le déplaisir de la princesse; il faut que vous me payiez. Il s'attendra à une demande d'argentet froncera le sourcil; vous le laisserez plongé dans cette idée malheureuse le plus longtemps que vous pourrez; puis vous direz: Je prie Votre Altesse d'ordonner que Fabrice soit jugé contradictoirement (ce qui veut dire lui présent) par les douze juges les plus respectés de vos états. Etsans perdre de tempsvous lui présenterez à signer une petite ordonnance écrite de votre belle mainet que je vais vous dicter; je vais mettrebien entendula clause que la première sentence est annulée. A celail n'y a qu'une objection; maissi vous menez l'affaire chaudementelle ne viendra pas à l'esprit du prince. Il peut vous dire: Il faut que Fabrice se constitue prisonnier à la citadelle. A quoi vous répondrez: Il se constituera prisonnier à la prison de la ville (vous savez que j'y suis le maîtretous les soirsvotre neveu viendra vous voir). Si le prince vous répond: Nonsa fuite a écorné l'honneur de ma citadelleet je veuxpour la formequ'il rentre dans la chambre où il était; vous répondrez à votre tour: Noncar là il serait à la disposition de mon ennemi Rassi; etpar une de ces phrases de femme que vous savez si bien lancervous lui ferez entendre quepour fléchir Rassivous pourrez bien lui raconter l'auto-da-fé de cette nuit; s'il insistevous annoncerez que vous allez passer quinze jours à votre château de Sacca.
Vous allez faire appeler Fabrice et le consulter sur cette démarche qui peut le conduire en prison. Pour tout prévoirsipendant qu'il est sous les verrousRassitrop impatientme fait empoisonnerFabrice peut courir des dangers. Mais la chose est peu probable; vous savez que j'ai fait venir un cuisinier françaisqui est le plus gai des hommeset qui fait des calembours; orle calembour est incompatible avec l'assassinat. J'ai déjà dit à notre ami Fabrice que j'ai retrouvé tous les témoins de son action belle et courageuse; ce fut évidemment ce Giletti qui voulut l'assassiner. Je ne vous ai pas parlé de ces témoinsparce que je voulais vous faire une surprisemais ce plan a manqué; le prince n'a pas voulu signer. J'ai dit à notre Fabrice quecertainementje lui procurerai une grande place ecclésiastique; mais j'aurai bien de la peine si ses ennemis peuvent objecter en cour de Rome une accusation d'assassinat.
Sentez-vousMadameques'il n'est pas jugé de la façon la plus solennelletoute sa vie le nom de Giletti sera désagréable pour lui? Il y aurait une grande pusillanimité à ne pas se faire jugerquand on est sûr d'être innocent. D'ailleursfût-il coupableje le ferais acquitter. Quand je lui ai parléle bouillant jeune homme ne m'a pas laissé acheveril a pris l'almanach officielet nous avons choisi ensemble les douze juges les plus intègres et les plus savants; la liste faitenous avons effacé six nomsque nous avons remplacés par six jurisconsultesmes ennemis personnelsetcomme nous n'avons pu trouver que deux ennemisnous y avons suppléé par quatre coquins dévoués à Rassi.
Cette proposition du comte inquiéta mortellement la duchesseet non sans cause; enfinelle se rendit à la raisonetsous la dictée du ministreécrivit l'ordonnance qui nommait les juges.
Le comte ne la quitta qu'à six heures du matin; elle essaya de dormirmais en vain. A neuf heureselle déjeuna avec Fabricequ'elle trouva brûlant d'envie d'être jugé; à dix heureselle était chez la princessequi n'était point visible; à onze heureselle vit le princequi tenait son leveret qui signa l'ordonnance sans la moindre objection. La duchesse envoya l'ordonnance au comteet se mit au lit.
Il serait peut-être plaisant de raconter la fureur de Rassiquand le comte l'obligea à contresigneren présence du princel'ordonnance signée le matin par celui-ci; mais les événements nous pressent.
Le comte discuta le mérite de chaque jugeet offrit de changer les noms. Mais le lecteur est peut-être un peu las de tous ces détails de procédurenon moins que de toutes ces intrigues de cour. De tout cecion peut tirer cette moraleque l'homme qui approche de la cour compromet son bonheurs'il est heureuxetdans tous les casfait dépendre son avenir des intrigues d'une femme de chambre.
D'un autre côtéen Amériquedans la républiqueil faut s'ennuyer toute la journée à faire une cour sérieuse aux boutiquiers de la rueet devenir aussi bête qu'euxet làpas d'Opéra.
La duchesseà son lever du soireut un moment de vive inquiétude: on ne trouvait plus Fabrice; enfinvers minuitau spectacle de la courelle reçut une lettre de lui. Au lieu de se constituer prisonnier à la prison de la villeoù le comte était le maîtreil était allé reprendre son ancienne chambre à la citadelletrop heureux d'habiter à quelques pas de Clélia.
Ce fut un événement d'une immense conséquence: en ce lieu il était exposé au poison plus que jamais. Cette folie mit la duchesse au désespoir; elle en pardonna la causeun fol amour pour Cléliaparce que décidément dans quelques jours elle allait épouser le riche marquis Crescenzi. Cette folie rendit à Fabrice toute l'influence qu'il avait eue jadis sur l'âme de la duchesse.
C'est ce maudit papier que je suis allée faire signer qui lui donnera la mort! Que ces hommes sont fous avec leurs idées d'honneur! Comme s'il fallait songer à l'honneur dans les gouvernements absolusdans les pays où un Rassi est ministre de la justice! Il fallait bel et bien accepter la grâce que le prince eût signée tout aussi facilement que la convocation de ce tribunal extraordinaire. Qu'importeaprès toutqu'un homme de la naissance de Fabrice soit plus ou moins accusé d'avoir tué lui-mêmeet l'épée au poingun histrion tel que Giletti!
A peine le billet de Fabrice reçula duchesse courut chez le comtequ'elle trouva tout pâle.
-- Grand Dieu! chère amiej'ai la main malheureuse avec cet enfantet vous allez encore m'en vouloir. Je puis vous prouver que j'ai fait venir hier soir le geôlier de la prison de la ville; tous les joursvotre neveu serait venu prendre du thé chez vous. Ce qu'il y a d'affreuxc'est qu'il est impossible à vous et à moi de dire au prince que l'on craint le poisonet le poison administré par Rassi; ce soupçon lui semblerait le comble de l'immoralité. Toutefoissi vous l'exigezje suis prêt à monter au palais; mais je suis sûr de la réponse. Je vais vous dire plus; je vous offre un moyen que je n'emploierais pas pour moi. Depuis que j'ai le pouvoir en ce paysje n'ai pas fait périr un seul hommeet vous savez que je suis tellement nigaud de ce côté-làque quelquefoisà la chute du jourje pense encore à ces deux espions que je fis fusiller un peu légèrement en Espagne. Eh bien; voulez- vous que je vous défasse de Rassi? Le danger qu'il fait courir à Fabrice est sans bornes; il tient là un moyen sûr de me faire déguerpir.
Cette proposition plut extrêmement à la duchesse; mais elle ne l'adopta pas.
-- Je ne veux pasdit-elle au comtequedans notre retraitesous ce beau ciel de Naplesvous ayez des idées noires le soir.
-- Maischère amieil me semble que nous n'avons que le choix des idées noires. Que devenez-vousque deviens-je moi-mêmesi Fabrice est emporté par une maladie?
La discussion reprit de plus belle sur cette idéeet la duchesse la termina par cette phrase:
-- Rassi doit la vie à ce que je vous aime mieux que Fabrice; nonje ne veux pas empoisonner toutes les soirées de la vieillesse que nous allons passer ensemble.
La duchesse courut à la forteresse; le général Fabio Conti fut enchanté d'avoir à lui opposer le texte formel des lois militaires: personne ne peut pénétrer dans une prison d'état sans un ordre signé du prince.
-- Mais le marquis Crescenzi et ses musiciens viennent chaque jour à la citadelle?
-- C'est que j'ai obtenu pour eux un ordre du prince.
La pauvre duchesse ne connaissait pas tous ses malheurs. Le général Fabio Conti s'était regardé comme personnellement déshonoré par la fuite de Fabrice: lorsqu'il le vit arriver à la citadelleil n'eût pas dû le recevoircar il n'avait aucun ordre pour cela. Maisse dit-ilc'est le ciel qui me l'envoie pour réparer mon honneur et me sauver du ridicule qui flétrirait ma carrière militaire. Il s'agit de ne pas manquer à l'occasion: sans doute on va l'acquitteret je n'ai que peu de jours pour me venger.
Livre Second
Chapitre XXV.
L'arrivée de notre héros mit Clélia au désespoir: la pauvre fillepieuse et sincère avec elle-mêmene pouvait se dissimuler qu'il n'y aurait jamais de bonheur pour elle loin de Fabrice; mais elle avait fait voeu à la Madonelors du demi- empoisonnement de son pèrede faire à celui-ci le sacrifice d'épouser le marquis Crescenzi. Elle avait fait le voeu de ne jamais revoir Fabriceet déjà elle était en proie aux remords les plus affreuxpour l'aveu auquel elle avait été entraînée dans la lettre qu'elle avait écrite à Fabrice la veille de sa fuite. Comment peindre ce qui se passa dans ce triste coeur lorsqueoccupée mélancoliquement à voir voltiger ses oiseauxet levant les yeux par habitude et avec tendresse vers la fenêtre de laquelle autrefois Fabrice la regardaitelle l'y vit de nouveau qui la saluait avec un tendre respect.
Elle crut à une vision que le ciel permettait pour la punir; puis l'atroce réalité apparut à sa raison. Ils l'ont reprisse dit-elleet il est perdu! Elle se rappelait les propos tenus dans la forteresse après la fuite; les derniers des geôliers s'estimaient mortellement offensés. Clélia regarda Fabriceet malgré ellece regard peignit en entier la passion qui la mettait au désespoir.
Croyez-voussemblait-elle dire à Fabriceque je trouverai le bonheur dans ce palais somptueux qu'on prépare pour moi? Mon père me répète à satiété que vous êtes aussi pauvre que nous; maisgrand Dieu! avec quel bonheur je partagerais cette pauvreté! Maishélas! nous ne devons jamais nous revoir.
Clélia n'eut pas la force d'employer les alphabets: en regardant Fabrice elle se trouva mal et tomba sur une chaise à côté de la fenêtre. Sa figure reposait sur l'appui de cette fenêtre; etcomme elle avait voulu le voir jusqu'au dernier momentson visage était tourné vers Fabricequi pouvait l'apercevoir en entier. Lorsque après quelques instants elle rouvrit les yeuxson premier regard fut pour Fabrice: elle vit des larmes dans ses yeux; mais ces larmes étaient l'effet de l'extrême bonheur; il voyait que l'absence ne l'avait point fait oublier. Les deux pauvres jeunes gens restèrent quelque temps comme enchantés dans la vue l'un de l'autre. Fabrice osa chantercomme s'il s'accompagnait de la guitarequelques mots improvisés et qui disaient: C'est pour vous revoir ; que je suis revenu en prison: on va me juger.
Ces mots semblèrent réveiller toute la vertu de Clélia: elle se leva rapidementse cacha les yeuxetpar les gestes les plus vifschercha à lui exprimer qu'elle ne devait jamais le revoir; elle l'avait promis à la Madoneet venait de le regarder par oubli. Fabrice osant encore exprimer son amourClélia s'enfuit indignée et se jurant à elle-même que jamais elle ne le reverraitcar tels étaient les termes précis de son voeu à la Madone: Mes yeux ne le reverront jamais. Elle les avait inscrits dans un petit papier que son oncle Cesare lui avait permis de brûler sur l'autel au moment de l'offrandetandis qu'il disait la messe.
Maismalgré tous les sermentsla présence de Fabrice dans la tour Farnèse avait rendu à Clélia toutes ses anciennes façons d'agir. Elle passait ordinairement toutes ses journées seuledans sa chambre. A peine remise du trouble imprévu où l'avait jetée la vue de Fabriceelle se mit à parcourir le palaiset pour ainsi dire à renouveler connaissance avec tous ses amis subalternes. Une vieille femme très bavarde employée à la cuisine lui dit d'un air de mystère: Cette fois-cile seigneur Fabrice ne sortira pas de la citadelle.
-- Il ne commettra plus la faute de passer par-dessus les mursdit Clélia; mais il sortira par la portes'il est acquitté.
-- Je dis et je puis dire à Votre Excellence qu'il ne sortira que les pieds les premiers de la citadelle.
Clélia pâlit extrêmementce qui fut remarqué de la vieille femmeet arrêta tout court son éloquence. Elle se dit qu'elle avait commis une imprudence en parlant ainsi devant la fille du gouverneurdont le devoir allait être de dire à tout le monde que Fabrice était mort de maladie. En remontant chez elleClélia rencontra le médecin de la prisonsorte d'honnête homme timide qui lui dit d'un air tout effaré que Fabrice était bien malade. Clélia pouvait à peine se soutenirelle chercha partout son onclele bon abbé don Cesareet enfin le trouva à la chapelleoù il priait avec ferveur; il avait la figure renversée. Le dîner sonna. A tableil n'y eut pas une parole d'échangée entre les deux frères; seulementvers la fin du repasle général adressa quelques mots fort aigres à son frère. Celui-ci regarda les domestiquesqui sortirent.
-- Mon généraldit don Cesare au gouverneurj'ai l'honneur de vous prévenir que je vais quitter la citadelle: je donne ma démission.
-- Bravo! bravissimo! pour me rendre suspect!... Et la raisons'il vous plaît?
-- Ma conscience.
-- Allezvous n'êtes qu'un cabotin! vous ne connaissez rien à l'honneur.
Fabrice est mortse dit Clélia; on l'a empoisonné à dînerou c'est pour demain. Elle courut à la volièrerésolue de chanter en s'accompagnant avec le piano. Je me confesseraise dit-elleet l'on me pardonnera d'avoir violé mon voeu pour sauver la vie d'un homme. Quelle ne fut pas sa consternation lorsquearrivée à la volièreelle vit que les abat-jour venaient d'être remplacés par des planches attachées aux barreaux de fer! Eperdueelle essaya de donner un avis au prisonnier par quelques mots plutôt criés que chantés. Il n'y eut de réponse d'aucune sorte; un silence de mort régnait déjà dans la tour Farnèse. Tout est consommése dit-elle. Elle descendit hors d'elle-mêmepuis remonta afin de se munir du peu d'argent qu'elle avait et de petites boucles d'oreilles en diamants; elle prit aussien passantle pain qui restait du dîneret qui avait été placé dans un buffet. S'il vit encoremon devoir est de le sauver. Elle s'avança d'un air hautain vers la petite porte de la tour; cette porte était ouverteet l'on venait seulement de placer huit soldats dans la pièce aux colonnes du rez-de-chaussée. Elle regarda hardiment ces soldats; Clélia comptait adresser la parole au sergent qui devait les commander: cet homme était absent. Clélia s'élança sur le petit escalier de fer qui tournait en spirale autour d'une colonne; les soldats la regardèrent d'un air fort ébahimaisapparemment à cause de son châle de dentelle et de son chapeaun'osèrent rien lui dire. Au premier étage il n'y avait personne; mais en arrivant au secondà l'entrée du corridor quisi le lecteur s'en souvientétait fermé par trois portes en barreaux de fer et conduisait à la chambre de Fabriceelle trouva un guichetier à elle inconnuet qui lui dit d'un air effaré:
-- Il n'a pas encore dîné.
-- Je le sais biendit Clélia avec hauteur. Cet homme n'osa l'arrêter. Vingt pas plus loinClélia trouva assis sur la première des six marches en bois qui conduisaient à la chambre de Fabrice un autre guichetier fort âgé et fort rouge qui lui dit résolument:
-- Mademoiselleavez-vous un ordre du gouverneur?
-- Est-ce que vous ne me connaissez pas?
Cléliaen ce momentétait animée d'une force surnaturelleelle était hors d'elle- même. Je vais sauver mon marise disait-elle.
Pendant que le vieux guichetier s'écriait: Mais mon devoir ne me permet pas... Clélia montait rapidement les six marches; elle se précipita contre la porte: une clef énorme était dans la serrure; elle eut besoin de toutes ses forces pour la faire tourner. A ce momentle vieux guichetier à demi ivre saisissait le bas de sa robe; elle entra vivement dans la chambrereferma la porte en déchirant sa robeetcomme le guichetier la poussait pour entrer après elleelle la ferma avec un verrou qui se trouvait sous sa main. Elle regarda dans la chambre et vit Fabrice assis devant une fort petite table où était son dîner. Elle se précipita sur la tablela renversaetsaisissant le bras de Fabricelui dit:
-- As-tu mangé?
Ce tutoiement ravit Fabrice. Dans son troubleClélia oubliait pour la première fois la retenue féminineet laissait voir son amour.
Fabrice allait commencer ce fatal repas: il la prit dans ses bras et la couvrit de baisers. Ce dîner était empoisonnépensa-t-il: si je lui dis que je n'y ai pas touchéla religion reprend ses droits et Clélia s'enfuit. Si elle me regarde au contraire comme un mourantj'obtiendrai d'elle qu'elle ne me quitte point. Elle désire trouver un moyen de rompre son exécrable mariagele hasard nous le présente: les geôliers vont s'assemblerils enfonceront la porteet voici une esclandre telle que peut-être le marquis Crescenzi en sera effrayéet le mariage rompu.
Pendant l'instant de silence occupé par ces réflexionsFabrice sentit que déjà Clélia cherchait à se dégager de ses embrassements.
-- Je ne me sens point encore de douleurslui dit-ilmais bientôt elles me renverseront à tes pieds; aide moi à mourir.
-- O mon unique ami! lui dit-elleje mourrai avec toi. Elle le serrait dans ses brascomme par un mouvement convulsif.
Elle était si belleà demi vêtue et dans cet état d'extrême passionque Fabrice ne put résister à un mouvement presque involontaire. Aucune résistance ne fut opposée.
Dans l'enthousiasme de passion et de générosité qui suit un bonheur extrêmeil lui dit étourdirnent:
-- Il ne faut pas qu'un indigne mensonge vienne souiller les premiers instants de notre bonheur: sans ton courage je ne serais plus qu'un cadavreou je me débattrais contre d'atroces douleurs; mais j'allais commencer à dîner lorsque tu es entréeet je n'ai point touché à ces plats.
Fabrice s'étendait sur ces images atroces pour conjurer l'indignation qu'il lisait dans les yeux de Clélia. Elle le regarda quelques instantscombattue par deux sentiments violents et opposéspuis elle se jeta dans ses bras. On entendit un grand bruit dans le corridoron ouvrait et on fermait avec violence les trois portes de feron parlait en criant.
-- Ah! si j'avais des armes! s'écria Fabrice; on me les a fait rendre pour me permettre d'entrer. Sans doute ils viennent pour m'achever! Adieuma Cléliaje bénis ma mort puisqu'elle a été l'occasion de mon bonheur. Clélia l'embrassa et lui donna un petit poignard à manche d'ivoiredont la lame n'était guère plus longue que celle d'un canif.
-- Ne te laisse pas tuerlui dit-elleet défends-toi jusqu'au dernier moment; si mon oncle l'abbé a entendu le bruitil a du courage et de la vertuil te sauvera; je vais leur parler. En disant ces mots elle se précipita vers la porte.
-- Si tu n'es pas tuédit-elle avec exaltationen tenant le verrou de la porteet tournant la tête de son côtélaisse-toi mourir de faim plutôt que de toucher à quoi que ce soit. Porte ce pain toujours sur toi. Le bruit s'approchaitFabrice la saisit à bras-le-corpsprit sa place auprès de la porteet ouvrant cette porte avec fureuril se précipita sur l'escalier de bois de six marches. Il avait à la main le petit poignard à manche d'ivoireet fut sur le point d'en percer le gilet du général Fontanaaide de camp du princequi recula bien viteen s'écriant tout effrayé: -- Mais je viens vous sauvermonsieur del Dongo.
Fabrice remonta les six marchesdit dans la chambre: Fontana vient me sauver ; puisrevenant près du général sur les marches de boiss'expliqua froidement avec lui. Il le pria fort longuement de lui pardonner un premier mouvement de colère. -- On voulait m'empoisonner; ce dîner qui est là devant moiest empoisonné; j'ai eu l'esprit de ne pas y touchermais je vous avouerai que ce procédé m'a choqué. En vous entendant monterj'ai cru qu'on venait m'achever à coups de dague... Monsieur le généralje vous requiers d'ordonner que personne n'entre dans ma chambre: on ôterait le poisonet notre bon prince doit tout savoir.
Le généralfort pâle et tout interdittransmit les ordres indiqués par Fabrice aux geôliers d'élite qui le suivaient: ces genstout penauds de voir le poison découvertse hâtèrent de descendre; ils prenaient les devantsen apparencepour ne pas arrêter dans l'escalier si étroit l'aide de camp du princeet en effet pour se sauver et disparaître. Au grand étonnement du général FontanaFabrice s'arrêta un gros quart d'heure au petit escalier de fer autour de la colonne du rez-de- chaussée; il voulait donner le temps à Clélia de se cacher au premier étage.
C'était la duchesse quiaprès plusieurs démarches follesétait parvenue à faire envoyer le général Fontana à la citadelle; elle y réussit par hasard. En quittant le comte Mosca aussi alarmé qu'elleelle avait couru au palais. La princessequi avait une répugnance marquée pour l'énergie qui lui semblait vulgairela crut folleet ne parut pas du tout disposée à tenter en sa faveur quelque démarche insolite. La duchessehors d'elle-mêmepleurait à chaudes larmeselle ne savait que répéter à chaque instant:
-- Maismadamedans un quart d'heure Fabrice sera mort par le poison!
En voyant le sang-froid parfait de la princesse la duchesse devint folle de douleur. Elle ne fit point cette réflexion moralequi n'eût pas échappé à une femme élevée dans une de ces religions du Nord qui admettent l'examen personnel: j'ai employé le poison la premièreet je péris par le poison. En Italie ces sortes de réflexionsdans les moments passionnés paraissent de l'esprit fort platcomme ferait à Paris un calembour en pareille circonstance.
La duchesseau désespoirhasarda d'aller dans le salon où se tenait le marquis Crescenzide service ce jour-là. Au retour de la duchesse à Parmeil l'avait remerciée avec effusion de la place de chevalier d'honneur à laquellesans elleil n'eût jamais pu prétendre. Les protestations de dévouement sans bornes n'avaient pas manqué de sa part. La duchesse l'aborda par ces mots:
-- Rassi va faire empoisonner Fabrice qui est à la citadelle. Prenez dans votre poche du chocolat et une bouteille d'eau que je vais vous donner. Montez à la citadelleet donnez-moi la vie en disant au général Fabio Conti que vous rompez avec sa fille s'il ne vous permet pas de remettre vous-même à Fabrice cette eau et ce chocolat.
Le marquis pâlitet sa physionomieloin d'être animée par ces motspeignit l'embarras le plus plat; il ne pouvait croire à un crime si épouvantable dans une ville aussi morale que Parmeet où régnait un si grand princeetc.; et encoreces platitudesil les disait lentement. En un motla duchesse trouva un homme honnêtemais faible au possible et ne pouvant se déterminer à agir. Après vingt phrases semblables interrompues par les cris d'impatience de Mme Sanseverinail tomba sur une idée excellente: le serment qu'il avait prêté comme chevalier d'honneur lui défendait de se mêler de manoeuvres contre le gouvernement.
Qui pourrait se figurer l'anxiété et le désespoir de la duchessequi sentait que le temps volait?
-- Maisdu moinsvoyez le gouverneurdites-lui que je poursuivrai jusqu'aux enfers les assassins de Fabrice!...
Le désespoir augmentait l'éloquence naturelle de la duchessemais tout ce feu ne faisait qu'effrayer davantage le marquis et redoubler son irrésolution; au bout d'une heureil était moins disposé à agir qu'au premier moment.
Cette femme malheureuseparvenue aux dernières limites du désespoiret sentant bien que le gouverneur ne refuserait rien à un gendre aussi richealla jusqu'à se jeter à ses genoux: alors la pusillanimité du marquis Crescenzi sembla augmenter encore; lui-mêmeà la vue de ce spectacle étrangecraignit d'être compromis sans le savoir; mais il arriva une chose singulière: le marquisbon homme au fondfut touché des larmes et de la positionà ses piedsd'une femme aussi belle et surtout aussi puissante.
Moi-mêmesi noble et si richese dit-ilpeut-être un jour je serai aussi aux genoux de quelque républicain! Le marquis se mit à pleureret enfin il fut convenu que la duchesseen sa qualité de grande maîtressele présenterait à la princessequi lui donnerait la permission de remettre à Fabrice un petit panier dont il déclarerait ignorer le contenu.
La veille au soiravant que la duchesse sût la folie faite par Fabrice d'aller à la citadelleon avait joué à la cour une comédiedell'arte ; et le princequi se réservait toujours les rôles d'amoureux à jouer avec la duchesseavait été tellement passionné en lui parlant de sa tendressequ'il eût été ridiculesien Italieun homme passionné ou un prince pouvait jamais l'être!
Le princefort timidemais toujours prenant fort au sérieux les choses d'amourrencontra dans l'un des corridors du château la duchesse qui entraînait le marquis Crescenzitout troubléchez la princesse. Il fut tellement surpris et ébloui par la beauté pleine d'émotion que le désespoir donnait à la grande maîtressequepour la première fois de sa vieil eut du caractère. D'un geste plus qu'impérieux il renvoya le marquis et se mit à faire une déclaration d'amour dans toutes les règles à la duchesse. Le prince l'avait sans doute arrangée longtemps à l'avancecar il y avait des choses assez raisonnables.
-- Puisque les convenances de mon rang me défendent de me donner le suprême bonheur de vous épouserje vous jurerai sur la sainte hostie consacréede ne jamais me marier sans votre permission par écrit. Je sens bienajoutait-ilque je vous fais perdre la main d'un premier ministrehomme d'esprit et fort aimable; mais enfin il a cinquante-six anset moi je n'en ai pas encore vingt-deux. Je croirais vous faire injure et mériter vos refus si je vous parlais des avantages étrangers à l'amour; mais tout ce qui tient à l'argent dans ma cour parle avec admiration de la preuve d'amour que le comte vous donneen vous laissant la dépositaire de tout ce qui lui appartient. Je serai trop heureux de l'imiter en ce point. Vous ferez un meilleur usage de ma fortune que moi-mêmeet vous aurez l'entière disposition de la somme annuelle que mes ministres remettent à l'intendant général de ma couronne; de façon que ce sera vousmadame la duchessequi déciderez des sommes que je pourrai dépenser chaque mois. La duchesse trouvait tous ces détails bien longs; les dangers de Fabrice lui perçaient le coeur.
-- Mais vous ne savez donc pasmon prince s'écria-t-ellequ'en ce momenton empoisonne Fabrice dans votre citadelle! Sauvez-le! je crois tout.
L'arrangement de cette phrase était d'une maladresse complète. Au seul mot de poisontout l'abandontoute la bonne foi que ce pauvre prince moral apportait dans cette conversation disparurent en un clin d'oeil; la duchesse ne s'aperçut de cette maladresse que lorsqu'il n'était plus temps d'y remédieret son désespoir fut augmentéchose qu'elle croyait impossible. Si je n'eusse pas parlé de poisonse dit-elleil m'accordait la liberté de Fabrice. O cher Fabrice! ajouta-t-elleil est donc écrit que c'est moi qui dois te percer le coeur par mes sottises!
La duchesse eut besoin de beaucoup de temps et de coquetteries pour faire revenir le prince à ses propos d'amour passionné; mais il resta profondément effarouché. C'était son esprit seul qui parlait; son âme avait été glacée par l'idée du poison d'abordet ensuite par cette autre idéeaussi désobligeante que la première était terrible: on administre du poison dans mes étatset cela sans me le dire! Rassi veut donc me déshonorer aux yeux de l'Europe! Et Dieu sait ce que je lirai le mois prochain dans les journaux de Paris!
Tout à coup l'âme de ce jeune homme si timide se taisantson esprit arriva à une idée.
-- Chère duchesse! vous savez si je vous suis attaché. Vos idées atroces sur le poison ne sont pas fondéesj'aime à le croire; mais enfin elles me donnent aussi à penserelles me font presque oublier pour un instant la passion que j'ai pour vouset qui est la seule que de ma vie j'ai éprouvée. Je sens que je ne suis pas aimable; je ne suis qu'un enfant bien amoureux; mais enfin mettez-moi à l'épreuve.
Le prince s'animait assez en tenant ce langage.
-- Sauvez Fabriceet je crois tout! Sans doute je suis entraînée par les craintes folles d'une âme de mère; mais envoyez à l'instant chercher Fabrice à la citadelleque je le voie. S'il vit encoreenvoyez-le du palais à la prison de la villeoù il restera des mois entierssi Votre Altesse l'exigeet jusqu'à son jugement.
La duchesse vit avec désespoir que le princeau lieu d'accorder d'un mot une chose aussi simpleétait devenu sombre; il était fort rougeil regardait la duchessepuis baissait les yeux et ses joues pâlissaient. L'idée de poisonmal à propos mise en avantlui avait suggéré une idée digne de son père ou de Philippe II: mais il n'osait l'exprimer.
-- Tenezmadamelui dit-il enfin comme se faisant violenceet d'un ton fort peu gracieuxvous me méprisez comme un enfantet de pluscomme un être sans grâces: eh bien! je vais vous dire une chose horriblemais qui m'est suggérée à l'instant par la passion profonde et vraie que j'ai pour vous. Si je croyais le moins du monde au poisonj'aurais déjà agimon devoir m'en faisait une loi; mais je ne vois dans votre demande qu'une fantaisie passionnéeet dont peut-êtreje vous demande la permission de le direje ne vois pas toute la portée. Vous voulez que j'agisse sans consulter mes ministresmoi qui règne depuis trois mois à peine! vous me demandez une grande exception à ma façon d'agir ordinaireet que je crois fort raisonnableje l'avoue. C'est vousmadamequi êtes ici en ce moment le souverain absoluvous me donnez des espérances pour l'intérêt qui est tout pour moi; maisdans une heurelorsque cette imagination de poisonlorsque ce cauchemar aura disparuma présence vous deviendra importunevous me disgracierezmadame. Eh bien! il me faut un serment: jurez madameque si Fabrice vous est rendu sain et saufj'obtiendrai de vousd'ici à trois moistout ce que mon amour peut désirer de plus heureux; vous assurerez le bonheur de ma vie entière en mettant à ma disposition une heure de la vôtreet vous serez toute à moi.
En cet instantl'horloge du château sonna deux heures. Ah! il n'est plus temps peut-êtrese dit la duchesse.
-- Je le jures'écria-t-elle avec des yeux égarés.
Aussitôt le prince devint un autre homme; il courut à l'extrémité de la galerie où se trouvait le salon des aides de camp.
-- Général Fontanacourez à la citadelle ventre à terremontez aussi vite que possible à la chambre où l'on garde M. del Dongo et amenez-le-moiil faut que je lui parle dans vingt minuteset dans quinze s'il est possible.
-- Ah! générals'écria la duchesse qui avait suivi le princeune minute peut décider de ma vie. Un rapport faux sans doute me fait craindre le poison pour Fabrice: criez-lui dès que vous serez à portée de la voixde ne pas manger. S'il a touché à son repasfaites-le vomirdites-lui que c'est moi qui le veuxemployez la force s'il le faut; dites-lui que je vous suis de bien prèset croyez-moi votre obligée pour la vie.
-- Madame la duchessemon cheval est selléje passe pour savoir manier un chevalet je cours ventre à terreje serai à la citadelle huit minutes avant vous.
-- Et moimadame la duchesses'écria le princeje vous demande quatre de ces huit minutes.
L'aide de camp avait disparuc'était un homme qui n'avait pas d'autre mérite que celui de monter à cheval. A peine eut-il refermé la porteque le jeune prince qui semblait avoir du caractèresaisit la main de la duchesse.
-- Daignezmadamelui dit-il avec passionvenir avec moi à la chapelle.
La duchesseinterdite pour la première fois de sa viele suivit sans mot dire. Le prince et elle parcoururent en courant toute la longueur de la grande galerie du palaisla chapelle se trouvant à l'autre extrémité. Entré dans la chapellele prince se mit à genouxpresque autant devant la duchesse que devant l'autel.
-- Répétez le sermentdit-il avec passion; si vous aviez été justesi cette malheureuse qualité de prince ne m'eût pas nuivous m'eussiez accordé par pitié pour mon amour ce que vous me devez maintenant parce que vous l'avez juré.
-- Si je revois Fabrice non empoisonnés'il vit encore dans huit jourssi Son Altesse le nomme coadjuteur avec future succession de l'archevêque Landrianimon honneurma dignité de femmetout par moi sera foulé aux piedset je serai à Son Altesse.
-- Maischère amiedit le prince avec une timide anxiété et une tendresse mélangées et bien plaisantesje crains quelque embûche que je ne comprends paset qui pourrait détruire mon bonheur; j'en mourrais. Si l'archevêque m'oppose quelqu'une de ces raisons ecclésiastiques qui font durer les affaires des années entièresqu'est-ce que je deviens? Vous voyez que j'agis avec une entière bonne foi; allez-vous être avec moi un petit jésuite?
-- Non: de bonne foisi Fabrice est sauvéside tout votre pouvoirvous le faites coadjuteur et futur archevêqueje me déshonore et je suis à vous.
Votre Altesse s'engage à mettre approuvé en marge d'une demande que monseigneur l'archevêque vous présentera d'ici à huit jours.
-- Je vous signe un papier en blancrégnez sur moi et sur mes étatss'écria le prince rougissant de bonheur et réellement hors de lui. Il exigea un second serment. Il était tellement émuqu'il en oubliait la timidité qui lui était si naturelleetdans cette chapelle du palais où ils étaient seulsil dit à voix basse à la duchesse des choses quidites trois jours auparavantauraient changé l'opinion qu'elle avait de lui. Mais chez elle le désespoir que lui causait le danger de Fabrice avait fait place à l'horreur de la promesse qu'on lui avait arrachée.
La duchesse était bouleversée de ce qu'elle venait de faire. Si elle ne sentait pas encore toute l'affreuse amertume du mot prononcéc'est que son attention était occupée à savoir si le général Fontana pourrait arriver à temps à la citadelle.
Pour se délivrer des propos follement tendres de cet enfant et changer un peu le discourselle loua un tableau célèbre du Parmesanqui était au maître-autel de cette chapelle.
-- Soyez assez bonne pour me permettre de vous l'envoyerdit le prince.
-- J'acceptereprit la duchesse; mais souffrez que je coure au-devant de Fabrice.
D'un air égaréelle dit à son cocher de mettre ses chevaux au galop. Elle trouva sur le pont du fossé de la citadelle le général Fontana et Fabricequi sortaient à pied.
-- As-tu mangé?
-- Nonpar miracle.
La duchesse se jeta au cou de Fabriceet tomba dans un évanouissement qui dura une heure et donna des craintes d'abord pour sa vieet ensuite pour sa raison.
Le gouverneur Fabio Conti avait pâli de colère à la vue du général Fontana: il avait apporté de telles lenteurs à obéir à l'ordre du princeque l'aide de campqui supposait que la duchesse allait occuper la place de maîtresse régnanteavait fini par se fâcher. Le gouverneur comptait faire durer la maladie de Fabrice deux ou trois jourset voilàse disait-ilque le généralun homme de la courva trouver cet insolent se débattant dans les douleurs qui me vengent de sa fuite.
Fabio Contitout pensifs'arrêta dans le corps de garde du rez-de-chaussée de la tour Farnèsed'où il se hâta de renvoyez les soldats; il ne voulait pas de témoins à la scène qui se préparait. Cinq minutes après il fut pétrifié d'étonnement en entendant parler Fabriceet le voyantvif et alertefaire au général Fontana la description de la prison. Il disparut.
Fabrice se montra un parfait gentleman dans son entrevue avec le prince. D'abord il ne voulut point avoir l'air d'un enfant qui s'effraie à propos de rien. Le prince lui demandant avec bonté comment il se trouvait: -- Comme un hommeAltesse Sérénissimequi meurt de faimn'ayant par bonheur ni déjeunéni dîné. Après avoir eu l'honneur de remercier le princeil sollicita la permission de voir l'archevêque avant de se rendre à la prison de la ville. Le prince était devenu prodigieusement pâlelorsque arriva dans sa tête d'enfant l'idée que le poison n'était point tout à fait une chimère de l'imagination de la duchesse. Absorbé dans cette cruelle penséeil ne répondit pas d'abord à la demande de voir l'archevêqueque Fabrice lui adressait; puis il se crut obligé de réparer sa distraction par beaucoup de grâces.
-- Sortez seulmonsieurallez dans les rues de ma capitale sans aucune garde. Vers les dix ou onze heures vous vous rendrez en prisonoù j'ai l'espoir que vous ne resterez pas longtemps.
Le lendemain de cette grande journéela plus remarquable de sa viele prince se croyait un petit Napoléon; il avait lu que ce grand homme avait été bien traité par plusieurs des jolies femmes de sa cour. Une fois Napoléon par les bonnes fortunesil se rappela qu'il l'avait été devant les balles. Son coeur était encore tout transporté de la fermeté de sa conduite avec la duchesse. La conscience d'avoir fait quelque chose de difficile en fit un tout autre homme pendant quinze jours; il devint sensible aux raisonnements généreux; il eut quelque caractère.
Il débuta ce jour-là par brûler la patente de comte dressée en faveur de Rassiqui était sur son bureau depuis un mois. Il destitua le général Fabio Contiet demanda au colonel Langeson successeurla vérité sur le poison. Langebrave militaire polonaisfit peur aux geôlierset dit au prince qu'on avait voulu empoisonner le déjeuner de M. del Dongo; mais il eût fallu mettre dans la confidence un trop grand nombre de personnes. Les mesures furent mieux prises pour le dîner; etsans l'arrivée du général FontanaM. del Dongo était perdu. Le prince fut consterné; maiscomme il était réellement fort amoureuxce fut une consolation pour lui de pouvoir se dire: Il se trouve que j'ai réellement sauvé la vie à M. del Dongoet la duchesse n'osera pas manquer à la parole qu'elle m'a donnée. Il arriva à une autre idée: Mon métier est bien plus difficile que je ne le pensais; tout le monde convient que la duchesse a infiniment d'espritla politique est ici d'accord avec mon coeur. Il serait divin pour moi qu'elle voulût être mon premier ministre.
Le soirle prince était tellement irrité des horreurs qu'il avait découvertesqu'il ne voulut pas se mêler de la comédie.
-- Je serais trop heureuxdit-il à la duchessesi vous vouliez régner sur mes états comme vous régnez sur mon coeur. Pour commencerje vais vous dire l'emploi de ma journée. Alors il lui conta tout fort exactement: la brûlure de la patente de comte de Rassila nomination de Langeson rapport sur l'empoisonnementetc.etc. Je me trouve bien peu d'expérience pour régner. Le comte m'humilie par ses plaisanteriesil plaisante même au conseiletdans le mondeil tient des propos dont vous allez contester la vérité; il dit que je suis un enfant qu'il mène où il veut. Pour être princemadameon n'en est pas moins hommeet ces choses-là fâchent. Afin de donner de l'invraisemblance aux histoires que peut faire M. Moscal'on m'a fait appeler au ministère ce dangereux coquin Rassiet voilà ce général Conti qui le croit encore tellement puissantqu'il n'ose avouer que c'est lui ou la Raversi qui l'ont engagé à faire périr votre neveu; j'ai bonne envie de renvoyer tout simplement par-devant les tribunaux le général Fabio Conti; les juges verront s'il est coupable de tentative d'empoisonnement.
-- Maismon princeavez-vous des juges?
-- Comment? dit le prince étonné.
-- Vous avez des jurisconsultes savants et qui marchent dans la rue d'un air grave; du resteils jugeront toujours comme il plaira au parti dominant dans votre cour.
Pendant que le jeune princescandaliséprononçait des phrases qui montraient sa candeur bien plus que sa sagacitéla duchesse se disait:
-- Me convient-il bien de laisser déshonorer Conti? Noncertainementcar alors le mariage de sa fille avec ce plat honnête homme de marquis Crescenzi devient impossible.
Sur ce sujetil y eut un dialogue infini entre la duchesse et le prince. Le prince fut ébloui d'admiration. En faveur du mariage de Clélia Conti avec le marquis Crescenzimais avec cette condition expresse par lui déclarée avec colère à l'ex- gouverneuril lui fit grâce sur sa tentative d'empoisonnement; maispar l'avis de la duchesseil l'exila jusqu'à l'époque du mariage de sa fille. La duchesse croyait n'aimer plus Fabrice d'amourmais elle désirait encore passionnément le mariage de Clélia Conti avec le marquis; il y avait là le vague espoir que peu à peu elle verrait disparaître la préoccupation de Fabrice.
Le princetransporté de bonheurvoulaitce soir-làdestituer avec scandale le ministre Rassi. La duchesse lui dit en riant:
-- Savez-vous un mot de Napoléon? Un homme placé dans un lieu élevéet que tout le monde regardene doit point se permettre de mouvements violents. Mais ce soir il est trop tardrenvoyons les affaires à demain.
Elle voulait se donner le temps de consulter le comteauquel elle raconta fort exactement tout le dialogue de la soiréeen supprimanttoutefoisles fréquentes allusions faites par le prince à une promesse qui empoisonnait sa vie. La duchesse se flattait de se rendre tellement nécessaire qu'elle pourrait obtenir un ajournement indéfini en disant au prince: Si vous avez la barbarie de vouloir me soumettre à cette humiliationque je ne vous pardonnerais pointle lendemain je quitte vos états.
Consulté par la duchesse sur le sort de Rassile comte se montra très philosophe. Le général Fabio Conti et lui allèrent voyager en Piémont.
Une singulière difficulté s'éleva pour le procès de Fabrice: les juges voulaient l'acquitter par acclamationet dès la première séance. Le comte eut besoin d'employer la menace pour que le procès durât au moins huit jourset que les juges se donnassent la peine d'entendre tous les témoins. Ces gens sont toujours les mêmesse dit-il.
Le lendemain de son acquittementFabrice del Dongo prit enfin possession de la place de grand vicaire du bon archevêque Landriani. Le même jourle prince signa les dépêches nécessaires pour obtenir que Fabrice fût nommé coadjuteur avec future successionetmoins de deux mois aprèsil fut installé dans cette place.
Tout le monde faisait compliment à la duchesse sur l'air grave de son neveu; le fait est qu'il était au désespoir. Dès le lendemain de sa délivrancesuivie de la destitution et de l'exil du général Fabio Contiet de la haute faveur de la duchesseClélia avait pris refuge chez la comtesse Cantarinisa tantefemme fort richefort âgéeet uniquement occupée des soins de sa santé. Clélia eût pu voir Fabrice: mais quelqu'un qui eût connu ses engagements antérieurset qui l'eût vue agir maintenanteût pu penser qu'avec les dangers de son amant son amour pour lui avait cessé. Non seulement Fabrice passait le plus souvent qu'il le pouvait décemment devant le palais Cantarinimais encore il avait réussiaprès des peines infiniesà louer un petit appartement vis-à-vis les fenêtres du premier étage. Une foisClélia s'étant mise à la fenêtre à l'étourdiepour voir passer une processionse retira à l'instantet comme frappée de terreur; elle avait aperçu Fabricevêtu de noirmais comme un ouvrier fort pauvrequi la regardait d'une des fenêtres de ce taudis qui avait des vitres de papier huilécomme sa chambre à la tour Farnèse. Fabrice eût bien voulu pouvoir se persuader que Clélia le fuyait par suite de la disgrâce de son pèreque la voix publique attribuait à la duchesse; mais il connaissait trop une autre cause de cet éloignementet rien ne pouvait le distraire de sa mélancolie.
Il n'avait été sensible ni à son acquittementni à son installation dans de belles fonctionsles premières qu'il eût eues à remplir dans sa vieni à sa belle position dans le mondeni enfin à la cour assidue que lui faisaient tous les ecclésiastiques et tous les dévots du diocèse. Le charmant appartement qu'il avait au palais Sanseverina ne se trouva plus suffisant. A son extrême plaisirla duchesse fut obligée de lui céder tout le second étage de son palais et deux beaux salons au premierlesquels étaient toujours remplis de personnages attendant l'instant de faire leur cour au jeune coadjuteur. La clause de future succession avait produit un effet surprenant dans le pays; on faisait maintenant des vertus à Fabrice de toutes ces qualités fermes de son caractèrequi autrefois scandalisaient si fort les courtisans pauvres et nigauds.
Ce fut une grande leçon de philosophie pour Fabrice que de se trouver parfaitement insensible à tous ces honneurset beaucoup plus malheureux dans cet appartement magnifiqueavec dix laquais portant sa livréequ'il n'avait été dans sa chambre de bois de la tour Farnèseenvironné de hideux geôlierset craignant toujours pour sa vie. Sa mère et sa soeurla duchesse V ***qui vinrent à Parme pour le voir dans sa gloirefurent frappées de sa profonde tristesse. La marquise del Dongomaintenant la moins romanesque des femmesen fut si profondément alarmée qu'elle crut qu'à la tour Farnèse on lui avait fait prendre quelque poison lent. Malgré son extrême discrétionelle crut devoir lui parler de cette tristesse si extraordinaireet Fabrice ne répondit que par des larmes.
Une foule d'avantagesconséquence de sa brillante positionne produisaient chez lui d'autre effet que de lui donner de l'humeur. Son frèrecette âme vaniteuse et gangrenée par le plus vil égoïsmelui écrivit une lettre de congratulation presque officielleet à cette lettre était joint un mandat de 50 000 francsafin qu'il pûtdisait le nouveau marquisacheter des chevaux et une voiture dignes de son nom. Fabrice envoya cette somme à sa soeur cadettemal mariée.
Le comte Mosca avait fait faire une belle traductionen italiende la généalogie de la famille Valserra del Dongopubliée jadis en latin par l'archevêque de ParmeFabrice. Il la fit imprimer magnifiquement avec le texte latin en regard; les gravures avaient été traduites par de superbes lithographies faites à Paris. La duchesse avait voulu qu'un beau portrait de Fabrice fût placé vis-à-vis celui de l'ancien archevêque. Cette traduction fut publiée comme étant l'ouvrage de Fabrice pendant sa première détention. Mais tout était anéanti chez notre hérosmême la vanité si naturelle à l'homme; il ne daigna pas lire une seule page de cet ouvrage qui lui était attribué. Sa position dans le monde lui fit une obligation d'en présenter un exemplaire magnifiquement relié au princequi crut lui devoir un dédommagement pour la mort cruelle dont il avait été si prèset lui accorda les grandes entrées de sa chambrefaveur qui donne l'excellence.
Livre Second
Chapitre XXVI.
Les seuls instants pendant lesquels Fabrice eut quelque chance de sortir de sa profonde tristesseétaient ceux qu'il passait caché derrière un carreau de vitrepar lequel il avait fait remplacer un carreau de papier huilé à la fenêtre de son appartement vis-à-vis le palais Contarinioùcomme on saitClélia s'était réfugiée; le petit nombre de fois qu'il l'avait vue depuis qu'il était sorti de la citadelleil avait été profondément affligé d'un changement frappantet qui lui semblait du plus mauvais augure. Depuis sa fautela physionomie de Clélia avait pris un caractère de noblesse et de sérieux vraiment remarquable; on eût dit qu'elle avait trente ans. Dans ce changement si extraordinaireFabrice aperçut le reflet de quelque ferme résolution. A chaque instant de la journéese disait-ilelle se jure à elle-même d'être fidèle au voeu qu'elle a fait à la Madoneet de ne jamais me revoir.
Fabrice ne devinait qu'en partie les malheurs de Clélia; elle savait que son pèretombé dans une profonde disgrâcene pouvait rentrer à Parme et reparaître à la cour (chose sans laquelle la vie était impossible pour lui) que le jour de son mariage avec le marquis de Crescenzielle écrivit à son père qu'elle désirait ce mariage. Le général était alors réfugié à Turinet malade de chagrin. A la véritéle contrecoup de cette grande résolution avait été de la vieillir de dix ans.
Elle avait fort bien découvert que Fabrice avait une fenêtre vis-à-vis le palais Contarini; mais elle n'avait eu le malheur de le regarder qu'une fois; dès qu'elle apercevait un air de tête ou une tournure d'homme ressemblant un peu à la sienneelle fermait les yeux à l'instant. Sa piété profonde et sa confiance dans le secours de la Madone étaient désormais ses seules ressources. Elle avait la douleur de ne pas avoir d'estime pour son père: le caractère de son futur mari lui semblait parfaitement plat et à la hauteur des façons de sentir du grand monde; enfinelle adorait un homme qu'elle ne devait jamais revoiret qui pourtant avait des droits sur elle. Cet ensemble de destinée lui semblait le malheur parfaitet nous avouerons qu'elle avait raison. Il eût falluaprès son mariagealler vivre à deux cents lieues de Parme.
Fabrice connaissait la profonde modestie de Clélia; il savait combien toute entreprise extraordinaireet pouvant faire anecdotesi elle était découverteétait assurée de lui déplaire. Toutefoispoussé à bout par l'excès de sa mélancolie et par ces regards de Clélia qui constamment se détournaient de luiil osa essayer de gagner deux domestiques de Mme Contarinisa tante. Un jourà la tombée de la nuitFabricehabillé comme un bourgeois de campagnese présenta à la porte du palaisoù l'attendait l'un des domestiques gagnés par lui; il s'annonça comme arrivant de Turinet ayant pour Clélia des lettres de son père. Le domestique alla porter son messageet le fit monter dans une immense antichambreau premier étage du palais. C'est en ce lieu que Fabrice passa peut-être le quart d'heure de sa vie le plus rempli d'anxiété. Si Clélia le repoussaitil n'y avait plus pour lui d'espoir de tranquillité. Afin de couper court aux soins importuns dont m'accable ma nouvelle dignitéj'ôterai à l'Eglise un mauvais prêtreetsous un nom supposéj'irai me réfugier dans quelque chartreuse. Enfin le domestique vint lui annoncer que Mlle Clélia Conti était disposée à le recevoir. Le courage manqua tout à fait à notre héros; il fut sur le point de tomber de peur en montant l'escalier du second étage.
Clélia était assise devant une petite table qui portait une seule bougie. A peine elle eut reconnu Fabrice sous son déguisementqu'elle prit la fuite et alla se cacher au fond du salon.
-- Voilà comment vous êtes soigneux de mon salutlui cria-t-elleen se cachant la figure avec les mains. Vous le savez pourtantlorsque mon père fut sur le point de périr par suite du poisonje fis voeu à la Madone de ne jamais vous voir. Je n'ai manqué à ce voeu que ce jourle plus malheureux de ma vie où je crus en conscience devoir vous soustraire à la mort. C'est déjà beaucoup quepar une interprétation forcée et sans doute criminelleje consente à vous entendre.
Cette dernière phrase étonna tellement Fabricequ'il lui fallut quelques secondes pour s'en réjouir. Il s'était attendu à la plus vive colèreet à voir Clélia enfuir; enfin la présence d'esprit lui revint et il éteignit la bougie unique. Quoiqu'il crût avoir bien compris les ordres de Cléliail était tout tremblant en avançant vers le fond du salon où elle s'était réfugiée derrière un canapé; il ne savait s'il ne l'offenserait pas en lui baisant la main; elle était toute tremblante d'amouret se jeta dans ses bras.
-- Cher Fabricelui dit-ellecombien tu as tardé de temps à venir! Je ne puis te parler qu'un instant car c'est sans doute un grand péché; et lorsque je promis de ne te voir jamaissans doute j'entendais aussi promettre de ne te point parler. Mais comment as-tu pu poursuivre avec tant de barbarie l'idée de vengeance qu'a eue mon pauvre père? car enfin c'est lui d'abord qui a été presque empoisonné pour faciliter ta fuite. Ne devais-tu pas faire quelque chose pour moi qui ai tant exposé ma bonne renommée afin de te sauver? Et d'ailleurs te voilà tout à fait lié aux ordres sacrés; tu ne pourrais plus m'épouser quand même je trouverais un moyen d'éloigner cet odieux marquis. Et puis comment as-tu oséle soir de la processionprétendre me voir en plein jouret violer ainside la façon la plus criantela sainte promesse que j'ai faite à la Madone?
Fabrice la serrait dans ses brashors de lui de surprise et de bonheur.
Un entretien qui commençait avec cette quantité de choses à se dire ne devait pas finir de longtemps. Fabrice lui raconta l'exacte vérité sur l'exil de son père; la duchesse ne s'en était mêlée en aucune sortepar la grande raison qu'elle n'avait pas cru un seul instant que l'idée du poison appartint au général Conti; elle avait toujours pensé que c'était un trait d'esprit de la faction Raversiqui voulait chasser le comte Mosca. Cette vérité historique longuement développée rendit Clélia fort heureuse; elle était désolée de devoir haïr quelqu'un qui appartenait à Fabrice. Maintenant elle ne voyait plus la duchesse d'un oeil jaloux.
Le bonheur que cette soirée établit ne dura que quelques jours.
L'excellent don Cesare arriva de Turin; etpuisant de la hardiesse dans la parfaite honnêteté de son coeuril osa se faire présenter à la duchesse. Après lui avoir demandé sa parole de ne point abuser de la confiance qu'il allait lui faireil avoua que son frèreabusé par un faux point d'honneuret qui s'était cru bravé et perdu dans l'opinion par la fuite de Fabriceavait cru devoir se venger.
Don Cesare n'avait pas parlé deux minutesque son procès était gagné: sa vertu parfaite avait touché la duchessequi n'était point accoutumée à un tel spectacle. Il lui plut comme nouveauté.
-- Hâtez le mariage de la fille du général avec le marquis Crescenziet je vous donne ma parole que je ferai tout ce qui est en moi pour que le général soit reçu comme s'il revenait de voyage. Je l'inviterai à dîner; êtes-vous content? Sans doute il y aura du froid dans les commencementset le général ne devra point se hâter de demander sa place de gouverneur de la citadelle. Mais vous savez que j'ai de l'amitié pour le marquiset je ne conserverai point de rancune contre son beau- père.
Armé de ces parolesdon Cesare vint dire à sa nièce qu'elle tenait en ses mains la vie de son pèremalade de désespoir. Depuis plusieurs mois il n'avait paru à aucune cour.
Clélia voulut aller voir son pèreréfugiésous un nom supposédans un village près de Turin; car il s'était figuré que la cour de Parme demandait son extradition à celle de Turinpour le mettre en jugement. Elle le trouva malade et presque fou. Le soir même elle écrivit à Fabrice une lettre d'éternelle rupture. En recevant cette lettreFabricequi développait un caractère tout à fait semblable à celui de sa maîtressealla se mettre en retraite au couvent de Vellejasitué dans les montagnes à dix lieues de Parme. Clélia lui écrivait une lettre de dix pages: elle lui avait juré jadis de ne jamais épouser le marquis sans son consentement; maintenant elle le lui demandaitet Fabrice le lui accorda du fond de sa retraite de Vellejapar une lettre remplie de l'amitié la plus pure.
En recevant cette lettre dontil faut l'avouerl'amitié l'irritaClélia fixa elle-même le jour de son mariagedont les fêtes vinrent encore augmenter l'éclat dont brilla cet hiver la cour de Parme.
Ranuce-Ernest V était avare au fond; mais il était éperdument amoureuxet il espérait fixer la duchesse à sa cour: il pria sa mère d'accepter une somme fort considérableet de donner des fêtes. La grande maîtresse sut tirer un admirable parti de cette augmentation de richesses; les fêtes de Parmecet hiver-làrappelèrent les beaux jours de la cour de Milan et de cet aimable prince Eugènevice-roi d'Italiedont la bonté laisse un si long souvenir.
Les devoirs du coadjuteur l'avaient rappelé à Parme mais il déclara quepar des motifs de piétéil continuerait sa retraite dans le petit appartement que son protecteurmonseigneur Landrianil'avait forcé de prendre à l'archevêché; et il alla s'y enfermersuivi d'un seul domestique. Ainsi il n'assista à aucune des fêtes si brillantes de la cource qui lui valut à Parme et dans son futur diocèse une immense réputation de sainteté. Par un effet inattendu de cette retraite qu'inspirait seule à Fabrice sa tristesse profonde et sans espoirle bon archevêque Landrianiqui l'avait toujours aiméet quidans le faitavait eu l'idée de le faire coadjuteurconçut contre lui un peu de jalousie. L'archevêque croyait avec raison devoir aller à toutes les fêtes de la courcomme il est d'usage en Italie. Dans ces occasionsil portait son costume de grande cérémoniequià peu de chose près est le même que celui qu'on lui voyait dans le choeur de sa cathédrale. Les centaines de domestiques réunis dans l'antichambre en colonnade du palais ne manquaient pas de se lever et de demander sa bénédiction à monseigneurqui voulait bien s'arrêter et la leur donner. Ce fut dans un de ces moments de silence solennel que monseigneur Landriani entendit une voix qui disait: Notre archevêque va au balet monsignore del Dongo ne sort pas de sa chambre!
De ce moment prit fin à l'archevêché l'immense faveur dont Fabrice y avait joui; mais il pouvait voler de ses propres ailes. Toute cette conduitequi n'avait été inspirée que par le désespoir où le plongeait le mariage de Cléliapassa pour l'effet d'une piété simple et sublimeet les dévotes lisaientcomme un livre d'édificationla traduction de la généalogie de sa familleoù perçait la vanité la plus folle. Les libraires firent une édition lithographiée de son portraitqui fut enlevée en quelques jourset surtout par les gens du peuple; le graveurpar ignoranceavait reproduit autour du portrait de Fabrice plusieurs des ornements qui ne doivent se trouver qu'aux portraits des évêqueset auxquels un coadjuteur ne saurait prétendre. L'archevêque vit un de ces portraitset sa fureur ne connut plus de bornes; il fit appeler Fabriceet lui adressa les choses les plus dureset dans des termes que la passion rendit quelquefois fort grossiers. Fabrice n'eut aucun effort à fairecomme on le pense bienpour se conduire comme l'eût fait Fénelon en pareille occurrence; il écouta l'archevêque avec toute l'humilité et tout le respect possibles; etlorsque ce prélat eut cessé de parleril lui raconta toute l'histoire de la traduction de cette généalogie faite par les ordres du comte Moscaà l'époque de sa première prison. Elle avait été publiée dans des fins mondaineset qui toujours lui avaient semblé peu convenables pour un homme de son état. Quant au portraitil avait été parfaitement étranger à la seconde éditioncomme à la première; et le libraire lui ayant adressé à l'archevêchépendant sa retraitevingt-quatre exemplaires de cette seconde éditionil avait envoyé son domestique en acheter un vingt-cinquième; etayant appris par ce moyen que ce portrait se vendait trente sousil avait envoyé cent francs comme paiement des vingt-quatre exemplaires.
Toutes ces raisonsquoique exposées du ton le plus raisonnable par un homme qui avait bien d'autres chagrins dans le coeurportèrent jusqu'à l'égarement la colère de l'archevêque; il alla jusqu'à accuser Fabrice d'hypocrisie.
-- Voilà ce que c'est que les gens du communse dit Fabricemême quand ils ont de l'esprit!
Il avait alors un souci plus sérieux; c'étaient les lettres de sa tantequi exigeait absolument qu'il vînt reprendre son appartement au palais Sanseverinaou que du moins il vînt la voir quelquefois. Là Fabrice était certain d'entendre parler des fêtes splendides données par le marquis Crescenzi à l'occasion de son mariage: orc'est ce qu'il n'était pas sûr de pouvoir supporter sans se donner en spectacle.
Lorsque la cérémonie du mariage eut lieuil y avait huit jours entiers que Fabrice s'était voué au silence le plus completaprès avoir ordonné à son domestique et aux gens de l'archevêché avec lesquels il avait des rapports de ne jamais lui adresser la parole.
Monsignore Landriani ayant appris cette nouvelle affectationfit appeler Fabrice beaucoup plus souvent qu'à l'ordinaireet voulut avoir avec lui de fort longues conversations; il l'obligea même à des conférences avec certains chanoines de campagnequi prétendaient que l'archevêché avait agi contre leurs privilèges. Fabrice prit toutes ces choses avec l'indifférence parfaite d'un homme qui a d'autres pensées. Il vaudrait mieux pour moipensait-ilme faire chartreux; je souffrirais moins dans les rochers de Velleja.
Il alla voir sa tanteet ne put retenir ses larmes en l'embrassant. Elle le trouva tellement changéses yeux encore agrandis par l'extrême maigreuravaient tellement l'air de lui sortir de la têteet lui-même avait une apparence tellement chétive et malheureuseavec son petit habit noir et râpé de simple prêtrequ'à ce premier abord la duchesseelle aussine put retenir ses larmes; mais un instant aprèslorsqu'elle se fut dit que tout ce changement dans l'apparence de ce beau jeune homme était causé par le mariage de Cléliaelle eut des sentiments presque égaux en véhémence à ceux de l'archevêquequoique plus habilement contenus. Elle eut la barbarie de parler longuement de certains détails pittoresques qui avaient signalé les fêtes charmantes données par le marquis Crescenzi. Fabrice ne répondait pas; mais ses yeux se fermèrent un peu par un mouvement convulsifet il devint encore plus pâle qu'il ne l'étaitce qui d'abord eût semblé impossible. Dans ces moments de vive douleursa pâleur prenait une teinte verte.
Le comte Mosca survintet ce qu'il voyaitet qui lui semblait incroyablele guérit enfin tout à fait de la jalousie que jamais Fabrice n'avait cessé de lui inspirer. Cet homme habile employa les tournures les plus délicates et les plus ingénieuses pour chercher à redonner à Fabrice quelque intérêt pour les choses de ce monde. Le comte avait toujours eu pour lui beaucoup d'estime et assez d'amitié; cette amitién'étant plus contrebalancée par la jalousiedevint en ce moment presque dévouée. En effetil a bien acheté sa belle fortunese disait-ilen récapitulant ses malheurs. Sous prétexte de lui faire voir le tableau du Parmesan que le prince avait envoyé à la duchessele comte prit à part Fabrice:
-- Ah çamon amiparlons en hommes! Puis-je vous être bon à quelque chose? Vous ne devez point redouter de questions de ma part; mais enfin l'argent peut-il vous être utilele pouvoir peut-il vous servir? Parlezje suis à vos ordres; si vous aimez mieux écrireécrivez-moi.
Fabrice l'embrassa tendrement et parla du tableau.
-- Votre conduite est le chef-d'oeuvre de la plus fine politiquelui dit le comte en revenant au ton léger de la conversation; vous vous ménagez un avenir fort agréablele prince vous respectele peuple vous vénèrevotre petit habit noir râpé fait passer de mauvaises nuits à monsignore Landriani. J'ai quelque habitude des affaireset je puis vous jurer que je ne saurais quel conseil vous donner pour perfectionner ce que je vois. Votre premier pas dans le monde à vingt-cinq ans vous fait atteindre à la perfection. On parle beaucoup de vous à la cour; et savez- vous à quoi vous devez cette distinction unique à votre âge? au petit habit noir râpé. La duchesse et moi nous disposonscomme vous le savezde l'ancienne maison de Pétrarque sur cette belle colline au milieu de la forêtaux environs du Pô: si jamais vous êtes las des petits mauvais procédés de l'enviej'ai pensé que vous pourriez être le successeur de Pétrarquedont le renom augmentera le vôtre. Le comte se mettait l'esprit à la torture pour faire naître un sourire sur cette figure d'anachorètemais il n'y put parvenir. Ce qui rendait le changement plus frappantc'est qu'avant ces derniers tempssi la figure de Fabrice avait un défautc'était de présenter quelquefoishors de proposl'expression de la volupté et de la gaieté.
Le comte ne le laissa point partir sans lui dire quemalgré son état de retraiteil y aurait peut-être de l'affectation à ne pas paraître à la cour le samedi suivantc'était le jour de naissance de la princesse. Ce mot fut un coup de poignard pour Fabrice. Grand Dieu! pensa-t-ilque suis-je venu faire dans ce palais! Il ne pouvait penser sans frémir à la rencontre qu'il pouvait faire à la cour. Cette idée absorba toutes les autres; il pensa que l'unique ressource qui lui restât était d'arriver au palais au moment précis où l'on ouvrirait les portes des salons.
En effetle nom de monsignore del Dongo fut un des premiers annoncés à la soirée de grand galaet la princesse le reçut avec toute la distinction possible. Les yeux de Fabrice étaient fixés sur la penduleetà l'instant où elle marqua la vingtième minute de sa présence dans ce salonil se levait pour prendre congélorsque le prince entra chez sa mère. Après lui avoir fait la cour quelques instantsFabrice se rapprochait de la porte par une savante manoeuvrelorsque vint éclater à ses dépens un de ces petits riens de cour que la grande maîtresse savait si bien ménager: le chambellan de service lui courut après pour lui dire qu'il avait été désigné pour faire le whist du prince. A Parmec'est un honneur insigne et bien au-dessus du rang que le coadjuteur occupait dans le monde. Faire le whist était un honneur marqué même pour l'archevêque. A la parole du chambellanFabrice se sentit percer le coeuret quoique ennemi mortel de toute scène publiqueil fut sur le point d'aller lui dire qu'il avait été saisi d'un étourdissement subit; mais il pensa qu'il serait en butte à des questions et à des compliments de condoléanceplus intolérables encore que le jeu. Ce jour-là il avait horreur de parler.
Heureusement le général des frères mineurs se trouvait au nombre des grands personnages qui étaient venus faire leur cour à la princesse. Ce moinefort savantdigne émule des Fontana et des Duvoisins'était placé dans un coin reculé du salon: Fabrice prit poste debout devant lui de façon à ne point apercevoir la porte d'entréeet lui parla théologie. Mais il ne put faire que son oreille n'entendît pas annoncer M. le marquis et madame la marquise Crescenzi. Fabricecontre son attenteéprouva un violent mouvement de colère.
-- Si j'étais Borso Valserrase dit-il (c'était un des généraux du premier Sforce)j'irais poignarder ce lourd marquisprécisément avec ce petit poignard à manche d'ivoire que Clélia me donna ce jour heureuxet je lui apprendrais s'il doit avoir l'insolence de se présenter avec cette marquise dans un lieu où je suis!
Sa physionomie changea tellementque le général des frères mineurs lui dit:
-- Est-ce que Votre Excellence se trouve incommodée?
-- J'ai un mal à la tête fou... ces lumières me font mal... et je ne reste que parce que j'ai été nommé pour la partie de whist du prince.
A ce motle général des frères mineursqui était un bourgeoisfut tellement déconcertéquene sachant plus que faireil se mit à saluer Fabricelequelde son côtébien autrement troublé que le général des mineursse prit à parler avec une volubilité étrange; il entendait qu'il se faisait un grand silence derrière lui et ne voulait pas regarder. Tout à coup un archet frappa un pupitre; on joua une ritournelleet la célèbre madame P... chanta cet air de Cimarosa autrefois si célèbre:
Quelle pupille tenere!
Fabrice tint bon aux premières mesuresmais bientôt sa colère s'évanouitet il éprouva un besoin extrême de répandre des larmes. Grand Dieu! se dit-ilquelle scène ridicule! et avec mon habit encore! Il crut plus sage de parler de lui.
-- Ces maux de tête excessifsquand je les contrariecomme ce soirdit-il au général des frères mineursfinissent par des accès de larmes qui pourraient donner pâture à la médisance dans un homme de notre état; ainsi je prie Votre Révérence Illustrissime de permettre que je pleure en la regardantet de n'y pas faire autrement attention.
-- Notre père provincial de Catanzara est atteint de la même incommoditédit le général des mineurs. Et il commença à voix basse une histoire infinie.
Le ridicule de cette histoirequi avait amené le détail des repas du soir de ce père provincialfit sourire Fabricece qui ne lui était pas arrivé depuis longtemps; mais bientôt il cessa d'écouter le général des mineurs. Madame P... chantaitavec un talent divinun air de Pergolèse (la princesse aimait la musique surannée). Il se fit un petit bruit à trois pas de Fabrice; pour la première fois de la soirée il détourna les yeux. Le fauteuil qui venait d'occasionner ce petit craquement sur le parquet était occupé par la marquise Crescenzidont les yeux remplis de larmes rencontrèrent en plein ceux de Fabricequi n'étaient guère en meilleur état. La marquise baissa la tête; Fabrice continua à la regarder quelques secondes: il faisait connaissance avec cette tête chargée de diamants; mais son regard exprimait la colère et le dédain. Puisse disant: et mes yeux ne te regarderont jamaisil se retourna vers son père généralet lui dit:
-- Voici mon incommodité qui me prend plus fort que jamais.
En effetFabrice pleura à chaudes larmes pendant plus d'une demi-heure. Par bonheurune symphonie de Mozarthorriblement écorchéecomme c'est l'usage en Italievint à son secours et l'aida à sécher ses larmes.
Il tint ferme et ne tourna pas les yeux vers la marquise Crescenzi; mais madame P... chanta de nouveauet l'âme de Fabricesoulagée par les larmesarriva à un état de repos parfait. Alors la vie lui apparut sous un nouveau jour. Est-ce que je prétendsse dit-ilpouvoir l'oublier entièrement dès les premiers moments? cela me serait-il possible? Il arriva à cette idée: Puis-je être plus malheureux que je ne le suis depuis deux mois? et si rien ne peut augmenter mon angoissepourquoi résister au plaisir de la voir. Elle a oublié ses sermentselle est légère: toutes les femmes ne le sont-elles pas? Mais qui pourrait lui refuser une beauté céleste? Elle a un regard qui me ravit en extasetandis que je suis obligé de faire effort sur moi-même pour regarder les femmes qui passent pour les plus belles! eh bien! pourquoi ne pas me laisser ravir? ce sera du moins un moment de répit.
Fabrice avait quelque connaissance des hommes; mais aucune expérience des passionssans quoi il se fût dit que ce plaisir d'un momentauquel il allait céderrendrait inutiles tous les efforts qu'il faisait depuis deux mois pour oublier Clélia.
Cette pauvre femme n'était venue à cette fête que forcée par son mari; elle voulait du moins se retirer après une demi-heuresous prétexte de santémais le marquis lui déclara quefaire avancer sa voiture pour partirquand beaucoup de voitures arrivaient encore serait une chose tout à fait hors d'usageet qui pourrait même être interprétée comme une critique indirecte de la fête donnée par la princesse.
-- En ma qualité de chevalier d'honneurajouta le marquisje dois me tenir dans le salon aux ordres de la princessejusqu'à ce que tout le monde soit sorti: il peut y avoir et il y aura sans doute des ordres à donner aux gensils sont si négligents! Et voulez-vous qu'un simple écuyer de la princesse usurpe cet honneur?
Clélia se résigna; elle n'avait pas vu Fabriceelle espérait encore qu'il ne serait pas venu à cette fête. Mais au moment où le concert allait commencerla princesse ayant permis aux dames de s'asseoirClélia fort peu alerte pour ces sortes de chosesse laissa ravir les meilleures places auprès de la princesseet fut obligée de venir chercher un fauteuil au fond de la sallejusque dans le coin reculé où Fabrice s'était réfugié. En arrivant à son fauteuille costume singulier en un tel lieu du général des frères mineurs arrêta ses yeuxet d'abord elle ne remarqua pas l'homme mince et revêtu d'un simple habit noir qui lui parlait; toutefois un certain mouvement secret arrêtait ses yeux sur cet homme. Tout le monde ici a des uniformes ou des habits richement brodés: quel peut être ce jeune homme en habit noir si simple? Elle le regardait profondément attentivelorsqu'une dameen venant se placerfit faire un mouvement à son fauteuil. Fabrice tourna la tête: elle ne le reconnut pastant il était changé. D'abord elle se dit: Voilà quelqu'un qui lui ressemblece sera son frère aîné; mais je ne le croyais que de quelques années plus âgé que luiet celui-ci est un homme de quarante ans. Tout à coup elle le reconnut à un mouvement de la bouche.
Le malheureuxqu'il a souffert! se dit-elle; et elle baissa la tête accablée par la douleuret non pour être fidèle à son voeu. Son coeur était bouleversé par la pitié; qu'il était loin d'avoir cet air après neuf mois de prison! Elle ne le regarda plus; maissans tourner précisément les yeux de son côtéelle voyait tous ses mouvements.
Après le concertelle le vit se rapprocher de la table de jeu du princeplacée à quelques pas du trône; elle respira quand Fabrice fut ainsi fort loin d'elle.
Mais le marquis Crescenzi avait été fort piqué de voir sa femme reléguée aussi loin du trône; toute la soirée il avait été occupé à persuader à une dame assise à trois fauteuils de la princesseet dont le mari lui avait des obligations d'argentqu'elle ferait bien de changer de place avec la marquise. La pauvre femme résistantcomme il était naturelil alla chercher le mari débiteurqui fit entendre à sa moitié la triste voix de la raisonet enfin le marquis eut le plaisir de consommer l'échangeil alla chercher sa femme.
-- Vous serez toujours trop modestelui dit-il; pourquoi marcher ainsi les yeux baissés? on vous prendra pour une de ces bourgeoises tout étonnées de se trouver iciet que tout le monde est étonné d'y voir. Cette folle de grande maîtresse n'en fait jamais d'autres! Et l'on parle de retarder les progrès du jacobinisme! Songez que votre mari occupe la première place mâle de la cour de la princesse; et quand même les républicains parviendraient à supprimer la cour et même la noblessevotre mari serait encore l'homme le plus riche de cet Etat. C'est là une idée que vous ne vous mettez point assez dans la tête.
Le fauteuil où le marquis eut le plaisir d'installer sa femme n'était qu'à six pas de la table de jeu du prince; elle ne voyait Fabrice qu'en profilmais elle le trouva tellement maigriil avait surtout l'air tellement au-dessus de tout ce qui pouvait arriver en ce mondelui qui autrefois ne laissait passer aucun incident sans dire son motqu'elle finit par arriver à cette affreuse conclusion: Fabrice était tout à fait changé; il l'avait oubliée; s'il était tellement maigric'était l'effet des jeûnes sévères auxquels sa piété se soumettait. Clélia fut confirmée dans cette triste idée par la conversation de tous ses voisins: le nom du coadjuteur était dans toutes les bouches; on cherchait la cause de l'insigne faveur dont on le voyait l'objet: luisi jeuneêtre admis au jeu du prince! On admirait l'indifférence polie et les airs de hauteur avec lesquels il jetait ses cartesmême quand il coupait Son Altesse.
-- Mais cela est incroyables'écriaient de vieux courtisans; la faveur de sa tante lui tourne tout à fait la tête... maisgrâce au cielcela ne durera pas; notre souverain n'aime pas que l'on prenne de ces petits airs de supériorité. La duchesse s'approcha du prince; les courtisans qui se tenaient à distance fort respectueuse de la table de jeude façon à ne pouvoir entendre de la conversation du prince que quelques mots au hasardremarquèrent que Fabrice rougissait beaucoup. Sa tante lui aura fait la leçonse dirent-ilssur ses grands airs d'indifférence. Fabrice venait d'entendre la voix de Cléliaelle répondait à la princesse quien faisant son tour dans le bal avait adressé la parole à la femme de son chevalier d'honneur. Arriva le moment où Fabrice dut changer de place au whist; alors il se trouva précisément en face de Cléliaet se livra plusieurs fois au bonheur de la contempler. La pauvre marquisese sentant regardée par lui perdait tout à fait contenance. Plusieurs fois elle oublia ce qu'elle devait à son voeu: dans son désir de deviner ce qui se passait dans le coeur de Fabriceelle fixait les yeux sur lui.
Le jeu du prince terminéles dames se levèrent pour passer dans la salle du souper. Il y eut un peu de désordre. Fabrice se trouva tout près de Clélia; il était encore très résolumais il vint à reconnaître un parfum très faible qu'elle mettait dans ses robes; cette sensation renversa tout ce qu'il s'était promis. Il s'approcha d'elle et prononça à demi-voix et comme se parlant à soi-mêmedeux vers de ce sonnet de Pétrarquequ'il lui avait envoyé du lac Majeurimprimé sur un mouchoir de soie: «Quel n'était pas mon bonheur quand le vulgaire me croyait malheureuxet maintenant que mon sort est changé! »
Nonil ne m'a point oubliéese dit Cléliaavec un transport de joie. Cette belle âme n'est point inconstante!
Nonvous ne me verrez jamais changerBeaux yeux qui m'avez appris à aimer.
Clélia osa se répéter à elle-même ces deux vers de Pétrarque.
La princesse se retira aussitôt après le souper; le prince l'avait suivie jusque chez elleet ne reparut point dans les salles de réception. Dès que cette nouvelle fut connuetout le monde voulut partir à la fois; il y eut un désordre complet dans les antichambres; Clélia se trouva tout près de Fabrice; le profond malheur peint dans ses traits lui fit pitié. -- Oublions le passélui dit-elleet gardez ce souvenir d'amitié. En disant ces motselle plaçait son éventail de façon à ce qu'il pût le prendre.
Tout changea aux yeux de Fabrice: en un instant il fut un autre homme; dès le lendemain il déclara que sa retraite était terminéeet revint prendre son magnifique appartement au palais Sanseverina. L'archevêque dit et crut que la faveur que le prince lui avait faite en l'admettant à son jeu avait fait perdre entièrement la tête à ce nouveau saint: la duchesse vit qu'il était d'accord avec Clélia. Cette penséevenant redoubler le malheur que donnait le souvenir d'une promesse fataleacheva de la déterminer à faire une absence. On admira sa folie. Quoi! s'éloigner de la cour au moment où la faveur dont elle était l'objet paraissait sans bornes! Le comteparfaitement heureux depuis qu'il voyait qu'il n'y avait point d'amour entre Fabrice et la duchessedisait à son amie:-- Ce nouveau prince est la vertu incarnéemais je l'ai appelé cet enfant : me pardonnera-t-il jamais? Je ne vois qu'un moyen de me remettre excellemment bien avec luic'est l'absence. Je vais me montrer parfait de grâces et de respectsaprès quoi je suis malade et je demande mon congé. Vous me le permettrezpuisque la fortune de Fabrice est assurée. Mais me ferez-vous le sacrifice immenseajouta-t-il en riantde changer le titre sublime de duchesse contre un autre bien inférieur? Pour m'amuserje laisse toutes les affaires ici dans un désordre inextricable; j'avais quatre ou cinq travailleurs dans mes divers ministèresje les ai fait mettre à la pension depuis deux moisparce qu'ils lisent les journaux français; et je les ai remplacés par des nigauds incroyables.
Après notre départle prince se trouvera dans un tel embarrasquemalgré l'horreur qu'il a pour le caractère de Rassije ne doute pas qu'il ne soit obligé dele rappeleret moi je n'attends qu'un ordre du tyran qui dispose de mon sortpour écrire une lettre de tendre amitié à mon ami Rassiet lui dire que j'ai tout lieu d'espérer que bientôt on rendra justice à son mérite. [P y E in Olo.]
Livre Second
Chapitre XXVII.
Cette conversation sérieuse eut lieu le lendemain du retour de Fabrice au palais Sanseverina; la duchesse était encore sous le coup de la joie qui éclatait dans toutes les actions de Fabrice. Ainsise disait-ellecette petite dévote m'a trompée! Elle n'a pas su résister à son amant seulement pendant trois mois.
La certitude d'un dénouement heureux avait donné à cet être si pusillanimele jeune princele courage d'aimer; il eut quelque connaissance des préparatifs de départ que l'on faisait au palais Sanseverina; et son valet de chambre françaisqui croyait peu à la vertu des grandes dameslui donna du courage à l'égard de la duchesse. Ernest V se permit une démarche qui fut sévèrement blâmée par la princesse et par tous les gens sensés de la cour; le peuple y vit le sceau de la faveur étonnante dont jouissait la duchesse. Le prince vint la voir dans son palais.
-- Vous partezlui dit-il d'un ton sérieux qui parut odieux à la duchessevous partez; vous allez me trahir et manquer à vos serments! Et pourtantsi j'eusse tardé dix minutes à vous accorder la grâce de Fabriceil était mort. Et vous me laissez malheureux! et sans vos serments je n'eusse jamais eu le courage de vous aimer comme je fais! Vous n'avez donc pas d'honneur!
-- Réfléchissez mûrementmon prince. Dans toute votre vie y a-t-il eu d'espace égal en bonheur aux quatre mois qui viennent de s'écouler? Votre gloire comme souverainetj'ose le croirevotre bonheur comme homme aimablene se sont jamais élevés à ce point. Voici le traité que je vous propose: si vous daignez y consentirje ne serai pas votre maîtresse pour un instant fugitifet en vertu d'un serment extorqué par la peurmais je consacrerai tous les instants de ma vie à faire votre félicitéje serai toujours ce que j'ai été depuis quatre moiset peut-être l'amour viendra-t-il couronner l'amitié. Je ne jurerais pas du contraire.
-- Eh bien! dit le prince raviprenez un autre rôlesoyez plus encorerégnez à la fois sur moi et sur mes étatssoyez mon premier ministre; je vous offre un mariage tel qu'il est permis par les tristes convenances de mon rang; nous en avons un exemple près de nous: le roi de Naples vient d'épouser la duchesse de Partana. Je vous offre tout ce que je puis faireun mariage du même genre. Je vais ajouter une idée de triste politique pour vous montrer que je ne suis plus un enfantet que j'ai réfléchi à tout. Je ne vous ferai point valoir la condition que je m'impose d'être le dernier souverain de ma racele chagrin de voir de mon vivant les grandes puissances disposer de ma succession; je bénis ces désagréments fort réelspuisqu'ils m'offrent un moyen de plus de vous prouver mon estime et ma passion.
La duchesse n'hésita pas un instant; le prince l'ennuyaitet le comte lui semblait parfaitement aimable; il n'y avait au monde qu'un homme qu'on pût lui préférer. D'ailleurs elle régnait sur le comteet le princedominé par les exigences de son rangeût plus ou moins régné sur elle. Et puisil pouvait devenir inconstant et prendre des maîtresses; la différence d'âge sembleraitdans peu d'annéeslui en donner le droit.
Dès le premier instantla perspective de s'ennuyer avait décidé de tout; toutefois la duchessequi voulait être charmantedemanda la permission de réfléchir.
Il serait trop long de rapporter ici les tournures de phrases presque tendres et les termes infiniment gracieux dans lesquels elle sut envelopper son refus. Le prince se mit en colère; il voyait tout son bonheur lui échapper. Que devenir après que la duchesse aurait quitté sa cour? D'ailleursquelle humiliation d'être refusé! Enfin qu'est-ce que va me dire mon valet de chambre français quand je lui conterai ma défaite?
La duchesse eut l'art de calmer le princeet de ramener peu à peu la négociation à ses véritables termes.
-- Si Votre Altesse daigne consentir à ne point presser l'effet d'une promesse fataleet horrible à mes yeuxcomme me faisant encourir mon propre méprisje passerai ma vie à sa couret cette cour sera toujours ce qu'elle a été cet hiver; tous mes instants seront consacrés à contribuer à son bonheur comme hommeet à sa gloire comme souverain. Si elle exige que j'obéisse à mon sermentelle aura flétri le reste de ma vieet à l'instant elle me verra quitter ses états pour n'y jamais rentrer. Le jour où j'aurai perdu l'honneur sera aussi le dernier jour où je vous verrai.
Mais le prince était obstiné comme les êtres pusillanimes; d'ailleurs son orgueil d'homme et de souverain était irrité du refus de sa main; il pensait à toutes les difficultés qu'il eût eues à surmonter pour faire accepter ce mariageet que pourtant il s'était résolu à vaincre.
Durant trois heures on se répéta de part et d'autre les mêmes argumentssouvent mêlés de mots fort vifs. Le prince s'écria:
-- Vous voulez donc me faire croiremadameque vous manquez d'honneur? Si j'eusse hésité aussi longtemps le jour où le général Fabio Conti donnait du poison à Fabricevous seriez occupée aujourd'hui à lui élever un tombeau dans une des églises de Parme.
-- Non pas à Parmecertesdans ce pays d'empoisonneurs.
-- Eh bien! partezmadame la duchessereprit le prince avec colèreet vous emporterez mon mépris.
Comme il s'en allaitla duchesse lui dit à voix basse:
-- Eh bien! présentez-vous ici à dix heures du soirdans le plus strict incognitoet vous ferez un marché de dupe. Vous m'aurez vue pour la dernière foiset j'eusse consacré ma vie à vous rendre aussi heureux qu'un prince absolu peut l'être dans ce siècle de jacobins. Et songez à ce que sera votre cour quand je níy serai plus pour la tirer par force de sa platitude et de sa méchanceté naturelles.
-- De votre côtévous refusez la couronne de Parmeet mieux que la couronnecar vous n'eussiez point été une princesse vulgaireépousée par politiqueet qu'on n'aime point; mon coeur est tout à vouset vous vous fussiez vue à jamais la maîtresse absolue de mes actions comme de mon gouvernement.
-- Ouimais la princesse votre mère eût eu le droit de me mépriser comme une vile intrigante.
-- Eh bien! j'eusse exilé la princesse avec une pension.
Il y eut encore trois quarts d'heure de répliques incisives. Le princequi avait l'âme délicatene pouvait se résoudre ni à user de son droitni à laisser partir la duchesse. On lui avait dit qu'après le premier moment obtenun'importe commentles femmes reviennent.
Chassé par la duchesse indignéeil osa reparaître tout tremblant et fort malheureux à dix heures moins trois minutes. A dix heures et demiela duchesse montait en voiture et partait pour Bologne. Elle écrivit au comte dès qu'elle fut hors des états du prince:
«Le sacrifice est fait. Ne me demandez pas d'être gaie pendant un mois. Je ne verrai plus Fabrice; je vous attends à Bologneet quand vous voudrez je serai la comtesse Mosca. Je ne vous demande qu'une chosene me forcez jamais à reparaître dans le pays que je quitteet songez toujours qu'au lieu de 150 000 livres de rentesvous allez en avoir 30 ou 40 tout au plus. Tous les sots vous regardaient bouche béanteet vous ne serez plus considéré qu'autant que vous voudrez bien vous abaisser à comprendre toutes leurs petites idées. Tu l'as vouluGeorges Dandin! »
Huit jours aprèsle mariage se célébrait à Pérouse dans une église où les ancêtres du comte ont leurs tombeaux. Le prince était au désespoir. La duchesse avait reçu de lui trois ou quatre courrierset n'avait pas manqué de lui renvoyer sous enveloppes ses lettres non décachetées. Ernest V avait fait un traitement magnifique au comteet donné le grand cordon de son ordre à Fabrice.
-- C'est là surtout ce qui m'a plu de ses adieux. Nous nous sommes séparésdisait le comte à la nouvelle comtesse Mosca della Rovereles meilleurs amis du monde; il m'a donné un grand cordon espagnolet des diamants qui valent bien le grand cordon. Il m'a dit qu'il me ferait ducs'il ne voulait se réserver ce moyen pour vous rappeler dans ses états. Je suis donc chargé de vous déclarerbelle mission pour un marique si vous daignez revenir à Parmene fût-ce que pour un moisje serai fait ducsous le nom que vous choisirezet vous aurez une belle terre.
C'est ce que la duchesse refusa avec une sorte d'horreur.
Après la scène qui s'était passée au bal de la couret qui semblait assez décisiveClélia parut ne plus se souvenir de l'amour qu'elle avait semblé partager un instant; les remords les plus violents s'étaient emparés de cette âme vertueuse et croyante. C'est ce que Fabrice comprenait fort bienet malgré toutes les espérances qu'il cherchait à se donnerun sombre malheur ne s'en était pas moins emparé de son âme. Cette fois cependant le malheur ne le conduisit point dans la retraitecomme à l'époque du mariage de Clélia.
Le comte avait prié son neveu de lui mander avec exactitude ce qui se passait à la couret Fabricequi commençait à comprendre tout ce qu'il lui devaits'était promis de remplir cette mission en honnête homme.
Ainsi que la ville et la courFabrice ne doutait pas que son ami n'eût le projet de revenir au ministèreet avec plus de pouvoir qu'il n'en avait jamais eu. Les prévisions du comte ne tardèrent pas à se vérifier: moins de six semaines après son départRassi était premier ministre; Fabio Contiministre de la guerreet les prisonsque le comte avait presque vidéesse remplissaient de nouveau. Le princeen appelant ces gens-là au pouvoircrut se venger de la duchesse; il était fou d'amour et haïssait surtout le comte Mosca comme un rival.
Fabrice avait bien des affaires; monseigneur Landrianiâgé de soixante-douze ansétant tombé dans un grand état de langueur et ne sortant presque plus de son palaisc'était au coadjuteur à s'acquitter de presque toutes ses fonctions.
La marquise Crescenziaccablée de remordset effrayée par le directeur de sa conscienceavait trouvé un excellent moyen pour se soustraire aux regards de Fabrice. Prenant prétexte de la fin d'une première grossesseelle s'était donné pour prison son propre palais; mais ce palais avait un immense jardin. Fabrice sut y pénétrer et plaça dans l'allée que Clélia affectionnait le plus des fleurs arrangées en bouquetset disposées dans un ordre qui leur donnait un langagecomme jadis elle lui en faisait parvenir tous les soirs dans les derniers jours de sa prison à la tour Farnèse.
La marquise fut très irritée de cette tentative; les mouvements de son âme étaient dirigés tantôt par les remordstantôt par la passion. Durant plusieurs mois elle ne se permit pas de descendre une seule fois dans le jardin de son palais; elle se faisait même scrupule d'y jeter un regard.
Fabrice commençait à croire qu'il était séparé d'elle pour toujourset le désespoir commençait aussi à s'emparer de son âme. Le monde où il passait sa vie lui déplaisait mortellementet s'il n'eût été intimement persuadé que le comte ne pouvait trouver la paix de l'âme hors du ministèreil se fût mis en retraite dans son petit appartement de l'archevêché. Il lui eût été doux de vivre tout à ses penséeset de n'entendre plus la voix humaine que dans l'exercice officiel de ses fonctions.
Maisse disait-ildans l'intérêt du comte et de la comtesse Moscapersonne ne peut me remplacer.
Le prince continuait à le traiter avec une distinction qui le plaçait au premier rang dans cette cour et cette faveur il la devait en grande partie à lui-même. L'extrême réserve quichez Fabriceprovenait d'une indifférence allant jusqu'au dégoût pour toutes les affectations ou les petites passions qui remplissent la vie des hommesavait piqué la vanité du jeune prince; il disait souvent que Fabrice avait autant d'esprit que sa tante. L'âme candide du prince s'apercevait à demi d'une vérité: c'est que personne n'approchait de lui avec les mêmes dispositions de coeur que Fabrice. Ce qui ne pouvait échappermême au vulgaire des courtisansc'est que la considération obtenue par Fabrice n'était point celle d'un simple coadjuteurmais l'emportait même sur les égards que le souverain montrait à l'archevêque. Fabrice écrivait au comte que si jamais le prince avait assez d'esprit pour s'apercevoir du gâchis dans lequel les ministres RassiFabio ContiZurla et autres de même force avaient jeté ses affairesluiFabriceserait le canal naturel par lequel il ferait une démarchesans trop compromettre son amour-propre.
Sans le souvenir du mot fatalcet enfantdisait-il à la comtesse Moscaappliqué par un homme de génie à une auguste personnel'auguste personne se serait déjà écriée: Revenez bien vite et chassez-moi tous ces va-nu-pieds. Dès aujourd'huisi la femme de l'homme de génie daignait faire une démarchesi peu significative qu'elle fûton rappellerait le comte avec transport; mais il rentrera par une bien plus belle portes'il veut attendre que le fruit soit mûr. Du resteon s'ennuie à ravir dans les salons de la princesseon n'y a pour se divertir que la folie du Rassiquidepuis qu'il est comteest devenu maniaque de noblesse. On vient de donner des ordres sévères pour que toute personne qui ne peut pas prouver huit quartiers de noblesse n'ose plus se présenter aux soirées de la princesse (ce sont les termes du rescrit). Tous les hommes qui sont en possession d'entrer le matin dans la grande galerieet de se trouver sur le passage du souverain lorsqu'il se rend à la messecontinueront à jouir de ce privilège; mais les nouveaux arrivants devront faire preuve des huit quartiers. Sur quoi l'on a dit qu'on voit bien que Rassi est sans quartier.
On pense que de telles lettres n'étaient point confiées à la poste. La comtesse Mosca répondait de Naples: «Nous avons un concert tous les jeudiset conversation tous les dimanches; on ne peut pas se remuer dans nos salons. Le comte est enchanté de ses fouillesil y consacre mille francs par moiset vient de faire venir des ouvriers des montagnes de l'Abruzzequi ne lui coûtent que vingt- trois sous par jour. Tu devrais bien venir nous voir. Voici plus de vingt foismonsieur l'ingratque je vous fais cette sommation. »
Fabrice n'avait garde d'obéir: la simple lettre qu'il écrivait tous les jours au comte ou à la comtesse lui semblait une corvée presque insupportable. On lui pardonnera quand on saura qu'une année entière se passa ainsisans qu'il pût adresser une parole à la marquise. Toutes ses tentatives pour établir quelque correspondance avaient été repoussées avec horreur. Le silence habituel quepar ennui de la vieFabrice gardait partoutexcepté dans l'exercice de ses fonctions et à la courjoint à la pureté parfaite de ses moeursl'avait mis dans une vénération si extraordinaire qu'il se décida enfin à obéir aux conseils de sa tante.
«Le prince a pour toi une vénération tellelui écrivait-ellequ'il faut t'attendre bientôt à une disgrâce; il te prodiguera les marques d'inattention et les mépris atroces des courtisans suivront les siens. Ces petits despotessi honnêtes qu'ils soientsont changeants comme la mode et par la même raison: l'ennui. Tu ne peux trouver de forces contre le caprice du souverain que dans la prédication. Tu improvises si bien en vers! essaye de parler une demi-heure sur la religion; tu diras des hérésies dans les commencements; mais paye un théologien savant et discret qui assistera à tes sermonset t'avertira de tes fautestu les répareras le lendemain. »
Le genre de malheur que porte dans l'âme un amour contrariéfait que toute chose demandant de l'attention et de l'action devient une atroce corvée. Mais Fabrice se dit que son crédit sur le peuples'il en acquéraitpourrait un jour être utile à sa tante et au comtepour lequel sa vénération augmentait tous les joursà mesure que les affaires lui apprenaient à connaître la méchanceté des hommes. Il se détermina à prêcheret son succèspréparé par sa maigreur et son habit râpéfut sans exemple. On trouvait dans ses discours un parfum de tristesse profondequiréuni à sa charmante figure et aux récits de la haute faveur dont il jouissait à la courenleva tous les coeurs de femme. Elles inventèrent qu'il avait été un des plus braves capitaines de l'armée de Napoléon. Bientôt ce fait absurde fut hors de doute. On faisait garder des places dans les églises où il devait prêcher; les pauvres síy établissaient par spéculation dès cinq heures du matin.
Le succès fut tel que Fabrice eut enfin l'idée qui changea tout dans son âmequene fût-ce que par simple curiositéla marquise Crescenzi pourrait bien un jour venir assister à l'un de ses sermons. Tout à coup le public ravi s'aperçut que son talent redoublait; il se permettaitquand il était émudes images dont la hardiesse eût fait frémir les orateurs les plus exercés; quelquefoiss'oubliant soi-mêmeil se livrait à des moments d'inspiration passionnéeet tout l'auditoire fondait en larmes. Mais c'était en vain que son oeil aggrottato cherchait parmi tant de figures tournées vers la chaire celle dont la présence eût été pour lui un si grand événement.
Mais si jamais j'ai ce bonheurse dit-ilou je me trouverai malou je resterai absolument court. Pour parer à ce dernier inconvénientil avait composé une sorte de prière tendre et passionnée qu'il plaçait toujours dans sa chairesur un tabouret; il avait le projet de se mettre à lire ce morceausi jamais la présence de la marquise venait le mettre hors d'état de trouver un mot.
Il apprit un jourpar ceux des domestiques du marquis qui étaient à sa soldeque des ordres avaient été donnés afin que l'on préparât pour le lendemain la loge de la Casa Crescenzi au grand théâtre. Il y avait une année que la marquise n'avait paru à aucun spectacleet c'était un ténor qui faisait fureur et remplissait la salle tous les soirs qui la faisait déroger à ses habitudes. Le premier mouvement de Fabrice fut une joie extrême. Enfin je pourrai la voir toute une soirée! On dit qu'elle est bien pâle. Et il cherchait à se figurer ce que pouvait être cette tête charmanteavec des couleurs à demi effacées par les combats de l'âme.
Son ami Ludovictout consterné de ce qu'il appelait la folie de son maîtretrouvamais avec beaucoup de peineune loge au quatrième rangpresque en face de celle de la marquise. Une idée se présenta à Fabrice: J'espère lui donner l'idée de venir au sermonet je choisirai une église fort petiteafin d'être en état de la bien voir. Fabrice prêchait ordinairement à trois heures. Dès le matin du jour où la marquise devait aller au spectacleil fit annoncer qu'un devoir de son état le retenant à l'archevêché pendant toute la journéeil prêcherait par extraordinaire à huit heures et demie du soirdans la petite église de Sainte-Marie de la Visitationsituée précisément en face d'une des ailes du palais Crescenzi. Ludovic présenta de sa part une quantité énorme de cierges aux religieuses de la Visitationavec prière d'illuminer à jour leur église. Il eut toute une compagnie de grenadiers de la gardeet l'on plaça une sentinellela baïonnette au bout du fusildevant chaque chapellepour empêcher les vols.
Le sermon n'était annoncé que pour huit heures et demieet à deux heures l'église étant entièrement rempliel'on peut se figurer le tapage qu'il y eut dans la rue solitaire que dominait la noble architecture du palais Crescenzi. Fabrice avait fait annoncer qu'en l'honneur de Notre-Dame de Pitiéil prêcherait sur la pitié qu'une âme généreuse doit avoir pour un malheureuxmême quand il serait coupable.
Déguisé avec tout le soin possibleFabrice gagna sa loge au théâtre au moment de l'ouverture des porteset quand rien n'était encore allumé. Le spectacle commença vers huit heureset quelques minutes après il eut cette joie qu'aucun esprit ne peut concevoir s'il ne l'a pas éprouvéeil vit la porte de la loge Crescenzi s'ouvrir; peu aprèsla marquise entra; il ne l'avait pas vue aussi bien depuis le jour où elle lui avait donné son éventail. Fabrice crut qu'il suffoquerait de joie; il sentait des mouvements si extraordinairesqu'il se dit: Peut-être je vais mourir! Quelle façon charmante de finir cette vie si triste! Peut-être je vais tomber dans cette loge; les fidèles réunis à la Visitation ne me verront point arriveret demainils apprendront que leur futur archevêque s'est oublié dans une loge de l'Opéraet encoredéguisé en domestique et couvert d'une livrée! Adieu toute ma réputation! Et que me fait ma réputation!
Toutefoisvers les huit heures trois quartsFabrice fit effort sur lui-même; il quitta sa loge des quatrièmes et eut toutes les peines du monde à gagnerà piedle lieu où il devait quitter son habit de demi-livrée et prendre un vêtement plus convenable. Ce ne fut que vers les neuf heures qu'il arriva à la Visitationdans un état de pâleur et de faiblesse tel que le bruit se répandit dans l'église que M. le coadjuteur ne pourrait pas prêcher ce soir-là. On peut juger des soins que lui prodiguèrent les religieusesà la grille de leur parloir intérieur où il s'était réfugié. Ces dames parlaient beaucoup; Fabrice demanda à être seul quelques instantspuis il courut à sa chaire. Un de ses aides de camp lui avait annoncévers les trois heuresque l'église de la Visitation était entièrement remplie mais de gens appartenant à la dernière classe et attirés apparemment par le spectacle de l'illumination. En entrant en chaireFabrice fut agréablement surpris de trouver toutes les chaises occupées par les jeunes gens à la mode et par les personnages de la plus haute distinction.
Quelques phrases d'excuses commencèrent son sermon et furent reçues avec des cris comprimés d'admiration. Ensuite vint la description passionnée du malheureux dont il faut avoir pitié pour honorer dignement la Madone de Pitié quielle-mêmea tant souffert sur la terre. L'orateur était fort ému; il y avait des moments où il pouvait à peine prononcer les mots de façon à être entendu dans toutes les parties de cette petite église. Aux yeux de toutes les femmes et de bon nombre des hommesil avait l'air lui-même du malheureux dont il fallait prendre pitiétant sa pâleur était extrême. Quelques minutes après les phrases d'excuses par lesquelles il avait commencé son discourson s'aperçut qu'il était hors de son assiette ordinaire: on le trouvait ce soir-là d'une tristesse plus profonde et plus tendre que de coutume. Une fois on lui vit les larmes aux yeux: à l'instant il s'éleva dans l'auditoire un sanglot général et si bruyantque le sermon en fut tout à fait interrompu.
Cette première interruption fut suivie de dix autres; on poussait des cris d'admirationil y avait des éclats de larmes; on entendait à chaque instant des cris tels que: Ah! sainte Madone! Ah! grand Dieu! L'émotion était si générale et si invincible dans ce public d'éliteque personne n'avait honte de pousser des criset les gens qui y étaient entraînés ne semblaient point ridicules à leurs voisins.
Au repos qu'il est d'usage de prendre au milieu du sermonon dit à Fabrice qu'il n'était resté absolument personne au spectacle; une seule dame se voyait encore dans sa logela marquise Crescenzi. Pendant ce moment de repos on entendit tout à coup beaucoup de bruit dans la salle: c'étaient les fidèles qui votaient une statue à M. le coadjuteur. Son succès dans la seconde partie du discours fut tellement fou et mondainles élans de contrition chrétienne furent tellement remplacés par des cris d'admiration tout à fait profanesqu'il crut devoir adresseren quittant la chaireune sorte de réprimande aux auditeurs. Sur quoi tous sortirent à la fois avec un mouvement qui avait quelque chose de singulier et de compassé; eten arrivant à la ruetous se mettaient à applaudir avec fureur et à crier: E viva del Dongo!
Fabrice consulta sa montre avec précipitationet courut à une petite fenêtre grillée qui éclairait l'étroit passage de l'orgue à l'intérieur du couvent. Par politesse envers la foule incroyable et insolite qui remplissait la ruele suisse du palais Crescenzi avait placé une douzaine de torches dans ces mains de fer que l'on voit sortir des murs de face des palais bâtis au moyen âge. Après quelques minuteset longtemps avant que les cris eussent cessél'événement que Fabrice attendait avec tant d'anxiété arrivala voiture de la marquise revenant du spectacleparut dans la ruele cocher fut obligé de s'arrêteret ce ne fut qu'au plus petit paset à force de crisque la voiture put gagner la porte.
La marquise avait été touchée de la musique sublimecomme le sont les coeurs malheureuxmais bien plus encore de la solitude parfaite du spectacle lorsqu'elle en apprit la cause. Au milieu du second acteet le ténor admirable étant en scèneles gens même du parterre avaient tout à coup déserté leurs places pour aller tenter fortune et essayer de pénétrer dans l'église de la Visitation. La marquisese voyant arrêtée par la foule devant sa portefondit en larmes. Je n'avais pas fait un mauvais choix! se dit-elle.
Mais précisément à cause de ce moment d'attendrissement elle résista avec fermeté aux instances du marquis et de tous les amis de la maisonqui ne concevaient pas qu'elle n'allât point voir un prédicateur aussi étonnant. Enfindisait-onil l'emporte même sur le meilleur ténor de l'Italie! Si je le voisje suis perdue! se disait la marquise.
Ce fut en vain que Fabricedont le talent semblait plus brillant chaque jourprêcha encore plusieurs fois dans cette même petite églisevoisine du palais Crescenzijamais il n'aperçut Cléliaqui même à la fin prit de l'humeur de cette affectation à venir troubler sa rue solitaireaprès l'avoir déjà chassée de son jardin.
En parcourant les figures de femmes qui l'écoutaientFabrice remarquait depuis assez longtemps une petite figure brune fort jolieet dont les yeux jetaient des flammes. Ces yeux magnifiques étaient ordinairement baignés de larmes dès la huitième ou dixième phrase du sermon. Quand Fabrice était obligé de dire des choses longues et ennuyeuses pour lui-mêmeil reposait assez volontiers ses regards sur cette tête dont la jeunesse lui plaisait. Il apprit que cette jeune personne s'appelait Anetta Marinifille unique et héritière du plus riche marchand drapier de Parmemort quelques mois auparavant.
Bientôt le nom de cette Anetta Marinifille du drapierfut dans toutes les bouches; elle était devenue éperdument amoureuse de Fabrice. Lorsque les fameux sermons commencèrentson mariage était arrêté avec Giacomo Rassifils aîné du ministre de la justicelequel ne lui déplaisait point; mais à peine eut- elle entendu deux fois monsignore Fabricequ'elle déclara qu'elle ne voulait plus se marier; etcomme on lui demandait la cause d'un si singulier changementelle répondit qu'il n'était pas digne d'une honnête fille d'épouser un homme en se sentant éperdument éprise d'un autre. Sa famille chercha d'abord sans succès quel pouvait être cet autre.
Mais les larmes brûlantes qu'Anetta versait au sermon mirent sur la voie de la vérité; sa mère et ses oncles lui ayant demandé si elle aimait monsignore Fabriceelle répondit avec hardiesse quepuisqu'on avait découvert la véritéelle ne s'avilirait point par un mensonge; elle ajouta quen'ayant aucun espoir d'épouser l'homme qu'elle adoraitelle voulait du moins n'avoir plus les yeux offensés par la figure ridicule du contino Rassi. Ce ridicule donné au fils d'un homme que poursuivait l'envie de toute la bourgeoisie devinten deux joursl'entretien de toute la ville. La réponse d'Anetta Marini parut charmanteet tout le monde la répéta. On en parla au palais Crescenzi comme on en parlait partout.
Clélia se garda bien d'ouvrir la bouche sur un tel sujet dans son salon; mais elle fit des questions à sa femme de chambreetle dimanche suivantaprès avoir entendu la messe à la chapelle de son palaiselle fit monter sa femme de chambre dans sa voitureet alla chercher une seconde messe à la paroisse de Mlle Marini. Elle y trouva réunis tous les beaux de la ville attirés par le même motif; ces messieurs se tenaient debout près de la porte. Bientôtau grand mouvement qui se fit parmi euxla marquise comprit que cette Mlle Marini entrait dans l'église; elle se trouva fort bien placée pour la voiretmalgré sa piéténe donna guère d'attention à la messe. Clélia trouva à cette beauté bourgeoise un petit air décidé quisuivant elleeût pu convenir tout au plus à une femme mariée depuis plusieurs années. Du reste elle était admirablement bien prise dans sa petite tailleet ses yeuxcomme l'on dit en Lombardiesemblaient faire la conversation avec les choses qu'ils regardaient. La marquise s'enfuit avant la fin de la messe.
Dès le lendemainles amis de la maison Crescenzilesquels venaient tous les soirs passer la soiréeracontèrent un nouveau trait ridicule de l'Anetta Marini. Comme sa mèrecraignant quelque folie de sa partne laissait que peu d'argent à sa dispositionAnetta était allée offrir une magnifique bague en diamantscadeau de son pèreau célèbre Hayezalors à Parme pour les salons du palais Crescenziet lui demander le portrait de M. del Dongo; mais elle voulut que ce portrait fût vêtu simplement de noiret non point en habit de prêtre. Orla veillela mère de la petite Anetta avait été bien surpriseet encore plus scandalisée de trouver dans la chambre de sa fille un magnifique portrait de Fabrice del Dongoentouré du plus beau cadre que l'on eût doré à Parme depuis vingt ans.
Livre Second
Chapitre XXVIII.
Entraîné par les événementsnous n'avons pas eu le temps d'esquisser la race comique de courtisans qui pullulent à la cour de Parme et faisaient de drôles de commentaires sur les événements par nous racontés. Ce qui rend en ce pays-là un petit noblegarni de ses trois ou quatre mille livres de rentedigne de figurer en bas noirsaux levers du princec'est d'abord de n'avoir jamais lu Voltaire et Rousseau: cette condition est peu difficile à remplir. Il fallait ensuite savoir parler avec attendrissement du rhume du souverainou de la dernière caisse de minéralogie qu'il avait reçue de Saxe. Si après cela on ne manquait pas à la messe un seul jour de l'annéesi l'on pouvait compter au nombre de ses amis intimes deux ou trois gros moinesle prince daignait vous adresser une fois la parole tous les ansquinze jours avant ou quinze jours après le premier janvierce qui vous donnait un grand relief dans votre paroisseet le percepteur des contributions n'osait pas trop vous vexer si vous étiez en retard sur la somme annuelle de cent francs à laquelle étaient imposées vos petites propriétés.
M. Gonzo était un pauvre hère de cette sortefort noblequioutre qu'il possédait quelque petit bienavait obtenu par le crédit du marquis Crescenzi une place magnifiquerapportant mille cent cinquante francs par an. Cet homme eût pu dîner chez luimais il avait une passion: il n'était à son aise et heureux que lorsqu'il se trouvait dans le salon de quelque grand personnage qui lui dît de temps à autre: Taisez-vousGonzovous n'êtes qu'un sot. Ce jugement était dicté par l'humeurcar Gonzo avait presque toujours plus d'esprit que le grand personnage. Il parlait à propos de tout et avec assez de grâce: de plusil était prêt à changer d'opinion sur une grimace du maître de la maison. A vrai direquoique d'une adresse profonde pour ses intérêtsil n'avait pas une idéeet quand le prince n'était pas enrhuméil était quelquefois embarrassé au moment d'entrer dans un salon.
Ce qui dans Parme avait valu une réputation à Gonzoc'était un magnifique chapeau à trois cornes garni d'une plume noire un peu délabréequ'il mettaitmême en frac; mais il fallait voir la façon dont il portait cette plumesoit sur la têtesoit à la main; là était le talent et l'importance. Il s'informait avec une anxiété véritable de l'état de santé du petit chien de la marquiseet si le feu eût pris au palais Crescenziil eût exposé sa vie pour sauver un de ces beaux fauteuils de brocart d'orqui depuis tant d'années accrochaient sa culotte de soie noirequand par hasard il osait s'y asseoir un instant.
Sept ou huit personnages de cette espèce arrivaient tous les soirs à sept heures dans le salon de la marquise Crescenzi. A peine assisun laquais magnifiquement vêtu d'une livrée jonquille toute couverte de galons d'argentainsi que la veste rouge qui en complétait la magnificencevenait prendre les chapeaux et les cannes des pauvres diables. Il était immédiatement suivi d'un valet de chambre apportant une tasse de café infiniment petitesoutenue par un pied d'argent en filigrane; et toutes les demi-heures un maître d'hôtelportant épée et habit magnifique à la françaisevenait offrir des glaces.
Une demi-heure après les petits courtisans râpéson voyait arriver cinq ou six officiers parlant haut et d'un air tout militaire et discutant habituellement sur le nombre et l'espèce des boutons que doit porter l'habit du soldat pour que le général en chef puisse remporter des victoires. Il n'eût pas été prudent de citer dans ce salon un journal français; carquand même la nouvelle se fût trouvée des plus agréablespar exemple cinquante libéraux fusillés en Espagnele narrateur n'en fût pas moins resté convaincu d'avoir lu un journal français. Le chef- d'oeuvre de l'habileté de tous ces gens-là était d'obtenir tous les dix ans une augmentation de pension de cent cinquante francs. C'est ainsi que le prince partage avec sa noblesse le plaisir de régner sur les paysans et sur les bourgeois.
Le principal personnagesans contreditdu salon Crescenziétait le chevalier Foscariniparfaitement honnête homme; aussi avait-il été un peu en prison sous tous les régimes. Il était membre de cette fameuse chambre des députés quià Milanrejeta la loi de l'enregistrement présentée par Napoléontrait peu fréquent dans l'histoire. Le chevalier Foscariniaprès avoir été vingt ans l'ami de la mère du marquisétait resté l'homme influent dans la maison. Il avait toujours quelque conte plaisant à fairemais rien n'échappait à sa finesseet la jeune marquisequi se sentait coupable au fond du coeurtremblait devant lui.
Comme Gonzo avait une véritable passion pour le grand seigneurqui lui disait des grossièretés et le faisait pleurer une ou deux fois par ansa manie était de chercher à lui rendre de petits services; ets'il n'eût été paralysé par les habitudes d'une extrême pauvretéil eût pu réussir quelquefoiscar il n'était pas sans une certaine dose de finesse et une beaucoup plus grande d'effronterie.
Le Gonzotel que nous le connaissonsméprisait assez la marquise Crescenzicar de sa vie elle ne lui avait adressé une parole peu polie; mais enfin elle était la femme de ce fameux marquis Crescenzichevalier d'honneur de la princesseet quiune fois ou deux par moisdisait à Gonzo:
-- Tais-toiGonzotu n'es qu'une bête.
Le Gonzo remarqua que tout ce qu'on disait de la petite Anetta Marini faisait sortir la marquisepour un instantde l'état de rêverie et d'incurie où elle restait habituellement plongée jusqu'au moment où onze heures sonnaientalors elle faisait le théet en offrait à chaque homme présenten l'appelant par son nom. Après quoiau moment de rentrer chez elleelle semblait trouver un moment de gaietéc'était l'instant qu'on choisissait pour lui réciter les sonnets satiriques.
On en fait d'excellents en Italie: c'est le seul genre de littérature qui ait encore un peu de vie; à la vérité il n'est pas soumis à la censureet les courtisans de la casa Crescenzi annonçaient toujours leur sonnet par ces mots: Madame la marquise veut-elle permettre que l'on récite devant elle un bien mauvais sonnet? et quand le sonnet avait fait rire et avait été répété deux ou trois foisl'un des officiers ne manquait pas de s'écrier: M. le ministre de la police devrait bien s'occuper de faire un peu pendre les auteurs de telles infamies. Les sociétés bourgeoisesau contraireaccueillent ces sonnets avec l'admiration la plus francheet les clercs de procureurs en vendent des copies.
D'après la sorte de curiosité montrée par la marquiseGonzo se figura qu'on avait trop vanté devant elle la beauté de la petite Marini qui d'ailleurs avait un million de fortuneet qu'elle en était jalouse. Comme avec son sourire continu et son effronterie complète envers tout ce qui n'était pas nobleGonzo pénétrait partoutdès le lendemain il arriva dans le salon de la marquiseportant son chapeau à plumes d'une certaine façon triomphante et qu'on ne lui voyait guère qu'une fois ou deux chaque année lorsque le prince lui avait dit: Adieu Gonzo.
Après avoir salué respectueusement la marquiseGonzo ne s'éloigna point comme de coutume pour aller prendre place sur le fauteuil qu'on venait de lui avancer. Il se plaça au milieu du cercleet s'écria brutalement: -- J'ai vu le portrait de monseigneur del Dongo. Clélia fut tellement surprise qu'elle fut obligée de s'appuyer sur le bras de son fauteuil; elle essaya de faire tête à l'oragemais bientôt fut obligée de déserter le salon.
-- Il faut convenirmon pauvre Gonzoque vous êtes d'une maladresse rares'écria avec hauteur l'un des officiers qui finissait sa quatrième glace. Comment ne savez-vous pas que le coadjuteurqui a été l'un des plus braves colonels de l'armée de Napoléona joué jadis un tour pendable au père de la marquiseen sortant de la citadelle où le général Conti commandait comme il fût sorti de la Steccata (la principale église de Parme)?
-- J'ignore en effet bien des chosesmon cher capitaineet je suis un pauvre imbécile qui fais des bévues toute la journée.
Cette répliquetout à fait dans le goût italienfit rire aux dépens du brillant officier. La marquise rentra bientôt; elle s'était armée de courageet n'était pas sans quelque vague espérance de pouvoir elle-même admirer ce portrait de Fabriceque l'on disait excellent. Elle parla des éloges du talent de Hayezqui l'avait fait. Sans le savoir elle adressait des sourires charmants au Gonzo qui regardait l'officier d'un air malin. Comme tous les autres courtisans de la maison se livraient au même plaisirl'officier prit la fuitenon sans vouer une haine mortelle au Gonzo; celui-ci triomphaitetle soiren prenant congéfut engagé à dîner pour le lendemain.
-- En voici bien d'une autre! s'écria Gonzole lendemainaprès le dînerquand les domestiques furent sortisn'arrive-t-il pas que notre coadjuteur est tombé amoureux de la petite Marini!...
On peut juger du trouble qui s'éleva dans le coeur de Clélia en entendant un mot aussi extraordinaire. Le marquis lui-même fut ému.
-- Mais Gonzomon amivous battez la campagne comme à l'ordinaire! et vous devriez parler avec un peu plus de retenue d'un personnage qui a eu l'honneur de faire onze fois la partie de whist de Son Altesse!
-- Eh bien! monsieur le marquisrépondit le Gonzo avec la grossièreté des gens de cette espèceje puis vous jurer qu'il voudrait bien aussi faire la partie de la petite Marini. Mais il suffit que ces détails vous déplaisent; ils n'existent plus pour moiqui veux avant tout ne pas choquer mon adorable marquis.
Toujoursaprès le dînerle marquis se retirait pour faire la sieste. Il n'eut gardece jour-là; mais le Gonzo se serait plutôt coupé la langue que d'ajouter un mot sur la petite Marini; età chaque instantil commençait un discourscalculé de façon à ce que le marquis pût espérer qu'il allait revenir aux amours de la petite bourgeoise. Le Gonzo avait supérieurement cet esprit italien qui consiste à différer avec délices de lancer le mot désiré. Le pauvre marquismourant de curiositéfut obligé de faire des avances: il dit à Gonzo quequand il avait le plaisir de dîner avec luiil mangeait deux fois davantage. Gonzo ne comprit paset se mit à décrire une magnifique galerie de tableaux que formait la marquise Balbila maîtresse du feu prince; trois ou quatre fois il parla de Hayezavec l'accent plein de lenteur de l'admiration la plus profonde. Le marquis se disait: Bon! il va arriver enfin au portrait commandé par la petite Marini! Mais c'est ce que Gonzo n'avait garde de faire. Cinq heures sonnèrentce qui donna beaucoup d'humeur au marquisqui était accoutumé à monter en voiture à cinq heures et demieaprès sa siestepour aller au Corso.
-- Voilà comment vous êtesavec vos bêtises! dit-il grossièrement au Gonzo; vous me ferez arriver au Corso après la princessedont je suis le chevalier d'honneuret qui peut avoir des ordres à me donner. Allons! dépêchez! dites-moi en peu de parolessi vous le pouvezce que c'est que ces prétendus amours de monseigneur le coadjuteur?
Mais le Gonzo voulait réserver ce récit pour l'oreille de la marquisequi l'avait invité à dîner; il dépêcha doncen fort peu de motsl'histoire réclaméeet le marquisà moitié endormicourut faire sa sieste. Le Gonzo prit une tout autre manière avec la pauvre marquise. Elle était restée tellement jeune et naïve au milieu de sa haute fortunequ'elle crut devoir réparer la grossièreté avec laquelle le marquis venait d'adresser la parole au Gonzo. Charmé de ce succèscelui-ci retrouva toute son éloquenceet se fit un plaisirnon moins qu'un devoird'entrer avec elle dans des détails infinis.
La petite Anetta Marini donnait jusqu'à un sequin par place qu'on lui retenait au sermon; elle arrivait toujours avec deux de ses tantes et l'ancien caissier de son père. Ces placesqu'elle faisait garder dès la veilleétaient choisies en général presque vis-à-vis la chairemais un peu du côté du grand autelcar elle avait remarqué que le coadjuteur se tournait souvent vers l'autel. Orce que le public avait remarqué aussic'est que non rarement les yeux si parlants du jeune prédicateur s'arrêtaient avec complaisance sur la jeune héritièrecette beauté si piquante; et apparemment avec quelque attentioncardès qu'il avait les yeux fixés sur elleson sermon devenait savant; les citations y abondaientl'on n'y trouvait plus de ces mouvements qui partent du coeur; et les damespour qui l'intérêt cessait presque aussitôtse mettaient à regarder la Marini et à en médire.
Clélia se fit répéter jusqu'à trois fois tous ces détails singuliers. A la troisièmeelle devint fort rêveuse; elle calculait qu'il y avait justement quatorze mois qu'elle n'avait vu Fabrice. Y aurait-il un bien grand malse disait-elleà passer une heure dans une églisenon pour voir Fabricemais pour entendre un prédicateur célèbre? D'ailleursje me placerai loin de la chaireet je ne regarderai Fabrice qu'une fois en entrant et une autre fois à la fin du sermon... Nonse disait Cléliace n'est pas Fabrice que je vais voirje vais entendre le prédicateur étonnant! Au milieu de tous ces raisonnementsla marquise avait des remords; sa conduite avait été si belle depuis quatorze mois! Enfinse dit-ellepour trouver quelque paix avec elle-mêmesi la première femme qui viendra ce soir a été entendre prêcher monsignore del Dongoj'irai aussi; si elle n'y est point alléeje m'abstiendrai.
Une fois ce parti prisla marquise fit le bonheur du Gonzo en lui disant:
-- Tâchez de savoir quel jour le coadjuteur prêcheraet dans quelle église? Ce soiravant que vous ne sortiezj'aurai peut-être une commission à vous donner.
A peine Gonzo parti pour le CorsoClélia alla prendre l'air dans le jardin de son palais. Elle ne se fit pas l'objection que depuis dix mois elle n'y avait pas mis les pieds. Elle était viveanimée; elle avait des couleurs. Le soirà chaque ennuyeux qui entrait dans le salonson coeur palpitait d'émotion. Enfin on annonça le Gonzoquidu premier coup d'oeilvit qu'il allait être l'homme nécessaire pendant huit jours; la marquise est jalouse de la petite Mariniet ce seraitma foiune comédie bien montéese dit-ilque celle dans laquelle la marquise jouerait le premier rôlela petite Anetta la soubretteet monsignore del Dongo l'amoureux! Ma foile billet d'entrée ne serait pas trop payé à deux francs. Il ne se sentait pas de joieetpendant toute la soiréeil coupait la parole à tout le monde et racontait les anecdotes les plus saugrenues (par exemplela célèbre actrice et le marquis de Pequignyqu'il avait apprise la veille d'un voyageur français). La marquisede son côténe pouvait tenir en place; elle se promenait dans le salonelle passait dans une galerie voisine du salonoù le marquis n'avait admis que des tableaux coûtant chacun plus de vingt mille francs. Ces tableaux avaient un langage si clair ce soir- là qu'ils fatiguaient le coeur de la marquise à force d'émotion. Enfinelle entendit ouvrir les deux battantselle courut au salon; c'était la marquise Raversi! Mais en lui adressant les compliments d'usageClélia sentait que la voix lui manquait. La marquise lui fit répéter deux fois la question:
-- Que dites-vous du prédicateur à la mode? qu'elle n'avait point entendue d'abord.
-- Je le regardais comme un petit intriganttrès digne neveu de l'illustre comtesse Mosca; mais à la dernière fois qu'il a prêchétenezà l'église de la Visitationvis- à-vis de chez vousil a été tellement sublimequetoute haine cessanteje le regarde comme l'homme le plus éloquent que j'aie jamais entendu.
-- Ainsi vous avez assisté à un de ses sermons? dit Clélia toute tremblante de bonheur.
-- Maiscommentdit la marquise en riantvous ne m'écoutiez donc pas? Je n'y manquerais pas pour tout au monde. On dit qu'il est attaqué de la poitrineet que bientôt il ne prêchera plus!
A peine la marquise sortieClélia appela le Gonzo dans la galerie.
-- Je suis presque résoluelui dit-elleà entendre ce prédicateur si vanté. Quand prêchera-t-il?
-- Lundi prochainc'est-à-dire dans trois jours; et l'on dirait qu'il a deviné le projet de Votre Excellence; car il vient prêcher à l'église de la Visitation.
Tout n'était pas expliqué; mais Clélia ne trouvait plus de voix pour parler; elle fit cinq ou six tours dans la galeriesans ajouter une parole. Gonzo se disait: Voilà la vengeance qui la travaille. Comment peut-on être assez insolent pour se sauver d'une prisonsurtout quand on a l'honneur d'être gardé par un héros tel que le général Fabio Conti!
-- Au resteil faut se presserajouta-t-il avec une fine ironie; il est touché à la poitrine. J'ai entendu le docteur Rambo dire qu'il n'a pas un an de vie; Dieu le punit d'avoir rompu son ban en se sauvant traîtreusement de la citadelle.
La marquise s'assit sur le divan de la galerieet fit signe à Gonzo de l'imiter. Après quelques instantselle lui remit une petite bourse où elle avait préparé quelques sequins. -- Faites-moi retenir quatre places.
-- Sera-t-il permis au pauvre Gonzo de se glisser à la suite de Votre Excellence?
-- Sans doute; faites retenir cinq places... Je ne tiens nullementajouta-t-elleà être près de la chaire mais j'aimerais à voir Mlle Marinique l'on dit si jolie.
La marquise ne vécut pas pendant les trois jours qui la séparaient du fameux lundijour du sermon. Le Gonzopour qui c'était un insigne honneur d'être vu en public à la suite d'une aussi grande dameavait arboré son habit français avec l'épée; ce n'est pas toutprofitant du voisinage du palaisil fit porter dans l'église un fauteuil doré magnifique destiné à la marquisece qui fut trouvé de la dernière insolence par les bourgeois. On peut penser ce que devint la pauvre marquiselorsqu'elle aperçut ce fauteuilet qu'on l'avait placé précisément vis-à-vis la chaire. Clélia était si confusebaissant les yeuxet réfugiée dans un coin de cet immense fauteuilqu'elle n'eut pas même le courage de regarder la petite Marinique le Gonzo lui indiquait de la mainavec une effronterie dont elle ne pouvait revenir. Tous les êtres non nobles n'étaient absolument rien aux yeux du courtisan.
Fabrice parut dans la chaire; il était si maigresi pâletellement consuméque les yeux de Clélia se remplirent de larmes à l'instant. Fabrice dit quelques parolespuis s'arrêtacomme si la voix lui manquait tout à coup; il essaya vainement de commencer quelques phrases; il se retournaet prit un papier écrit.
-- Mes frèresdit-ilune âme malheureuse et bien digne de toute votre pitié vous engagepar ma voixà prier pour la fin de ses tourmentsqui ne cesseront qu'avec sa vie.
Fabrice lut la suite de son papier fort lentement; mais l'expression de sa voix était tellequ'avant le milieu de la prière tout le monde pleuraitmême le Gonzo.-- Au moins on ne me remarquera passe disait la marquise en fondant en larmes.
Tout en lisant le papier écritFabrice trouva deux ou trois idées sur l'état de l'homme malheureux pour lequel il venait solliciter les prières des fidèles. Bientôt les pensées lui arrivèrent en foule. En ayant l'air de s'adresser au publicil ne parlait qu'à la marquise. Il termina son discours un peu plus tôt que de coutumeparce quequoi qu'il pût faireles larmes le gagnaient à un tel point qu'il ne pouvait plus prononcer d'une manière intelligible. Les bons juges trouvèrent ce sermon singuliermais égal au moinspour le pathétiqueau fameux sermon prêché aux lumières. Quant à Cléliaà peine eut-elle entendu les dix premières lignes de la prière lue par Fabricequ'elle regarda comme un crime atroce d'avoir pu passer quatorze mois sans le voir. En rentrant chez elleelle se mit au lit pour pouvoir penser à Fabrice en toute liberté; et le lendemain d'assez bonne heureFabrice reçut un billet ainsi conçu:
«On compte sur votre honneur; cherchez quatre braves de la discrétion desquels vous soyez sûret demain au moment où minuit sonnera à la Steccatatrouvez-vous près d'une petite porte qui porte le numéro 19dans la rue Saint- Paul. Songez que vous pouvez être attaquéne venez pas seul. »
En reconnaissant ces caractères divinsFabrice tomba à genoux et fondit en larmes: Enfins'écria-t-ilaprès quatorze mois et huit jours! Adieu les prédications.
Il serait bien long de décrire tous les genres de folies auxquels furent en proiece jour-làles coeurs de Fabrice et de Clélia. La petite porte indiquée dans le billet n'était autre que celle de l'orangerie du palais Crescenzietdix fois dans la journéeFabrice trouva le moyen de la voir. Il prit des armeset seulun peu avant minuitd'un pas rapideil passait près de cette portelorsque à son inexprimable joieil entendit une voix bien connuedire d'un ton très bas:
-- Entre iciami de mon coeur.
Fabrice entra avec précautionet se trouva à la vérité dans l'orangeriemais vis-à- vis une fenêtre fortement grillée et élevéeau-dessus du solde trois ou quatre pieds. L'obscurité était profondeFabrice avait entendu quelque bruit dans cette fenêtreet il en reconnaissait la grille avec la mainlorsqu'il sentit une mainpassée à travers les barreauxprendre la sienne et la porter à des lèvres qui lui donnèrent un baiser.
-- C'est moilui dit une voix chériequi suis venue ici pour te dire que je t'aimeet pour te demander si tu veux m'obéir.
On peut juger de la réponsede la joiede l'étonnement de Fabrice; après les premiers transportsClélia lui dit:
-- J'ai fait voeu à la Madonecomme tu saisde ne jamais te voir; c'est pourquoi je te reçois dans cette obscurité profonde. Je veux bien que tu saches quesi jamais tu me forçais à te regarder en plein jourtout serait fini entre nous. Mais d'abordje ne veux pas que tu prêches devant Anetta Mariniet ne va pas croire que c'est moi qui ai eu la sottise de faire porter un fauteuil dans la maison de Dieu.
-- Mon cher angeje ne prêcherai plus devant qui que ce soit; je n'ai prêché que dans l'espoir qu'un jour je te verrais.
-- Ne parle pas ainsisonge qu'il ne m'est pas permisà moide te voir.
Icinous demandons la permission de passersans en dire un seul motsur un espace de trois années.
A l'époque où reprend notre récitil y avait déjà longtemps que le comte Mosca était de retour à Parmecomme premier ministreplus puissant que jamais.
Après ces trois années de bonheur divinl'âme de Fabrice eut un caprice de tendresse qui vint tout changer. La marquise avait un charmant petit garçon de deux ansSandrinoqui faisait la joie de sa mère; il était toujours avec elle ou sur les genoux du marquis Crescenzi;Fabrice au contrairene le voyait presque jamais; il ne voulut pas qu'il s'accoutumât à chérir un autre père. Il conçut le dessein d'enlever l'enfant avant que ses souvenirs fussent bien distincts.
Dans les longues heures de chaque journée où la marquise ne pouvait voir son amila présence de Sandrino la consolait; car nous avons à avouer une chose qui semblera bizarre au nord des Alpes: malgré ses erreurs elle était restée fidèle à son voeu; elle avait promis à la Madonel'on se le rappelle peut-êtrede ne jamais voir Fabrice; telles avaient été ses paroles précises: en conséquence elle ne le recevait que de nuitet jamais il n'y avait de lumières dans l'appartement.
Mais tous les soirs il était reçu par son amie; etce qui est admirableau milieu d'une cour dévorée par la curiosité et par l'ennuiles précautions de Fabrice avaient été si habilement calculéesque jamais cette amiciziacomme on dit en Lombardiene fut même soupçonnée. Cet amour était trop vif pour qu'il n'y eût pas des brouilles; Clélia était fort sujette à la jalousiemais presque toujours les querelles venaient d'une autre cause. Fabrice avait abusé de quelque cérémonie publique pour se trouver dans le même lieu que la marquise et la regarderelle saisissait alors un prétexte pour sortir bien viteet pour longtemps exilait son ami.
On était étonné à la cour de Parme de ne connaître aucune intrigue à une femme aussi remarquable par sa beauté et l'élévation de son esprit; elle fit naître des passions qui inspirèrent bien des folieset souvent Fabrice aussi fut jaloux.
Le bon archevêque Landriani était mort depuis longtemps; la piétéles moeurs exemplairesl'éloquence de Fabrice l'avaient fait oublier; son frère aîné était mort et tous les biens de la famille lui étaient arrivés. A partir de cette époque il distribua chaque année aux vicaires et aux curés de son diocèse les cent et quelque mille francs que rapportait l'archevêché de Parme.
Il eût été difficile de rêver une vie plus honoréeplus honorable et plus utile que celle que Fabrice s'était faitelorsque tout fut troublé par ce malheureux caprice de tendresse.
-- D'après ce voeu que je respecte et qui fait pourtant le malheur de ma vie puisque tu ne veux pas me voir de jourdit-il un jour à Cléliaje suis obligé de vivre constamment seuln'ayant d'autre distraction que le travail; et encore le travail me manque. Au milieu de cette façon sévère et triste de passer les longues heures de chaque journéeune idée s'est présentéequi fait mon tourment et que je combats en vain depuis six mois: mon fils ne m'aimera pointil ne m'entend jamais nommer. Elevé au milieu du luxe aimable du palais Crescenzià peine s'il me connaît. Le petit nombre de fois que je le voisje songe à sa mèredont il me rappelle la beauté céleste et que je ne puis regarderet il doit me trouver une figure sérieuse ce quipour les enfantsveut dire triste.
-- Eh bien! dit la marquiseoù tend tout ce discours qui m'effraye?
-- A ravoir mon fils! Je veux qu'il habite avec moi je veux le voir tous les joursje veux qu'il s'accoutume à m'aimer; je veux l'aimer moi-même à loisir. Puisqu'une fatalité unique au monde veut que je sois privé de ce bonheur dont jouissent tant d'âmes tendreset que je ne passe pas ma vie avec tout ce que j'adoreje veux du moins avoir auprès de moi un être qui te rappelle à mon coeurqui te remplace en quelque sorte. Les affaires et les hommes me sont à charge dans ma solitude forcée; tu sais que l'ambition a toujours été un mot vide pour moidepuis l'instant où j'eus le bonheur d'être écroué par Barboneet tout ce qui n'est pas sensation de l'âme me semble ridicule dans la mélancolie qui loin de toi m'accable.
On peut comprendre la vive douleur dont le chagrin de son ami remplit l'âme de la pauvre Clélia; sa tristesse fut d'autant plus profonde qu'elle sentait que Fabrice avait une sorte de raison. Elle alla jusqu'à mettre en doute si elle ne devait pas tenter de rompre son voeu. Alors elle eût reçu Fabrice de jour comme tout autre personnage de la sociétéet sa réputation de sagesse était trop bien établie pour qu'on en médît. Elle se disait qu'avec beaucoup d'argent elle pourrait se faire relever de son voeu; mais elle sentait aussi que cet arrangement tout mondain ne tranquilliserait pas sa conscienceet peut-être le ciel irrité la punirait de ce nouveau crime.
D'un autre côtési elle consentait à céder au désir si naturel de Fabricesi elle cherchait à ne pas faire le malheur de cette âme tendre qu'elle connaissait si bienet dont son voeu singulier compromettait si étrangement la tranquillitéquelle apparence d'enlever le fils unique d'un des plus grands seigneurs d'Italie sans que la fraude fût découverte? Le marquis Crescenzi prodiguerait des sommes énormesse mettrait lui-même à la tête des rechercheset tôt ou tard l'enlèvement serait connu. Il n'y avait qu'un moyen de parer à ce dangeril fallait envoyer l'enfant au loinà Edimbourgpar exempleou à Paris; mais c'est à quoi la tendresse d'une mère ne pouvait se résoudre. L'autre moyen proposé par Fabriceet en effet le plus raisonnableavait quelque chose de sinistre augure et de presque encore plus affreux aux yeux de cette mère éperdue; il fallaitdisait Fabricefeindre une maladie; l'enfant serait de plus en plus malenfin il viendrait à mourir pendant une absence du marquis Crescenzi.
Une répugnance quichez Cléliaallait jusqu'à la terreurcausa une rupture qui ne put durer.
Clélia prétendait qu'il ne fallait pas tenter Dieu; que ce fils si chéri était le fruit d'un crimeet quesi encore l'on irritait la colère célesteDieu ne manquerait pas de le retirer à lui. Fabrice reparlait de sa destinée singulière: L'état que le hasard m'a donnédisait-il à Cléliaet mon amour m'obligent à une solitude éternelleje ne puiscomme la plupart de mes confrères avoir les douceurs d'une société intimepuisque vous ne voulez me recevoir que dans l'obscuritéce qui réduit à des instantspour ainsi direla partie de ma vie que je puis passer avec vous.
Il y eut bien des larmes répandues. Clélia tomba malade; mais elle aimait trop Fabrice pour se refuser constamment au sacrifice terrible qu'il lui demandait en apparenceSandrino tomba malade; le marquis se hâta de faire appeler les médecins les plus célèbreset Clélia rencontra dès cet instant un embarras terrible qu'elle n'avait pas prévu; il fallait empêcher cet enfant adoré de prendre aucun des remèdes ordonnés par les médecins; ce n'était pas une petite affaire.
L'enfantretenu au lit plus qu'il ne fallait pour sa santédevint réellement malade. Comment dire au médecin la cause de ce mal? Déchirée par deux intérêts contraires et si chersClélia fut sur le point de perdre la raison. Fallait-il consentir à une guérison apparenteet sacrifier ainsi tout le fruit d'une feinte si longue et si pénible? Fabricede son côténe pouvait ni se pardonner la violence qu'il exerçait sur le coeur de son amieni renoncer à son projet. Il avait trouvé le moyen d'être introduit toutes les nuits auprès de l'enfant maladece qui avait amené une autre complication. La marquise venait soigner son filset quelquefois Fabrice était obligé de la voir à la clarté des bougiesce qui semblait au pauvre coeur malade de Clélia un péché horrible et qui présageait la mort de Sandrino. C'était en vain que les casuistes les plus célèbresconsultés sur l'obéissance à un voeudans le cas où l'accomplissement en serait évidemment nuisibleavaient répondu que le voeu ne pouvait être considéré comme rompu d'une façon criminelletant que la personne engagée par une promesse envers la Divinité s'abstenait non pour un vain plaisir des sens mais pour ne pas causer un mal évident. La marquise n'en fut pas moins au désespoiret Fabrice vit le moment où son idée bizarre allait amener la mort de Clélia et celle de son fils.
Il eut recours à son ami intimele comte Moscaqui tout vieux ministre qu'il étaitfut attendri de cette histoire d'amour qu'il ignorait en grande partie.
-- Je vous procurerai l'absence du marquis pendant cinq ou six jours au moins: quand la voulez-vous?
A quelque temps de làFabrice vint dire au comte que tout était préparé pour que l'on pût profiter de l'absence.
Deux jours aprèscomme le marquis revenait à cheval d'une de ses terres aux environs de Mantouedes brigandssoldés apparemment par une vengeance particulièrel'enlevèrentsans le maltraiter en aucune façon et le placèrent dans une barquequi employa trois jours à descendre le Pô et à faire le même voyage que Fabrice avait exécuté autrefois après la fameuse affaire Giletti. Le quatrième jourles brigands déposèrent le marquis dans une île déserte du Pôaprès avoir eu le soin de le voler complètementet de ne lui laisser ni argent ni aucun effet ayant la moindre valeur. Le marquis fut deux jours entiers avant de pouvoir regagner son palais à Parme; il le trouva tendu de noir et tout son monde dans la désolation.
Cet enlèvementfort adroitement exécutéeut un résultat bien funeste: Sandrinoétabli en secret dans une grande et belle maison où la marquise venait le voir presque tous les joursmourut au bout de quelques mois. Clélia se figura qu'elle était frappée par une juste punitionpour avoir été infidèle à son voeu à la Madone: elle avait vu si souvent Fabrice aux lumièreset même deux fois en plein jour et avec des transports si tendresdurant la maladie de Sandrino! Elle ne survécut que de quelques mois à ce fils si chérimais elle eut la douceur de mourir dans les bras de son ami.
Fabrice était trop amoureux et trop croyant pour avoir recours au suicide; il espérait retrouver Clélia dans un meilleur mondemais il avait trop d'esprit pour ne pas sentir qu'il avait beaucoup à réparer.
Peu de jours après la mort de Cléliail signa plusieurs actes par lesquels il assurait une pension de mille francs à chacun de ses domestiqueset se réservaitpour lui- mêmeune pension égale; il donnait des terresvalant cent milles livres de rente à peu prèsà la comtesse Mosca; pareille somme à la marquise del Dongosa mèreet ce qui pouvait rester de la fortune paternelleà l'une de ses soeurs mal mariée. Le lendemain après avoir adressé à qui de droit la démission de son archevêché et de toutes les places dont l'avaient successivement comblé la faveur d'Ernest V et l'amitié du premier ministreil se retira à la Chartreuse de Parmesituée dans les bois voisins du Pôà deux lieues de Sacca.
La comtesse Mosca avait fort approuvédans le tempsque son mari reprît le ministèremais jamais elle n'avait voulu consentir à rentrer dans les états d'Ernest V. Elle tenait sa cour à Vignanoà un quart de lieue de Casal-Maggioresur la rive gauche du Pôet par conséquent dans les états de l'Autriche. Dans ce magnifique que palais de Vignanoque le comte lui avait fait bâtirelle recevait les jeudis toute la haute société de Parmeet tous les jours ses nombreux amis. Fabrice n'eût pas manqué un jour de venir à Vignano. La comtesse en un mot réunissait toutes les apparences du bonheurmais elle ne survécut que fort peu de temps à Fabricequ'elle adoraitet qui ne passa qu'une année dans sa Chartreuse.