 home page
home page
 pagina iniziale
pagina iniziale
|

|
by
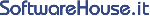
|


|
Ebook in formato Kindle (mobi) - Kindle File Ebook (mobi)
Formato per Iphone, Ipad e Ebook (epub) - Ipad, Iphone and Ebook reader format (epub)
Versione ebook di Readme.it powered by Softwarehouse.itRaymond RadiguetLe diable au corps
Je vaisencourir bien des reproches. Mais qu'y puis-je ? Est-ce ma fautesi j'eus douze ans quelques mois avant la déclaration de laguerre ? Sans douteles troubles qui me vinrent de cettepériode extraordinaire furent d'une sorte qu'on n'éprouvejamais à cet âge ; mais comme il n'existe riend'assez fort pour nous vieillir malgré les apparencesc'esten enfant que je devais me conduire dans une aventure où déjàun homme eût éprouvé de l'embarras. Je ne suispas le seul. Et mes camarades garderont de cette époque unsouvenir qui n'est pas celui de leurs aînés. Que ceuxdéjà qui m'en veulent se représentent ce que futla guerre pour tant de très jeunes garçons :quatre ans de grandes vacances.
Noushabitions à F...au bord de la Marne.
Mesparents condamnaient plutôt la camaraderie mixte. Lasensualitéqui naît avec nous et se manifeste encoreaveugley gagna au lieu de s'y perdre.
Je n'aijamais été un rêveur. Ce qui me semble rêveaux autresplus crédulesme paraissait à moi aussiréel que le fromage au chatmalgré la cloche de verre.Pourtant la cloche existe.
La clochese cassantle chat en profitemême si ce sont ses maîtresqui la cassent et s'y coupent les mains.
Jusqu'àdouze ansje ne vois aucune amourettesauf pour une petite fillenommée Carmenà qui je fis tenirpar un gamin plusjeune que moiune lettre dans laquelle je lui exprimais mon amour.Je m'autorisais de cet amour pour solliciter un rendez-vous. Malettre lui avait été remise le matin avant qu'elle serendît en classe. J'avais distingué la seule fillettequi me ressemblâtparce qu'elle était propreet allaità l'école accompagnée d'une petitecomme moi demon petit frère. Afin que ces deux témoins se tussentj'imaginai de les marieren quelque sorte. A ma lettrej'en joignisdonc une de la part de mon frèrequi ne savait pas écrirepour Mlle Fauvette. J'expliquai à mon frère monentremiseet notre chance de tomber juste sur deux soeurs de nosâges et douées de noms de baptêmes aussiexceptionnels. J'eus la tristesse de voir que je ne m'étaispas mépris sur le bon genre de Carmenlorsque aprèsavoir déjeunéavec mes parents qui me gâtaientet ne me grondaient jamaisje rentrai en classe.
A peinemes camarades à leurs pupitres -- moi en haut de la classeaccroupi pour prendre dans un placarden ma qualité depremierles volumes de la lecture à haute voix --ledirecteur entra. Les élèves se levèrent. Iltenait une lettre à la main. Mes jambes fléchirentlesvolumes tombèrentet je les ramassaitandis que le directeurs'entretenait avec le maître. Déjàles élèvesdes premiers bancs se tournaient vers moiécarlateau fondde la classecar ils entendaient chuchoter mon nom. Enfinledirecteur m'appelaet pour me punir finementtout en n'éveillantcroyait-ilaucune mauvaise idée chez les élèvesme félicita d'avoir écrit une lettre de douze lignessans aucune faute. Il me demanda si je l'avais bien écriteseulpuis il me pria de le suivre dans son bureau. Nous n'y allâmespoint. Il me morigéna dans la coursous l'averse. Ce quitroubla fort mes notions de moralefut qu'il considéraitcomme aussi grave d'avoir compromis la jeune fille (dont les parentslui avaient communiqué ma déclaration)que d'avoirdérobé une feuille de papier à lettres. Il memenaça d'envoyer cette feuille chez moi. Je le suppliai den'en rien faire. Il cédamais me dit qu'il conservait lalettreet qu'à la première récidive il nepourrait plus cacher ma mauvaise conduite.
Ce mélanged'effronterie et de timidité déroutait les miens et lestrompaitcommeà l'écolema facilitévéritable paresseme faisait prendre pour un bon élève.
Je rentraien classe. Le professeurironiquem'appela Don Juan. J'en fusextrêmement flattésurtout de ce qu'il me citâtle nom d'une oeuvre que je connaissais et que ne connaissaient pasmes camarades. Son « BonjourDon Juan » et monsourire entendu transformèrent la classe à mon égard.Peut-être avait-elle déjà su que j'avais chargéun enfant des petites classes de porter une lettre à une« fille »comme disent les écoliersdans leur dur langage. Cet enfant s'appelait Messager ; je nel'avais pas élu d'après son nommaisquand mêmece nom m'avait inspiré confiance.
A uneheurej'avais supplié le directeur de ne rien dire àmon père ; à quatreje brûlais de luiraconter tout. Rien ne m'y obligeait. Je mettrais cet aveu sur lecompte de la franchise. Sachant que mon père ne se fâcheraitpasj'étaissomme touteravi qu'il connût maprouesse.
J'avouaidoncajoutant avec orgueil que le directeur m'avait promis unediscrétion absolue (comme à une grande personne). Monpère voulait savoir si je n'avais pas forgé de toutespièces ce roman d'amour. Il vint chez le directeur. Au coursde cette visiteil parla incidemment de ce qu'il croyait êtreune farce. -- Quoi ? dit alors le directeur surpris et trèsennuyé ; il vous a raconté cela ? Il m'avaitsupplié de me tairedisant que vous le tueriez.
Cemensonge du directeur l'excusait ; il contribua encore àmon ivresse d'homme. J'y gagnai séance tenante l'estime de mescamarades et des clignements d'yeux du maître. Le directeurcachait sa rancune. Le malheureux ignorait ce que je savais déjà :mon pèrechoqué par sa conduiteavait décidéde me laisser finir mon année scolaireet de me reprendre.Nous étions alors au commencement de juin. Ma mère nevoulant pas que cela influât sur mes prixmes couronnesseréservait de dire la choseaprès la distribution. Cejour venugrâce à une injustice du directeur quicraignait confusément les suites de son mensongeseul de laclasseje reçus la couronne d'or que méritait aussi leprix d'excellence. Mauvais calcul : l'école y perdit sesdeux meilleurs élèvescar le père du prixd'excellence retira son fils.
Des élèvescomme nous servaient d'appeaux pour en attirer d'autres.
Ma mèreme jugeait trop jeune pour aller à Henri-IV. Dans son espritcela voulait dire : pour prendre le train. Je restai deux ans àla maison et travaillai seul.
Je mepromettais des joies sans bornescarréussissant àfaire en quatre heures le travail que ne fournissaient pas en deuxjours mes anciens condisciplesj'étais libre plus de lamoitié du jour. Je me promenais seul au bord de la Marne quiétait tellement notre rivière que mes soeurs disaienten parlant de la Seine« une Marne ». J'allaismême dans le bateau de mon pèremalgré sadéfense ; mais je ne ramais paset sans m'avouer que mapeur n'était pas celle de lui désobéirmais lapeur tout court. Je lisaiscouché dans ce bateau. En 1913et 1914deux cents livres y passent. Point ce que l'on nomme demauvais livresmais plutôt les meilleurssinon pour l'espritdu moins pour le mérite. Aussibien plus tardà l'âgeoù l'adolescent méprise les livres de la Bibliothèqueroseje pris goût à leur charme enfantinalors qu'àcette époque je ne les aurais voulu lire pour rien au monde.
Ledésavantage de ces récréations alternant avec letravail était de transformer pour moi toute l'année enfausses vacances. Ainsimon travail de chaque jour était-ilpeu de chosemaiscommetravaillant moins de temps que les autresje travaillais en plus pendant leurs vacancesce peu de chose étaitle bouchon de liège qu'un chat garde toute sa vie au bout dela queuealors qu'il préférerait sans doute un mois decasserole.
Les vraiesvacances approchaientet je m'en occupais fort peu puisque c'étaitpour moi le même régime. Le chat regardait toujours lefromage sous la cloche. Mais vint la guerre. Elle brisa la cloche.Les maîtres eurent d'autres chats à fouetter et le chatse réjouit.
A vraidirechacun se réjouissait en France. Les enfantsleurslivres de prix sous le brasse pressaient devant les affiches. Lesmauvais élèves profitaient du désarroi desfamilles.
Nousallions chaque jouraprès dînerà la gare deJ...à deux kilomètres de chez nousvoir passer lestrains militaires. Nous emportions des campanules et nous leslancions aux soldats. Des dames en blouse versaient du vin rouge dansles bidons et en répandaient des litres sur le quai jonchéde fleurs. Tout cet ensemble me laisse un souvenir de feu d'artifice.Et jamais autant de vin gaspilléde fleurs mortes. Il fallutpavoiser les fenêtres de notre maison.
Bientôtnous n'allâmes plus à J.... Mes frères et messoeurs commençaient d'en vouloir à la guerreils latrouvaient longue. Elle leur supprimait le bord de la mer. Habituésà se lever tardil leur fallait acheter les journaux àsix heures. Pauvre distraction ! Mais vers le vingt aoûtces jeunes monstres reprennent espoir. Au lieu de quitter la table oùles grandes personnes s'attardentils y restent pour entendre monpère parler de départ. Sans doute n'y aurait-il plus demoyens de transport. Il faudrait voyager très loin àbicyclette. Mes frères plaisantent ma petite. Les roues de sabicyclette ont à peine quarante centimètres dediamètre : « On te laissera seule sur laroute. » Ma sanglote. Mais quel entrain pour astiquer lesmachines ! Plus de paresse. Ils proposent de réparer lamienne. Ils se lèvent dès l'aube pour connaîtreles nouvelles. Tandis que chacun s'étonneje découvreenfin les mobiles de ce patriotisme : un voyage àbicyclette ! Jusqu'à la mer ! et une mer plus loinplus jolie que d'habitude. Ils eussent brûlé Paris pourpartir plus vite. Ce qui terrifiait l'Europe était devenu leurunique espoir.
L'égoïsmedes enfants est-il différent du nôtre ? L'étéà la campagnenous maudissons la pluie qui tombeet lescultivateurs la réclament.
Il estrare qu'un cataclysme se produise sans phénomènesavant-coureurs. L'attentat autrichienl'orage du procèsCaillaux répandaient une atmosphère irrespirablepropice à l'extravagance. Aussi mon vrai souvenir de guerreprécède la guerre.
Voicicomment :
Nous nousmoquionsmes frères et moid'un de nos voisinshommegrotesquenain à barbiche blanche et à capuchonconseiller municipalnommé Maréchaud. Tout le mondel'appelait le père Maréchaud. Bien que porte àportenous nous défendions de le saluerce dont il enrageaitsi fortqu'un journ'y tenant plusil nous aborda sur la route etnous dit : « Eh bien ! on ne salue pas unconseiller municipal ? » Nous nous sauvâmes. Apartir de cette impertinenceles hostilités furent déclarées.Mais que pouvait contre nous un conseiller municipal ? Enrevenant de l'écoleet en y allantmes frèrestiraient sa sonnetteavec d'autant plus d'audace que le chienquipouvait avoir mon âgen'était pas à craindre.
La veilledu 14 juillet 1914en allant à la rencontre de mesfrèresquelle ne fut pas ma surprise de voir un attroupementdevant la grille des Maréchaud. Quelques tilleuls élaguéscachaient mal leur villa au fond du jardin. Depuis deux heures del'après-midileur jeune bonne étant devenue folle seréfugiait sur le toit et refusait de descendre. Déjàles Maréchaudépouvantés par le scandaleavaient clos leurs voletssi bien que le tragique de cette folle surun toit s'augmentait de ce que la maison parût abandonnée.Des gens criaients'indignaient que ses maîtres ne fissentrien pour sauver cette malheureuse. Elle titubait sur les tuilessansd'ailleursavoir l'air d'une ivrogne. J'eusse voulu pouvoirrester là toujoursmais notre bonneenvoyée par mamèrevint nous rappeler au travail. Sans celaje seraisprivé de fête. Je partis la mort dans l'âmeetpriant Dieu que la bonne fût encore sur le toitlorsquej'irais chercher mon père à la gare.
Elle étaità son postemais les rares passants revenaient de Parissedépêchaient pour rentrer dîneret ne pas manquerle bal. Ils ne lui accordaient qu'une minute distraite.
Du restejusqu'icipour la bonneil ne s'agissait encore que de répétitionplus ou moins publique. Elle devait débuter le soirselonl'usageles girandoles lumineuses lui formant une véritablerampe. Il y avait à la fois celle de l'avenue et celles dujardincar les Maréchaudmalgré leur absence feinten'avaient osé se dispenser d'illuminercomme notables. Aufantastique de cette maison du crimesur le toit de laquelle sepromenaitcomme sur un pont de navire pavoiséune femme auxcheveux flottantscontribuait beaucoup la voix de cette femme :inhumainegutturaled'une douceur qui donnait la chair de poule.
Lespompiers d'une petite commune étant des « volontaires »ils s'occupent tout le jour d'autre chose que de pompes. C'est lelaitierle pâtissierle serrurierquileur travail finiviendront éteindre l'incendies'il ne s'est pas éteintde lui-même. Dès la mobilisationnos pompiers formèrenten outre une sorte de milice mystérieuse faisant despatrouillesdes manoeuvres et des rondes de nuit. Ces bravesarrivèrent enfin et fendirent la foule.
Une femmes'avança. C'était l'épouse d'un conseillermunicipaladversaire de Maréchaudet quidepuis quelquesminutess'apitoyait bruyamment sur la folle. Elle fit desrecommandations au capitaine : « Essayez de laprendre par la douceur ; elle en est tellement privéelapauvre petitedans cette maison où on la bat. Surtoutsic'est la crainte d'être renvoyéede se trouver sansplacequi la fait agirdites-lui que je la prendrai chez moi. Jelui doublerai ses gages. »
Cettecharité bruyante produisit un effet médiocre sur lafoule. La dame l'ennuyait. On ne pensait qu'à la capture. Lespompiersau nombre de sixescaladèrent la grillecernèrentla maisongrimpant de tous les côtés. Mais àpeine l'un d'eux apparut-il sur le toitque la foulecomme lesenfants à Guignolse mit à vociféreràprévenir la victime.
--Taisez-vous donc ! criait la damece qui excitait les « Envoilà un ! En voilà un ! » dupublic. A ces crisla folles'armant de tuilesen envoya une surle casque du pompier parvenu au faîte. Les cinq autresredescendirent aussitôt.
Tandis queles tirsles manègesles baraquesplace de la Mairieselamentaient de voir si peu de clientèleune nuit où larecette devait être fructueuseles plus hardis voyousescaladaient les murs et se pressaient sur la pelouse pour suivre lachasse. La folle disait des choses que j'ai oubliéesaveccette profonde mélancolie résignée que donne auxvoix la certitude qu'on a raisonque tout le monde se trompe. Lesvoyousqui préféraient ce spectacle à la foirevoulaient cependant combiner les plaisirs. Aussitremblant que lafolle fût prise en leur absencecouraient-ils faire vite untour de chevaux de bois. D'autresplus sagesinstallés surles branches des tilleulscomme pour la revue de Vincennessecontentaient d'allumer des feux de Bengaledes pétards.
On imaginel'angoisse du couple Maréchaudchez soienfermé aumilieu de ce bruit et de ces lueurs.
Leconseiller municipalépoux de la dame charitablegrimpésur un petit mur de la grilleimprovisait un discours sur lacouardise des propriétaires. On l'applaudit.
Croyantque c'était elle qu'on applaudissaitla folle saluaitunpaquet de tuiles sous chaque brascar elle en jetait une chaque foisque miroitait un casque. De sa voix inhumaineelle remerciait qu'onl'eût enfin comprise. Je pensai à quelque fillecapitaine corsairerestant seule sur son bateau qui sombre.
La foulese dispersaitun peu lasse. J'avais voulu rester avec mon pèretandis que ma mèrepour assouvir ce besoin de mal au coeurqu'ont les enfantsconduisait les siens au manège enmontagnes russes. Certesj'éprouvais cet étrangebesoin plus vivement que mes frères. J'aimais que mon coeurbatte plus vite et irrégulièrement. Ce spectacled'unepoésie profondeme satisfaisait davantage. « Commetu es pâle »avait dit ma mère. Je trouvaile prétexte des feux de Bengale. Ils me donnaientdis-jeunecouleur verte.
-- Jecrains tout de même que cela l'impressionne tropdit-elle àmon père.
-- Ohrépondit-ilpersonne n'est plus insensible. Il peut regardern'importe quoisauf un lapin qu'on écorche.
Mon pèredisait cela pour que je restasse. Mais il savait que ce spectacle mebouleversait. Je sentais qu'il le bouleversait aussi. Je lui demandaide me prendre sur ses épaules pour mieux voir. En réalitéj'allais m'évanouirmes jambes ne me portaient plus.
Maintenanton ne comptait qu'une vingtaine de personnes. Nous entendîmesles clairons. C'était la retraite aux flambeaux.
Centtorches éclairaient soudain la follecommeaprès lalumière douce des rampesle magnésium éclatepour photographier une nouvelle étoile. Alorsagitant sesmains en signe d'adieuet croyant à la fin du mondeousimplement qu'on allait la prendreelle se jeta du toitbrisa lamarquise dans sa chuteavec un fracas épouvantablepourvenir s'aplatir sur les marches de pierre. Jusqu'ici j'avais essayéde supporter toutbien que mes oreilles tintassent et que le coeurme manquât. Mais quand j'entendis des gens crier : « Ellevit encore »je tombaisans connaissancedes épaulesde mon père.
Revenu àmoiil m'entraîna au bord de la Marne. Nous y restâmestrès tarden silenceallongés dans l'herbe.
Au retourje crus voir derrière la grille une silhouette blanchelefantôme de la bonne ! C'était le pèreMaréchaud en bonnet de cotoncontemplant les dégâtssa marquiseses tuilesses pelousesses massifsses marchescouvertes de sangson prestige détruit.
Sij'insiste sur un tel épisodec'est qu'il fait comprendremieux que tout autre l'étrange période de la guerreetcombienplus que le pittoresqueme frappait la poésie deschoses.
Nousentendîmes le canon. On se battait près de Meaux. Onracontait que des uhlans avaient été capturésprès de Lagnyà quinze kilomètres de chez nous.Tandis que ma tante parlait d'une amieenfuie dès lespremiers joursaprès avoir enterré dans son jardin despendulesdes boîtes de sardinesje demandai à mon pèrele moyen d'emporter nos vieux livres ; c'est ce qu'il me coûtaitle plus de perdre.
Enfinaumoment où nous nous apprêtions à la fuitelesjournaux nous apprirent que c'était inutile.
Messoeursmaintenantallaient à J... porter des paniers depoires aux blessés. Elles avaient découvert undédommagementmédiocre il est vraià tousleurs beaux projets écroulés. Quand elles arrivaient àJ...les paniers étaient presque vides !
Je devaisentrer au lycée Henri-IV ; mais mon père préférame garder encore un an à la campagne. Ma seule distraction dece morne hiver fut de courir chez notre marchande de journauxpourêtre sûr d'avoir un exemplaire du Motjournal qui meplaisait et paraissait le samedi. Ce jour-làje n'étaisjamais levé tard.
Mais leprintemps arrivaqu'égayèrent mes premièresincartades. Sous prétexte de quêtesce printempsplusieurs foisje me promenaiendimanchéune jeune personneà ma droite. Je tenais le tronc ; ellela corbeilled'insignes. Dès la seconde quêtedes confrèresm'apprirent à profiter de ces journées libres oùl'on me jetait dans les bras d'une petite fille. Dès lorsnous nous empressions de recueillirle matinle plus d'argentpossibleremettions à midi notre récolte à ladame patronnesse et allions toute la journée polissonner surles coteaux de Chennevières. Pour la première foisj'eus un ami. J'aimais à quêter avec sa. Pour lapremière foisje m'entendais avec un garçon aussiprécoce que moiadmirant même sa beautésoneffronterie. Notre mépris commun pour ceux de notre âgenous rapprochait encore. Nous seulsnous jugions capables decomprendre les choses ; etenfinnous seulsnous trouvionsdignes des femmes. Nous nous croyions des hommes. Par chancenousn'allions pas être séparés. René allait aulycée Henri-IVet je serais dans sa classeen troisième.Il ne devait pas apprendre le grec ; il me fit cet extrêmesacrifice de convaincre ses parents de le lui laisser apprendre.Ainsi nous serions toujours ensemble. Comme il n'avait pas fait sapremière annéec'était s'obliger à desrépétitions particulières. Les parents de Renén'y comprirent rienquil'année précédentedevant ses supplicationsavaient consenti à ce qu'iln'étudiât pas le grec. Ils y virent l'effet de ma bonneinfluenceets'ils supportaient ses autres camaradesj'étaisdu moinsle seul ami qu'ils approuvassent.
Pour lapremière foisnul jour des vacances de cette année neme fut pesant. Je connus donc que personne n'échappe àson âgeet que mon dangereux mépris s'étaitfondu comme glace dès que quelqu'un avait bien voulu prendregarde à moide la façon qui me convenait. Nos communesavances raccourcirent de moitié la route que l'orgueil dechacun de nous avait à faire.
Le jour dela rentrée des classesRené me fut un guide précieux.
Avec luitout me devenait plaisiret moi quiseulne pouvait avancer d'unpasj'aimais faire à pieddeux fois par jourle trajet quisépare Henri-IV de la gare de la Bastilleoù nousprenions notre train.
Trois anspassèrent ainsisans autre amitié et sans autre espoirque les polissonneries du jeudi -- avec les petites filles que lesparents de mon ami nous fournissaient innocemmentinvitant ensembleà goûter les amis de leur fils et les amies de leurfille --menues faveurs que nous dérobionset qu'elles nousdérobaientsous prétexte de jeux à gages.
La bellesaison venuemon père aimait à nous emmenermesfrères et moidans de longues promenades. Un de nos butsfavoris était Ormessonet de suivre le Morbrasrivièrelarge d'un mètretraversant des prairies où poussentdes fleurs qu'on ne rencontre nulle part ailleurset dont j'aioublié le nom. Des touffes de cresson ou de menthe cachent aupied qui se hasarde l'endroit où commence l'eau. La rivièrecharrie au printemps des milliers de pétales blancs et roses.Ce sont les aubépines.
Undimanche d'avril 1917comme cela nous arrivait souventnousprîmes le train pour La Varenned'où nous devions nousrendre à pied à Ormesson. Mon père me dit quenous retrouverions à La Varenne des gens agréableslesGrangier. Je les connaissais pour avoir vu le nom de leur filleMarthedans le catalogue d'une exposition de peinture. Un jourj'avais entendu mes parents parler de la visite d'un M. Grangier.Il était venuavec un carton empli des oeuvres de sa filleâgée de dix-huit ans. Marthe était malade. Sonpère aurait voulu lui faire une surprise : que sesaquarelles figurassent dans une exposition de charité dont mamère était présidente. Ces aquarelles étaientsans nulle recherche ; on y sentait la bonne élèvede cours de dessintirant la langueléchant les pinceaux.
Sur lequai de la gare de La Varenneles Grangier nous attendaient. M. etMme Grangier devaient être du même âgeapprochant de la cinquantaine. Mais Mme Grangier paraissaitl'aînée de son mari ; son inélégancesa taille courtefirent qu'elle me déplut au premier coupd'oeil.
Au coursde cette promenadeje devais remarquer qu'elle fronçaitsouvent les sourcilsce qui couvrait son front de rides auxquellesil fallait une minute pour disparaître. Afin qu'elle eûttous les motifs de me déplairesans que je me reprochassed'être injusteje souhaitais qu'elle employât des façonsde parler assez communes. Sur ce pointelle me déçut.
Le pèreluiavait l'air d'un brave hommeancien sous-officieradoréde ses soldats. Mais où était Marthe ? Jetremblais à la perspective d'une promenade sans autrecompagnie que celle de ses parents. Elle devait venir par le prochaintrain« dans un quart d'heureexpliqua Mme Grangiern'ayant pu être prête à temps. Son frèrearriverait avec elle ».
Quand letrain entra en gareMarthe était debout sur le marchepied duwagon. « Attends bien que le train s'arrête »lui cria sa mère. Cette imprudente me charma.
Sa robeson chapeautrès simplesprouvaient son peu d'estime pourl'opinion des inconnus. Elle donnait la main à un petit garçonqui paraissait avoir onze ans. C'était son frèreenfant pâleaux cheveux d'albinoset dont tous les gestestrahissaient la maladie.
Sur larouteMarthe et moi marchions en tête. Mon pèremarchait derrièreentre les Grangier.
Mesfrèreseuxbâillaient avec ce nouveau petit camaradechétifà qui l'on défendait de courir.
Comme jecomplimentais Marthe sur ses aquarelleselle me réponditmodestement que c'étaient des études. Elle n'yattachait aucune importance. Je jugeai bonpour la premièrefoisde ne pas lui dire que je trouvais ces sortes de fleursridicules.
Sous sonchapeauelle ne pouvait bien me voir. Moije l'observais.
-- Vousressemblez peu à madame votre mèrelui dis-je.
C'étaitun madrigal.
-- On mele dit quelquefois ; maisquand vous viendrez à lamaisonje vous montrerai des photographies de maman lorsqu'elleétait jeuneje lui ressemble beaucoup.
Voulantdissiper le malaise de cette réponse pénibleet necomprenant pas quepénibleelle ne pouvait l'être quepour moipuisque heureusementMarthe ne voyait point sa mèreavec mes yeuxje lui dis :
-- Vousavez tort de vous coiffer de la sorteles cheveux lisses vousiraient mieux.
Je restaiterrifién'ayant jamais dit pareille chose à unefemme. Je pensais à la façon dont j'étaiscoiffémoi.
-- Vouspourrez le demander à maman (comme si elle avait besoin de sejustifier !) ; d'habitudeje ne me coiffe pas si malmaisj'étais déjà en retard et je craignais demanquer le second train. D'ailleursje n'avais pas l'intentiond'ôter mon chapeau.
« Quellefille était-ce doncpensais-jepour admettre qu'un gamin laquerelle à propos de ses mèches ? »
J'essayaisde deviner ses goûts en littérature ; je fusheureux qu'elle connût Baudelaire et Verlainecharmé dela façon dont elle aimait Baudelairequi n'étaitpourtant pas la mienne. J'y discernais une révolte. Sesparents avaient fini par admettre ses goûts. Son fiancédans ses lettreslui parlait de ce qu'il lisaitet s'il luiconseillait certains livresil lui en défendait d'autres. Illui avait défendu Les Fleurs du mal. Désagréablementsurpris d'apprendre qu'elle était fiancéeje meréjouis de savoir qu'elle désobéissait àun soldat assez nigaud pour craindre Baudelaire. Je fus heureux desentir qu'il devait souvent choquer Marthe. Après la premièresurprise désagréableje me félicitai de sonétroitessed'autant mieux que j'eusse craints'il avait luiaussi goûté Les Fleurs du malque leur futurappartement ressemblât à celui de La Mort des amants.Je me demandai ensuite ce que cela pouvait bien me faire.
Son fiancélui avait aussi défendu les académies de dessin. Moiqui n'y allais jamaisje lui proposai de l'y conduireajoutant quej'y travaillai souvent. Maiscraignant ensuite que mon mensonge fûtdécouvertje la priai de n'en point parler à mon père.Il ignoraitdis-jeque je manquais des cours de gymnastiquepourme rendre à la Grande- Chaumière. Car je ne voulais pasqu'elle pût se figurer que je cachais l'académie àmes parentsparce qu'ils me défendaient de voir des femmesnues. J'étais heureux qu'il se fît secret entre nousetmoitimideme sentais déjà tyrannique avec elle.
J'étaisfier aussi d'être préféré à lacampagnecar nous n'avions pas encore fait allusion au décorde notre promenade. Quelquefois ses parents l'appelaient :« RegardeMartheà ta droitecomme les coteauxde Chennevières sont jolis »ou bienson frères'approchait d'elle et lui demandait le nom d'une fleur qu'il venaitde cueillir. Elle leur accordait d'attention distraite juste assezpour qu'ils ne se fâchassent point.
Nous nousassîmes dans les prairies d'Ormesson. Dans ma candeurjeregrettais d'avoir été si loinet d'avoir tellementprécipité les choses. « Après uneconversation moins sentimentaleplus naturellepensai-jejepourrais éblouir Martheet m'attirer la bienveillance de sesparentsen racontant le passé de ce village. » Jem'en abstins. Je croyais avoir des raisons profondeset pensaisqu'après tout ce qui s'était passéuneconversation tellement en dehors de nos inquiétudes communesne pourrait que rompre le charme. Je croyais qu'il s'étaitpassé des choses graves. C'était d'ailleurs vraisimplementje le sus dans la suiteparce que Marthe avait faussénotre conversation dans le même sens que moi. Mais moi qui nepouvais m'en rendre compteje me figurais lui avoir adressédes paroles significatives. Je croyais avoir déclarémon amour à une personne insensible. J'oubliais que M. etMme Grangier eussent pu entendre sans le moindre inconvénienttout ce que j'avais dit à leur fille ; mais moiaurais-je pu le lui dire en leur présence ?
-- Marthene m'intimide pasme répétais-je. Doncseulssesparents et mon père m'empêchent de me pencher sur soncou et de l'embrasser.
Profondémenten moiun autre garçon se félicitait de cestrouble-fête. Celui-ci pensait :
-- Quellechance que je ne me trouve pas seul avec elle ! Car je n'oseraispas davantage l'embrasseret n'aurais aucune excuse.
Ainsitriche le timide.
Nousreprenions le train à la gare de Sucy. Ayant une bonnedemi-heure à l'attendrenous nous assîmes à laterrasse d'un café. Je dus subir les compliments deMme Grangier. Ils m'humiliaient. Ils rappelaient à safille que je n'étais encore qu'un lycéenqui passeraitson baccalauréat dans un an. Marthe voulut boire de lagrenadine ; j'en commandais aussi. Le matin encoreje me seraiscru déshonoré en buvant de la grenadine. Mon pèren'y comprenait rien. Il me laissait toujours servir les apéritifs.Je tremblai qu'il ne plaisantât sur ma sagesse. Il le fitmaisà mots couvertsde façon que Marthe ne devinâtpas que je buvais de la grenadine pour faire comme elle.
Arrivésà F...nous dîmes adieu aux Grangier. Je promis àMarthe de lui porterle jeudi suivantla collection du journal LeMot et Une Saison en Enfer.
-- Encoreun titre qui plairait à mon fiancé !
Elleriait.
-- VoyonsMarthe ! ditfronçant les sourcilssa mère qu'untel manque de soumission choquait toujours.
Mon pèreet mes frères s'étaient ennuyéqu'importe !Le bonheur est égoïste.
Lelendemainau lycéeje n'éprouvai pas le besoin deraconter à Renéà qui je disais toutmajournée du dimanche. Mais je n'étais pas d'humeur àsupporter qu'il me raillât de n'avoir pas embrasséMarthe en cachette. Autre chose m'étonnait ; c'estqu'aujourd'hui je trouvais René moins différent de mescamarades.
Ressentantde l'amour pour Marthej'en ôtais à Renéàmes parentsà mes soeurs.
Je mepromettais bien cet effort de volonté de ne pas venir la voiravant le jour de notre rendez-vous. Pourtantle mardi soirnepouvant attendreje sus trouver à ma faiblesse de bonnesexcuses qui me permissent de porter après dîner le livreet les journaux. Dans cette impatienceMarthe verrait la preuve demon amourdisais-jeet si elle refuse de la voirje saurais bienl'y contraindre.
Pendant unquart d'heureje courus comme un fou jusqu'à sa maison.Alorscraignant de la déranger pendant son repasj'attendisen nagedix minutesdevant la grille. Je pensais que pendant cetemps mes palpitations de coeur s'arrêteraient. Ellesaugmentaientau contraire. Je manquai tourner bridemais depuisquelques minutesd'une fenêtre voisineune femme me regardaitcurieusementvoulant savoir ce que je faisaisréfugiécontre cette porte. Elle me décida. Je sonnai. J'entrai dansla maison. Je demandai à la domestique si Madame étaitchez elle. Presque aussitôtMme Grangier parut dans lapetite pièce où l'on m'avait introduit. Je sursautaicomme si la domestique eût dû comprendre que j'avaisdemandé « Madame » par convenance et queje voulais voir « Mademoiselle ». Rougissantje priai Mme Grangier de m'excuser de la déranger àpareille heurecomme s'il eût été une heure dumatin : ne pouvant venir jeudij'apportais le livre et lesjournaux à sa fille.
-- Celatombe à merveilleme dit Mme Grangiercar Marthen'aurait pu vous recevoir. Son fiancé a obtenu une permissionquinze jours plus tôt qu'il ne pensait. Il est arrivéhieret Marthe dîne ce soir chez ses futurs beaux-parents.
Je m'enallai doncet puisque je n'avais plus de chance de la revoir jamaiscroyais-jem'efforçais de ne plus penser à Martheetpar cela mêmene pensant qu'à elle.
Pourtantun mois aprèsun matinsautant de mon wagon à la garede la Bastilleje la vis qui descendait d'un autre. Elle allaitchoisir dans des magasins différentes chosesen vue de sonmariage. Je lui demandai de m'accompagner jusqu'à Henri-IV.
-- Tiensdit-ellel'année prochainequand vous serez en secondevousaurez mon beau- père pour professeur de géographie.
Vexéqu'elle me parlât étudescomme si aucune autreconversation n'eût été de mon âgeje luirépondis aigrement que ce serait assez drôle.
Ellefronça les sourcils. Je pensai à sa mère.
Nousarrivions à Henri-IVetne voulant pas la quitter sur cesparoles que je croyais blessantesje décidai d'entrer enclasse une heure plus tardaprès le cours de dessin. Je fusheureux qu'en cette circonstance Marthe ne montrât pas desagessene me fît aucun reprocheet plutôt semblâtme remercier d'un tel sacrificeen réalité nul. Je luifus reconnaissant qu'en échange elle ne me proposâtpoint de l'accompagner dans ses coursesmais qu'elle me donnâtson temps comme je lui donnais le mien.
Nousétions maintenant dans le jardin du Luxembourg ; neufheures sonnèrent à l'horloge du Sénat. Jerenonçai au lycée. J'avais dans ma pochepar miracleplus d'argent que n'en a d'habitude un collégien de deux ansayant la veille vendu mes timbres-poste les plus rares à labourse aux timbresqui se tient derrière le Guignol desChamps-Elysées.
Au coursde la conversationMarthe m'ayant appris qu'elle déjeunaitchez ses beaux- parentsje décidai de la résoudre àrester avec moi. La demie de neuf heures sonnait. Marthe sursautapoint encore habituée à ce qu'on abandonnât pourelle tous ses devoirs de classe. Maisvoyant que je restais sur machaise de ferelle n'eut pas le courage de me rappeler que j'auraisdû être assis sur les bancs de Henri-IV.
Nousrestions immobiles. Ainsi doit être le bonheur. Un chien sautadu bassin et se secoua. Marthe se levacomme quelqu'un quiaprèsla siesteet le visage encore enduit de sommeilsecoue ses rêves.Elle faisait avec ses bras des mouvements de gymnastique. J'enaugurai mal pour notre entente.
-- Ceschaises sont trop duresme dit-ellecomme pour s'excuser d'êtredebout.
Elleportait une robe de foulardchiffonnée depuis qu'elle s'étaitassise. Je ne pus m'empêcher d'imaginer les dessins que lecannage imprime sur la peau.
-- Allonsaccompagnez-moi dans les magasinspuisque vous êtes décidésà ne pas aller en classedit Marthefaisant pour la premièrefois allusion à ce que je négligeais pour elle.
Jel'accompagnai dans plusieurs maisons de lingeriel'empêchantde commander ce qui lui plaisait et ne me plaisait pas ; parexempleévitant le rosequi m'importuneet qui étaitsa couleur favorite.
Aprèsces premières victoiresil fallait obtenir de Marthe qu'ellene déjeunât pas chez ses beaux-parents. Ne pensant pasqu'elle pouvait leur mentir pour le simple plaisir de rester en macompagnieje cherchai ce qui la déterminerait à mesuivre dans l'école buissonnière. Elle rêvait deconnaître un bar américain. Elle n'avait jamais osédemander à son fiancé de l'y conduire. D'ailleursilignorait les bars. Je tenais mon prétexte. A son refusempreint d'une véritable déceptionje pensai qu'elleviendrait. Au bout d'une demi-heureayant usé de tout pour laconvaincreet n'insistant même plusje l'accompagnai chez sesbeaux-parentsdans l'état d'esprit d'un condamné àmort espérant jusqu'au dernier moment qu'un coup de main sefera sur la route du supplice. Je voyais approcher la ruesans querien ne se produisît. Mais soudainMarthefrappant àla vitrearrêta le chauffeur du taxi devant un bureau deposte.
Elle medit :
--Attendez-moi une seconde. Je vais téléphoner àma belle-mère que je suis dans un quartier trop éloignépour arriver à temps.
Au bout dequelques minutesn'en pouvant plus d'impatiencej'avisais unemarchande de fleurs et je choisis une à une des roses rougesdont je fis faire une botte. Je ne pensais pas tant au plaisir deMarthe qu'à la nécessité pour elle de mentirencore ce soir pour expliquer à ses parents d'oùvenaient les roses. Notre projetlors de la premièrerencontred'aller à une académie de dessin ; lemensonge du téléphone qu'elle répéteraitce soirà ses parentsmensonge auquel s'ajouterait celui desrosesm'étaient des faveurs plus douce qu'un baiser. Carayant souvent embrassésans grand plaisirdes lèvresde petites filleset oubliant que c'était parce que je ne lesaimais pasje désirais peu les lèvres de Marthe.Tandis qu'une telle complicité m'était restéejusqu'à ce jourinconnue.
Marthesortait de la posterayonnanteaprès le premier mensonge. Jedonnai au chauffeur l'adresse d'un bar de la rue Daunou.
Elles'extasiaitcomme une pensionnairesur la veste blanche du barmanla grâce avec laquelle il secouait les gobelets d'argentlesnoms bizarres ou poétiques des mélanges. Elle respiraitde temps en temps les roses rouges dont elle se promettait de faireune aquarellequ'elle me donnerait en souvenir de cette journée.Je lui demandai de me montrer une photographie de son fiancé.Je le trouvai beau. Sentant quelle importance elle attachait àmes opinionsje poussai l'hypocrisie jusqu'à lui dire qu'ilétait très beaumais d'un air peu convaincupour luidonner à penser que le lui disais par politesse. Ce quiselonmoidevait jeter le trouble dans l'âme de Martheetde plusm'attirer sa reconnaissance.
Maisl'après-midiil fallut songer au motif de son voyage. Sonfiancédont elle savait les goûtss'en étaitremis complètement à elle du soin de choisir leurmobilier. Mais sa mère voulait à toute force la suivre.Martheenfinen lui promettant de ne pas faire de foliesavaitobtenu de venir seule. Elle devaitce jour-làchoisirquelques meubles pour leur chambre à coucher. Bien que je mepromis de ne montrer d'extrême plaisir ou déplaisir àaucune des paroles de Martheil me fallut faire un effort pourcontinuer de marcher sur le boulevard d'un pas tranquille quimaintenant ne s'accordait plus avec le rythme de mon coeur.
Cetteobligation d'accompagner Marthe m'apparut comme une malchance. Ilfallait donc l'aider à choisir une chambre pour elle et unautre ! Puisj'entrevis le moyen de choisir une chambre pourMarthe et pour moi.
J'oubliaissi vite son fiancéqu'au bout d'un quart d'heure de marcheon m'aurait surpris en me rappelant quedans cette chambreun autredormirait auprès d'elle.
Son fiancégoûtait le style Louis XV.
Le mauvaisgoût de Marthe était autre ; elle aurait plutôtversé dans le japonais. Il me fallut donc les combattre tousdeux. C'était à qui jouerait le plus vite. Au moindremot de Marthedevinant ce qui la tentaitil me fallait lui désignerle contrairequi ne me plaisait pas toujoursafin de me donnerl'apparence de céder à ses capricesquandj'abandonnerais un meuble pour un autrequi dérangeait moinsson oeil.
Ellemurmurait : « Lui voulait une chambre rose. »N'osant même plus m'avouer ses propres goûtselle lesattribuait à son fiancé. Je devinai que dans quelquesjours nous les raillerions ensemble.
Pourtantje ne comprenais pas bien cette faiblesse. « Si elle nem'aime paspensai-jequelle raison a-t-elle de me céderdesacrifier ses préférenceset celles de ce jeune hommeaux miennes ? » Je n'en trouvai aucune. La plusmodeste eût été encore de me dire que Marthem'aimait. Pourtant j'étais sûr du contraire.
Marthem'avait dit : « Au moins laissons-lui l'étofferose. » -- « Laissons-lui ! »Rien que pour ce motje me sentais près de lâcherprise. Mais « lui laisser l'étoffe rose »équivalait à tout abandonner. Je représentai àMarthe combien ces murs roses gâcheraient les meubles simplesque « nous avions choisis »etreculantencore devant le scandalelui conseillai de faire peindre les mursde sa chambre à la chaux !
C'étaitle coup de grâce. Toute la journéeMarthe avait ététellement harcelée qu'elle le reçut sans révolte.Elle se contenta de me dire : « En effetvous avezraison. »
A la finde cette journée éreintanteje me félicitai dupas que j'avais fait. J'étais parvenu à transformermeuble à meublece mariage d'amourou plutôtd'amouretteen un mariage de raisonet lequel ! puisque laraison n'y tenait aucune placechacun ne trouvant chez l'autre queles avantages qu'offre un mariage d'amour.
En mequittantce soir-làau lieu d'éviter désormaismes conseilselle m'avait prié de l'aider les jours suivantsdans le choix des autres meubles. Je le lui promismais àcondition qu'elle me jurât de ne jamais le dire à sonfiancépuisque la seule raison qui pût à lalongue lui faire admettre ces meubless'il avait de l'amour pourMarthec'était de penser que tout sortait d'ellede son bonplaisirqui deviendrait le leur.
Quand jerentrai à la maisonje crus lire dans le regard de mon pèrequ'il avait déjà appris mon escapade. Naturellement ilne savait rien ; comment aurait-il pu le savoir ?
« Bah !Jacques s'habituera bien à cette chambre »avaitdit Marthe. En me couchantje me répétai quesi ellesongeait à son mariage avant de dormirelle devaitce soirl'envisager de tout autre sorte qu'elle ne l'avait fait les joursprécédents. Pour moiquelle que fût l'issue decette idyllej'étaisd'avancebien vengé de sonJacques : je pensais à la nuit de noces dans cettechambre austèredans « ma » chambre !
Lelendemain matinje guettais dans la rue le facteur qui devaitm'apporter une lettre d'absence. Il me la remitje l'empochaijetant les autres dans la boite de notre grille. Procédétrop simple pour ne pas en user toujours.
Manquer laclasse voulait direselon moique j'étais amoureux deMarthe. Je me trompais. Marthe ne m'était que le prétextede cette école buissonnière. Et la preuvec'estqu'après avoir goûté en compagnie de Marthe auxcharmes de la libertéje voulus y goûter seulpuisfaire des adeptes. La liberté me devint vite une drogue.
L'annéescolaire touchait à sa finet je voyais avec terreur que maparesse allait rester impuniealors que je souhaitais le renvoi ducollègeun drameenfinqui clôturât cettepériode.
A force devivre dans les mêmes idéesde ne voir qu'une chosesion la veut avec ardeuron ne remarque plus le crime de ses désirs.Certesje ne cherchais pas à faire de la peine à monpère ; pourtantje souhaitais la chose qui pourrait luien faire le plus. Les classes m'avaient toujours été unsupplice ; Marthe et la liberté avaient achevé deme les rendre intolérables. Je me rendais bien compte quesij'aimais moins Renéc'était simplement parce qu'il merappelait quelque chose du collège. Je souffraiset cettecrainte me rendait même physiquement maladedans la niaiseriede mes condisciples.
Pour lemalheur de Renéje lui avais fait trop bien partager monvice. Aussilorsquemoins habile que moiil m'annonça qu'ilétait renvoyé de Henri-IVje crus l'être moi-même. Il fallait l'apprendre à mon pèrecar ilme saurait gré de lui dire moi-mêmeavant la lettre ducenseurlettre trop grave à subtiliser.
Nousétions un mercredi. Le lendemainjour de congéj'attendis que mon père fût à Paris pour prévenirma mère. La perspective de quatre jours de trouble dans sonménage l'alarma plus que la nouvelle. Puisje partis au bordde la Marneoù Marthe m'avait dit qu'elle me rejoindraitpeut-être. Elle n'y était pas. Ce fut une chance. Monamour puisant dans cette rencontre une mauvaise énergiej'aurais puensuitelutter contre mon père ; tandis quel'orage éclatant après une journée de videdetristesseje rentrai le front bascomme il convenait. Je revinschez nous un peu après l'heure où je savais que monpère avait coutume d'y être. Il « savait »donc. Je me promenai dans le jardinattendant que mon père mefît venir. Mes soeurs jouaient en silence. Elles devinaientquelque chose. Un de mes frèresassez excité parl'orageme dit de me rendre dans la chambre où mon pères'était étendu.
Des éclatsde voixdes menacesm'eussent permis la révolte. Ce futpire. Mon père se taisait ; ensuitesans aucune colèreavec une voix même plus douce que de coutumeil me dit :
-- Ehbienque comptes-tu faire maintenant ?
Les larmesqui ne pouvaient s'enfuir par mes yeuxcomme un essaim d'abeillesbourdonnaient dans ma tête. A une volontéj'eusse puopposer la miennemême impuissante. Mais devant une telledouceurje ne pensais qu'à me soumettre.
-- Ce quetu m'ordonneras de faire.
-- Nonnemens pas encore. Je t'ai toujours laissé agir comme tu levoulais ; continue. Sans doute auras-tu à coeur de m'enfaire repentir.
Dansl'extrême jeunessel'on est trop enclincomme les femmesàcroire que les larmes dédommagent de tout. Mon père neme demandait même pas de larmes. Devant sa générositéj'avais honte du présent et de l'avenir. Car je sentais quequoi que je lui diseje mentirais. « Au moins que cemensonge le réconfortepensai-jeen attendant de lui êtreune source de nouvelles peines. » Ou plutôt nonjecherche encore à me mentir à moi-même. Ce que jevoulaisc'était faire un travailguère plus fatigantqu'une promenadeet qui laissât comme elleà monespritla liberté de ne pas se détacher de Marthe uneminute. Je feignis de vouloir peindre et de n'avoir jamais oséle dire. Encore une foismon père ne dit pas nonàcondition que je continuasse d'apprendre chez nous ce que j'aurais dûapprendre au collègemais avec la liberté de peindre.
Quand lesliens ne sont pas encore solidespour perdre quelqu'un de vueilsuffit de manquer une fois un rendez-vous. A force de penser àMarthej'y pensai de moins en moins. Mon esprit agissaitcomme nosyeux agissent avec le papier des murs de notre chambre. A force de levoirils ne le voient plus.
Choseincroyable ! J'avais même pris goût au travail. Jen'avais pas menti comme je le craignais.
Lorsquequelque chosevenu de l'extérieurm'obligeait àpenser moins paresseusement à Marthej'y pensais avec amouravec la mélancolie que l'on éprouve pour ce qui auraitpu être. « Bah ! me disais-jec'eût ététrop beau. On ne peut à la fois choisir le lit et coucherdedans. »
Une choseétonnait mon père. La lettre du censeur n'arrivait pas.Il me fit à ce sujet sa première scènecroyantque j'avais soustrait la lettreque j'avais feint ensuite de luiannoncer gratuitement la nouvelleque j'avais ainsi obtenu sonindulgence. En réalitécette lettre n'existait pas. Jeme croyais renvoyé du collègemais je me trompais.Aussimon père ne comprit-il rienlorsqueau débutdes vacancesnous reçûmes une lettre du proviseur.
Ildemandait si j'étais malade et s'il fallait m'inscrire pourl'année suivante.
La joie dedonner enfin satisfaction à mon père comblait un peu levide sentimental dans lequel je me trouvaiscarsi je croyais neplus aimer Martheje la considérais du moins comme le seulamour qui eût été digne de moi. C'est dire que jel'aimais encore.
J'étaisdans ces dispositions de coeur quandà la fin de novembreunmois après avoir reçu une lettre de faire part de sonmariageje trouvaien rentrant chez nousune invitation de Marthequi commençait par ces lignes : « Je necomprends rien à votre silence. Pourquoi ne venez-vous pas mevoir ? Sans doute avez-vous oublié que vous avez choisimes meubles ?....»
Marthehabitait J...; sa rue descendait jusqu'à la Marne. Chaquetrottoir réunissait au plus une douzaine de villas. Jem'étonnai que la sienne fut si grande. En réalitéMarthe habitait seulement le hautles propriétaires et unvieux ménage se partageant le bas.
Quandj'arrivai pour goûteril faisait déjà nuit.Seule une fenêtreà défaut d'une présencehumainerévélait celle du feu. A voir cette fenêtreilluminée par des flammes inégalescomme des vaguesje crus à un commencement d'incendie. La porte de fer dujardin était entrouverte. Je m'étonnai d'une semblablenégligence. Je cherchai la sonnette : je ne la trouvaipoint. Enfingravissant les trois marches du perronje me décidaià frapper contre les vitres du rez-de-chaussée dedroitederrière lesquelles j'entendais des voix. Une vieillefemme ouvrit la porte : je lui demandai où demeuraitMme Lacombe (tel était le nouveau nom de Marthe) :« C'est au-dessus. » Je montai l'escalier dansle noirtrébuchantme cognantet mourant de crainte qu'ilfût arrivé quelque malheur. Je faillis lui sauter aucoucomme les gens qui se connaissent à peineaprèsavoir échappé au naufrage. Elle n'y eût riencompris. Sans doute me trouva-t-elle l'air égarécaravant toute choseje lui demandai pourquoi « il y avaitle feu ».
-- C'estqu'en vous attendantj'avais fait dans la cheminée du salonun feu de bois d'olivierà la lueur duquel je lisais.
En entrantdans la petite chambre qui lui servait de salonpeu encombréede meubleset que les tenturesles gros tapis doux comme un poil debêterétrécissaient jusqu'à lui donnerl'aspect d'une boîteje fus à la fois heureux etmalheureux comme un dramaturge quivoyant sa pièceydécouvre trop tard des fautes.
Marthes'était de nouveau étendue le long de la cheminéetisonnant la braiseet prenant garde à ne pas mêlerquelque parcelle noire aux cendres.
-- Vousn'aimez peut-être pas l'odeur de l'olivier ? Ce sont mesbeaux-parents qui en ont fait venir pour moi une provision de leurpropriété du Midi.
Marthesemblait s'excuser d'un détail de son crudans cette chambrequi était mon oeuvre. Peut-être cet élémentdétruisait-il un toutqu'elle comprenait mal.
Aucontraire. Ce feu me ravitet aussi de voir qu'elle attendait commemoi de se sentir brûlante d'un côtépour seretourner de l'autre. Son visage calme et sérieux ne m'avaitjamais paru plus beau que dans cette lumière sauvage. A ne passe répandre dans la piècecette lumière gardaittoute sa force. Dès qu'on s'en éloignaitil faisaitnuitet on se cognait aux meubles.
Martheignorait ce que c'est que d'être mutine. Dans son enjouementelle restait grave.
Mon esprits'engourdissait peu à peu auprès d'elleje la trouvaidifférente. C'est quemaintenant que j'étais sûrde ne plus l'aimerje commençais à l'aimer. Je mesentais incapable de calculsde machinationsde tout ce dontjusqu'alorset encore à ce moment-làje croyais quel'amour ne peut se passer. Tout à coupje me sentaismeilleur. Ce brusque changement aurait ouvert les yeux de toutautre : je ne vis pas que j'étais amoureux de Marthe. Aucontrairej'y vis la preuve que mon amour était mortetqu'une belle amitié le remplacerait. Cette longue perspectived'amitié me fit admettre soudain combien un autre sentimenteût été criminellésant un homme quil'aimaità qui elle devait appartenir et qui ne pouvait lavoir.
Pourtantautre chose m'aurait dû renseigner sur mes véritablessentiments. Il y a quelques moisquand je rencontrais Marthemonprétendu amour ne m'empêchait pas de la jugerdetrouver laides la plupart des choses qu'elle trouvait belleslaplupart des choses qu'elle disaitenfantines. Aujourd'huisi je nepensais pas comme elleje me donnais tort. Après lagrossièreté de mes premiers désirsc'étaitla douceur d'un sentiment plus profond qui me trompait. Je ne mesentais plus capable de rien entreprendre de ce que je m'étaispromis. Je commençais à respecter Martheparce que jecommençais à l'aimer.
Je revinstous les soirs ; je ne pensai même pas à la prierde me montrer sa chambreencore moins à lui demander commentJacques trouvait nos meubles. Je ne souhaitais rien d'autre que cesfiançailles éternellesnos corps étendus prèsde la cheminéese touchant l'un l'autreet moin'osantbougerde peur qu'un seul de mes gestes suffît àchasser le bonheur.
MaisMarthequi goûtait le même charmecroyait le goûterseule. Dans ma paresse heureuseelle lut de l'indifférence.Pensant que je ne l'aimais paselle s'imagina que je me lasseraisvite de ce salon silencieuxsi elle ne faisait rien pour m'attacherà elle.
Nous noustaisions. J'y voyais une preuve du bonheur.
Je mesentais tellement près de Martheavec la certitude que nouspensions en même temps aux mêmes chosesque lui parlerm'eût semblé absurdecomme de parler haut quand on estseul. Ce silence accablait la pauvre petite. La sagesse eût étéde me servir de moyens de correspondre aussi grossiers que la paroleou le gestetout en déplorant qu'il n'en existât pointde plus subtils.
A me voirtous les jours m'enfoncer de plus en plus dans ce mutisme délicieuxMarthe se figura que je m'ennuyais de plus en plus. Elle se sentaitprête à tout pour me distraire.
Sachevelure dénouéeelle aimait dormir près dufeu. Ou plutôt je croyais qu'elle dormait. Son sommeil luiétait prétextepour mettre ses bras autour de mon couet une fois réveilléeles yeux humidesme direqu'elle venait d'avoir un rêve triste. Elle ne voulait jamaisme le raconter. Je profitais de son faux sommeil pour respirer sescheveuxson couses joues brûlanteset en les effleurant àpeine pour qu'elle ne se réveillât point ; toutescaresses qui ne sont pascomme on croitla menue monnaie del'amourmaisau contrairela plus rareet auxquelles seule lapassion puisse recourir. Moije les croyais permises à monamitié. Pourtantje commençai à me désespérersérieusement de ce que seul l'amour nous donnât desdroits sur une femme. Je me passerai bien de l'amourpensai-jemaisjamais de n'avoir aucun droit sur Marthe. Etpour en avoirj'étaismême décidé à l'amourtout en croyant ledéplorer. Je désirais Marthe et ne le comprenais pas.
Quand elledormait ainsisa tête appuyée contre un de mes brasjeme penchais sur elle pour voir son visage entouré de flammes.C'était jouer avec le feu. Un jour que je m'approchais tropsans pourtant que mon visage touchât le sienje fus commel'aiguille qui dépasse d'un millimètre la zoneinterdite et appartient à l'aimant. Est-ce la faute del'aimant ou de l'aiguille ? C'est ainsi que je sentis mes lèvrescontre les siennes. Elle fermait encore les yeuxmais visiblementcomme quelqu'un qui ne dort pas. Je l'embrassaistupéfait demon audacealors qu'en réalité c'était ellequilorsque j'approchais de son visageavait attiré ma têtecontre sa bouche. Ses deux mains accrochaient à mon cou ;elles ne se seraient pas accrochées plus furieusement dans unnaufrage. Et je ne comprenais pas si elle voulait que je la sauveoubien que je me noie avec elle.
Maintenantelle s'était assiseelle tenait ma tête sur ses genouxcaressant mes cheveuxet me répétant trèsdoucement : « Il faut que tu t'en aillesil ne fautplus jamais revenir. » Je n'osais pas la tutoyer ;lorsque je ne pouvais plus me taireje cherchais longuement mesmotsconstruisant mes phrases de façon à ne pas luiparler directementcar si je ne pouvais pas la tutoyerje sentaiscombien il était encore plus impossible de lui dire vous. Meslarmes me brûlaient. S'il en tombait une sur la main de Martheje m'attendais toujours à l'entendre pousser un cri. Jem'accusai d'avoir rompu le charmeme disant qu'en effet j'avais étéfou de poser mes lèvres contres les siennesoubliant quec'était elle qui m'avait embrassé. « Il fautque t'en aillesne plus jamais revenir. » Mes larmes derage se mêlaient à mes larmes de peine. Ainsi la fureurdu loup pris lui fait autant de mal que le piège. Si j'avaisparléç'aurait été pour injurier Marthe.Mon silence l'inquiéta ; elle y voyait de la résignation.« Puisqu'il est trop tardla faisais-je penserdans moninjustice peut-être clairvoyanteaprès toutj'aimeautant qu'il souffre. » Dans ce feuje grelottaisjeclaquais des dents. A ma véritable peine qui me sortait del'enfances'ajoutaient des sentiments enfantins. J'étais lespectateur qui ne veut pas s'en aller parce que le dénouementlui déplaît. Je lui dis : « Je ne m'enirai pas. Vous vous êtes moquée de moi. Je ne veux plusvous voir. »
Car si jene voulais pas rentrer chez mes parentsje ne voulais pas non plusrevoir Marthe. Je l'aurais plutôt chassée de chez elle.
Mais ellesanglotait : « Tu es un enfant. Tu ne comprends doncpas que si je te demande de t'en allerc'est que je t'aime. »
Haineusementje lui dis que je comprenais fort bien qu'elle avait des devoirs etque son mari Était à la guerre.
Ellesecouait la tête : « Avant toij'étaisheureuseje croyais aimer mon fiancé. Je lui pardonnais de nepas bien me comprendre. C'est toi qui m'as montré que je nel'aimais pas. Mon devoir n'est pas celui que tu penses. Ce n'est pasde ne pas mentir à mon marimais de ne pas te mentir. Va-t'enet ne me crois pas méchante ; bientôt tu m'aurasoubliée. Mais je ne veux pas causer le malheur de ta vie. Jepleureparce que je suis trop vieille pour toi ! »
Ce motd'amour était sublime d'enfantillage. Etquelles que soientles passions que j'éprouve dans la suitejamais ne sera pluspossible l'émotion adorable de voir une fille de dix-neuf anspleurer parce qu'elle se trouve trop vieille.
La saveurdu premier baiser m'avait déçu comme un fruit que l'ongoûte pour la première fois. Ce n'est pas dans lanouveautéc'est dans l'habitude que nous trouvons les plusgrands plaisirs. Quelques minutes aprèsnon seulement j'étaishabitué à la bouche de Marthemais encore je nepouvais plus m'en passer. Et c'est alors qu'elle parlait de m'enpriver à tout jamais.
Cesoir-làMarthe me reconduisit jusqu'à la maison. Pourme sentir plus près d'elleje me blottissais sous capeet jela tenais par la taille. Elle ne disait plus qu'il ne fallait pasnous revoir ; au contraireelle était triste à lapensée que nous allions nous quitter dans quelques instants.Elle me faisait lui jurer mille folies.
Devant lamaison de mes parentsje ne voulus pas laisser Marthe repartirseuleet l'accompagnai jusque chez elle. Sans doute cesenfantillages n'eussent-ils jamais pris fincar elle voulaitm'accompagner encore. J'acceptaià condition qu'elle melaisserait à moitié route.
J'arrivaiune demi-heure en retard pour le dîner. C'était lapremière fois. Je mis ce retard sur le compte du train. Monpère fit semblant de le croire.
Plus rienne me pesait. Dans la rueje marchais aussi légèrementque dans mes rêves.
Jusqu'icitout ce que j'avais convoitéenfantil en avait fallu fairemon deuil. D'autre partla reconnaissance me gâtait les jouetsofferts. Quel prestige aurait pour un enfant un jouet qui se donnelui-même ! J'étais ivre de passion. Marthe étaità moi ; ce n'est pas moi qui l'avais ditc'étaitelle. Je pouvais toucher sa figureembrasser ses yeuxses brasl'habillerl'abîmerà ma guise. Dans mon délireje la mordais aux endroits où sa peau tait nuepour que samère la soupçonnât d'avoir un amant. J'auraisvoulu pouvoir y marquer mes initiales. Ma sauvagerie d'enfantretrouvait le vieux sens des tatouages. Marthe disait : « Ouimords-moimarque-moije voudrais que tout le monde sache. »
J'auraisvoulu pouvoir embrasser ses seins. Je n'osais pas le lui demanderpensant qu'elle saurait les offrir elle-mêmecomme ses lèvres.Au bout de quelques joursl'habitude d'avoir ses lèvres étantvenueje n'envisageai pas d'autre délice.
Nouslisions ensemble à la lueur du feu. Elle y jetait souvent deslettres que son mari lui envoyaitchaque jourdu front. A leurinquiétudeon devinait que celles de Marthe se faisaient demoins en moins tendres et de plus en plus rares. Je ne voyais pasflamber ces lettres sans malaise. Elles grandissaient une seconde lefeu etsomme toutej'avais peur de voir plus clair.
Marthequi souvent maintenant me demandait s'il était vrai que jel'avais aimée dès notre première rencontremereprochait de ne le lui avoir pas dit avant son mariage. Elle neserait pas mariéeprétendait-elle ; carsi elleavait éprouvé pour Jacques une sorte d'amour au débutde leurs fiançaillescelles-citrop longuespar la faute dela guerreavaient peu à peu effacé l'amour de soncoeur. Elle n'aimait déjà plus Jacques quand ellel'épousa. Elle espérait que ces quinze jours depermission accordés à Jacques transformeraientpeut-être ses sentiments.
Il futmalhabile. Celui qui aime agace toujours celui qui n'aime pas. EtJacques aimait toujours davantage. Ses lettres étaient dequelqu'un qui souffremais plaçant trop haut sa Marthe pourla croire capable de trahison. Aussi n'accusait-il que luilasuppliant seulement de lui expliquer quel mal il avait pu faire :« Je me trouve si grossier à côté detoije sens que chacune de mes paroles te blesse. »Marthe lui répondait seulement qu'il se trompaitqu'elle nelui reprochait rien.
Nousétions alors au début de mars. Le printemps étaitprécoce. Les jours où elle ne m'accompagnait pas àParisMarthenue sous un peignoirattendait que je revinsse de mescours de dessinétendue devant la cheminée oùbrûlait toujours l'olivier de ses beaux-parents. Elle leuravait demandé de renouveler sa provision. Je ne sais quelletimiditési ce n'est celle qu'on éprouve en face de cequ'on n'a jamais faitme retenait. Je pensais à Daphnis. Icic'est Chloé qui avait reçu quelques leçonsetDaphnis n'osait lui demander de les lui apprendre. Au faitneconsidérais-je pas Marthe plutôt comme une viergelivréela première quinzaine de ses nocesà uninconnu et plusieurs fois prise par lui de force ?
Le soirseul dans mon litj'appelais Marthem'en voulantmoi qui mecroyais un hommede ne l'être pas assez pour finir d'en fairema maîtresse. Chaque jourallant chez elleje me promettaisde ne pas sortir qu'elle le fût.
Le jour del'anniversaire de mes seize ansau mois de mars 1918tout ensuppliant de ne pas me fâcherelle me fit cadeau d'unpeignoirsemblable au sienqu'elle voulait me voir mettre chezelle. Dans ma joieje faillis faire un calembourmoi qui n'enfaisais jamais. Ma robe prétexte ! Car il me semblait quece qui jusqu'ici avait entravé mes désirsc'étaitla peur du ridiculede me sentir habillélorsqu'elle nel'était pas. D'abordje pensai à mettre cette robe lejour même. Puisje rougiscomprenant ce que son cadeaucontenait de reproches.
Dèsle début de notre amourMarthe m'avait donné une clefde son appartementafin que je n'eusse pas à l'attendre dansle jardinsipar hasardelle était en ville. Je pouvais meservir moins innocemment de cette clef. Nous étions un samedi.Je quittai Marthe en lui promettant de venir déjeuner lelendemain avec elle. Mais j'étais décidé àrevenir le soir aussitôt que possible.
A dînerj'annonçai à mes parents que j'entreprendrais lelendemain avec René une longue promenade dans la forêtde Senart. Je devais pour cela partir à cinq heures du matin.Comme toute la maison dormirait encorepersonne ne pourrait devinerl'heure à laquelle j'étais partiet si j'avaisdécouché.
A peineavais-je fait part de ce projet à ma mèrequ'ellevoulut préparer elle-même un panier rempli deprovisionspour la route. J'étais consternéce panierdétruisait tout le romanesque et le sublime de mon acte. Moiqui goûtais d'avance l'effroi de Marthe quand j'entrerais danssa chambreje pensais maintenant à ses éclats de rireen voyant paraître ce Prince Charmantun panier de ménagèreà son bras. J'eus beau dire à ma mère que Renés'était muni de toutelle ne voulut rien entendre. Résisterdavantagec'était éveiller les soupçons.
Ce quifait le malheur des uns causerait le bonheur des autres. Tandis quema mère emplissait le panier qui me gâtait d'avance mapremière nuit d'amourje voyais les yeux pleins de convoitisede mes frères. Je pensai bien à le leur offrir encachettemais une fois tout mangéau risque de se fairefouetteret pour le plaisir de me perdreils eussent tout raconté.
Il fallaitdonc me résignerpuisque nulle cachette ne semblait assezsûre.
Je m'étaisjuré de ne pas partir avant minuit pour être sûrque mes parents dormissent. J'essayai de lire. Mais comme dix heuressonnaient à la mairieet que mes parents étaientcouchés depuis quelque temps déjàje ne pusattendre. Ils habitaient au premier étagemoi aurez-de-chaussée. Je n'avais pas mis mes bottines afind'escalader le mur le plus silencieusement possible. Les tenant d'unemaintenant de l'autre ce panier fragile à cause desbouteillesj'ouvris avec précaution une petite ported'office. Il pleuvait. Tant mieux ! la pluie couvrirait lebruit. Apercevant que la lumière n'était pas encoreéteinte dans la chambre de mes parentsje fus sur le point deme recoucher. Mais j'étais en route. Déjà laprécaution des bottines était impossible ; àcause de la pluieje dus les remettre. Ensuiteil me fallaitescalader le mur pour ne point ébranler la cloche de lagrille. Je m'approchai du murcontre lequel j'avais pris soinaprèsle dînerde poser une chaise de jardin pour faciliter monévasion. Ce mur était garni de tuiles à sonfaîte. La pluie les rendait glissantes. Comme je m'ysuspendaisl'une d'elles tomba. Mon angoisse décupla le bruitde sa chute. Il fallait maintenant sauter dans la rue. Je tenais lepanier avec mes dents ; je tombai dans une flaque. Une longueminuteje restai deboutles yeux levés vers la fenêtrede mes parentspour voir s'ils bougeaients'étant aperçusde quelque chose. La fenêtre resta vide. J'étais sauf !
Pour merendre chez Martheje suivis la Marne. Je comptais cacher mon panierdans un buisson et le reprendre le lendemain. La guerre rendait cettechose dangereuse. En effetau seul endroit où il y eûtdes buissons et où il était possible de cacher lepanierse tenait une sentinellegardant le pont de J... J'hésitailongtempsplus pâle qu'un homme qui pose une cartouche dedynamite. Je cachai tout de même mes victuailles.
La grillede Marthe était fermée. Je pris la clef qu'on laissaittoujours dans la boîte aux lettres. Je traversai le petitjardin sur la pointe des piedspuis montai les marches du perron.J'ôtai encore mes bottines avant de prendre l'escalier.
Martheétait si nerveuse ! Peut-être s'évanouirait-elleen me voyant dans sa chambre. Je tremblai ; je ne trouvai pas letrou de la serrure. Enfinje tournai la clef lentementafin de neréveiller personne. Je butai dans l'antichambre contre leporte-parapluies. Je craignais de prendre les sonnettes pour lescommutateurs. J'allai à tâtons jusqu'à lachambre. Je m'arrêtai avecencorel'envie de fuir. Peut-êtreMarthe ne me pardonnerait jamais. Ou bien si j'allais tout d'un coupapprendre qu'elle me trompeet la trouver avec un homme !
J'ouvris.Je murmurai :
--Marthe ?
Ellerépondit :
-- Plutôtque de me faire une peur pareilletu aurais bien pu ne venir quedemain matin. Tu as donc ta permission huit jours plus tôt ?
Elle meprenait pour Jacques !
Orsi jevoyais de quelle façon elle l'eût accueillij'apprenaisdu même coup qu'elle me cachait déjà quelquechose. Jacques devait donc venir dans huit jours !
J'allumai.Elle restait tournée contre le mur. Il était simple dedire : « C'est moi »et pourtantje nele disais pas. Je l'embrassai dans le cou.
-- Tafigure est toute mouillée. Essuie-toi donc.
Alorselle se retourna et poussa un cri.
D'uneseconde à l'autreelle changea d'attitude etsans prendre lapeine de s'expliquer ma présence nocturne :
-- Maismon pauvre chéritu vas prendre mal ! Déshabille-toivite.
Ellecourut ranimer le feu dans le salon. A son retour dans la chambrecomme je ne bougeais paselle dit :
-- Veux-tuque je t'aide ?
Moi quiredoutais par-dessus tout le moment où je devrais medéshabiller et qui en envisageais le ridiculeje bénissaisla pluie grâce à quoi ce déshabillage prenait unsens maternel. Mais Marthe repartaitrevenaitrepartait dans lacuisinepour voir si l'eau de mon grog était chaude. Enfinelle me trouva nu sur le litme cachant à moitié sousl'édredon. Elle me gronda : c'était fou de resternu ; il fallait me frictionner à l'eau de Cologne.
PuisMarthe ouvrit une armoire et jeta un costume de nuit. « Ildevait être de ma taille. » Un costume de Jacques !Et je pensais à l'arrivéefort possiblede ce soldatpuisque Marthe y avait cru.
J'étaisdans le lit. Marthe m'y rejoignit. Je lui demandai d'éteindre.Carmême en ses brasje me méfiais de ma timidité.Les ténèbres me donneraient du courage. Marthe merépondit doucement :
-- Non. Jeveux te voir t'endormir.
A cetteparole pleine de grâceje sentis quelque gêne. J'yvoyais la touchante douceur de cette femme qui risquait tout pourdevenir ma maîtresse etne pouvant deviner ma timiditémaladiveadmettait que je m'endormisse auprès d'elle. Depuisquatre moisje disais l'aimeret ne lui en donnais pas cette preuvedont les hommes sont si prodigues et qui souvent leur tient lieud'amour. J'éteignis de force.
Je meretrouvai avec le trouble de tout à l'heureavant d'entrerchez Marthe. Mais comme l'attente devant la portecelle devantl'amour ne pouvait être bien longue. Du restemon imaginationse promettait de telles voluptés qu'elle n'arrivait plus àles concevoir. Pour la première fois aussije redoutai deressembler au mari et de laisser à Marthe un mauvais souvenirde nos premiers moments d'amour.
Elle futdonc plus heureuse que moi. Mais la minute où nous nousdésenlaçâmeset ses yeux admirablesvalaientbien mon malaise.
Son visages'était transfiguré. Je m'étonnai même dene pas pouvoir toucher l'auréole qui entourait vraiment safigurecomme dans les tableaux religieux.
Soulagéde mes craintesil m'en venait d'autres.
C'est quecomprenant enfin la puissance des gestes que ma timiditén'avait osés jusqu'alorsje tremblais que Marthe appartîntà son mari plus qu'elle ne voulait le prétendre.
Comme ilm'est impossible de comprendre ce que je goûte pour la premièrefoisje devais connaître ces jouissances de l'amour chaquejour davantage.
Enattendantle faux plaisir m'apportait une vraie douleur d'homme :la jalousie.
J'envoulais à Martheparce que je comprenaisà son visagereconnaissanttout ce que valent les liens de la chair. Jemaudissais l'homme qui avait avant moi éveillé soncorps. Je considérais ma sottise d'avoir vu en Marthe unevierge. A toute autre époquesouhaiter la mort de son maric'eût été chimère enfantinemais ce voeudevenait presque aussi criminel que si j'eusse tué. Je devaisà la guerre mon bonheur naissant ; j'en attendaisl'apothéose. J'espérais qu'elle servirait ma hainecomme un anonyme commet le crime à notre place.
Maintenantnous pleurons ensemble ; c'est la faute du bonheur. Marthe mereproche de n'avoir pas empêché son mariage. « Maisalorsserais-je dans ce lit choisi par moi ? Elle vivrait chezses parents ; nous ne pourrions nous voir. Elle n'auraitappartenu à Jacquesmais elle ne m'appartiendrait pas. Sansluiet ne pouvant comparerpeut-être regretterait-elleencoreespérant mieux. Je ne hais pas Jacques. Je hais lacertitude de tout devoir à cet homme que nous trompons. Maisj'aime trop Marthe pour trouver notre bonheur criminel. »
Nouspleurons ensemble de n'être que des enfantsdisposant de peu.Enlever Marthe ! Comme elle n'appartient à personnequ'àmoice serait me l'enleverpuisqu'on nous séparerait. Déjànous envisageons la fin de la guerrequi sera celle de notre amour.Nous le savonsMarthe a beau me jurer qu'elle quittera toutqu'elleme suivraje ne suis pas d'une nature portée à larévolteetme mettant à la place de Marthejen'imagine pas cette folle rupture. Marthe m'explique pourquoi elle setrouvait trop vieille. Dans quinze ansla vie ne fera encore quecommencer pour moides femmes m'aimerontqui auront l'âgequ'elle a. « Je ne pourrais que souffrirajoute-t-elle. Si tu me quittesj'en mourrai. Si tu restesce serapar faiblesseet je souffrirai de te voir sacrifier ton bonheur. »
Malgrémon indignationje m'en voulais de ne point paraître assezconvaincu du contraire. Mais Marthe ne demandait qu'à l'êtreet mes plus mauvaises raisons lui semblaient bonnes. Elle répondait :« Ouije n'ai pas pensé à cela. Je sensbien que tu ne mens pas. » Moidans les craintes deMartheje sentais ma confiance moins solide. Alors mes consolationsétaient molles. Je lui disais : « Mais nonmais nontu es folle. » Hélas ! j'étaistrop sensible à la jeunesse pour ne pas envisager que je medétacherais de Marthele jour où sa jeunesse sefaneraitet que s'épanouirait la mienne.
Bien quemon amour me parût avoir atteint sa forme définitiveilétait à l'état d'ébauche. Il faiblissaitau moindre obstacle.
Donclesfolies que cette nuit-là firent nos âmesnousfatiguèrent davantage que celles de notre chair. Les unessemblaient nous reposer des autres ; en réalitéelles nous achevaient. Les coqsplus nombreuxchantaient. Ilsavaient chanté toute la nuit. Je m'aperçus de cemensonge poétique : les coqs chantent au lever du soleil.Ce n'était pas extraordinaire. Mon âge ignoraitl'insomnie. Mais Marthe le remarqua aussiavec tant de surprisequece ne pouvait être que la première fois. Elle ne putcomprendre la force avec laquelle je la serrai contre moicar sasurprise me donnait la preuve qu'elle n'avait pas encore passéune nuit blanche avec Jacques.
Mestranses me faisaient prendre notre amour pour un amour exceptionnel.Nous croyons être les premiers à ressentir certainstroublesne sachant pas que l'amour est comme la poésieetque tous les amantsmême les plus médiocress'imaginent qu'ils innovent. Disais-je à Marthe (sans y croired'ailleurs)mais pour lui faire penser que je partageais sesinquiétudes : « Tu me délaisserasd'autres hommes te plairont »elle m'affirmait d'êtresûre d'elle. Moide mon côtéje me persuadaispeu à peu que je lui resterais même quand elle seraitmoins jeunema paresse finissant par faire dépendre notreéternel bonheur de son énergie.
Le sommeilnous avait surpris dans notre nudité. A mon réveillavoyant découverteje craignis qu'elle n'eût pris froid.Je tâtai son corps. Il était brûlant. La voirdormir me procurait une volupté sans égale. Au bout dedix minutescette volupté me parut insupportable. J'embrassaiMarthe sur l'épaule. Elle ne s'éveilla pas. Un secondbaisermoins chasteagit avec la violence d'un réveille-matin.Elle sursautaetse frottant les yeuxme couvrit de baiserscommequelqu'un qu'on aime et qu'on retrouve dans son lit aprèsavoir rêvé qu'il est mort. Elleau contraireavait crurêver ce qui est était vraiet me retrouvait au réveil.
Il étaitdéjà onze heures. Nous buvions notre chocolatquandnous entendîmes la sonnette. Je pensai à Jacques :« Pourvu qu'il ait une arme. » Moi qui avais sipeur de la mortje ne tremblai pas. Au contrairej'aurais acceptéque ce fût Jacquesà condition qu'il nous tuât.Toute autre solution me semblait ridicule.
Envisagerla mort avec calme ne compte que si nous l'envisageons seul. La mortà deux n'est plus la mortmême pour les incrédules.Ce qui chagrinece n'est pas de quitter la viemais de quitter cequi lui donne un sens. Lorsqu'un amour est notre viequelledifférence y a-t-il entre vivre ensemble ou mourir ensemble ?
Je n'euspas le temps de me croire un héroscarpensant peut-êtreque Jacques ne tuerait que Martheou moije mesurai mon égoïsme.Savais-je même de ces deux drameslequel était lepire ?
CommeMarthe ne bougeait pasje crus m'être trompéet qu'onavait sonné chez les propriétaires. Mais la sonnetteretentit de nouveau.
--Tais-toine bouge pas ! murmura-t-ellece doit être mamère. J'avais complètement oublié qu'ellepasserait après la messe.
J'étaisheureux d'être témoin d'un de ses sacrifices. Dèsqu'une maîtresseun amisont en retard de quelques minutes àun rendez-vousje les vois morts. Attribuant cette forme d'angoisseà sa mèreje savourais sa crainteet que ce fûtpar ma faute qu'elle l'éprouvât.
Nousentendîmes la grille du jardin se refermer après unconciliabule (évidemmentMme Grangier demandait aurez-de-chaussée si on avait vu ce matin sa fille). Martheregarda derrière les volets et me dit : « C'étaitbien elle. » Je ne pus résister au plaisir de voirmoi aussiMme Grangier repartantson livre de messe àla maininquiète de l'absence incompréhensible de safille. Elle se retourna encore vers les volets clos.
Maintenantqu'il ne me restait plus rien à désirerje me sentaisdevenir injuste. Je m'affectais de ce que Marthe pût mentirsans scrupules à sa mèreet ma mauvaise foi luireprochait de pouvoir mentir. Pourtant l'amourqui est l'égoïsmeà deuxsacrifie tout à soiet vit de mensonges.Poussé par le même démonje lui fis encore lereproche de m'avoir caché l'arrivée de son mari.Jusqu'alorsj'avais maté mon despotismene me sentant pas ledroit de régner sur Marthe. Ma dureté avait desaccalmies. Je gémissais : « Bientôt tume prendras en horreur. Je suis comme ton mariaussi brutal. -- Iln'est pas brutal »disait-elle. Je reprenais de plusbelle : « Alorstu nous trompes tous les deuxdis-moi que tu l'aimessois contente : dans huit jours tupourras me tromper avec lui. »
Elle semordait les lèvrespleurait : « Qu'ai-je doncfait qui te rende aussi méchant ? Je t'en supplien'abîme pas notre premier jour de bonheur. »
-- Il fautque tu m'aimes bien peu pour qu'aujourd'hui soit ton premier jour debonheur.
Ces sortesde coups blessent celui qui les porte. Je ne pensais rien de ce queje disaiset pourtant j'éprouvais le besoin de le dire. Ilm'était impossible d'expliquer à Marthe que mon amourgrandissait. Sans doute atteignait-il l'âge ingratet cettetaquinerie férocec'était la mue de l'amour devenantpassion. Je souffrais. Je suppliai Marthe d'oublier mes attaques.
La bonnedes propriétaires glissa des lettres sous la porte. Marthe lesprit. Il y en avait deux de Jacques. Comme réponse àmes doutes : « Fais-endit ellece que bon tesemble. » J'eus honte. Je lui demandai de les liremaisde les garder pour elle. Marthepar un de ces réflexes quinous poussent aux pires bravadesdéchira une des enveloppes.Difficile à déchirerla lettre devait êtrelongue. Son geste devint une nouvelle occasion de reproches. Jedétestais cette bravadele remords qu'elle ne manquerait pasd'en ressentir. Je fismalgré toutun effortetvoulantqu'elle ne déchirât point la seconde lettreje gardaipour moi que d'après cette scène il étaitimpossible que Marthe ne fût pas méchante. Sur mademandeelle la lut. Un réflexe pouvait lui faire déchirerla première lettremais non lui faire direaprèsavoir parcouru la seconde : « Le Ciel nous récompensede ne pas avoir déchiré la lettre. Jacques m'y annonceque les permissions viennent d'être suspendues dans sonsecteuril ne viendra pas avant un mois. »
L'amourseul excuse de telles fautes de goût.
Ce maricommençait à me gênerplus que s'il avait étélà et que s'il avait fallu prendre garde. Une lettre de luiprenait soudain l'importance d'un spectre. Nous déjeunâmestard. Vers cinq heuresnous allâmes nous promener au bord del'eau. Marthe resta stupéfaite lorsque d'une touffe d'herbesje sortis un paniersous l'oeil de la sentinelle. L'histoire dupanier l'amusa bien. Je n'en craignais plus le grotesque. Nousmarchionssans nous rendre compte de l'indécence de notretenuenos corps collés l'un contre l'autre. Nos doigtss'enlaçaient. Ce premier dimanche de soleil avait fait pousserles promeneurs à chapeau de paillecomme la pluie leschampignons. Les gens qui connaissaient Marthe n'osaient pas lui direbonjour ; mais ellene se rendant compte de rienleur disaitbonjour sans malice. Ils durent y voir une fanfaronnade. Ellem'interrogeait pour savoir comment je m'étais enfui de lamaison. Elle riaitpuis sa figure s'assombrissait ; alors elleme remerciaiten me serrant les doigts de toutes ses forcesd'avoircouru tant de risques. Nous repassâmes chez elle pour y déposerle panier. A vrai direj'entrevis pour ce paniersous forme d'envoiaux arméesune fin digne de ces aventures. Mais cette finétait si choquante que je la gardai pour moi.
Marthevoulait suivre la Marne jusqu'à la Varenne. Nous dînerionsen face de l'île d'Amour. Je lui promis de lui montrer le muséede l'Écu de Francele premier musée que j'avais vutout enfantet qui m'avait ébloui. J'en parlais àMarthe comme d'une chose très intéressante. Mais quandnous constatâmes que ce musée était une farcejene voulus pas admettre que je m'étais trompé àce point. Les ciseaux de Fulbert ! tout ! j'avais tout cru.Je prétendis avoir fait à Marthe une plaisanterieinnocente. Elle ne comprenait pascar il était peu dans meshabitudes de plaisanter. A vrai direcette déconvenue merendait mélancolique. Je me disais : Peut-être moiquiaujourd'huicrois tellement à l'amour de Martheyverrai-je un attrape-nigaudcomme le musée de l'Écu deFrance !
Car jedoutais souvent de son amour. Quelquefoisje me demandais si jen'étais pas pour elle un passe-tempsun caprice dont ellepourrait se détacher du jour au lendemainla paix larappelant à ses devoirs. Pourtantme disais-jeil y a desmoments où une bouchedes yeuxne peuvent mentir. Certes.Mais une fois ivresles hommes les moins généreux sefâchent si l'on n'accepte pas leur montreleur portefeuille.Dans cette veineils sont aussi sincères que s'ils setrouvent en état normal. Les moments où on ne peut pasmentir sont précisément ceux où l'on ment lepluset surtout à soi-même. Croire une femme « aumoment où elle ne peut mentir »c'est croire àla fausse générosité d'un avare.
Maclairvoyance n'était qu'une forme plus dangereuse de manaïveté. Je me jugeais moins naïfje l'étaissous une autre formepuisque aucun âge n'échappe àla naïveté. Celle de la vieillesse n'est pas la moindre.Cette prétendue clairvoyance m'assombrissait toutme faisaitdouter de Marthe. Plutôtje doutais de moi-mêmene metrouvant pas digne d'elle. Aurais-je eu mille fois plus de preuves deson amourje n'aurais pas été moins malheureux.
Je savaistrop le trésor de ce qu'on n'exprime jamais à ceuxqu'on aimepar la crainte de paraître puérilpour nepas redouter chez Marthe cette pudeur navranteet je souffrais de nepouvoir pénétrer son esprit.
Je revinsà la maison à neuf heures et demie du soir. Mes parentsm'interrogèrent sur ma promenade. Je leur décrivis avecenthousiasme la forêt de Senart et ses fougères deuxfois hautes comme moi. Je parlai aussi de Brunoycharmant village oùnous avions déjeuné. Tout à coupma mèremoqueusem'interrompant :
-- AproposRené est venu cet après-midi à quatreheurestrès étonné en apprenant qu'il faisaitune grande promenade avec toi.
J'étaisrouge de dépit. Cette aventureet bien d'autresm'apprirentquemalgré certaines dispositionsje ne suis pas fait pourle mensonge. On m'y attrape toujours. Mes parents n'ajoutèrentrien d'autre. Ils eurent le triomphe modeste.
Mon pèred'ailleursétait inconsciemment complice de mon premieramour. Il l'encourageait plutôtravi que ma précocités'affirmât d'une façon ou d'une autre. Il avait aussitoujours eu peur que je tombasse entre les mains d'une mauvaisefemme. Il était content de me savoir aimé d'une bravefille. Il ne devait se cabrer que le jour où il eut la preuveque Marthe souhaitait le divorce.
Ma mèreellene voyait pas notre liaison d'un aussi bon oeil. Elle étaitjalouse. Elle regardait Marthe avec des yeux de rivale. Elle trouvaitMarthe antipathiquene se rendant pas compte que toute femmedufait de mon amourle lui serait devenue. D'ailleurselle sepréoccupait plus que mon père du qu'en-dira-t-on. Elles'étonnait que Marthe pût se compromettre avec un gaminde mon âge. Puis elle avait été élevéeà F. Dans toutes ces petites villes de banlieuedu momentqu'elles s'éloignent de la banlieue ouvrièresévissentles mêmes passionsla même soif de racontars qu'enprovince. Maisen outrele voisinage de Paris rend les racontarsles suppositions plus délurés. Chacun y doit tenir sonrang. C'est ainsi que pour avoir une maîtressedont le mariétait soldatje vis peu à peuet sur l'injonction deleurs parentss'éloigner mes camarades. Ils disparurent parordre hiérarchique : depuis le fils du notairejusqu'àcelui de notre jardinier. Ma mère était atteinte parces mesures qui me semblaient un hommage. Elle me voyait perdu parune folle. Elle reprochait certainement à mon père deme l'avoir fait connaîtreet de fermer les yeux. Maisestimant que c'était à mon père d'agiret monpère se taisantelle gardait le silence.
Je passaistoutes mes nuits avec Marthe. J'y arrivais à dix heures etdemiej'en repartais le matin à cinq ou six. Je ne sautaisplus par-dessus les murs. Je me contentais d'ouvrir la porte avec maclef ; mais cette franchise exigeait quelques soins. Pour que lacloche ne donnât pas l'éveilj'enveloppais le soir sonbattant avec de l'ouate. Je l'ôtais le lendemain en rentrant.
A lamaisonpersonne ne se doutait de mes absences ; il n'en allaitpas de même à J... Depuis quelque temps déjàles propriétaires et le vieux ménage me voyaient d'unassez mauvais oeilrépondant à peine à messaluts.
Le matinà cinq heurespour faire le moins de bruit possiblejedescendaismes souliers à la main. Je les remettais en bas.Un matinje croisai dans l'escalier le garçon laitier. Iltenait ses boîtes de lait à la main ; je tenaismoimes souliers. Il me souhaita le bonjour avec un sourireterrible. Marthe était perdue. Il allait le raconter dans toutJ. Ce qui me torturait encore le plus était mon ridicule. Jepouvais acheter le silence d'un garçon laitiermais je m'enabstins faute de savoir comment m'y prendre.
L'après-midije n'osai rien en dire à Marthe. D'ailleurscet épisodeétait inutile pour que Marthe fût compromise. C'étaitdepuis longtemps chose faite. La rumeur me l'attribua mêmecomme maîtresse bien avant la réalité. Nous nenous étions rendu compte de rien. Nous allions bientôtvoir clair. C'est ainsi qu'un jourje trouvai Marthe sans forces. Lepropriétaire venait de lui dire que depuis quatre joursilguettait mon départ à l'aube. Il avait d'abord refuséde croiremais il ne lui restait aucun doute. Le vieux ménagedont la chambre était sous celle de Marthe se plaignait dubruit que nous faisions nuit et jour. Marthe était atterréevoulait partir. Il ne fut pas question d'apporter un peu de prudencedans nos rendez-vous. Nous nous en sentions incapables : le pliétait pris. Alors Marthe commença de comprendre biendes choses qui l'avaient surprise. La seule amie qu'elle chérîtvraimentune jeune fille suédoisene répondait pas àses lettres. J'appris que le correspondant de cette jeune fille nousayant un jour aperçus dans le trainenlacésil luiavait conseillé de ne pas revoir Marthe.
Je fispromettre à Marthe que s'il éclatait un drameoùque ce fûtsoit chez ses parentssoit avec son mariellemontrerait de la fermeté. Les menaces du propriétairequelques rumeursme donnaient tout lieu de craindreet d'espérerà la foisune explication entre Marthe et Jacques.
Marthem'avait supplié de venir la voir souventpendant lapermission de Jacquesà qui elle avait déjàparlé de moi. Je refusairedoutant de jouer mal mon rôleet de voir Marthe avec un homme empressé auprès d'elle.La permission devait être de onze jours. Peut-êtretricherait-il et trouverait-il le moyen de rester deux jours de plus.Je fis jurer à Marthe de m'écrire chaque jour.J'attendis trois jours avant de me rendre à la poste restantepour être sûr de trouver une lettre. Il y en avait déjàquatre. Je ne pus les prendre : il me manquait un des papiersd'identité nécessaires. J'étais d'autant moins àl'aise que j'avais falsifié mon bulletin de naissancel'usagede la poste restante n'étant permis qu'à partir dedix-huit ans. J'insistaisau guichetavec l'envie de jeter dupoivre dans les yeux de la demoiselle des postesde m'emparer deslettres qu'elle tenait et ne me donnerait pas. Enfincomme j'étaisconnu à la postej'obtinsfaute de mieuxqu'on les envoyâtle lendemain chez mes parents.
Décidémentj'avais encore fort à faire pour devenir un homme. En ouvrantla première lettre de Martheje me demandai comment elleexécuterait ce tour de force : écrire une lettred'amour. J'oubliais qu'aucun genre épistolaire n'est moinsdifficile : il n'y est besoin que d'amour. Je trouvai leslettres de Marthe admirableset dignes des plus belles que j'avaislues. PourtantMarthe m'y disait des choses bien ordinaireset sonsupplice de vivre loin de moi.
Ilm'étonnait que ma jalousie ne fût pas plus mordante. Jecommençais à considérer Jacques comme « lemari ». Peu à peuj'oubliais sa jeunessejevoyais en lui un barbon.
Jen'écrivais pas à Marthe ; il y avait tout de mêmetrop de risques. Au fondje me trouvais plutôt heureux d'êtretenu à ne pas lui écrireéprouvantcommedevant toute nouveautéla crainte vague de n'être pascapableet que mes lettres la choquassent ou lui parussent naïves.
Manégligence fit qu'au bout de deux joursayant laissétraîner sur ma table de travail une lettre de Martheelledisparut ; le lendemainelle reparut sur la table. Ladécouverte de cette lettre dérangeait mes plans :j'avais profité de la permission de Jacquesde mes longuesheures de présencepour faire croire chez moi que je medétachais de Marthe. Carsi je m'étais d'abord montréfanfaron pour que mes parents apprissent que j'avais une maîtresseje commençais à souhaiter qu'ils eussent moins depreuves. Et voici que mon père apprenait la véritablecause de ma sagesse.
Jeprofitais de ces loisirs pour de nouveau me rendre àl'académie de dessin ; cardepuis longtempsjedessinais mes nus d'après Marthe. Je ne sais pas si mon pèrele devinait ; du moins s'étonnait-il malicieusementetd'une manière qui me faisais rougirde la monotonie desmodèles. Je retournais donc à la Grande-Chaumièretravaillai beaucoupafin de réunir une provision d'étudespour le reste de l'annéeprovision que je renouvellerais àla prochaine visite du mari.
Je revisaussi Renérenvoyé d'Henri-IV. Il allait àLouis-le-Grand. Je l'y cherchais tous les soirsaprès laGrande-Chaumière. Nous nous fréquentions en cachettecar depuis son renvoi d'Henri-IVet surtout depuis Marthesesparentsqui naguère me considéraient comme un bonexemplelui avaient défendu ma compagnie.
Renépour qui l'amourdans l'amoursemblait un bagage encombrantmeplaisantait sur ma passion pour Marthe. Ne pouvant supporter sespointesje lui dis lâchement que je n'avais pas de véritableamour. Son admiration pour moiquices derniers tempsavaitfaiblis'en accrut séance tenante.
Jecommençais à m'endormir sur l'amour de Marthe. Ce quime tourmentait le plusc'était le jeûne infligéà mes sens. Mon énervement était celui d'unpianiste sans pianod'un fumeur sans cigarettes.
Renéqui se moquait de mon coeurétait pourtant épris d'unefemme qu'il croyait aimer sans amour. Ce gracieux animalEspagnoleblondese désarticulait si bien qu'il devait sortir d'uncirque. René qui feignait la désinvolture étaitfort jaloux. Il me suppliami- riantmi-pâlissantde luirendre un service bizarre. Ce servicepour qui connaît lecollègeétait l'idée type d'un collégien.Il désirait savoir si cette femme le tromperait. Il s'agissaitdonc de lui faire des avances pour se rendre compte.
Ce servicem'embarrassa. Ma timidité reprenait le dessus. Mais pour rienau monde je n'aurais voulu paraître timide etdu resteladame vint me tirer d'embarras. Elle me fit des avances si promptesque la timiditéqui empêche certaines choses et obligeà d'autresm'empêcha de respecter René etMarthe. Du moins espérais-je y trouver du plaisirmaisj'étais comme le fumeur habitué à une seulemarque. Il ne me resta donc que le remords d'avoir trompéRenéà qui je jurai que sa maîtresse repoussaittoute avance.
Vis-à-visde Martheje n'éprouvais aucun remords. Je m'y forçais.J'avais beau me dire que je ne lui pardonnerais jamais si elle metrompaitje n'y pus rien. « Ce n'est pas pareil »me donnai-je comme excuse avec la remarquable platitude que l'égoïsmeapporte dans ses réponses. De même j'admettais fort biende ne pas écrire à Marthemaissi elle ne m'avait pasécritj'y eusse vu qu'elle ne m'aimait pas. Pourtantcettelégère infidélité renforça monamour.
Jacques necomprenait rien à l'attitude de sa femme. Martheplutôtbavardene lui adressait pas la parole. S'il lui demandait :« Qu'as-tu ? » elle répondait :« Rien. »
Mme Grangiereut différentes scènes avec le pauvre Jacques. Ellel'accusait de maladresse envers sa fillese repentait de la luiavoir donnée. Elle attribuait à cette maladresse deJacques le brusque changement survenu dans le caractère de safille. Elle voulut la reprendre chez elle. Jacques s'inclina.Quelques jours après son arrivéeil accompagna Marthechez sa mèrequiflattant ses moindres capricesencourageait sans se rendre compte son amour pour moi. Marthe étaitnée dans cette demeure. Chaque chosedisait-elle àJacqueslui rappelait le temps heureux où elle s'appartenait.Elle devait dormir dans sa chambre de jeune fille. Jacques voulut quetout au moins on y dressât un lit pour lui. Il provoqua unecrise de nerfs. Marthe refusait de souiller cette chambre virginale.
M. Grangiertrouvait ces pudeurs absurdes. Mme Grangier en profita pour direà son mari et à son gendre qu'ils ne comprenaient rienà la délicatesse féminine. Elle se sentaitflattée que l'âme de sa fille appartînt si peu àJacques. Car tout ce que Marthe ôtait à son mariMme Grangier se l'attribuaittrouvant ses scrupules sublimes.Sublimesils l'étaientmais pour moi.
Les joursoù Marthe se prétendait le plus maladeelle exigeaitde sortir. Jacques savait bien que ce n'était pas pour leplaisir de l'accompagner. Marthene pouvant confier àpersonne les lettres à mon adresseles mettait elle-mêmeà la poste.
Je mefélicitai encore plus de mon silencecarsi j'avais pu luiécrireen réponse au récit des tortures qu'elleinfligeaitje fusse intervenu en faveur de la victime. A certainsmomentsje m'épouvantais du mal dont j'étaisl'auteur ; à d'autresje me disais que Marthe nepunirait jamais assez Jacques du crime de me l'avoir prise vierge.Mais comme rien ne nous rend moins « sentimental »que la passionj'étaissomme touteravi de ne pouvoirécrire et qu'ainsi Marthe continuât de désespérerJacques.
Ilrepartit sans courage.
Tousmirent cette crise sur le compte de la solitude énervante danslaquelle vivait Marthe. Car ses parents et son mari étaientles seuls à ignorer notre liaisonles propriétairesn'osant rien apprendre à Jacques par respect pour l'uniforme.Mme Grangier se félicitait déjà deretrouver sa filleet qu'elle vécût comme avant sonmariage. Aussi les Grangier n'en revinrent-ils pas lorsque Marthelelendemain du départ de Jacquesannonça qu'elleretournait à J....
Je l'yrevis le jour même. D'abordje la grondai mollement d'avoirété si méchante. Mais quand je lus la premièrelettre de Jacquesje fus pris de panique. Il disait combiens'iln'avait plus l'amour de Martheil lui serait facile de se fairetuer.
Je nedémêlai pas le « chantage ». Je mevis responsable d'une mortoubliant que je l'avais souhaitée.Je devins encore plus incompréhensible et plus injuste. Dequelque côté que nous nous tournions s'ouvrait uneblessure. Marthe avait beau me répéter qu'il étaitmoins inhumain de ne plus flatter l'espoir de Jacquesc'est moi quil'obligeais de répondre avec douceur. C'est moi qui dictais àsa femme les seules lettres tendres qu'il en ait jamais reçues.Elle les écrivait en se cabranten pleurantmais je lamenaçais de ne jamais revenirsi elle n'obéissait pas.Que Jacques me dût ses seules joies atténuait mesremords.
Je viscombien son désir de suicide était superficielàl'espoir qui débordait de ses lettresen réponse auxnôtres.
J'admiraismon attitudevis-à-vis du pauvre Jacquesalors quej'agissais par égoïsme et par crainte d'avoir un crimesur la conscience.
Unepériode heureuse succéda au drame. Hélas !un sentiment de provisoire subsistait. Il tenait à mon âgeet à ma nature veule. Je n'avais de volonté pour rienni pour fuir Marthe qui peut-être m'oublieraitet retourneraitau devoirni pour pousser Jacques dans la mort. Notre union étaitdonc à la merci de la paixdu retour définitif destroupes. Qu'il chasse sa femmeelle me resterait. Qu'il la gardejeme sentais incapable de la lui reprendre de force. Notre bonheurétait un château de sable. Mais ici la maréen'étant pas à heure fixej'espérais qu'ellemonterait le plus tard possible.
Maintenantc'est Jacquescharméqui défendait Marthe contre samèremécontente du retour à J... Ce retourl'aigreur aidantavait du reste éveillé chezMme Grangier quelques soupçons. Autre chose luiparaissait suspect : Marthe refusait d'avoir des domestiquesaugrand scandale de sa famille etencore plusde sa belle-famille.Mais que pouvaient parents et beaux-parents contre Jacques devenunotre alliégrâce aux raisons que je lui donnais parl'intermédiaire de Marthe.
C'estalors que J... ouvrit le feu sur elle.
Lespropriétaires affectaient de ne plus lui parler. Personne nela saluait. Seuls les fournisseurs étaient professionnellementtenus à moins de morgue. AussiMarthesentant quelquefois lebesoin d'échanger des paroless'attardait dans les boutiques.Lorsque j'étais chez ellesi elle s'absentait pour acheter dulait et des gâteauxet qu'au bout de cinq minutes elle ne fûtpas de retourl'imaginant sous un tramwayje courais àtoutes jambes jusque chez la crémière ou le pâtissier.Je l'y trouvais causant avec eux. Fou de m'être laisséprendre à mes angoisses nerveusesaussitôt dehorsjem'emportais. Je l'accusais d'avoir des goûts vulgairesdetrouver un charme à la conversation des fournisseurs. Ceux-cidont j'interrompais les proposme détestaient.
L'étiquettedes cours est assez simplecomme tout ce qui est noble. Mais rienn'égale en énigmes le protocole des petites gens. Leurfolie des préséances se fonded'abordsur l'âge.Rien ne les choquerait plus que la révérence d'unvieille duchesse à quelque jeune prince. On devine la haine dupâtissierde la crémièreà voir un gamininterrompre leurs rapports familiers avec Marthe. Ils lui eussent àelle trouvé mille excusesà cause de cesconversations.
Lespropriétaires avaient un fils de vingt-deux ans. Il vint enpermission. Marthe l'invita à prendre le thé.
Le soirnous entendîmes des éclats de voix : on luidéfendait de revoir la locataire. Habitué à ceque mon père ne mît son veto à aucun des mesactesrien ne m'étonna plus que l'obéissance dudadais.
Lelendemaincomme nous traversions le jardinil bêchait. Sansdoute était-ce un pensum. Un peu gênémalgrétoutil détourna la tête pour ne pas avoir àdire bonjour.
Cesescarmouches peinaient Marthe ; assez intelligente et assezamoureuse pour se rendre compte que le bonheur ne réside dansla considération des voisinselle était comme cespoètes qui savent que la vraie poésie est chose« maudite »mais quimalgré leurcertitudesouffrent parfois de ne pas obtenir les suffrages qu'ilsméprisent.
Lesconseillers municipaux jouent toujours un rôle dans mesaventures. M. Marin qui habitait en dessous de chez Marthevieillard à barbe grise et de stature nobleétait unancien conseiller municipal de J.... Retiré dès avantla guerreil aimait servir la patrielorsque l'occasion seprésentait à portée de sa main. Se contentant dedésapprouver la politique communaleil vivait avec sa femmene recevant et ne rendant de visites qu'aux approches de la nouvelleannée.
Depuisquelques joursun remue-ménage se faisait au-dessousd'autant plus distinct que nous entendionsde notre chambrelesmoindres bruits du rez-de-chaussée. Des frotteurs vinrent. Labonneaidée par celle du propriétaireastiquaitl'argenterie dans le jardinôtait le vert-de-gris dessuspensions de cuivre. Nous sûmes par la crémièrequ'un raout-surprise se préparait chez les Marinsous unmystérieux prétexte. Mme Marin était alléeinviter le maire et le supplier de lui accorder huit litres de lait.Autoriserait-il aussi la marchande à faire de la crème ?
Les permisaccordésle jour venu (un vendredi)une quinzaine denotables parurent à l'heure dite avec leurs femmeschacunefondatrice d'une société d'allaitement maternel ou desecours aux blessésdont elle était la présidenteet les autressociétaires. La maîtresse de cettemaisonpour faire « genre »recevait devantla porte. Elle avait profité de l'attraction mystérieusepour transformer son raout en pique-nique. Toutes ces damesprêchaient l'économie et inventaient des recettes.Aussileurs douceurs étaient- elles des gâteaux sansfarinedes crèmes au lichenetc. Chaque nouvelle arrivantedisait à Mme Marin : « Oh ! çane paie pas de minemais je crois que ce sera bon tout de même. »
M. Marinluiprofitait de ce raout pour préparer sa « rentréepolitique ».
Orlasurprisec'était Marthe et moi. La charitable indiscrétiond'un de mes camarades de chemin de ferle fils d'un des notablesmel'apprit. Jugez de ma stupeur quand je sus que la distraction desMarin était de se tenir sous notre chambre vers la fin del'après- midi et de surprendre nos caresses.
Sans doutey avaient-ils pris goût et voulaient-ils publier leursplaisirs. Bien entendules Maringens respectablesmettaient cedévergondage sur le compte de la morale. Ils voulaient fairepartager leur révolte par tout ce que la commune comptait degens comme il faut.
Lesinvités étaient en place. Mme Marin me savait chezMarthe et avait dressé la table sous la chambre. Ellepiaffait. Elle eût voulu la canne du régisseur pourannoncer le spectacle. Grâce à l'indiscrétion dujeune hommequi trahissait pour mystifier sa famille et parsolidarité d'âgenous gardâmes le silence. Jen'avais pas osé dire à Marthe le motif du pique-nique.Je pensais au visage décomposé de Mme Marinlesyeux sur les aiguilles de l'horlogeet à l'impatience de seshôtes. Enfinvers sept heuresles couples se retirèrentbredouillestraitant tout bas les Marin d'imposteurs et le pauvreM. Marinâgé de soixante-dix ansd'arriviste. Cefutur conseiller vous promettait monts et merveilleset n'attendaitmême pas d'être élu pour manquer à sespromesses. En ce qui concernait Mme Marinces dames virent dansle raout un moyen avantageux pour elle de se fournir du dessert. Lemaireen personnageavait paru juste quelques minutes ; cesquelques minutes et les huit litres de lait firent chuchoter qu'ilétait du dernier bien avec la fille des Marininstitutrice àl'école. Le mariage de Mlle Marin avait jadis faitscandaleparaissant peu digne d'une institutricecar elle avaitépousé un sergent de ville.
Je poussaila malice jusqu'à leur faire entendre ce qu'ils eussentsouhaité faire entendre aux autres. Marthe s'étonna decette tardive ardeur. Ne pouvant plus y teniret au risque de lachagrinerje lui dis quel était le but du raout. Nous enrîmes ensemble aux larmes.
Mme Marinpeut-être indulgente si j'eusse servi ses plansne nouspardonna pas son désastre. Il lui donna de la haine. Mais ellene pouvait l'assouvirne disposant plus de moyenset n'osant userde lettres anonymes.
Nousétions au mois de mai. Je rencontrais moins Marthe chez elleet n'y couchais que si je pouvais inventer chez moi un mensonge poury rester le matin. Je l'inventais une ou deux fois la semaine. Laperpétuelle réussite de mon mensonge me surprenait. Enréalitémon père ne me croyait pas. Avec unefolle indulgence il fermait les yeuxà la seule condition queni mes frères ni les domestiques ne l'apprissent. Il mesuffisait donc de dire que je partais à cinq heures du matincomme le jour de ma promenade à la forêt de Senart. Maisma mère ne préparait plus de panier.
Mon pèresupportait toutpuissans transitionse cabrantme reprochait maparesse. Ces scènes se déchaînaient et secalmaient vitecomme les vagues.
Rienn'absorbe plus que l'amour. On n'est pas paresseuxparce queétantamoureuxon paresse. L'amour sent confusément que son seuldérivatif réel est le travail. Aussi le considère-t-ilcomme un rival. Et il n'en supporte aucun. Mais l'amour est paressebienfaisantecomme la molle pluie qui féconde.
Si lajeunesse est niaisec'est faute d'avoir étéparesseuse. Ce qui infirme nos systèmes d'éducationc'est qu'ils s'adressent aux médiocresà cause dunombre. Pour un esprit en marchela paresse n'existe pas. Je n'aijamais plus appris que dans ces longues journées quipour untémoineussent semblé videset où j'observaismon coeur novice comme un parvenu observe ses gestes à table.
Quand jene couchais pas chez Marthec'est-à-dire presque tous lesjoursnous nous promenions après dînerle long de laMarnejusqu'à onze heures. Je détachais le canot demon père. Marthe ramait ; moiétenduj'appuyaisma tête sur ses genoux. Je la gênais. Soudainun coup derame me cognantme rappelait que cette promenade ne durerait pastoute la vie.
L'amourveut faire partager sa béatitude. Ainsiune maîtressede nature assez froide devient caressantenous embrasse dans le couinvente mille agaceriessi nous sommes en train d'écrire unelettre. Je n'avais jamais tel désir d'embrasser Marthe quelorsqu'un travail la distrayait de moi ; jamais tant envie detoucher ses cheveuxde la décoifferque quand elle secoiffait. Dans le canotje me précipitais sur ellelajonchant de baiserspour qu'elle lâchât ses ramesetque le canot dérivâtprisonnier des herbesdesnénuphars blancs et incapable de se conteniralors que mepoussait surtout la manie de dérangersi forte. Puisnousamarrions le canot derrière les hautes touffes. Ma crainted'être visibles ou de chavirerme rendait nos ébatsmille fois plus voluptueux.
Aussi neme plaignais-je point de l'hostilité des propriétairesqui rendait ma présence chez Marthe très difficile.
Masoi-disant idée fixe de la posséder comme ne l'avait puposséder Jacquesd'embrasser un coin de sa peau aprèslui avoir fait jurer que jamais d'autres lèvres que lesmiennes ne s'y étaient misesn'était que dulibertinage. Me l'avouais-je ? Tout amour comporte sa jeunesseson âge mûrsa vieillesse. Étais-je à cedernier stade où déjà l'amour ne me satisfaisaitplus sans certaines recherches. Car si ma volupté s'appuyaitsur l'habitudeelle s'avivait de ces mille riensde ces légèrescorrections infligées à l'habitude. Ainsin'est-ce pasd'abord dans l'augmentation des dosesqui vite deviendraientmortellesqu'un intoxiqué trouve l'extasemais dans lerythme qu'il inventesoit en changeant ses heuressoit en usant desupercheries pour dérouter l'organisme.
J'aimaistant cette rive gauche de la Marneque je fréquentaisl'autresi différenteafin de pouvoir contempler celle quej'aimais. La rive droite est moins molleconsacrée auxmaraîchersaux cultivateursalors que la mienne l'est auxoisifs. Nous attachions le canot à un arbreallions nousétendre au milieu du blé. Notre égoïsmedans sa cachetteoubliait le préjudicesacrifiant le bléau confort de notre amourcomme nous y sacrifiions Jacques.
Un parfumde provisoire excitait mes sens. D'avoir goûté àdes joies plus brutalesplus ressemblantes à celles qu'onéprouve sans amour avec la première venueaffadissaitles autres.
J'appréciaisdéjà le sommeil chastelibrele bien-être de sesentir seul dans un lit aux draps frais. J'alléguais desraisons de prudence pour ne plus passer de nuits chez Marthe. Elleadmirait ma force de caractère. Je redoutais aussi l'agacementque donne une certaine voix angélique des femmes quis'éveillent et quicomédiennes de racesemblentchaque matin sortir de l'au-delà.
Je mereprochais mes critiquesmes feintespassant des journées àme demander si j'aimais Marthe plus ou moins que naguère. Monamour sophistiquait tout. De même que je traduisais faussementles phrases de Marthecroyant leur donner un sens plus profondj'interprétais ses silences. Ai-je toujours eu tort ; uncertain chocqui ne se peut décrirenous prévenantque nous avons touché juste. Mes jouissancesmes angoissesétaient plus fortes. Couché auprès d'ellel'envie qui me prenaitd'une seconde à l'autred'êtrecouché seulchez mes parentsme faisait augurerl'insupportable d'une vie commune. D'autre partje ne pouvaisimaginer de vivre sans Marthe. Je commençais àconnaître le châtiment de l'adultère.
J'envoulais à Marthe d'avoiravant notre amourconsenti àmeubler la maison de Jacques à ma guise. Ces meubles medevinrent odieuxque je n'avais pas choisis pour mon plaisirmaisafin de déplaire à Jacques. Je m'en fatiguaissansexcuses. Je regrettais de n'avoir pas laissé Marthe leschoisir seule. Sans doute m'eussent-ils d'abord déplumaisquel charmeensuitede m'y habituerpar amour pour elle. J'étaisjaloux que le bénéfice de cette habitude revînt àJacques.
Marthe meregardait avec de grands yeux naïfs lorsque je lui disaisamèrement : « J'espère quequand nousvivrons ensemblenous ne garderons pas ces meubles. »Elle respectait tout ce que je disais. Croyant que j'avais oubliéque ces meubles venaient de moielle n'osait me le rappeler. Elle selamentait intérieurement de ma mauvaise mémoire.
Dans lespremiers jours de juinMarthe reçut une lettre de Jacques oùenfinil ne l'entretenait pas que de son amour. Il étaitmalade. On l'évacuait à l'hôpital de Bourges. Jene me réjouissais pas de le savoir malademais qu'il eûtquelque chose à dire me soulageait. Passant par J.lelendemain ou le surlendemainil suppliait Marthe qu'elle guettâtson train sur le quai de la gare. Marthe me montra cette lettre. Elleattendait un ordre.
L'amourlui donnait une nature d'esclave. Aussien face d'une telleservitude préambulaireavais-je du mal à ordonner oudéfendre. Selon moimon silence voulait dire que jeconsentais. Pouvais-je l'empêcher d'apercevoir son mari pendantquelques secondes ? Elle garda le même silence. Doncparune espèce de convention taciteje n'allai pas chez elle lesurlendemain.
Lesurlendemainun commissionnaire m'apporta chez mes parents un motqu'il ne devait remettre qu'à moi. Il était de Marthe.Elle m'attendrait au bord de l'eau. Elle me suppliait de venirsij'avais encore de l'amour pour elle.
Je courusjusqu'au banc sur lequel Marthe m'attendait. Son bonjoursi peu enrapport avec le style de son billetme glaça. Je crus soncoeur changé.
SimplementMarthe avait pris mon silence de l'avant-veille pour un silencehostile. Elle n'avait pas imaginé la moindre conventiontacite. A des heures d'angoisse succédait le grief de me voiren viepuisque seule la mort eût dû m'empêcher devenir hier. Ma stupeur ne pouvait se feindre. Je lui expliquai maréservemon respect pour ses devoirs envers Jacques malade.Elle me crut à demi. J'étais irrité. Je faillislui dire : « Pour une fois que je ne mens pas. »Nous pleurâmes.
Mais cesconfuses parties d'échecs sont interminablesépuisantessi l'un des deux n'y met bon ordre. En sommel'attitude de Martheenvers Jacques n'était pas flatteuse. Je l'embrassailaberçai. « Le silencedis-jene nous réussitpas. » Nous nous promîmes de ne rien nous celer denos pensées secrètesmoi la plaignant un peu de croireque c'est chose possible.
A J...Jacques avait cherché des yeux Marthepuis le train passantdevant leur maisonil avait vu les volets ouverts. Sa lettre lasuppliait de le rassurer. Il lui demandait de venir à Bourges.« Il faut que tu partes »dis-jede façonque cette simple phrase ne sentît pas le reproche.
-- J'iraidit-ellesi tu m'accompagnes.
C'étaitpousser trop loin l'inconscience. Mais ce qu'exprimaient d'amour sesparolesses actes les plus choquantsme conduisait vite de lacolère à la gratitude. Je me cabrai. Je me calmai. Jelui parlai doucementému par sa naïveté. Je latraitais comme un enfant qui demande la lune.
Je luireprésentai combien il était amoral qu'elle se fîtaccompagner par moi. Que ma réponse ne fût pas orageusecomme celle d'un amant outragésa portée s'en accrut.Pour la première foiselle m'entendait prononcer le mot de« morale ». Ce mot vint à merveillecarsi peu méchanteelle devait bien connaître descrises de doutecomme moisur la moralité de notre amour.Sans ce motelle eût pu me croire amoralétant fortbourgeoisemalgré sa révolte contre les excellentspréjugés bourgeois. Maisau contrairepuisquepourla première foisje la mettais en gardec'était unepreuve que jusqu'alors je considérais que nous n'avions rienfait de mal.
Martheregrettait cette espèce de voyage de noces scabreux. Ellecomprenaitmaintenantce qu'il y avait d'impossible.
-- Dumoinsdit-ellepermets-moi de ne pas y aller.
Ce mot de« morale » prononcé à la légèrem'instituait son directeur de conscience. J'en usai comme cesdespotes qui se grisent d'un pouvoir nouveau. La puissance ne semontre que si l'on en use avec injustice. Je répondis donc queje ne voyais aucun crime à ce qu'elle n'allât pas àBourges. Je lui trouvai des motifs qui la persuadèrent :fatigue du voyageproche convalescence de Jacques. Ces motifsl'innocentaientsinon aux yeux de Jacquesdu moins vis-à-visde sa belle-famille.
A la forced'orienter Marthe dans un sens qui me convenaitje la façonnaispeu à peu à mon image. C'est de quoi je m'accusaisetde détruire sciemment notre bonheur. Qu'elle me ressemblâtet que ce fût mon oeuvreme ravissait et me fâchait. J'yvoyais une raison de notre entente. J'y discernais aussi la cause dedésastres futurs. En effetje lui avais peu à peucommuniqué mon incertitudequile jour des décisionsl'empêcherait d'en prendre aucune. Je la sentais comme moi lesmains mollesespérant que la mer épargnerait lechâteau de sabletandis que les autres enfants s'empressent debâtir plus loin.
Il arriveque cette ressemblance morale déborde sur le physique. Regarddémarche : plusieurs fois des étrangers nousprirent pour frère et soeur. C'est qu'il existe en nous desgermes de ressemblance que développe l'amour. Un gesteuneinflexion de voixtôt ou tardtrahissent les amants les plusprudents.
Il fautadmettre que si le coeur a ses raisons que la raison ne connaîtpasc'est que celle- ci est moins raisonnable que notre coeur. Sansdoutesommes-nous tous des Narcisseaimant et détestant leurimagemais à qui toute autre est indifférente. C'estcet instinct de ressemblance qui nous mène dans la vienouscriant « halte ! » devant un paysageunefemmeun poème. Nous pouvons en admirer d'autressansressentir ce choc. L'instinct de ressemblance est la seule ligne deconduite qui ne soit pas artificielle. Mais dans la sociétéseuls les esprits grossiers semblent ne point pêcher contre lamoralepoursuivant toujours le même type. Ainsi certainshommes s'acharnent sur les « blondes »ignorant que souvent les ressemblances les plus profondes sont lesplus secrètes.
Marthedepuis quelques jourssemblait distraitesans tristesse. Distraiteavec tristessej'aurais pu m'expliquer sa préoccupation parl'approche du quinze juilletdate à laquelle il lui faudraitrejoindre la famille de Jacqueset Jacques en convalescencesur uneplage de la Manche. A son tourMarthe se taisaitsursautant aubruit de ma voix. Elle supportait l'insupportable : visites defamilleavaniessous-entendus aigres de sa mèrebonhommesde son pèrequi lui supposait un amantsans y croire.
Pourquoisupportait-elle tout ? Était-ce la suite de mes leçonslui reprochant d'attacher trop d'importance aux chosesde s'affecterdes moindres ? Elle paraissait heureusemais d'un bonheursingulierdont elle ressentait de la gêneet qui m'étaitdésagréablepuisque je ne la partageais pas. Moi quitrouvais enfantin que Marthe découvrît dans mon mutismeune preuve d'indifférenceà mon tourje l'accusais dene plus m'aimerparce qu'elle se taisait.
Marthen'osait pas m'apprendre qu'elle était enceinte.
J'eussevoulu paraître heureux de cette nouvelle. Mais d'abord elle mestupéfia. N'ayant jamais pensé que je pouvais devenirresponsable de quoi que ce fûtje l'étais du pire.J'enrageais aussi de n'être pas assez homme pour trouver lachose simple. Marthe n'avait parlé que contrainte. Elletremblait que cet enfant qui devait nous rapprocher nous séparât.Je mimai si bien l'allégresse que ses craintes se dissipèrent.Elle gardait les traces profondes de la morale bourgeoiseet cetenfant signifiait pour elle que Dieu récompenserait notreamourqu'il ne punissait aucun crime.
Alors queMarthe trouvait maintenant dans sa grossesse une raison pour que jene la quittasse jamaiscette grossesse me consterna. A notre âgeil me semblait impossibleinjusteque nous eussions un enfant quientraverait notre jeunesse. Pour la première foisje merendais à des craintes d'ordre matériel : nousserions abandonnés de nos familles.
Aimantdéjà cet enfantc'est par amour que je le repoussais.Je ne me voulais pas responsable de son existence dramatique. J'eusseété moi-même incapable de la vivre.
L'instinctest notre guide ; un guide qui nous conduit à notreperte. HierMarthe redoutait que sa grossesse nous éloignâtl'un de l'autre. Aujourd'hui qu'elle ne m'avait jamais tant aiméelle croyait que mon amour grandissait comme le sien. Moihierrepoussant cet enfantje commençais aujourd'hui àl'aimer et j'ôtais de l'amour à Marthede mêmequ'au début de notre liaison mon coeur lui donnait ce qu'ilretirait aux autres.
Maintenantposant ma bouche sur le ventre de Marthece n'était plus elleque j'embrassaisc'était mon enfant. Hélas !Marthe n'était plus ma maîtressemais une mère.
Jen'agissais plus jamais comme si nous étions seuls. Il y avaittoujours un témoin près de nousà qui nousdevions rendre compte de nos actes. Je pardonnais mal ce brusquechangement dont je rendais Marthe seule responsableet pourtantjesentais que je lui aurais encore pardonné si elle m'avaitmenti. A certaines secondesje croyais que Marthe mentait pour fairedurer un peu plus notre amourmais que son fils n'était pasle mien.
Comme unmalade qui recherche le calmeje ne savais de quel côtéme tourner. Je sentais ne plus aimer la même Marthe et que monfils ne serait heureux qu'à la condition de se croire celui deJacques. Certesce subterfuge me consternait. Il faudrait renoncer àMarthe. D'autre partj'avais beau me trouver un hommele faitactuel était trop grave pour que je me rengorgeasse jusqu'àcroire possible une aussi folle (je pensais : une aussi sage)existence.
CarenfinJacques reviendrait. Après cette périodeextraordinaireil retrouveraitcomme tant d'autres soldats trompésà cause des circonstances exceptionnellesune épousetristedociledont rien ne décèlerait l'inconduite.Mais cet enfant ne pouvait s'expliquer pour son mari que si ellesupportait son contact aux vacances. Ma lâcheté l'ensupplia.
De toutesnos scènescelle-ci ne fut ni la moins étrange ni lamoins pénible. Je m'étonnai du reste de rencontrer sipeu de lutte. J'en eus l'explication plus tard. Marthe n'osaitm'avouer une victoire de Jacques à sa dernièrepermission et comptaitfeignant de m'obéirse refuser aucontraire à luià Granvillesous prétexte desmalaises de son état. Tout cet échafaudage secompliquait de dates dont la fausse coïncidencelors del'accouchementne laisserait de doutes à personne. « Bah !me disais-jenous avons du temps devant nous. Les parents de Martheredouteront le scandale. Ils l'emmèneront à la campagneet retarderont la nouvelle. »
La date dudépart de Marthe approchait. Je ne pouvais que bénéficierde cette absence. Ce serait un essai. J'espérais me guérirde Marthe. Si je n'y parvenais passi mon amour était tropvert pour se détacher de lui-mêmeje savais bien que jeretrouverais Marthe aussi fidèle.
Ellepartit le douze juilletà sept heures du matin. Je restai àJ... la nuit précédente. En y allantje me promettaisde ne pas fermer l'oeil de la nuit. Je ferais une telle provision decaressesque je n'aurais plus besoin de Marthe pour le reste de mesjours.
Un quartd'heure après m'être couchéje m'endormis.
Engénéralla présence de Marthe troublait monsommeil. Pour la première foisà côtéd'elleje dormis aussi bien que si j'eusse été seul.
A monréveilelle était déjà debout. Ellen'avait pas osé me réveiller. Il ne me restait plusqu'une demi-heure avant le train. J'enrageais d'avoir laisséperdre par le sommeil les dernières heures que nous avions àpasser ensemble. Elle pleurait aussi de partir. Pourtantj'eussevoulu employer les dernières minutes à autre chose qu'àboire nos larmes.
Marthe melaissait sa clefme demandant de venirde penser à nousetde lui écrire sur sa table.
Je m'étaisjuré de ne pas l'accompagner jusqu'à Paris. Maisje nepouvais vaincre mon désir de ses lèvres etcomme jesouhaitais lâchement l'aimer moinsje mettais ce désirsur le compte du départde cette « dernièrefois » si faussepuisque je sentais bien qu'il n'y auraitde dernière fois sans qu'elle le voulût.
A la gareMontparnasseoù elle devait rejoindre ses beaux-parentsjel'embrassai sans retenue. Je cherchais encore mon excuse dans le faitquesa belle-famille surgissantil se produirait un drame décisif.
Revenu àF...accoutumé à n'y vivre qu'en attendant de merendre chez Martheje tâchai de me distraire. Je bêchaile jardinj'essayai de lireje jouai à cache-cache avec messoeursce qui ne m'était pas arrivé depuis cinq ans.Le soirpour ne pas éveiller les soupçonsil fallutque j'allasse me promener. D'habitudejusqu'à la Marnelaroute m'était légère. Ce soir-làje metraînailes cailloux me tordant le pied et précipitantmes battements de coeur. Étendu dans la barqueje souhaitaila mortpour la première fois. Mais aussi incapable de mourirque de vivreje comptais sur un assassin charitable. Je regrettaisqu'on ne pût mourir d'ennuini de peine. Peu à peumatête se vidaitavec un bruit de baignoire. Une dernièresuccionplus longuela tête est vide. Je m'endormis.
Le froidd'une aube de juillet me réveilla. Je rentraitransicheznous. La maison était grande ouverte. Dans l'antichambre monpère me reçut avec dureté. Ma mère avaitété un peu malade : on avait envoyé lafemme de chambre me réveiller pour que j'allasse chercher ledocteur. Mon absence était donc officielle.
Jesupportai la scène en admirant la délicatesseinstinctive du bon juge quientre mille actions d'aspect blâmablechoisit la seule innocente pour permettre au criminel de sejustifier. Je ne me justifiai d'ailleurs pasc'était tropdifficile. Je laissai croire à mon père que je rendraisde J...etlorsqu'il m'interdit de sortir après le dînerje le remerciai à part moi d'être encore mon complice etde me fournir une excuse pour ne plus traîner seul dehors.
J'attendaisle facteur. C'était ma vie. J'étais incapable dumoindre effort pour oublier.
Marthem'avait donné un coupe-papierexigeant que je ne m'enservisse que pour ouvrir ses lettres. Pouvais-je m'en servir ?J'avais trop de hâte. Je déchirais les enveloppes.Chaque foishonteuxje me promettais de garder la lettre un quartd'heureintacte. J'espéraispar cette méthodepouvoir à la longue reprendre de l'empire sur moi-mêmegarder les lettres fermées dans ma poche. Je remettais cerégime au lendemain.
Un jourimpatienté par ma faiblesseet dans un mouvement de ragejedéchirais une lettre sans la lire. Dès que les morceauxde papier eurent jonché le jardinje me précipitaiàquatre pattes. La lettre contenait une photographie de Marthe. Moi sisuperstitieux et qui interprétais les faits les plus mincesdans un sens tragiquej'avais déchiré ce visage. J'yvis un avertissement du Ciel. Mes transes ne se calmèrentqu'après avoir passé quatre heures à recoller lalettre et le portrait. Jamais je n'avais fourni un tel effort. Lacrainte qu'il arrivât malheur à Marthe me soutintpendant ce travail absurde qui me brouillait les yeux et les nerfs.
Unspécialiste avait recommandé les bains de mer àMarthe. Tout en m'accusant de méchancetéje les luidéfendisne voulant pas que d'autres que moi pussent voir soncorps.
Du restepuisque de toute manière Marthe devait passer un mois àGranvilleje me félicitais de la présence de Jacques.Je me rappelais sa photographie en blanc que Marthe m'avait montréele jour des meubles. Rien ne me faisait plus peur que les jeuneshommes sur la plage. D'avanceje les jugeais plus beauxplus fortsplus élégants que moi.
Son marila protégerait contre eux.
Acertaines minutes de tendressecomme un ivrogne qui embrasse tout lemondeje rêvassais d'écrire à Jacquesde luiavouer que j'étais l'amant de Martheetm'autorisant de cetitrede la lui recommander. Parfoisj'enviais Martheadoréepar Jacques et par moi. Ne devions-nous pas chercher ensemble àfaire son bonheur ? Dans ces crisesje me sentais amantcomplaisant. J'eusse voulu connaître Jacqueslui expliquer leschoseset pourquoi nous ne devions pas être jaloux l'un del'autre. Puistout à coupla haine redressait cette pentedouce.
Danschaque lettreMarthe me demandait d'aller chez elle. Son insistanceme rappelait celle d'une de mes tantes fort dévotemereprochant de ne jamais aller sur la tombe de ma grand-mère.Je n'ai pas l'instinct du pèlerinage. Ces devoirs ennuyeuxlocalisent la mortl'amour.
Ne peut-onpenser à une morteou à sa maîtresse absenteailleurs qu'en un cimetièreou dans certaine chambre ?Je n'essayais pas de l'expliquer à Marthe et lui racontais queje me rendais chez elle ; de mêmeà ma tantequej'étais allé au cimetière. Pourtantje devaisaller chez Marthe ; mais dans de singulièrescirconstances.
Jerencontrai un jour sur le réseau cette jeune fille suédoiseà laquelle ses correspondants défendaient de voirMarthe. Mon isolement me fit prendre goût aux enfantillages decette petite personne. Je lui proposer de venir goûter àJ...en cachettele lendemain. Je lui cachais l'absence de Marthepour qu'elle ne s'effarouchât paset ajoutai mêmecombien elle serait heureuse de la revoir. J'affirme que je ne savaisau juste ce que je comptais faire. J'agissais comme ces enfants quiliant connaissancecherchent à s'étonner entre eux. Jene résistais pas à voir surprise ou colère surla figure d'ange de Svéaquand je serais tenu de luiapprendre l'absence de Marthe.
Ouic'était sans doute ce plaisir puéril d'étonnerparce que je ne trouvais rien à lui dire de surprenanttandisqu'elle bénéficiait d'une sorte d'exotisme et mesurprenait à chaque phrase. Rien de plus délicieux quecette soudaine intimité entre personnes qui se comprennentmal. Elle portait au cou une petite croix d'orémailléede bleuqui pendait sur une robe assez laide que je réinventaisà mon goût. Une véritable poupée vivante.Je sentais croître mon désir de renouveler cetête-à-tête ailleurs qu'en un wagon.
Ce quigâtait un peu son air de couventinec'était l'allured'une élève de l'école Pigieroùd'ailleurs elle étudiait une heure par joursans grandprofitle français et la machine à écrire. Elleme montra ses devoirs dactylographiés. Chaque lettre étaitune fautecorrigée en marge par le professeur. Elle sortitd'un sac à main affreuxévidemment son oeuvreun étuià cigarettes orné d'une couronne comtale. Elle m'offritune cigarette. Elle ne fumait pasmais portait toujours cet étuiparce que ses amies fumaient. Elle me parlait de coutumes suédoisesque je feignais de connaître : nuit de la Saint-Jeanconfitures de myrtilles. Ensuiteelle tira de son sac unephotographie de sa soeur jumelleenvoyée de Suède laveille ; à chevaltoute nueavec sur la tête unchapeau haut de forme de leur grand-père. Je devins écarlate.Sa soeur lui ressemblait tellement que je la soupçonnais derire de moiet de montrer sa propre image. Je me mordais les lèvrespour calmer leur envie d'embrasser cette espiègle naïve.Je dus avoir une expression bien bestialecar je la vis peureusecherchant des yeux le signal d'alarme.
Lelendemainelle arriva chez Marthe à quatre heures. Je lui disque Marthe était à Paris mais rentrerait vite.J'ajoutai : « Elle m'a défendu de vous laisserpartir avant son retour. » Je comptais ne lui avouer monstratagème que trop tard.
Heureusementelle était gourmande. Ma gourmandise à moi prenait uneforme inédite. Je n'avais aucune faim pour la tartela glaceà la framboisemais souhaitais être tarte et glace dontelle approchât la bouche. Je faisais avec la mienne desgrimaces involontaires.
Ce n'estpas par vice que je convoitais Svéamais par gourmandise. Sesjoues m'eussent suffià défaut de ses lèvres.
Je parlaisen prononçant chaque syllabe pour qu'elle comprît bien.Excité par cette amusante dînetteje m'énervaismoi toujours silencieuxde ne pouvoir parler vite. J'éprouvaisun besoin de bavardagede confidences enfantines. J'approchais monoreille de sa bouche. Je buvais ses petites paroles.
Je l'avaiscontrainte à prendre une liqueur. Aprèsj'eus pitiéd'elle comme d'un oiseau qu'on grise.
J'espéraisque sa griserie servirait mes desseinscar peu importait qu'elle medonnât ses lèvres de bon coeur ou non. Je pensai àl'inconvenance de cette scène chez Marthemaismerépétai-jeen sommeje ne retire rien à notreamour. Je désirais Svéa comme un fruitce dont unemaîtresse ne peut être jalouse.
Je tenaissa main dans mes mains qui m'apparurent pataudes. J'aurais voulu ladéshabillerla bercer. Elle s'étendit sur le divan. Jeme levaime penchai à l'endroit où commençaientses cheveuxduvet encore. Je ne concluais pas de son silence que mesbaisers lui fissent plaisir ; maisincapable de s'indignerelle ne trouvait aucune façon polie de me repousser enfrançais. Je mordillais ses jouesm'attendant à cequ'un jus sucré jaillissecomme des pêches.
Enfinj'embrassai sa bouche. Elle subissait mes caressespatiente victimefermant cette bouche et les yeux. Son seul geste de refus consistaità remuer faiblement la tête de droite à gaucheet de gauche à droite. Je ne me méprenais pasmais mabouche y trouvait l'illusion d'une réponse. Je restais auprèsd'elle comme je n'avais jamais été auprès deMarthe. Cette résistance qui n'en était pas uneflattait mon audace et ma paresse. J'étais assez naïfpour croire qu'il en irait de même ensuite et que jebénéficierais d'un viol facile.
Je n'avaisjamais déshabillé de femmes ; j'avais plutôtété déshabillé par elles. Aussi je m'ypris maladroitementcommençant par lui ôter sessouliers et ses bas. Je baisais ses pieds et ses jambes. Mais quandje voulus dégrafer son corsageSvéa se débattitcomme un petit diable qui ne veut pas aller se coucher et que l'ondévêt de force. Elle me rouait de coups de pieds.J'attrapais ses pieds au volje les emprisonnaisles baisais.Enfinla satiété arrivacomme la gourmandise s'arrêteaprès trop de crème et de friandises. Il fallut bienque je lui apprisse ma supercherieet que Marthe était envoyage. Je lui fis promettresi elle rencontrait Marthede nejamais lui raconter notre entrevue. Je ne lui avouai pas que j'étaisson amantmais le lui laissai entendre. Le plaisir du mystèrelui fit répondre « à demain »quandrassasié d'elleje lui demandai par politesse si nousnous reverrions un jour.
Je neretournai pas chez Marthe. Et peut-être Svéa nevint-elle pas sonner à la porte close. Je sentais combienblâmable pour la morale courante était ma conduite. Carsans doute sont-ce les circonstances qui m'avaient fait paraîtreSvéa si précieuse. Ailleurs que dans la chambre deMarthel'eussé-je désirée ?
Mais jen'avais pas de remords. Et ce n'est pas en pensant à Martheque je délaissai la petite Suédoisemais parce quej'avais tiré d'elle tout le sucre.
Quelquesjours aprèsje reçus une lettre de Marthe. Elle encontenait une de son propriétairelui disant que sa maisonn'était pas une maison de rendez-vousquel usage je faisaisde la clef de son appartementoù j'avais emmené unefemme. « J'ai une preuve de ta traîtrise »ajoutait Marthe. Elle ne me reverrait jamais. Sans doutesouffrirait-ellemais elle préférait souffrir qued'être dupe.
Je savaisces menaces anodineset qu'il suffirait d'un mensongeou mêmeau besoin de la véritépour les anéantir. Maisil me vexait quedans une lettre de ruptureMarthe ne me parlâtpas de suicide. Je l'accusai de froideur. Je trouvai sa lettreindigne d'une explication. Car moidans une situation analoguesanspenser au suicidej'aurais crupar convenanceen devoir menacerMarthe. Trace indélébile de l'âge et du collège :je croyais certains mensonges commandés par le codepassionnel.
Unebesogne neuvedans mon apprentissage de l'amourse présentait :m'innocenter vis-à-vis de Martheet l'accuser d'avoir moinsde confiance en moi qu'en son propriétaire. Je lui expliquaicombien habile était cette manoeuvre de la coterie Marin. EneffetSvéa était venue la voir un jour oùj'écrivais chez elleet si j'avais ouvert c'est parce queayant aperçu la jeune fille par la fenêtreet sachantqu'on l'éloignait de Martheje ne voulais pas lui laissercroire que Marthe lui tenait rigueur de cette pénibleséparation. Sans doutevenait-elle en cachette et au prix dedifficultés sans nombre.
Ainsipouvais-je annoncer à Marthe que le coeur de Svéa luidemeurait intact. Et je terminais en exprimant le réconfortd'avoir pu parler de Marthechez elleavec sa plus intime compagne.
Cettealerte me fit maudire l'amour qui nous force à rendre comptede nos actesalors que j'eusse tant aimé n'en jamais rendrecompteà moi pas plus qu'aux autres.
Il fautpourtantme disais-jeque l'amour offre de grands avantages puisquetous les hommes remettent leur liberté entre ses mains. Jesouhaitais d'être assez fort pour me passer d'amour etainsin'avoir à sacrifier aucun de mes désirs. J'ignorais queservitude pour servitudeil vaut encore mieux être asservi parson coeur que l'esclave de ses sens.
Commel'abeille butine et enrichit la ruche -- de tous ses désirsqui le prennent dans la rue --un amoureux enrichit son amour. Il enfait bénéficier sa maîtresse. Je n'avais pasencore découvert cette discipline qui donne aux naturesinfidèles la fidélité. Qu'un homme convoite unefille et reporte cette chaleur sur la femme qu'il aimeson désirplus vif parce que insatisfait laissera croire à cette femmequ'elle n'a jamais été mieux aimée. On latrompemais la moraleselon les gensest sauve. A de tels calculscommence le libertinage. Qu'on ne condamne donc pas trop vitecertains hommes capables de tromper leur maîtresse au plus fortde leur amour ; qu'on ne les accuse pas d'être frivoles.Ils répugnent à ce subterfuge et ne songent mêmepas à confondre leur bonheur et leurs plaisirs.
Martheattendait que je me disculpasse. Elle me supplia de lui pardonner sesreproches. Je le fisnon sans façons. Elle écrivit aupropriétairele priant ironiquement d'admettre qu'en sonabsence j'ouvrisse à une de ses amies.
QuandMarthe revintaux derniers jours d'aoûtelle n'habita pasJ...mais la maison de ses parentsqui prolongeaient leurvillégiature. Ce nouveau décor où Marthe avaittoujours vécu me servit d'aphrodisiaque. La fatigue sensuellele désir secret du sommeil solitairedisparurent. Je nepassai aucune nuit chez mes parents. Je flambaisje me hâtaiscomme les gens qui doivent mourir jeunes et qui mettent les bouchéesdoubles. Je voulais profiter de Marthe avant que l'abîmâtsa maternité.
Cettechambre de jeune filleoù elle avait refusé laprésence de Jacquesétait notre chambre. Au-dessus deson lit étroitj'aimais que mes yeux la rencontrassent enpremière communiante. Je l'obligeais à regarderfixement une autre image d'ellebébépour que notreenfant lui ressemblât. Je rôdaisravidans cette maisonqui l'avait vue naître et s'épanouir. Dans une chambrede débarrasje touchais son berceaudont je voulais qu'ilservît encoreet je lui faisais sortir ses brassièresses petites culottesreliques des Grangier.
Je neregrettais pas l'appartement de J...où les meubles n'avaientpas le charme du plus laid mobilier des familles. Ils ne pouvaientrien m'apprendre. Au contraireicime parlaient de Marthe tous cesmeubles auxquelspetiteelle avait dû se cogner la tête.Et puisnous vivions seulssans conseiller municipalsanspropriétaire. Nous ne nous gênions pas plus que dessauvagesnous promenant presque nus dans le jardinvéritableîle déserte. Nous nous couchions sur la pelousenousgoûtions sous une tonnelle d'aristolochede chèvrefeuillede vigne vierge. Bouche à bouchenous nous disputions lesprunes que je ramassaistoutes blesséestièdes desoleil. Mon père n'avait pu obtenir que je m'occupasse de monjardincomme mes frèresmais je soignais celui de Marthe. Jeratissaisj'arrachais les mauvaises herbes. Au soir d'une journéechaudeje ressentais le même orgueil d'hommesi enivrantàétancher la soif de la terredes fleurs suppliantesqu'àsatisfaire le désir d'une femme. J'avais toujours trouvéla bonté un peu niaise : je comprenais toute sa force.Les fleurs s'épanouissant grâce à mes soinslespoules dormant à l'ombre après que je leur avais jetédes graines : que de bonté ? -- Que d'égoïsme !Des fleurs mortesdes poules maigres eussent mis de la tristessedans notre île d'amour. Eau et graines venant de mois'adressaient plus à moi qu'aux fleurs et qu'aux poules.
Dans cerenouveau du coeurj'oubliais ou je méprisais mes récentesdécouvertes. Je prenais le libertinage provoqué par lecontact avec cette maison de famille pour la fin du libertinage.Aussicette dernière semaine d'août et ce mois deseptembre furent-ils ma seule époque de vrai bonheur. Je netrichaisni ne me blessaisni ne blessais Marthe. Je ne voyais plusd'obstacles. J'envisageais à seize ans un genre de vie qu'onsouhaite à l'âge mûr. Nous vivrions à lacampagne ; nous y resterions éternellement jeunes.
Étenducontre elle sur la pelousecaressant sa figure avec un brin d'herbej'expliquais lentementposémentà Marthequelleserait notre vie. Marthedepuis son retourcherchait un appartementpour nous à Paris. Ses yeux se mouillèrentquand jelui déclarai que je désirais vivre à lacampagne : « Je n'aurais jamais osé tel'offrirme dit- elle. Je croyais que tu t'ennuieraisseul avecmoique tu avais besoin de la ville. -- Comme tu me connais mal »répondais-je. J'aurais voulu habiter près de Mandresoù nous étions allés nous promener un jouretoù on cultive les roses. Depuisquand par hasardayant dînéà Paris avec Marthenous reprenions le dernier trainj'avaisrespiré ces roses. Dans la cour de la gareles manoeuvresdéchargeaient d'immenses caisses qui embaument. J'avaistoutemon enfanceentendu parler de ce mystérieux train des rosesqui passe à une heure où les enfants dorment.
Marthedisait : « Les roses n'ont qu'une saison. Aprèsne crains-tu pas de trouver Mandres laide ? N'est-il pas sage dechoisir un lieu moins beaumais d'un charme plus égal ? »
Je mereconnaissais bien là. L'envie de jouir pendant deux mois desroses me faisait oublier les dix autres moiset le fait de choisirMandres m'apportait encore une preuve de la nature éphémèrede notre amour.
Souventne dînant pas à F... sous prétexte de promenadesou d'invitationsje restais avec Marthe.
Unaprès-midije trouvai près d'elle un jeune homme enuniforme d'aviateur. C'était son cousin. Martheque je netutoyais passe leva et vint m'embrasser dans le cou. Son cousinsourit de ma gêne. « Devant Paulrien àcraindremon chéridit-elle. Je lui ai tout raconté. »J'étais gênémais enchanté que Marthe eûtavoué à son cousin qu'elle m'aimait. Ce garçoncharmant et superficielet qui ne songeait qu'à ce que sonuniforme ne fût pas réglementaireparut ravi de cetamour. Il y voyait une bonne farce faite à Jacques qu'ilméprisait pour n'être ni aviateur ni habitué desbars.
Paulévoquait toutes les parties d'enfance dont ce jardin avait étéle théâtre. Je questionnaisavide de cette conversationqui me montrait Marthe sous un jour inattendu. En même tempsje ressentais de la tristesse. Car j'étais trop près del'enfance pour en oublier les jeux inconnus des parentssoit que lesgrandes personnes ne gardent aucune mémoire de ces jeuxsoitqu'elles les envisagent comme un mal inévitable. J'étaisjaloux du passé de Marthe.
Comme nousracontions à Paulen riantla haine du propriétaireet le raout des Marinil nous proposamis en vervesa garçonnièrede Paris.
Jeremarquai que Marthe n'osa pas lui avouer que nous avions projet devivre ensemble. On sentait qu'il encourageait notre amouren tantque divertissementmais qu'il hurlerait avec les loups le jour d'unscandale.
Marthe selevait de table et servait. Les domestiques avaient suiviMme Grangier à la campagnecartoujours par prudenceMarthe prétendait n'aimer vivre que comme Robinson. Sesparentscroyant leur fille romanesqueet que les romanesques sontpareils aux fous qu'il ne faut pas contredirela laissaient seule.
Nousrestâmes longtemps à table. Paul montait les meilleursbouteilles. Nous étions gaisd'une gaieté que nousregretterions sans doutecar Paul agissait en confident d'unadultère quelconque. Il raillait Jacques. En me taisantjerisquais de lui faire sentir son manque de tact ; je préféraime prendre au jeu plutôt qu'à humilier ce cousin facile.
Lorsquenous regardâmes l'heurele dernier train pour Paris étaitpassé. Marthe proposa un lit. Paul accepta. Je regardai Marthed'un tel oeilqu'elle ajouta : « Bien entendumonchéritu restes. » J'eus l'illusion d'êtrechez moiépoux de Martheet de recevoir un cousin de mafemmelorsquesur le seuil de notre chambrePaul nous dit bonsoirembrassant sa cousine sur les joues le plus naturellement du monde.
A la finde septembreje sentis bien que quitter cette maison c'étaitquitter le bonheur. Encore quelques mois de grâceet il nousfaudrait choisirvivre dans le mensonge ou dans la véritépas plus à l'aise ici que là. Comme il importait queMarthe ne fût pas abandonnée de ses parentsavant lanaissance de notre enfantj'osai enfin m'enquérir si elleavait prévenu Mme Grangier de sa grossesse. Elle me ditque ouiet qu'elle avait prévenu Jacques. J'eus donc uneoccasion de constater qu'elle me mentait parfoiscarau mois demaiaprès le séjour de Jacqueselle m'avait juréqu'il ne l'avait pas approchée.
La nuitdescendait de plus en plus tôt ; et la fraîcheur dessoirs empêchait nos promenades. Il nous était difficilede nous voir à J... Pour qu'un scandale n'éclatâtpasil nous fallait prendre des précautions de voleursguetter dans la rue l'absence des Marin et du propriétaire.
Latristesse de ce mois d'octobrede ces soirées fraîchesmais pas assez froides pour permettre du feunous conseillait le litdès cinq heures. Chez mes parentsse coucher le joursignifiait : être maladece lit de cinq heures mecharmait. Je n'imaginais pas que d'autres y fussent. J'étaisseul avec Marthecouchéarrêtéau milieu d'unmonde actif. Marthe nuej'osais à peine la regarder. Suis-jedonc monstrueux ? Je ressentais des remords du plus noble emploide l'homme. D'avoir abîmé la grâce de Marthedevoir son ventre saillirje me considérais comme un vandale.Au début de notre amourquand je la mordaisne medisait-elle pas : « Marque-moi » ? Nel'avais-je pas marquée de la pire façon ?
MaintenantMarthe ne m'était pas seulement la plus aiméece quine veut pas dire la mieux aimée des maîtressesmaiselle me tenait lieu de tout. Je ne pensais même pas àmes amis ; je les redoutaisau contrairesachant qu'ilscroient nous rendre service en nous détournant de notre route.Heureusementils jugent nos maîtresses insupportables etindignes de nous. C'est notre seule sauvegarde. Lorsqu'il n'en vaplus ainsielles risquent de devenir les leurs.
Mon pèrecommençait à s'effrayer. Mais ayant toujours pris madéfense contre sa soeur et ma mèreil ne voulait pasavoir l'air de se rétracteret c'est sans rien leur en direqu'il se ralliait à elles. Avec moiil se déclaraitprêt à tout pour me séparer de Marthe. Ilpréviendrait ses parentsson mari... Le lendemainil melaissait libre.
Jedevinais ses faiblesses. J'en profitais. J'osais répondre. Jel'accablais dans le même sens que ma mère et ma tantelui reprochant de mettre trop tard en oeuvre son autorité.N'avait-il pas voulu que je connusse Marthe ? Il s'accablait àson tour. Une atmosphère tragique circulait dans la maison.Quel exemple pour mes deux frères ! Mon pèreprévoyait déjà de ne rien pouvoir leur répondreun jourlorsqu'ils justifieraient leur indiscipline par la mienne.
Jusqu'alorsil croyait à une amourettemaisde nouveauma mèresurprit une correspondance. Elle lui porte triomphalement ces piècesde son procès. Marthe parlait de notre avenir et de notreenfant !
Ma mèreme considérait trop encore comme un bébépourme devoir raisonnablement un petit-fils ou une petite-fille. Il luiapparaissait impossible d'être grand-mère à sonâge. Au fondc'était pour elle la meilleure preuve quecet enfant n'était pas le mien.
L'honnêtetépeut rejoindre les sentiments les plus vifs. Ma mèreavec saprofonde honnêteténe pouvait admettre qu'une femmetrompât son mari. Cet acte lui représentait un teldévergondage qu'il ne pouvait s'agir d'amour. Que je fussel'amant de Marthe signifiait pour ma mère qu'elle en avaitd'autres. Mon père savait combien faux peut être un telraisonnementmais l'utilisait pour jeter un trouble dans mon âmeet diminuer Marthe. Il me laissa entendre que j'étais le seulà ne pas « savoir ». Je répliquaiqu'on la calomniait de la sorte à cause de son amour pour moi.Mon pèrequi ne voulait pas que je bénéficiassede ces bruitsme certifia qu'ils précédaient notreliaisonet même son mariage.
Aprèsavoir conservé à notre maison une façade digneil perdait toute retenueetquand je n'étais pas rentrédepuis plusieurs joursenvoyait la femme de chambre chez Martheavec un mot à mon adressem'ordonnant de rentrer d'urgence ;sinon il déclarerait ma fuite à la préfecture depolice et poursuivrait Mme L. pour détournement demineur.
Marthesauvegardait les apparencesprenait un air surprisdisait àla femme de chambre qu'elle me remettrait l'enveloppe à mapremière visite. Je rentrais un peu plus tardmaudissant monâge. Il m'empêchait de m'appartenir. Mon pèren'ouvrait pas la boucleni ma mère. Je fouillais le code sanstrouver les articles de loi concernant les mineurs. Avec uneremarquable inconscienceje ne croyais pas que ma conduite me pûtmener en maison de correction. Enfinaprès avoir épuisévainement le codej'en revins au grand Larousseoù je relusdix fois l'article « mineur »sans découvrirrien qui nous concernât.
Lelendemainmon père me laissait libre encore.
Pour ceuxqui rechercheraient les mobiles de son étrange conduitejeles résume en trois lignes : il me laissait agir àma guise. Puisil en avait honte. Il menaçaitplus furieuxcontre lui que contre moi. Ensuitela honte de s'être mis encolère le poussait à lâcher les brides.
Mme Grangierelleavait été mise en éveilà sonretour de la campagnepar les insidieuses questions des voisins.Feignant de croire que j'étais un frère de Jacquesilslui apprenaient notre vie commune. Commed'autre partMarthe nepouvait se retenir de prononcer mon nom à propos de riendesupporter quelque chose que j'avais fait ou ditsa mère neresta pas longtemps dans le doute sur la personnalité du frèrede Jacques.
Ellepardonnait encorecertaine que l'enfantqu'elle croyait de Jacquesmettrait un terme à l'aventure. Elle ne raconta rien àM. Grangierpar crainte d'un éclat. Mais elle mettaitcette discrétion sur le compte d'une grandeur d'âme dontil importait d'avertir Marthe pour qu'elle lui en sût gré.Afin de prouver à sa fille qu'elle savait toutelle laharcelait sans cesseparlait par sous-entenduset si maladroitementque M. Grangierseul avec sa femme la priait de ménagerleur pauvre petiteinnocenteà qui ces continuellessuppositions finiraient par tourner la tête. A quoiMme Grangier répondait quelquefois par un simple sourirede façon à lui laisser entendre que leur fille avaitavoué.
Cetteattitudeet son attitude précédentelors du premierséjour de Jacquesm'incitent à croire queMme Grangiereût-elle désapprouvécomplètement sa fillepour l'unique satisfaction de donnertort à son mari et à son gendrelui auraitdevanteuxdonné raison. Au fondMme Grangier admirait Marthede tromper son marice qu'elle-même n'avait jamais oséfairesoit par scrupulessoit par manque d'occasion. Sa fille lavengeait d'avoir étécroyait-elleincomprise.Niaisement idéalisteelle se bornait à lui en vouloird'aimer un garçon aussi jeune que moiet moins apte quen'importe qui à comprendre la « délicatesseféminine ».
LesLacombeque Marthe visitait de moins en moinsne pouvaienthabitant Parisrien soupçonner. SimplementMartheleurapparaissant toujours plus bizarreleur déplaisait de plus enplus. Ils étaient inquiets de l'avenir. Ils se demandaient ceque serait ce ménage dans quelques années. Toutes lesmèrespar principesne souhaitent rien tant pour leur filsque le mariagemais désapprouvent la femme qu'ilschoisissent. La mère de Jacques le plaignait donc d'avoir unetelle femme. Quand à Mlle Lacombela principale raisonde ses médisances venait de ce que Marthedétenaitseulele secret d'une idylle poussée assez loinl'étéoù elle avait connu Jacques au bord de la mer. Cette soeurprédisait le plus sombre avenir au ménagedisait queMarthe tromperait Jacquessi par hasard ce n'était déjàchose faite.
L'acharnementde son épouse et de sa fille forçait parfois àsortir de table M. Lacombebrave hommequi aimait Marthe.Alorsmère et fille échangeaient un regardsignificatif. Celui de Mme Lacombe exprimait : « Tuvoisma petitecomment ces sortes de femmes savent ensorceler noshommes. » Celui de Mlle Lacombe : « C'estparce que je ne suis pas une Marthe que je ne trouve pas à memarier. » En réalitéla malheureusesousprétexte qu'« autre temps autres moeurs »et que le mariage ne se concluait plus à l'ancienne modefaisait fuir les maris en ne se montrant pas assez rebelle. Sesespoirs de mariage duraient ce que dure une saison balnéaire.Les jeunes gens promettaient de venirsitôt à Parisdemander la main de Mlle Lacombe. Ils ne donnaient plus signe devie. Le principal grief de Mlle Lacombequi allait coifferSainte-Catherineétait peut-être que Marthe eûttrouvé si facilement un mari. Elle se consolait en se disantque seul un nigaud comme son frère avait pu se laisserprendre.
Pourtantquels que fussent les soupçons des famillespersonne nepensait que l'enfant de Marthe pût avoir un autre pèreque Jacques. J'en étais assez vexé. Il fut mêmedes jours où j'accusais Marthe d'être lâchepourn'avoir pas encore dit la vérité. Enclin à voirpartout une faiblesse qui n'était qu'à moije pensaispuisque Mme Grangier glissait sur le commencement du dramequ'elle fermerait les yeux jusqu'au bout.
L'orageapprochait. Mon père menaçait d'envoyer certaineslettres à Mme Grangier. Je souhaitais qu'il exécutâtses menaces. Puisje réfléchissais. Mme Grangiercacherait les lettres à son mari. Du restel'un et l'autreavaient intérêt à ce qu'un orage n'éclatâtpoint. Et j'étouffais. J'appelais cet orage. Ces lettresc'est à Jacquesdirectement qu'il fallait que mon pèreles communiquât.
Le jour decolère où il me dit que c'était chose faitejelui eusse sauté au cou. Enfin ! Enfinil me rendait leservice d'apprendre à Jacques ce qui importait qu'il sût.Je plaignais mon père de croire mon amour si faible. Et puisces lettres mettraient un terme à celles où Jacquess'attendrissait sur notre enfant. Ma fièvre m'empêchaitde comprendre ce que cet acte avait de foud'impossible. Jecommençai seulement à voir juste lorsque mon pèreplus calmele lendemainme rassuracroyait-ilm'avouant sonmensonge. Il l'estimait inhumain. Certes. Mais où se trouvel'humain et l'inhumain ?
J'épuisaisma force nerveuse en lâchetéen audaceéreintépar les mille contradictions de mon âge aux prises avec uneaventure d'homme.
L'amouranesthésiait en moi tout ce qui n'était pas Marthe. Jene pensais pas que mon père pût souffrir. Je jugeais detout si faussement et si petitement que je finissais par croire laguerre déclarée entre lui et moi. Aussin'était-ceplus seulement par amour pour Marthe que je piétinais mesdevoirs filiauxmais parfoisoserai-je l'avouerpar esprit dereprésailles !
Jen'accordais plus beaucoup d'attention aux lettres que mon pèrefaisait porter chez Marthe. C'est elle qui me suppliait de rentrerplus souvent à la maisonde me montrer raisonnable. Alorsjem'écriais : « Vas-tutoi aussiprendre particontre moi ? » Je serrais les dentstapais du pied.Que je me misse dans un état pareilà la penséeque j'allais être éloigné d'elle pour quelquesheuresMarthe y voyait le signe de la passion. Cette certituded'être aimée lui donnait une fermeté que je nelui avais jamais vue. Sûre que je penserais à elleelleinsistait pour que je rentrasse.
Jem'aperçus vite d'où venait son courage. Je commençaià changer de tactique. Je feignais de me rendre à sesraisons. Alorstout à coupelle avait une autre figure. A mevoir si sage (ou si léger)la peur la prenait que jel'aimasse moins. A son tourelle me suppliait de restertant elleavait besoin d'être rassurée.
Pourtantune foisrien ne réussit. Depuis déjà troisjoursje n'avais mis les pieds chez mes parentset j'affirmai àMarthe mon intention de passer encore une nuit avec elle. Elle essayatout pour me détourner de cette décision :caressesmenaces. Elle sut même feindre à son tour.Elle finit par déclarer quesi je ne rentrais pas chez mesparentselle coucherait chez les siens.
Jerépondis que mon père ne lui tiendrait aucun compte dece beau geste. Eh bien ! elle n'irait pas chez sa mère.Elle irait au bord de la Marne. Elle prendrait froidpuis mourrait ;elle serait enfin délivrée de moi : « Aieau moins pitié de notre enfantdisait Marthe. Ne comprometspas son existence à plaisir. » Elle m'accusait dem'amuser de son amourd'en vouloir connaître les limites. Enface d'une telle insistanceje lui répétais les proposde mon père : elle me trompait avec n'importe qui ;je ne serais pas dupe. « Une seule raisonlui dis-jet'empêche de céder. Tu reçois ce soir un de tesamants. » Que répondre à d'aussi follesinjustices ? Elle se détourna. Je lui reprochais de nepoint bondir dans l'outrage. Enfinje travaillais si bien qu'elleconsentit à passer la nuit avec moi. A condition que ce ne fûtpas chez elle. Elle ne voulait pour rien au monde que sespropriétaires pussent dire le lendemain au messager de mesparents qu'elle était là.
Oùdormir ?
Nousétions des enfants debout sur une chaisefiers de dépasserd'une tête les grandes personnes. Les circonstances noushissaientmais nous restions incapables. Et sidu fait mêmede notre inexpériencecertaines choses compliquéesnous paraissaient toutes simplesdes choses très simplesparcontredevenaient des obstacles. Nous n'avions jamais osénous servir de la garçonnière de Paul. Je ne pensaispas qu'il fût possible d'expliquer à la conciergeenlui glissant une pièceque nous viendrons quelquefois.
Il nousfallait donc coucher à l'hôtel. Je n'y étaisjamais allé. Je tremblais à la perspective d'enfranchir le seuil.
L'enfancecherche des prétextes. Toujours appelée à sejustifier devant les parentsil est fatal qu'elle mente.
Vis-à-vismême d'un garçon d'hôtel borgneje pensais devoirme justifier. C'est pourquoiprétextant qu'il nous faudraitdu linge et quelques objets de toiletteje forçais Marthe àfaire une valise. Nous demanderions deux chambres. On nous croiraitfrère et soeur. Jamais je n'oserais demander une seulechambremon âge (l'âge où l'on se fait expulserdes casinos) m'exposant à des mortifications.
Le voyageà onze heures du soirfut interminable. Il y avait deuxpersonnes dans notre wagon : une femme reconduisait son maricapitaineà la gare de l'Est. Le wagon n'était nichaufféni éclairé. Marthe appuyait sa têtecontre la vitre humide. Elle subissait le caprice d'un jeune garçoncruel. J'étais assez honteuxet je souffraispensant combienJacquestoujours si tendre avec elleméritait mieux que moid'être aimé.
Je ne pusm'empêcher de me justifierà voix basse. Elle secoua latête : « J'aime mieuxmurmura-t-elleêtremalheureuse avec toi qu'heureuse avec lui. » Voilàde ces mots d'amour qui ne veulent rien direet que l'on a honte derapportermais quiprononcés par la bouche aiméevous enivrent. Je crus même comprendre la phrase de Marthe.Pourtant que signifiait-elle au juste ? Peut-on êtreheureux avec quelqu'un que l'on aime pas ?
Et jedemandaisje me demande encore si l'amour vous donne le droitd'arracher une femme à une destinéepeut-êtremédiocremais pleine de quiétude. « J'aimemieux être malheureuse avec toi. » ; ces motscontenaient-ils un reproche inconscient ? Sans douteMartheparce qu'elle m'aimaitconnut-elle avec moi ces heures dontavecJacqueselle n'avait pas idéemais ces moments heureux medonnaient-ils le droit d'être cruel ?
Nousdescendîmes à la Bastille. Le froidque je supporteparce que je l'imagine la chose la plus propre du mondeétaitdans ce hall de la gareplus sale que la chaleur dans un port demeret sans la gaieté qui compense. Marthe se plaignait decrampes. Elle s'accrochait à mon bras. Couple lamentableoubliant sa beautésa jeunessehonteux de soi comme uncouple de mendiants !
Je croyaisla grossesse de Marthe ridiculeet je marchais les yeux baissés.J'étais bien loin de l'orgueil paternel.
Nouserrions sous la pluie glacialeentre la Bastille et la gare de Lyon.A chaque hôtelpour ne pas entrerj'inventais une mauvaiseexcuse. Je disais à Marthe que je cherchais un hôtelconvenableun hôtel de voyageursrien que des voyageurs.
Place dela gare de Lyonil devint difficile de me dérober. Marthem'enjoignit d'interrompre ce supplice.
Tandisqu'elle attendait dehorsj'entrai dans un vestibuleespérantje ne sais trop quoi. Le garçon me demanda si je désiraisune chambre. Il était facile de répondre oui. Ce futtrop facileetcherchant une excuse comme un rat d'hôtel prissur le faitje lui demandais Mme Lacombe. Je la lui demandaisrougissantet craignant qu'il me répondît : « Vousmoquez-vousjeune homme ? Elle est dans la rue. » Ilconsulta les registres. Je devais me tromper d'adresse. Je sortisexpliquant à Marthe qu'il n'y avait plus de place et que nousn'en trouverions pas dans le quartier. Je respirai. Je me hâtaicomme un voleur qui s'échappe.
Tout àl'heuremon idée fixe de fuir ces hôtels où jemenais Marthe de force m'empêchait de penser à elle.Maintenantje la regardaisla pauvre petite. Je retins mes larmeset quand elle me demanda où nous chercherions un litje lasuppliai de ne pas en vouloir à un maladeet de retournersagement elle à J.moi chez mes parents. Malade et sagement !elle fit un sourire machinal en entendant ces mots déplacés.
Ma hontedramatisa le retour. Quandaprès les cruautés de cegenreMarthe avait le malheur de me dire : « Tout demêmecomme tu as été méchant »je m'emportaisla trouvais sans générosité. Siau contraireelle se taisaitavait l'air d'oublierla peur meprenait qu'elle agît ainsiparce qu'elle me considéraitcomme un maladeun dément. Alorsje n'avais de cesse que jene lui eusse fait dire qu'elle n'oubliait pointet quesi elle mepardonnaitil ne fallait pas cependant que je profitasse de saclémence ; qu'un jourlasse de mes mauvais traitementssa fatigue l'emporterait sur notre amouret qu'elle me laisseraitseul. Quand je la forçais à me parler avec cetteénergieet bien que je ne crusse pas à ses menaces ;j'éprouvais une douleur délicieusecomparableen plusfortà l'émoi que me donnent les montagnes russes.Alorsje me précipitais sur Marthel'embrassais pluspassionnément que jamais.
--Répète-moi que tu me quitteraslui disais-jehaletantet la serrant dans mes brasjusqu'à la casser.Soumisecomme ne peut même pas l'être une esclavemaisseul un médiumelle répétaitpour me plairedes phrases auxquelles elle ne comprenait rien.
Cette nuitdes hôtels fut décisivece dont je me rendis mal compteaprès tant d'autres extravagances. Mais si je croyais quetoute une vie peut boiter de la sorteMartheelledans le coin duwagon de retourépuiséeatterréeclaquant desdentscomprit tout. Peut-être même vit-elle qu'au boutde cette course d'une annéedans une voiture follementconduiteil ne pouvait y avoir d'autre issue que la mort.
Lelendemainje trouvais Marthe au litcomme d'habitude. Je voulus l'yrejoindre ; elle me repoussatendrement. « Je ne mesens pas très biendisait-elleva-t'enne reste pas prèsde moi. Tu prendrais mon rhume. » Elle toussaitavait lafièvre. Elle me diten souriantpour n'avoir pas l'air deformuler un reprocheque c'était la veille qu'elle avait dûprendre froid. Malgré son affolementelle m'empêchad'aller chercher le docteur. « Ce n'est riendisait-elle.Je n'ai besoin que de rester au chaud. » En réalitéelle ne voulait pasen m'envoyantmoichez le docteursecompromettre aux yeux de ce vieil ami de sa famille. J'avais un telbesoin d'être rassuré que le refus de Marthe m'ôtames inquiétudes. Elles ressuscitèrentet plus fortesque tout à l'heurequandlorsque je partis pour dînerchez mes parentsMarthe me demanda si je pouvais faire un détouret déposer une lettre chez le docteur.
Lelendemainen arrivant à la maison de Martheje croisaicelui-ci dans l'escalier. Je n'osai pas l'interrogeret le regardaianxieusement. Son air calme me fit du bien : ce n'étaitqu'une attitude professionnelle.
J'entraichez Marthe. Où était-elle ? La chambre étaitvide. Marthe pleuraitla tête cachée sous lescouvertures. Le médecin la condamnait à garder lachambrejusqu'à la délivrance. De plusson étatexigeait des soins ; il fallait qu'elle demeurât chez sesparents. On nous séparait.
Le malheurne s'admet point. Seulle bonheur semble dû. En admettantcette séparation sans révolteje ne montrais pas decourage. Simplementje ne comprenais point. J'écoutaisstupidel'arrêt du médecincomme un condamné sasentence. S'il ne pâlit point : « Quelcourage ! » dit-on. Pas du tout : c'est plutôtmanque d'imagination. Lorsqu'on le réveille pour l'exécutionalorsil entend la sentence. De mêmeje ne compris que nousn'allions plus nous voirque lorsqu'on vint annoncer à Marthela voiture envoyée par le docteur. Il avait promis den'avertir personneMarthe exigeant d'arriver chez sa mère àl'improviste.
Je fisarrêter à quelque distance de la maison des Grangier. Latroisième fois que le cocher se retournanous descendîmes.Cet homme croyait surprendre notre troisième baiserilsurprenait le même. Je quittais Marthe sans prendre lesmoindres dispositions pour correspondrepresque sans lui dire aurevoircomme une personne qu'on doit rejoindre une heure après.Déjàdes voisines curieuses se montraient auxfenêtres.
Ma mèreremarqua que j'avais les yeux rouges. Mes soeurs rirent parce que jelaissais deux fois de suite retomber ma cuillère àsoupe. Le plancher chavirait. Je n'avais pas le pied marin pour lasouffrance. Du resteje ne crois pouvoir comparer mieux qu'au mal demer ces vertiges du coeur et de l'âme. La vie sans Marthec'était une longue traversée. Arriverais-je ?Commeaux premiers symptômes du mal de meron se moqued'atteindre le port et on souhaite mourir sur placeje mepréoccupais peu d'avenir. Au bout de quelques joursle malmoins tenaceme laissa le temps de penser à la terre ferme.
Lesparents de Marthe n'avaient plus à deviner grand-chose. Ils nese contentaient pas d'escamoter les lettres. Ils les brûlaientdevant elledans la cheminée de sa chambre. Les siennesétaient écrites au crayonà peine lisibles. Sonfrère les mettait à la poste.
Je n'avaisplus à essuyer de scènes de famille. Je reprenais lesbonnes conversations avec mon pèrele soirdevant le feu. Enun anj'étais devenu un étranger pour mes soeurs.Elles se réapprivoisaientse réhabituaient àmoi. Je prenais la plus petite sur mes genouxetprofitant de lapénombrela serrais avec une telle violencequ'elle sedébattaitmi-riantemi-pleurante. Je pensais à monenfantmais j'étais triste. Il me semblait impossible d'avoirpour lui une tendresse plus forte. Étais-je mûr pourqu'un bébé me fût autre chose que frère ousoeur ?
Mon pèreme conseillait des distractions. Ces conseils-là sontengendrés par le calme. Qu'avais-je à fairesauf ceque je ne ferais plus ? Au bruit de la sonnetteau passaged'une voitureje tressaillais. Je guettais dans ma prison lesmoindres signes de délivrance.
A force deguetter des bruits qui pouvaient annoncer quelque chosemesoreillesun jourentendirent des cloches. C'étaient cellesde l'armistice.
Pour moil'armistice signifiait le retour de Jacques. Déjàjele voyais au chevet de Marthesans qu'il me fût possibled'agir. J'étais perdu.
Mon pèrerevint à Paris. Il voulait que j'y retournasse avec lui :« On ne manque pas une fête pareille. »Je n'osais refuser. Je craignais de paraître un monstre. Puissomme toutedans ma frénésie de malheuril ne medéplaisait pas d'aller voir la joie des autres.
Avouerai-jequ'elle ne m'inspira pas grande envie. Je me sentais seul capabled'éprouver les sentiments qu'on prête à la foule.Je cherchais le patriotisme. Mon injusticepeut- êtrene memontrait que l'allégresse d'un congé inattendu :les cafés ouverts plus tardle droit pour les militairesd'embrasser les midinettes. Ce spectacledont j'avais penséqu'il m'affligeraitqu'il me rendrait jalouxou même qu'il medistrairait par la contagion d'un sentiment sublimem'ennuya commeune Sainte-Catherine.
Depuisquelques joursaucune lettre ne me parvenait. Un des raresaprès-midi où il tomba de la neigemes frèresme remirent un message du petit Grangier. C'était une lettreglaciale de Mme Grangier. Elle me priait de venir au plus vite.Que pouvait-elle me vouloir ? La chance d'être en contactmême indirectavec Martheétouffa mes inquiétudes.J'imaginais Mme Grangier m'interdisant de revoir sa filledecorrespondre avec elleet moil'écoutanttête bassecomme un mauvais élève. Incapable d'éclaterdeme mettre en colèreaucun geste ne manifesterait ma haine. Jesaluerais avec politesseet la porte se refermerait pour toujours.Alorsje trouverais les réponsesles arguments de mauvaisefoiles mots cinglants qui eussent pu laisser à Mme Grangierde l'amant de sa fille une image moins piteuse que celle d'uncollégien pris en faute. Je prévoyais la scèneseconde par seconde.
Lorsque jepénétrai dans le petit salonil me sembla revivre mapremière visite. Cette visite signifiait alors que je nereverrais peut-être plus Marthe.
Mme Grangierentra. Je souffris pour elle de sa petite taillecar elles'efforçait d'être hautaine. Elle s'excusa de m'avoirdérangé pour rien. Elle prétendit qu'ellem'avait envoyé ce message pour obtenir un renseignement tropcompliqué à demander par écritmais qu'entretempselle avait eu ce renseignement. Cet absurde mystère metourmenta plus que n'importe quelle catastrophe. Près de laMarneje rencontrai le petit Grangierappuyé contre unegrille. Il avait reçu une boule de neige en pleine figure. Ilpleurnichait. Je le cajolaije l'interrogeai sur Marthe. Sa soeurm'appelaitme dit-il. Leur mère ne voulait rien entendremais leur père avait dit : « Marthe est auplus malj'exige qu'on obéisse. »
Je comprisen une seconde la conduite si bourgeoisesi étrangedeMme Grangier. Elle m'avait appelépar respect pour sonépouxet la volonté d'une mourante. Mais l'alertepasséeMarthe saine et sauveon reprenait la consigneJ'eusse dû me réjouir. Je regrettais que la crise n'eutpas duré le temps de me laisser voir la malade.
Deux joursaprèsMarthe m'écrivit. Elle ne faisait aucuneallusion à ma visite. Sans doute la lui avait-on escamotée.Marthe parlait de notre avenirsur un ton spécialsereincélestequi me troublait un peu. Serait-il vrai que l'amourest la forme la plus violente de l'égoïsmecarcherchant une raison à mon troubleje me dis que j'étaisjaloux de notre enfantdont Marthe aujourd'hui m'entretenait plusque de moi-même.
Nousl'attendions pour mars. Un vendredi de janviermes frèrestout essoufflésnous annoncèrent que le petit Grangieravait un neveu. Je ne compris pas leur air de triompheni pourquoiils avaient tant couru. Ils ne se doutaient certes pas de ce que lanouvelle pouvait avoir d'extraordinaire à mes yeux. Mais unoncle était pour mes frères une personne d'âge.Que le petit Grangier fût oncle tenait donc du prodigeet ilsétaient accourus pour nous faire partager leur émerveillement.
C'estl'objet que nous avons constamment sous les yeux que nousreconnaissons avec le plus de difficultési on le change unpeu de place. Dans le neveu du petit Grangierje ne reconnus pastout de suite l'enfant de Marthe‹ mon enfant.
L'affolementque dans un lieu public produit un court-circuitj'en fus lethéâtre. Tout à coupil faisait noir en moi Danscette nuitmes sentiments se bousculaient ; je me cherchaisjecherchais à tâtons des datesdes précisions. Jecomptais sur mes doigts comme je l'avais vu faire quelquefois àMarthesans alors la soupçonner de trahison. Cet exercice neservait d'ailleurs à rien. Je ne savais plus compter.Qu'était-ce que cet enfant que nous attendions pour marsetqui naissait en janvier ? Toutes les explications que jecherchais à cette anormalitéc'est ma jalousie qui lesfournissait. Tout de suitema certitude fut faite. Cet enfant étaitcelui de Jacques. N'était-il pas venu en permission neuf moisauparavant. Ainsidepuis ce tempsMarthe me mentait. D'ailleursnem'avait-elle pas déjà menti au sujet de cettepermission ! Ne m'avait-elle pas d'abord juré s'êtrependant ces quinze jours maudits refusée à Jacquespour m'avouerlongtemps aprèsqu'il l'avait plusieurs foispossédée !
Je n'avaisjamais pensé bien profondément que cet enfant pûtêtre celui de Jacques. Et siau début de la grossessede Marthej'avais pu souhaiter lâchement qu'il en fûtainsiil me fallait bien avoueraujourd'huique je croyais êtreen face de l'irréparablequebercé pendant des moispar la certitude de ma paternitéj'aimais cet enfantcetenfant qui n'était pas le mien. Pourquoi fallait-il que je neme sentisse le coeur d'un pèrequ'au moment oùj'apprenais que je ne l'étais pas !
On levoitje me trouvais dans un désordre incroyableet commejeté à l'eauen pleine nuitsans savoir nager. Je necomprenais plus rien. Une chose surtout que je ne comprenais pasc'était l'audace de Marthed'avoir donné mon nom àce fils légitime. A certains momentsj'y voyais un défijeté au sort qui n'avait pas voulu que cet enfant fût lemienà d'autres momentsje n'y voulais plus voir qu'unmanque de tactune de ces fautes de goût qui m'avaientplusieurs fois choqué chez Martheet qui n'étaient queson excès d'amour.
J'avaiscommencé une lettre d'injures Je croyais la lui devoirpardignité ! Mais les mots ne venaient pascar mon espritétait ailleursdans des régions plus nobles.
Jedéchirai la lettre. J'en écrivis une autreoùje laissai parler mon coeur. Je demandais pardon à MarthePardon de quoi ? Sans doute que ce fils fût celui deJacques. Je la suppliais de m'aimer quand même.
L'hommetrès jeune est un animal rebelle à la douleur. Déjàj'arrangeais autrement ma chance. J'acceptais presque cet enfant del'autre. Mais avant même que j'eusse fini ma lettrej'en reçusune de Marthedébordante de joie. -- Ce fils était lenôtrené deux mois avant terme. Il fallait le mettre encouveuse. « J'ai failli mourir »disait-elle.Cette phrase m'amusa comme un enfantillage.
Car jen'avais place que pour la joie. J'eusse voulu faire part de cettenaissance au monde entierdire à mes frères qu'euxaussi étaient oncles. Avec joieje me méprisais :comment avoir pu douter de Marthe ? Ces remordsmêlésà mon bonheurme la faisaient aimer plus fort que jamaismonfils aussi. Dans mon incohérenceje bénissais laméprise. Somme toutej'étais content d'avoir faitconnaissancepour quelques instantsavec la douleur. Du moinsjele croyais. Mais rien ne ressemble moins aux choses elles-mêmes ;que ce qui en est tout près. Un homme qui a failli mourircroit connaître la mort. Le jour où elle se présenteenfin à luiil ne la reconnaît pas : « Cen'est pas elle »dit-ilen mourant.
Dans salettre Marthe me disait encore « Il te ressemble ».J'avais vu des nouveau-nésmes frères et mes soeurset je savais que seul l'amour d'une femme peut leur découvrirla ressemblance qu'elle souhaite. « Il a mes yeux »ajoutait-elle. Et seul aussi son désir de nous voir réunisen un seul être pouvait lui faire reconnaître ses yeux.
Chez lesGrangieraucun doute ne subsistait plus. Ils maudissaient Marthemais s'en faisaient les complicesafin que le scandale ne« rejaillît » pas sur la famille. Lemédecinautre complice de l'ordrecachant que cettenaissance était prématuréese chargeraitd'expliquer au maripar quelque fablela nécessitéd'une couveuse.
Les jourssuivantsje trouvai naturel le silence de Marthe. Jacques devaitêtre auprès d'elle. Aucune permissionne m'avait si peuatteintque celle-ciaccordée au malheureux pour lanaissance de son fils. Dans un dernier sursaut de puérilitéje souriais même à la pensée que ces jours decongéil me les devait.
Notremaison respirait le calme.
Les vraispressentiments se forment à des profondeurs que notre espritne visite pas. Aussiparfoisnous font-ils accomplir des actes quenous interprétons tout de travers.
Je mecroyais plus tendre à cause de mon bonheur et je me félicitaisde savoir Marthe dans une maison que mes souvenirs heureuxtransformaient en fétiche.
Un hommedésordonné qui va mourir et ne s'en doute pas metsoudain de l'ordre autour de lui. Sa vie change. Il classe sespapiers. Il se lève tôtil se couche de bonne heure. Ilrenonce à ses vices. Son entourage se félicite. Aussisa mort brutale semble-t-elle d'autant plus injuste. Il allaitvivre heureux.
De mêmele calme nouveau de mon existence était ma toilette ducondamné. Je me croyais meilleur fils parce que j'en avais un.Orma tendresse me rapprochait de mon pèrede ma mèreparce que quelque chose en moi savait que j'auraissous peubesoinde la leur.
Un jouràmidimes frères revinrent de l'école nous criant queMarthe était morte.
La foudrequi tombe sur un homme est si prompte qu'il ne souffre pas. Maisc'est pour celui qui l'accompagne un triste spectacle. Tandis que jene ressentais rienle visage de mon père se décomposait.Il poussa mes frères. « Sortezbégaya-t-il.Vous êtes fousvous êtes fous. » Moij'avaisla sensation de durcirde refroidirde me pétrifier.Ensuitecomme une seconde déroule aux yeux d'un mourant tousles souvenirs d'une existencela certitude me dévoila monamour avec tout ce qu'il avait de monstrueux. Parce que mon pèrepleuraitje sanglotais. Alorsma mère me prit en main. Lesyeux secselle me soigna froidementtendrementcomme s'il se fûtagi d'une scarlatine.
Ma syncopeexpliqua le silence de la maisonles premiers joursà mesfrères. Les autres joursils ne comprirent plus. On ne leuravait jamais interdit les jeux bruyants. Ils se taisaient. Maisàmidileurs pas sur les dalles du vestibule me faisaient perdreconnaissance comme s'ils eussent dû chaque fois m'annoncer lamort de Marthe.
Marthe !Ma jalousie la suivant jusque dans la tombeje souhaitais qu'il n'yeût rienaprès la mort. Ainsiest-il insupportable quela personne que nous aimons se trouve en nombreuse compagnie dans unefête où nous ne sommes pas. Mon coeur était àl'âge où l'on ne pense pas encore à l'avenir.Ouic'est bien le néant que je désirais pour Martheplutôt qu'un monde nouveauoù la rejoindre un jour.
La seulefois que j'aperçus Jacquesce fut quelques mois après.Sachant que mon père possédait des aquarelles deMartheil désirait les connaître. Nous sommes toujoursavides de surprendre ce qui touche aux êtres que nous aimons.Je voulus voir l'homme auquel Marthe avait accordé sa main.
Retenantmon souffle et marchant sur la pointe des piedsje me dirigeais versla porte entrouverte. J'arrivais juste pour entendre :
-- Mafemme est morte en l'appelant. Pauvre petit ! N'est-ce pas maseule raison de vivre ?
En voyantce veuf si digne et dominant son désespoirje compris quel'ordreà la longuese met de lui-même autour deschoses. Ne venais-je pas d'apprendre que Marthe était morte enm'appelant et que mon fils aurait une existence raisonnable ?