 home page
home page
 pagina iniziale
pagina iniziale
|

|
by
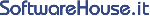
|


|
Ebook in formato Kindle (mobi) - Kindle File Ebook (mobi)
Formato per Iphone, Ipad e Ebook (epub) - Ipad, Iphone and Ebook reader format (epub)
Versione ebook di Readme.it powered by Softwarehouse.itGuy de MaupassantBoule de suif
Pendantplusieurs jours de suite des lambeaux d'armée en dérouteavaient traversé la ville. Ce n'était point de latroupemais des hordes débandées. Les hommes avaientla barbe longue et saledes uniformes en guenilleset ilsavançaient d'une allure mollesans drapeausans régiment.Tous semblaient accabléséreintésincapablesd'une pensée ou d'une résolutionmarchant seulementpar habitudeet tombant de fatigue sitôt qu'ils s'arrêtaient.On voyait surtout des mobilisésgens pacifiquesrentierstranquillespliant sous le poids du fusil ; des petits moblotsalertesfaciles à l'épouvante et prompts àl'enthousiasmeprêts à l'attaque comme à lafuite ; puisau milieu d'euxquelques culottes rougesdébrisd'une division moulue dans une grande bataille ; des artilleurssombres alignés avec ces fantassins divers ; etparfoislecasque brillant d'un dragon au pied pesant qui suivait avec peine lamarche plus légère des lignards.
Deslégions de francs-tireurs aux appellations héroïques: "les Vengeurs de la défaite -- les Citoyens de la tombe-- les Partageurs de la mort" -- passaient à leur touravec des airs de bandits.
Leurschefsanciens commerçants en drap ou en grainesex-marchandsde suif ou de savonguerriers de circonstancenommésofficiers pour leurs écus ou la longueur de leurs moustachescouverts d'armesde flanelle et de galonsparlaient d'une voixretentissantediscutaient plans de campagneet prétendaientsoutenir seuls la France agonisante sur leurs épaules defanfarons ; mais ils redoutaient parfois leurs propres soldatsgensde sac et de cordesouvent braves à outrancepillards etdébauchés.
LesPrussiens allaient entrer dans Rouendisait-on.
La Gardenationale quidepuis deux moisfaisait des reconnaissances trèsprudentes dans les bois voisinsfusillant parfois ses propressentinelleset se préparant au combat quand un petit lapinremuait sous des broussaillesétait rentrée dans sesfoyers. Ses armesses uniformestout son attirail meurtrierdontelle épouvantait naguère les bornes des routesnationales à trois lieues à la rondeavaientsubitement disparu.
Lesderniers soldats français venaient enfin de traverser la Seinepour gagner Pont-Audemer par Saint-Sever et Bourg-Achard ; etmarchant après tousle général désespéréne pouvant rien tenter avec ces loques disparateséperdului-même dans la grande débâcle d'un peuplehabitué à vaincre et désastreusement battumalgré sa bravoure légendaires'en allait àpiedentre deux officiers d'ordonnance.
Puis uncalme profondune attente épouvantée et silencieuseavaient plané sur la cité. Beaucoup de bourgeoisbedonnantsémasculés par le commerceattendaientanxieusement les vainqueurstremblant qu'on ne considérâtcomme une arme leurs broches à rôtir ou leurs grandscouteaux de cuisine.
La viesemblait arrêtée ; les boutiques étaient closesla rue muette. Quelquefois un habitantintimidé par cesilencefilait rapidement le long des murs.
L'angoissede l'attente faisait désirer la venue de l'ennemi.
Dansl'après-midi du jour qui suivit le départ des troupesfrançaisesquelques uhlanssortis on ne sait d'oùtraversèrent la ville avec célérité.Puisun peu plus tardune masse noire descendit de la côteSainte-Catherinetandis que deux autres flots envahisseursapparaissaient par les routes de Darnetal et de Boisguillaume. Lesavant-gardes des trois corpsjuste au même momentsejoignirent sur la place de l'Hôtel-de-Ville ; etpar toutesles rues voisinesl'armée allemande arrivaitdéroulantses bataillons qui faisaient sonner les pavés sous leur pasdur et rythmé.
Descommandements criés d'une voix inconnue et gutturale montaientle long des maisons qui semblaient mortes et désertestandisquederrière les volets fermésdes yeux guettaientces hommes victorieuxmaîtres de la citédes fortuneset des viesde par le "droit de guerre". Les habitantsdans leurs chambres assombriesavaient l'affolement que donnent lescataclysmesles grands bouleversements meurtriers de la terrecontre lesquels toute sagesse et toute force sont inutiles. Car lamême sensation reparaît chaque fois que l'ordre établides choses est renverséque la sécuritén'existe plusque tout ce que protégeaient les lois deshommes ou celles de la naturese trouve à la merci d'unebrutalité inconsciente et féroce. Le tremblement deterre écrasant sous des maisons croulantes un peuple entier ;le fleuve débordé qui roule les paysans noyésavec les cadavres des boeufs et les poutres arrachées auxtoitsou l'armée glorieuse massacrant ceux qui se défendentemmenait les autres prisonnierspillant au nom du Sabre etremerciant un Dieu au son du canonsont autant de fléauxeffrayants qui déconcertent toute croyance à la justiceéternelletoute la confiance qu'on nous enseigne en laprotection du ciel et en la raison de l'homme.
Mais àchaque porte des petits détachements frappaientpuisdisparaissaient dans les maisons. C'était l'occupation aprèsl'invasion. Le devoir commençait pour les vaincus de semontrer gracieux envers les vainqueurs.
Au bout dequelque tempsune fois la première terreur disparueun calmenouveau s'établit. Dans beaucoup de famillesl'officierprussien mangeait à table. Il était parfois bien élevéetpar politesseplaignait la Francedisait sa répugnanceen prenant part à cette guerre. On lui étaitreconnaissant de ce sentiment ; puis on pouvaitun jour ou l'autreavoir besoin de sa protection. En le ménageant on obtiendraitpeut-être quelques hommes de moins à nourrir. Etpourquoi blesser quelqu'un dont on dépendait tout àfait ? Agir ainsi serait moins de la bravoure que de la témérité.- Et la témérité n'est plus un défaut desbourgeois de Rouencomme au temps des défenses héroïquesoù s'illustra leur cité. - On se disait enfinraisonsuprême tirée de l'urbanité françaisequ'il demeurait bien permis d'être poli dans son intérieurpourvu qu'on ne se montrât pas familieren publicavec lesoldat étranger. Au dehors on ne se connaissait plusmaisdans la maison on causait volontierset l'Allemand demeurait pluslongtempschaque soirà se chauffer au foyer commun.
La villemême reprenait peu à peu de son aspect ordinaire. LesFrançais ne sortaient guère encoremais les soldatsprussiens grouillaient dans les rues. Du resteles officiers dehussards bleusqui traînaient avec arrogance leurs grandsoutils de mort sur le pavéne semblaient pas avoir pour lessimples citoyens énormément plus de mépris queles officiers de chasseursquil'année d'avantbuvaient auxmêmes cafés.
Il y avaitcependant quelque chose dans l'airquelque chose de subtil etd'inconnuune atmosphère étrangère intolérablecomme une odeur répanduel'odeur de l'invasion. Elleemplissait les demeures et les places publiqueschangeait le goûtdes alimentsdonnait l'impression d'être en voyagetrèsloinchez des tribus barbares et dangereuses.
Lesvainqueurs exigeaient de l'argentbeaucoup d'argent. Les habitantspayaient toujours ; ils étaient riches d'ailleurs. Mais plusun négociant normand devient opulent et plus il souffre detout sacrificede toute parcelle de sa fortune qu'il voit passer auxmains d'un autre.
Cependantà deux ou trois lieues sous la villeen suivant le cours dela rivièrevers CroissetDieppedalle ou Biessartlesmariniers et les pêcheurs ramenaient souvent du fond de l'eauquelque cadavre d'Allemand gonflé dans son uniformetuéd'un coup de couteau ou de savatela tête écraséepar une pierreou jeté à l'eau d'une poussée duhaut d'un pont. Les vases du fleuve ensevelissaient ces vengeancesobscuressauvages et légitimeshéroïsmesinconnusattaques muettesplus périlleuses que les bataillesau grand jour et sans le retentissement de la gloire.
Car lahaine de l'étranger arme toujours quelques intrépidesprêts à mourir pour une Idée.
Enfincomme les envahisseursbien qu'assujettissant la ville à leurinflexible disciplinen'avaient accompli aucune des horreurs que larenommée leur faisait commettre tout le long de leur marchetriomphaleon s'enharditet le besoin du négoce travailla denouveau le coeur des commerçants du pays. Quelques-uns avaientde gros intérêts engagés au Havre que l'arméefrançaise occupaitet ils voulurent tenter de gagner ce porten allant par terre à Dieppe où ils s'embarqueraient.
On employal'influence des officiers allemands dont on avait fait laconnaissanceet une autorisation de départ fut obtenue dugénéral en chef.
Doncunegrande diligence à quatre chevaux ayant étéretenue pour ce voyageet dix personnes s'étant fait inscrirechez le voiturieron résolut de partir un mardi matinavantle jourpour éviter tout rassemblement.
Depuisquelque temps déjà la gelée avait durci laterreet le lundivers trois heuresde gros nuages noirs venant dunord apportèrent la neige qui tomba sans interruption pendanttoute la soirée et toute la nuit.
A quatreheures et demie du matinles voyageurs se réunirent dans lacour de l'hôtel de Normandieoù l'on devait monter envoiture.
Ilsétaient encore pleins de sommeilet grelottaient de froidsous leurs couvertures. On se voyait mal dans l'obscurité ; etl'entassement des lourds vêtements d'hiver faisait ressemblertous ces corps à des curés obèses avec leurslongues soutanes. Mais deux hommes se reconnurentun troisièmeles abordails causèrent : "J'emmène ma femmedit l'un. -- J'en fais autant. -- Et moi aussi." Le premierajouta : "Nous ne reviendrons pas à Rouenet si lesPrussiens approchent du Havre nous gagnerons l'Angleterre." Tousavaient les mêmes projetsétant de complexionsemblable.
Cependanton n'attelait pas la voiture. Une petite lanterneque portait unvalet d'écuriesortait de temps à autre d'une porteobscure pour disparaître immédiatement dans une autre.Des pieds de chevaux frappaient la terreamortis par le fumier deslitièreset une voix d'homme parlant aux bêtes etjurant s'entendait au fond du bâtiment. Un léger murmurede grelots annonça qu'on maniait les harnais ; ce murmuredevint bientôt un frémissement clair et continu rythmépar le mouvement de l'animals'arrêtant parfoispuisreprenant dans une brusque secousse qu'accompagnait le bruit mat d'unsabot ferré battant le sol.
La portesubitement se ferma. Tout bruit cessa. Les bourgeoisgeléss'étaient tus : ils demeuraient immobiles et roidis.
Un rideaude flocons blancs ininterrompu miroitait sans cesse en descendantvers la terre ; il effaçait les formespoudrait les chosesd'une mousse de glace ; et l'on n'entendait plusdans le grandsilence de la ville calme et ensevelie sous l'hiverque cefroissement vagueinnommable et flottant de la neige qui tombeplutôt sensation que bruitentremêlement d'atomeslégers qui semblaient emplir l'espacecouvrir le monde.
L'hommereparutavec sa lanternetirant au bout d'une corde un chevaltriste qui ne venait pas volontiers. Il le plaça contre letimonattacha les traitstourna longtemps autour pour assurer lesharnaiscar il ne pouvait se servir que d'une mainl'autre portantsa lumière. Comme il allait chercher la seconde bêteilremarqua tous ces voyageurs immobilesdéjà blancs deneigeet leur dit : "Pourquoi ne montez-vous pas dans lavoiture ? vous serez à l'abriau moins."
Ils n'yavaient pas songésans douteet ils se précipitèrent.Les trois hommes installèrent leurs femmes dans le fondmontèrent ensuite ; puis les autres formes indécises etvoilées prirent à leur tour les dernières placessans échanger une parole.
Leplancher était couvert de paille où les piedss'enfoncèrent. Les dames du fondayant apporté despetites chaufferettes en cuivre avec un charbon chimiqueallumèrentces appareilsetpendant quelque tempsà voix basseellesen énumérèrent les avantagesse répétantdes choses qu'elles savaient déjà depuis longtemps.
Enfinladiligence étant atteléeavec six chevaux au lieu dequatre à cause du tirage plus pénibleune voix dudehors demanda : "Tout le monde est-il monté ?" Unevoix du dedans répondit : "Oui." - On partit.
La voitureavançait lentementlentementà tout petits pas. Lesroues s'enfonçaient dans la neige ; le coffre entier geignaitavec des craquements sourds ; les bêtes glissaientsoufflaientfumaient et le fouet gigantesque du cocher claquait sansreposvoltigeait de tous les côtésse nouant et sedéroulant comme un serpent minceet cinglant brusquementquelque croupe rebondie qui se tendait alors sous un effort plusviolent.
Mais lejour imperceptiblement grandissait. Ces flocons légers qu'unvoyageurRouennais pur sangavait comparés à unepluie de cotonne tombaient plus. Une lueur sale filtrait àtravers de gros nuages obscurs et lourds qui rendaient plus éclatantela blancheur de la campagne où apparaissaient tantôt uneligne de grands arbres vêtus de givretantôt unechaumière avec un capuchon de neige.
Dans lavoitureon se regardait curieusementà la triste clartéde cette aurore.
Tout aufondaux meilleures placessommeillaienten face l'un de l'autreM. et Mme Loiseaudes marchands de vins en gros de la rueGrand-Pont.
Anciencommis d'un patron ruiné dans les affairesLoiseau avaitacheté le fonds et fait fortune. Il vendait à trèsbon marché de très mauvais vins aux petits débitantsdes campagnes et passait parmi ses connaissances et ses amis pour unfripon madréun vrai Normand plein de ruses et de jovialité.
Saréputation de filou était si bien établiequ'unsoir à la préfectureM. Tournelauteur de fables etde chansonsesprit mordant et finune gloire localeayant proposéaux dames qu'il voyait un peu somnolentes de faire une partie de"Loiseau vole"le mot lui-même vola à traversles salons du préfetpuisgagnant ceux de la villeavaitfait rire pendant un mois toutes les mâchoires de la province.
Loiseauétait en outre célèbre par ses farces de toutenatureses plaisanteries bonnes ou mauvaises ; et personne nepouvait parler de lui sans ajouter immédiatement : "Ilest impayablece Loiseau."
De tailleexiguëil présentait un ventre en ballon surmontéd'une face rougeaude entre deux favoris grisonnants.
Sa femmegrandeforterésolueavec la voix haute et la décisionrapideétait l'ordre et l'arithmétique de la maison decommercequ'il animait par son activité joyeuse.
A côtéd'eux se tenaitplus digneappartenant à une castesupérieureM. Carré-Lamadonhomme considérableposé dans les cotonspropriétaire de trois filaturesofficier de la Légion d'honneur et membre du Conseil général.Il était restétout le temps de l'Empirechef del'opposition bienveillanteuniquement pour se faire payer plus cherson ralliement à la cause qu'il combattait avec des armescourtoisesselon sa propre expression. Mme Carré-Lamadonbeaucoup plus jeune que son maridemeurait la consolation desofficiers de bonne famille envoyés à Rouen en garnison.
Ellefaisait vis-à-vis à son épouxtoute mignonnetoute joliepelotonnée dans ses fourrureset regardait d'unair navré l'intérieur lamentable de la voiture.
Sesvoisinsle comte et la comtesse Hubert de Brévilleportaientun des noms les plus anciens et les plus nobles de la Normandie . Lecomtevieux gentilhomme de grande tournures'efforçaitd'accentuerpar les artifices de sa toilettesa ressemblancenaturelle avec le roi Henri IVquisuivant une légendeglorieuse pour la familleavait rendu grosse une dame de Brévilledont le maripour ce faitétait devenu comte et gouverneurde province.
Collèguede M. Carré-Lamadon au Conseil généralle comteHubert représentait le parti orléaniste dans ledépartement. L'histoire de son mariage avec la fille d'unpetit armateur de Nantes était toujours demeuréemystérieuse. Mais comme la comtesse avait grand airrecevaitmieux que personnepassait même pour avoir étéaimée par un des fils de Louis-Philippetoute la noblesse luifaisait fêteet son salon demeurait le premier du paysleseul où se conservât la vieille galanterieet dontl'entrée fût difficile.
La fortunedes Brévilletoute en biens-fondsatteignaitdisait-oncinq cent mille livres de revenu.
Ces sixpersonnes formaient le fond de la voiturele côté de lasociété rentéesereine et fortedes honnêtesgens autorisés qui ont de la religion et des principes.
Par unhasard étrangetoutes les femmes se trouvaient sur le mêmebanc ; et la comtesse avait encore pour voisines deux bonnes soeursqui égrenaient de longs chapelets en marmottant des Pater etdes Ave. L'une était vieille avec une face défoncéepar la petite vérole comme si elle eût reçu àbout portant une bordée de mitraille en pleine figure.L'autretrès chétiveavait une tête jolie etmaladive sur une poitrine de phtisique rongée par cette foidévorante qui fait les martyrs et les illuminés.
En facedes deux religieusesun homme et une femme attiraient les regards detous.
L'hommebien connuétait Cornudet le démocla terreur desgens respectables. Depuis vingt ansil trempait sa barbe rousse dansles bocks de tous les cafés démocratiques. Il avaitmangé avec les frères et amis une assez belle fortunequ'il tenait de son pèreancien confiseuret il attendaitimpatiemment la République pour obtenir enfin la place méritéepar tant de consommations révolutionnaires. Au quatreseptembrepar suite d'une farce peut-êtreil s'étaitcru nommé préfet ; mais quand il voulut entrer enfonctionsles garçons de bureaudemeurés seulsmaîtres de la placerefusèrent de le reconnaîtrece qui le contraignit à la retraite. Fort bon garçon duresteinoffensif et serviableil s'était occupé avecune ardeur incomparable d'organiser la défense. Il avait faitcreuser des trous dans les plainescoucher tous les jeunes arbresdes forêts voisinessemé des pièges sur toutesles routesetà l'approche de l'ennemisatisfait de sespréparatifsil s'était vivement replié vers laville. Il pensait maintenant se rendre plus utile au Havreoùde nouveaux retranchements allaient être nécessaires.
La femmeune de celles appelées galantesétait célèbrepar son embonpoint précoce qui lui avait valu le surnom deBoule de suif. Petiteronde de partoutgrasse à lardavecdes doigts bouffisétranglés aux phalangespareils àdes chapelets de courtes saucissesavec une peau luisante et tendueune gorge énorme qui saillait sous sa robeelle restaitcependant appétissante et couruetant sa fraîcheurfaisait plaisir à voir. Sa figure était une pommerougeun bouton de pivoine prêt à fleurir ; etlà-dedans s'ouvraienten hautdeux yeux noirs magnifiquesombragés de grands cils épais qui mettaient une ombrededans ; en basune bouche charmanteétroitehumide pour lebaisermeublée de quenottes luisantes et microscopiques.
Elle étaitde plusdisait-onpleine de qualités inappréciables.
Aussitôtqu'elle fut reconnuedes chuchotements coururent parmi les femmeshonnêteset les mots de "prostituée"de"honte publique" furent chuchotés si haut qu'elleleva la tête. Alors elle promena sur ses voisins un regardtellement provocant et hardi qu'un grand silence aussitôtrégnaet tout le monde baissa les yeux à l'exceptionde Loiseauqui la guettait d'un air émoustillé.
Maisbientôt la conversation reprit entre les trois damesque laprésence de cette fille avait rendues subitement amiespresque intimes. Elles devaient faireleur semblait-ilcomme unfaisceau de leurs dignités d'épouses en face de cettevendue sans vergogne ; car l'amour légal le prend toujours dehaut avec son libre confrère.
Les troishommes aussirapprochés par un instinct de conservateurs àl'aspect de Cornudetparlaient argent d'un certain ton dédaigneuxpour les pauvres. Le comte Hubert disait les dégâts quelui avaient fait subir les Prussiensles pertes qui résulteraientdu bétail volé et des récoltes perduesavec uneassurance de grand seigneur dix fois millionnaire que ces ravagesgêneraient à peine une année. M. Carré-Lamadonfort éprouvé dans l'industrie cotonnièreavaiteu soin d'envoyer six cent mille francs en Angleterreune poire pourla soif qu'il se ménageait à toute occasion. Quant àLoiseauil s'était arrangé pour vendre àl'Intendance française tous les vins communs qui lui restaienten cavede sorte que l'Etat lui devait une somme formidable qu'ilcomptait bien toucher au Havre.
Et tousles trois se jetaient des coups d'oeil rapides et amicaux. Bien quede conditions différentesils se sentaient frères parl'argentde la grande franc-maçonnerie de ceux qui possèdentqui font sonner de l'or en mettant la main dans la poche de leurculotte.
---
La voitureallait si lentement qu'à dix heures du matin on n'avait pasfait quatre lieues. Les hommes descendirent trois fois pour monterdes côtes à pied. On commençait às'inquiétercar on devait déjeuner à Tôteset l'on désespérait maintenant d'y parvenir avant lanuit. Chacun guettait pour apercevoir un cabaret sur la routequandla diligence sombra dans un amoncellement de neigeet il fallut deuxheures pour la dégager.
L'appétitgrandissaittroublait les esprits ; et aucune gargoteaucunmarchand de vin ne se montraientl'approche des Prussiens et lepassage des troupes françaises affamées ayant effrayétoutes les industries.
Lesmessieurs coururent aux provisions dans les fermes au bord du cheminmais ils n'y trouvèrent pas même de paincar le paysandéfiantcachait ses réserves dans la crainte d'êtrepillé par les soldats quin'ayant rien à se mettresous la dentprenaient par force ce qu'ils découvraient.
Vers uneheure de l'après-midiLoiseau annonça que décidémentil se sentait un rude creux dans l'estomac. Tout le monde souffraitcomme lui depuis longtemps ; et le violent besoin de mangeraugmentant toujoursavait tué les conversations.
De tempsen tempsquelqu'un bâillait ; un autre presque aussitôtl'imitait ; et chacunà tour de rôlesuivant soncaractèreson savoir-vivre et sa position socialeouvrait labouche avec fracas ou modestement en portant vite sa main devant letrou béant d'où sortait une vapeur.
Boule desuifà plusieurs reprisesse pencha comme si elle cherchaitquelque chose sous ses jupons. Elle hésitait une seconderegardait ses voisinspuis se redressait tranquillement. Les figuresétaient pâles et crispées. Loiseau affirma qu'ilpayerait mille francs un jambonneau. Sa femme fit un geste comme pourprotester ; puis elle se calma. Elle souffrait toujours en entendantparler d'argent gaspilléet ne comprenait même pas lesplaisanteries sur ce sujet. "Le fait est que je ne me sens pasbiendit le comte ; comment n'ai-je pas songé àapporter des provisions ?" Chacun se faisait le mêmereproche.
CependantCornudet avait une gourde pleine de rhum ; il en offrit : on refusafroidement. Loiseau seul en accepta deux gouttesetlorsqu'ilrendit la gourdeil remercia : "C'est bon tout de mêmeça réchauffeet ça trompe l'appétit."L'alcool le mit en belle humeur et il proposa de faire comme sur lepetit navire de la chanson : de manger le plus gras des voyageurs.Cette allusion indirecte à Boule de suif choqua les gens bienélevés. On ne répondit pas ; Cornudet seul eutun sourire. Les deux bonnes soeurs avaient cessé de marmotterleur rosaireetles mains enfoncées dans leurs grandesmancheselles se tenaient immobilesbaissant obstinément lesyeuxoffrant sans doute au ciel la souffrance qu'il leur envoyait.
Enfinàtrois heurescomme on se trouvait au milieu d'une plaineinterminablesans un seul village en vueBoule de suifse baissantvivementretira de sous la banquette un large panier couvert d'uneserviette blanche.
Elle ensortit d'abord une petite assiette de faïenceune fine timbaleen argentpuis une vaste terrine dans laquelle deux poulets entierstout découpésavaient confit sous leur gelée ;et l'on apercevait encore dans le panier d'autres bonnes chosesenveloppéesdes pâtésdes fruitsdesfriandisesles provisions préparées pour un voyage detrois joursafin de ne point toucher à la cuisine desauberges. Quatre goulots de bouteilles passaient entre les paquets denourriture. Elle prit une aile de poulet etdélicatementsemit à la manger avec un de ces petits pains qu'on appelle"Régence" en Normandie.
Tous lesregards étaient tendus vers elle. Puis l'odeur se répanditélargissant les narinesfaisant venir aux bouches une saliveabondante avec une contraction douloureuse de la mâchoire sousles oreilles. Le mépris des dames pour cette fille devenaitférocecomme une envie de la tuer ou de la jeter en bas de lavoituredans la neigeellesa timbaleson panier et sesprovisions.
MaisLoiseau dévorait des yeux la terrine de poulet. Il dit : "Ala bonne heureMadame a eu plus de précaution que nous. Il ya des personnes qui savent toujours penser à tout." Elleleva la tête vers lui : "Si vous en désirezMonsieur ? C'est dur de jeûner depuis le matin." Il salua: "Ma foifranchementje ne refuse pasje n'en peux plus. Ala guerre comme à la guerren'est-ce pasMadame ?" Etjetant un regard circulaireil ajouta : "Dans des moments commecelui-làon est bien aise de trouver des gens qui vousobligent." Il avait un journalqu'il étendit pour nepoint tacher son pantalonet sur la pointe d'un couteau toujourslogé dans sa pocheil enleva une cuisse toute vernie degeléela dépeça des dentspuis la mâchaavec une satisfaction si évidente qu'il y eut dans la voitureun grand soupir de détresse.
Mais Boulede suifd'une voix humble et douceproposa aux bonnes soeurs departager sa collation. Elles acceptèrent toutes les deuxinstantanémentetsans lever les yeuxse mirent àmanger très vite après avoir balbutié desremerciements. Cornudet ne refusa pas non plus les offres de savoisineet l'on forma avec les religieuses une sorte de table endéveloppant des journaux sur les genoux.
Lesbouches s'ouvraient et se fermaient sans cesseavalaientmastiquaientengloutissaient férocement. Loiseaudans soncointravaillait duretà voix basseil engageait sa femmeà l'imiter. Elle résista longtempspuisaprèsune crispation qui lui parcourut les entrailleselle céda.Alors son mariarrondissant sa phrasedemanda à leur"charmante compagne" si elle lui permettait d'offrir unpetit morceau à Mme Loiseau. Elle dit : "Mais ouicertainementMonsieur"avec un sourire aimableet tendit laterrine.
Unembarras se produisit lorsqu'on eut débouché lapremière bouteille de bordeaux : il n'y avait qu'une timbale.On se la passa après l'avoir essuyée. Cornudet seulpar galanterie sans douteposa ses lèvres à la placehumide encore des lèvres de sa voisine.
Alorsentourés de gens qui mangeaientsuffoqués par lesémanations des nourrituresle comte et la comtesse deBrévilleainsi que M. et Mme Carré-Lamadon souffrirentce supplice odieux qui a gardé le nom de Tantale. Tout d'uncoup la jeune femme du manufacturier poussa un soupir qui fitretourner les têtes ; elle était aussi blanche que laneige du dehors ; ses yeux se fermèrentson front tomba :elle avait perdu connaissance. Son mariaffoléimplorait lesecours de tout le monde. Chacun perdait l'espritquand la plus âgéedes bonnes soeurssoutenant la tête de la maladeglissa entreses lèvres la timbale de Boule de suif et lui fit avalerquelques gouttes de vin. La jolie dame remuaouvrit les yeuxsouritet déclara d'une voix mourante qu'elle se sentait fort bienmaintenant. Maisafin que cela ne se renouvelât pluslareligieuse la contraignit à boire un plein verre de bordeauxet elle ajouta : "C'est la faimpas autre chose."
AlorsBoule de suifrougissante et embarrasséebalbutia enregardant les quatre voyageurs restés à jeun : "MonDieusi j'osais offrir à ces messieurs et à cesdames..." Elle se tutcraignant un outrage. Loiseau prit laparole : "Ehparbleudans des cas pareils tout le monde estfrère et doit s'aider. AllonsMesdamespas de cérémonieacceptezque diable ! Savons-nous si nous trouverons seulement unemaison où passer la nuit ? Du train dont nous allonsnous neserons pas à Tôtes avant demain midi." On hésitaitpersonne n'osant assumer la responsabilité du "oui".
Mais lecomte trancha la question. Il se tourna vers la grosse filleintimidéeetprenant son grand air de gentilhommeil luidit : "Nous acceptons avec reconnaissanceMadame."
Le premierpas seul coûtait. Une fois le Rubicon passéon s'endonna carrément. Le panier fut vidé. Il contenaitencore un pâté de foie grasun pâté demauviettesun morceau de langue fuméedes poires deCrassaneun pavé de Pont-l'Evêquedes petits fours etune tasse pleine de cornichons et d'oignons au vinaigreBoule desuifcomme toutes les femmesadorant les crudités.
On nepouvait manger les provisions de cette fille sans lui parler. Donc oncausaavec réserve d'abordpuiscomme elle se tenait fortbienon s'abandonna davantage. Mmes de Bréville etCarré-Lamadonqui avaient un grand savoir-vivrese firentgracieuses avec délicatesse. La comtesse surtout montra cettecondescendance aimable des très nobles dames qu'aucun contactne peut saliret fut charmante. Mais la forte Mme Loiseauqui avaitune âme de gendarmeresta revêcheparlant peu etmangeant beaucoup.
Ons'entretint de la guerrenaturellement. On raconta des faitshorribles des Prussiensdes traits de bravoure des Français ;et tous ces gens qui fuyaient rendirent hommage au courage desautres. Les histoires personnelles commencèrent bientôtet Boule de suif racontaavec une émotion vraieavec cettechaleur de parole qu'ont parfois les filles pour exprimer leursemportements naturelscomment elle avait quitté Rouen : "J'aicru d'abord que je pourrais resterdisait-elle. J'avais ma maisonpleine de provisionset j'aimais mieux nourrir quelques soldats quem'expatrier je ne sais où. Mais quand je les ai vuscesPrussiensce fut plus fort que moi ! Ils m'ont tourné le sangde colère ; et j'ai pleuré de honte toute la journée.Oh ! si j'étais un hommeallez ! Je les regardais de mafenêtreces gros porcs avec leur casque à pointeet mabonne me tenait les mains pour m'empêcher de leur jeter monmobilier sur le dos. Puis il en est venu pour loger chez moi ; alorsj'ai sauté à la gorge du premier. Ils ne sont pas plusdifficiles à étrangler que d'autres ! Et je l'auraisterminécelui-làsi l'on ne m'avait pas tiréepar les cheveux. Il a fallu me cacher après ça. Enfinquand j'ai trouvé une occasionje suis partieet me voici."
On lafélicita beaucoup. Elle grandissait dans l'estime de sescompagnons qui ne s'étaient pas montrés si crânes; et Cornudeten l'écoutantgardait un sourire approbateuret bienveillant d'apôtre ; de même un prêtre entendun dévot louer Dieucar les démocrates à longuebarbe ont le monopole du patriotisme comme les hommes en soutane ontcelui de la religion. Il parla à son tour d'un tondoctrinaireavec l'emphase apprise dans les proclamations qu'oncollait chaque jour aux murset il finit par un morceau d'éloquenceoù il étrillait magistralement cette "crapule deBadinguet".
Mais Boulede suif aussitôt se fâchacar elle étaitbonapartiste. Elle devenait plus rouge qu'une guigneetbégayantd'indignation : "J'aurais bien voulu vous voir à saplacevous autres. Ca aurait été du propreah oui !C'est vous qui l'avez trahicet homme ! On n'aurait plus qu'àquitter la France si l'on était gouverné par despolissons comme vous !" Cornudetimpassiblegardait un souriredédaigneux et supérieur ; mais on sentait que les grosmots allaient arriver quand le comte s'interposa et calmanon sanspeinela fille exaspéréeen proclamant avec autoritéque toutes les opinions sincères étaient respectables.Cependant la comtesse et la manufacturièrequi avaient dansl'âme la haine irraisonnée des gens comme il faut pourla Républiqueet cette instinctive tendresse que nourrissenttoutes les femmes pour les gouvernements à panache etdespotiquesse sentaientmalgré ellesattirées verscette prostituée pleine de dignitédont les sentimentsressemblaient si fort aux leurs.
Le panierétait vide. A dix on l'avait tari sans peineen regrettantqu'il ne fût pas plus grand. La conversation continua quelquetempsun peu refroidie néanmoins depuis qu'on avait fini demanger.
La nuittombaitl'obscurité peu à peu devint profondeet lefroidplus sensible pendant les digestionsfaisait frissonner Boulede suifmalgré sa graisse. Alors Mme de Bréville luiproposa sa chaufferette dont le charbondepuis le matinavait étéplusieurs fois renouveléet l'autre accepta tout de suite carelle se sentait les pieds gelés. Mme Carré-Lamadon etLoiseau donnèrent les leurs aux religieuses.
Le cocheravait allumé ses lanternes. Elles éclairaient d'unelueur vive un nuage de buée au-dessus de la croupe en sueurdes timoniersetdes deux côtés de la routela neigequi semblait se dérouler sous le reflet mobile des lumières.
On nedistinguait plus rien dans la voiture ; mais tout à coup unmouvement se fit entre Boule de suif et Cornudet ; et Loiseaudontl'oeil fouillait l'ombrecrut voir l'homme à la grande barbes'écarter vivement comme s'il eût reçu quelquebon coup lancé sans bruit.
---
Des petitspoints de feu parurent en avant sur la route. C'était Tôtes.On avait marché onze heuresce quiavec les deux heures derepos laissées en quatre fois aux chevaux pour manger l'avoineet soufflerfaisait quatorze. On entra dans le bourget devantl'hôtel du Commerce on s'arrêta.
Laportière s'ouvrit. Un bruit bien connu fit tressaillir tousles voyageurs : c'étaient les heurts d'un fourreau de sabresur le sol. Aussitôt la voix d'un Allemand cria quelque chose.
Bien quela diligence fût immobilepersonne ne descendaitcomme sil'on se fût attendu à être massacré àla sortie. Alors le conducteur apparuttenant à la main unede ses lanternesqui éclaira subitement jusqu'au fond de lavoiture les deux rangs de têtes effaréesdont lesbouches étaient ouvertes et les yeux écarquillésde surprise et d'épouvante.
A côtédu cocher se tenaiten pleine lumièreun officier allemandun grand jeune homme excessivement mince et blondserré dansson uniforme comme une fille en son corsetet portant sur le côtésa casquette plate et cirée qui le faisait ressembler auchasseur d'un hôtel anglais. Sa moustache démesuréeà longs poils droitss'amincissant indéfiniment dechaque côté et terminée par un seul fil blondsimince qu'on n'en apercevait pas la finsemblait peser sur les coinsde sa boucheettirant la joueimprimait aux lèvres un plitombant.
Il invitaen français d'Alsacien les voyageurs à sortirdisantd'un ton raide : "Foulez-vous descendreMessieurs et Dames ?"
Les deuxbonnes soeurs obéirent les premières avec une docilitéde saintes filles habituées à toutes les soumissions.Le comte et la comtesse parurent ensuitesuivis du manufacturier etde sa femmepuis de Loiseau poussant devant lui sa grande moitié.Celui-cien mettant pied à terredit à l'officier :"BonjourMonsieur"par un sentiment de prudence bien plusque de politesse. L'autreinsolent comme les gens tout-puissantsleregarda sans répondre.
Boule desuif et Cornudetbien que près de la portièredescendirent les derniersgraves et hautains devant l'ennemi. Lagrosse fille tâchait de se dominer et d'être calme : ledémoc tourmentait d'une main tragique et un peu tremblante salongue barbe roussâtre. Ils voulaient garder de la dignitécomprenant qu'en ces rencontres-là chacun représente unpeu son pays ; etpareillement révoltés par lasouplesse de leurs compagnonselle tâchait de se montrer plusfière que ses voisinesles femmes honnêtestandis queluisentant bien qu'il devait l'exemplecontinuait en toute sonattitude sa mission de résistance commencée audéfoncement des routes.
On entradans la vaste cuisine de l'aubergeet l'Allemands'étantfait présenter l'autorisation de départ signéepar le général en chef et où étaientmentionnés les nomsle signalement et la profession de chaquevoyageurexamina longuement tout ce mondecomparant les personnesaux renseignements écrits.
Puis ildit brusquement : "C'est pien"et il disparut.
Alors onrespira. On avait faim encore ; le souper fut commandé. Unedemi-heure était nécessaire pour l'apprêter ; etpendant que deux servantes avaient l'air de s'en occuperon allavisiter les chambres. Elles se trouvaient toutes dans un long couloirque terminait une porte vitrée marquée d'un numéroparlant.
Enfin onallait se mettre à tablequand le patron de l'auberge parutlui-même. C'était un ancien marchand de chevauxun groshomme asthmatique qui avait toujours des sifflementsdesenrouementsdes chants de glaires dans le larynx. Son pèrelui avait transmis le nom de Follenvie.
Il demanda: "Mademoiselle Elisabeth Rousset ?"
Boule desuif tressaillitse retourna : "C'est moi.
--Mademoisellel'officier prussien veut vous parler immédiatement.
-- A moi ?
-- Ouisivous êtes bien Mlle Elisabeth Rousset."
Elle setroublaréfléchit une secondepuis déclaracarrément : "C'est possiblemais je n'irai pas."
Unmouvement se fit autour d'elle ; chacun discutaitcherchait la causede cet ordre. Le comte s'approcha : "Vous avez tortMadamecarvotre refus peut amener des difficultés considérablesnon seulement pour vousmais même pour tous vos compagnons. Ilne faut jamais résister aux gens qui sont les plus forts.Cette démarche assurément ne peut présenteraucun danger : c'est sans doute pour quelque formalitéoubliée."
Tout lemonde se joignit à luion la priaon la pressaon lasermonnaet l'on finit par la convaincre ; car tous redoutaient lescomplications qui pourraient résulter d'un coup de tête.Elle dit enfin : "C'est pour vous que je le faisbien sûr!"
Lacomtesse lui prit la main : "Et nous vous en remercions."
Ellesortit. On l'attendit pour se mettre à table. Chacun sedésolait de n'avoir pas été demandé àla place de cette fille violente et irascibleet préparaitmentalement des platitudes pour le cas où on l'appellerait àson tour.
Mais aubout de dix minutes elle reparutsoufflantrouge àsuffoquerexaspérée. Elle balbutiait : "Oh lacanaille ! la canaille !"
Touss'empressaient pour savoirmais elle ne dit rien ; etcomme lecomte insistaitelle répondit avec une grande dignité: "Noncela ne vous regarde pasje ne peux pas parler."
Alors ons'assit autour d'une haute soupière d'où sortait unparfum de choux. Malgré cette alertele souper fut gai. Lecidre était bonle ménage Loiseau et les bonnes soeursen prirentpar économie. Les autres demandèrent du vin; Cornudet réclama de la bière. Il avait une façonparticulière de déboucher la bouteillede fairemousser le liquidede le considérer en penchant le verrequ'il élevait ensuite entre la lampe et son oeil pour bienapprécier la couleur. Quand il buvaitsa grande barbequiavait gardé la nuance de son breuvage aimésemblaittressaillir de tendresse ; ses yeux louchaient pour ne point perdrede vue sa chopeet il avait l'air de remplir l'unique fonction pourlaquelle il était né. On eût dit qu'ilétablissait en son esprit un rapprochement et comme uneaffinité entre les deux grandes passions qui occupaient toutesa vie : le Pale-Ale et la Révolution ; et assurémentil ne pouvait déguster l'un sans songer à l'autre.
M. et MmeFollenvie dînaient tout au bout de la table. L'hommerâlantcomme une locomotive crevéeavait trop de tirage dans lapoitrine pour pouvoir parler en mangeant ; mais la femme ne setaisait jamais. Elle raconta toutes ses impressions àl'arrivée des Prussiensce qu'ils faisaient. ce qu'ilsdisaientles exécrantd'abordparce qu'ils lui coûtaientde l'argentetensuiteparce qu'elle avait deux fils àl'armée. Elle s'adressait surtout à la comtesseflattée de causer avec une dame de qualité.
Puis ellebaissait la voix pour dire les choses délicateset son maride temps en tempsl'interrompait : "Tu ferais mieux de tetairemadame Follenvie." Mais elle n'en tenait aucun compteetcontinuait : "OuiMadameces gens-làça ne faitque manger des pommes de terre et du cochonet puis du cochon et despommes de terre. Et il ne faut pas croire qu'ils sont propres. Oh non! Ils ordurent partoutsauf le respect que je vous dois. Et si vousles voyiez faire l'exercice pendant des heures et des jours ; ilssont là tous dans un champ : Et marche en avantet marche enarrièreet tourne par-ciet tourne par-là. S'ilscultivaient la terre au moinsou s'ils travaillaient aux routes dansleur pays ! Mais nonMadameces militairesça n'estprofitable à personne ! Faut-il que le pauvre peuple lesnourrisse pour n'apprendre rien qu'à massacrer ! Je ne suisqu'une vieille femme sans éducationc'est vraimais en lesvoyant qui s'esquintent le tempérament à piétinerdu matin au soirje me dis : Quand il y a des gens qui font tant dedécouvertes pour être utilesfaut-il que d'autres sedonnent tant de mal pour être nuisibles ! Vraimentn'est-cepas une abomination de tuer des gensqu'ils soient prussiensoubien anglaisou bien polonaisou bien français ? Si l'on serevenge sur quelqu'un qui vous a fait tortc'est malpuisqu'on vouscondamne ; mais quand on extermine nos garçons comme dugibieravec des fusilsc'est donc bienpuisqu'on donne desdécorations à celui qui en détruit le plus ?Nonvoyez-vousje ne comprendrai jamais ça !"
Cornudetéleva la voix : "La guerre est une barbarie quand onattaque un voisin paisible ; c'est un devoir sacré quand ondéfend la patrie."
La vieillefemme baissa la tête : "Ouiquand on se défendc'est autre chose ; mais si l'on ne devrait pas plutôt tuertous les rois qui font ça pour leur plaisir ?"
L'oeil deCornudet s'enflamma : "Bravocitoyenne"dit-il.
M.Carré-Lamadon réfléchissait profondément.Bien qu'il fût fanatique des illustres capitainesle bon sensde cette paysanne le faisait songer à l'opulencequ'apporteraient dans un pays tant de bras inoccupés et parconséquent ruineuxtant de forces qu'on entretientimproductivessi on les employait aux grands travaux industrielsqu'il faudra des siècles pour achever.
MaisLoiseauquittant sa placealla causer tout bas avec l'aubergiste.Le gros homme riaittoussaitcrachait ; son énorme ventresautillait de joie aux plaisanteries de son voisinet il lui achetasix feuillettes de bordeaux pour le printempsquand les Prussiensseraient partis.
Le souperà peine achevécomme on était brisé defatigueon se coucha.
CependantLoiseauqui avait observé les chosesfit mettre au lit sonépousepuis colla tantôt son oreille et tantôtson oeil au trou de la serrurepour tâcher de découvrirce qu'il appelait : "les mystères du corridor".
Au boutd'une heure environil entendit un frôlementregarda bienviteet aperçut Boule de suif qui paraissait plus replèteencore sous un peignoir de cachemire bleubordé de dentellesblanches. Elle tenait un bougeoir à la main et se dirigeaitvers le gros numéro tout au fond du couloir. Mais une porteàcôtés'entrouvritetquand elle revint au bout dequelques minutesCornudeten bretellesla suivait. Ils parlaientbaspuis ils s'arrêtèrent. Boule de suif semblaitdéfendre l'entrée de sa chambre avec énergie.Loiseaumalheureusementn'entendait pas les parolesmaisàla fincomme ils élevaient la voixil put en saisirquelques-unes. Cornudet insistait avec vivacité. Il disait :"Voyonsvous êtes bêtequ'est-ce que çavous fait ?"
Elle avaitl'air indigné et répondit : "Nonmon cheril y ades moments où ces choses-là ne se font pas ; et puisicice serait une honte."
Il necomprenait pointsans douteet demanda pourquoi. Alors elles'emportaélevant encore le ton : "Pourquoi ? Vous necomprenez pas pourquoi ? Quand il y a des Prussiens dans la maisondans la chambre à côté peut-être ?"
Il se tut.Cette pudeur patriotique de catin qui ne se laissait point caresserprès de l'ennemi dut réveiller en son coeur sa dignitédéfaillantecaraprès l'avoir seulement embrasséeil regagna sa porte à pas de loup.
Loiseautrès alluméquitta la serrurebattit un entrechatdans sa chambremit son madrassouleva le drap sous lequel gisaitla dure carcasse de sa compagne qu'il réveilla d'un baiser enmurmurant : "M'aimes-tuchérie ?"
Alorstoute la maison devint silencieuse. Mais bientôt s'élevaquelque partdans une direction indéterminée quipouvait être la cave aussi bien que le grenierun ronflementpuissantmonotonerégulierun bruit sourd et prolongéavec des tremblements de chaudière sous pression. M. Follenviedormait.
Comme onavait décidé qu'on partirait à huit heures lelendemaintout le monde se trouva dans la cuisine ; mais la voituredont la bâche avait un toit de neigese dressait solitaire aumilieu de la coursans chevaux et sans conducteur. On chercha envain celui-ci dans les écuriesdans les fourragesdans lesremises. Alors tous les hommes se résolurent à battrele pays et ils sortirent. Ils se trouvèrent sur la placeavecl'église au fond etdes deux côtésdes maisonsbasses où l'on apercevait des soldats prussiens. Le premierqu'ils virent épluchait des pommes de terre. Le secondplusloinlavait la boutique du coiffeur. Un autrebarbu jusqu'aux yeuxembrassait un mioche qui pleurait et le berçait sur ses genouxpour tâcher de l'apaiser ; et les grosses paysannes dont leshommes étaient à "l'armée de la guerre"indiquaient par signes à leurs vainqueurs obéissants letravail qu'il fallait entreprendre : fendre du boistremper lasoupemoudre le café ; un d'eux même lavait le linge deson hôtesseune aïeule tout impotente.
Le comteétonnéinterrogea le bedeau qui sortait du presbytère.Le vieux rat d'église lui répondit : "Oh ! ceux-làne sont pas méchants : c'est pas des Prussiens à cequ'on dit. Ils sont de plus loinje ne sais pas bien d'où ;et ils ont tous laissé une femme et des enfants au pays ; çane les amuse pasla guerreallez ! Je suis sûr qu'on pleurebien aussi là-bas après les hommes ; et çafournira une fameuse misère chez eux comme chez nous. Iciencoreon n'est pas trop malheureux pour le momentparce qu'ils nefont pas de mal et qu'ils travaillent comme s'ils étaient dansleurs maisons. Voyez-vousMonsieurentre pauvres gensfaut bienqu'on s'aide... C'est les grands qui font la guerre."
Cornudetindigné de l'entente cordiale établie entre lesvainqueurs et les vaincusse retirapréférants'enfermer dans 1'auberge. Loiseau eut un mot pour rire : "Ilsrepeuplent." M. Carré-Lamadon eut un mot grave : "Ilsréparent." Mais on ne trouvait pas le cocher. A la fin onle découvrit dans le café du village attabléfraternellement avec l'ordonnance de l'officier. Le comtel'interpella : "Ne vous avait-on pas donné l'ordred'atteler pour huit heures ?
-- Ah bienouimais on m'en a donné un autre depuis.
-- Lequel?
-- De nepas atteler du tout.
-- Quivous a donné cet ordre ?
-- Ma foi! le commandant prussien.
--Pourquoi ?
-- Je n'ensais rien. Allez lui demander. On me défend d'attelermoi jen'attelle pas. Voilà.
-- C'estlui-même qui vous a dit cela ?
-- NonMonsieur : c'est l'aubergiste qui m'a donné l'ordre de sapart.
-- Quandça ?
-- Hiersoircomme j'allais me coucher."
Les troishommes rentrèrent fort inquiets.
On demandaM. Follenviemais la servante répondit que Monsieuràcause de son asthmene se levait jamais avant dix heures. Il avaitmême formellement défendu de le réveiller plustôtexcepté en cas d'incendie.
On voulutvoir l'officiermais cela était impossible absolumentbienqu'il logeât dans l'auberge. M. Follenvie seul étaitautorisé à lui parler pour les affaires civiles. Alorson attendit. Les femmes remontèrent dans leurs chambresetdes futilités les occupèrent.
Cornudets'installa sous la haute cheminée de la cuisineoùflambait un grand feu. Il se fit apporter là une des petitestables du caféune canetteet il tira sa pipe qui jouissaitparmi les démocrates d'une considération presque égaleà la siennecomme si elle avait servi la patrie en servant àCornudet. C'était une superbe pipe en écumeadmirablement culottéeaussi noire que les dents de sonmaîtremais par fuméerecourbéeluisantefamilière à sa mainet complétant saphysionomie. Et il demeura immobileles yeux tantôt fixéssur la flamme du foyertantôt sur la mousse qui couronnait sachope ; et chaque fois qu'il avait buil passait d'un air satisfaitses longs doigts maigres dans ses longs cheveux graspendant qu'ilhumait sa moustache frangée d'écume.
Loiseausous prétexte de se dégourdir les jambesalla placerdu vin aux débitants du pays. Le comte et le manufacturier semirent à causer politique. Ils prévoyaient l'avenir dela France. L'un croyait aux d'Orléansl'autre à unsauveur inconnuun héros qui se révéleraitquand tout serait désespéré : un Du Guesclinune Jeanne d'Arc peut-être ? ou un autre Napoléon Ier ?Ah ! si le prince impérial n'était pas si jeune !Cornudetles écoutantsouriait en homme qui sait le mot desdestinées. Sa pipe embaumait la cuisine.
Comme dixheures sonnaientM. Follenvie parut. On l'interrogea bien vite ;mais il ne put que répéter deux ou trois foissans unevarianteces paroles : "L'officier m'a dit comme ça :"Monsieur Follenvievous défendrez qu'on attelle demainla voiture de ces voyageurs. Je ne veux pas qu'ils partent sans monordre. Vous entendez. Ca suffit."
Alors onvoulut voir l'officier. Le comte lui envoya sa carte où M.Carré-Lamadon ajouta son nom et tous ses titres. Le Prussienfit répondre qu'il admettrait ces deux hommes à luiparler quand il aurait déjeunéc'est-à-direvers une heure.
Les damesreparurent et l'on mangea quelque peumalgré l'inquiétude.Boule de suif semblait malade et prodigieusement troublée.
Onachevait le café quand l'ordonnance vint chercher cesmessieurs.
Loiseau sejoignit aux deux premiers ; mais comme on essayait d'entraînerCornudet pour donner plus de solennité à leur démarcheil déclara fièrement qu'il entendait n'avoir jamaisaucun rapport avec les Allemands ; et il se remit dans sa cheminéedemandant une autre canette.
Les troishommes montèrent et furent introduits dans la plus bellechambre de l'aubergeoù l'officier les reçutétendudans un fauteuilles pieds sur la cheminéefumant une longuepipe de porcelaineet enveloppé par une robe de chambreflamboyantedérobée sans doute dans la demeureabandonnée de quelque bourgeois de mauvais goût. Il nese leva pasne les salua pasne les regarda pas. Il présentaitun magnifique échantillon de la goujaterie naturelle aumilitaire victorieux.
Au bout dequelques instants il dit enfin :
"Qu'est-ceque fous foulez ?"
Le comteprit la parole : "Nous désirons partirMonsieur.
-- Non.
--Oserai-je vous demander la cause de ce refus ?
-- Parceque che ne feux pas.
-- Je vousferai respectueusement observerMonsieurque votre généralen chef nous a délivré une permission de départpour gagner Dieppeet je ne pense pas que nous ayons rien fait pourmériter vos rigueurs.
-- Che nefeux pas... foilà tout... Fous poufez tescentre."
S'étantinclinés tous les troisils se retirèrent.L'après-midi fut lamentable. On ne comprenait rien à cecaprice d'Allemandet les idées les plus singulièrestroublaient les têtes. Tout le monde se tenait dans la cuisineet l'on discutait sans finimaginant des choses invraisemblables. Onvoulait peut-être les garder comme otages - mais dans quel but? - ou les emmener prisonniers ? ouplutôtleur demander unerançon considérable ? A cette penséeunepanique les affola. Les plus riches étaient les plusépouvantésse voyant déjà contraintspour racheter leur viede verser des sacs pleins d'or entre lesmains de ce soldat insolent. Ils se creusaient la cervelle pourdécouvrir des mensonges acceptablesdissimuler leursrichessesse faire passer pour pauvrestrès pauvres. Loiseauenleva sa chaîne de montre et la cacha dans sa poche. La nuitqui tombait augmenta les appréhensions. La lampe fut alluméeetcomme on avait encore deux heures avant le dînerMmeLoiseau proposa une partie de trente-et-un. Ce serait unedistraction. On accepta. Cornudet lui-mêmeayant éteintsa pipe par politessey prit part.
Le comtebattit les cartes -- donna-- Boule de suif avait trente et und'emblée ; et bientôt l'intérêt de lapartie apaisa la crainte qui hantait les esprits. Mais Cornudets'aperçut que le ménage Loiseau s'entendait pourtricher.
Comme onallait se mettre à tableM. Follenvie reparutetde sa voixgraillonnanteil prononça : "L'officier prussien faitdemander à Mlle Elisabeth Rousset si elle n'a pas encorechangé d'avis."
Boule desuif resta debouttoute pâle ; puisdevenant subitementcramoisieelle eut un tel étouffement de colèrequ'elle ne pouvait plus parler. Enfin elle éclata : "Vouslui direz à cette crapuleà ce saligaudàcette charogne de Prussienque jamais je ne voudrai ; vous entendezbienjamaisjamaisjamais !"
Le grosaubergiste sortit. Alors Boule de suif fut entouréeinterrogéesollicitée par tout le monde de dévoilerle mystère de sa visite. Elle résista d'abord ; maisl'exaspération l'emporta bientôt : "Ce qu'il veut?... ce qu'il veut ?... Il veut coucher avec moi !" cria-t-elle.Personne ne se choqua du mottant l'indignation fut vive. Cornudetbrisa sa chope en la reposant violemment sur la table. C'étaitune clameur de réprobation contre ce soudard ignobleunsouffle de colèreune union de tous pour la résistancecomme si l'on eût demandé à chacun une partie dusacrifice exigé d'elle. Le comte déclara avec dégoûtque ces gens-là se conduisaient à la façon desanciens barbares. Les femmes surtout témoignèrent àBoule de suif une commisération énergique etcaressante. Les bonnes soeursqui ne se montraient qu'aux repasavaient baissé la tête et ne disaient rien.
On dînanéanmoins lorsque la première fureur fut apaisée; mais on parla peu : on songeait.
Les damesse retirèrent de bonne heureet les hommestout en fumantorganisèrent un écarté auquel fut conviéM. Follenviequ'on avait l'intention d'interroger habilement sur lesmoyens à employer pour vaincre la résistance del'officier. Mais il ne songeait qu'à ses cartessans rienécoutersans rien répondre ; et il répétaitsans cesse : "Au jeuMessieursau jeu." Son attentionétait si tendue qu'il en oubliait de cracherce qui luimettait parfois des points d'orgue dans la poitrine. Ses poumonssifflants donnaient toute la gamme de l'asthmedepuis les notesgraves et profondes jusqu'aux enrouements aigus des jeunes coqsessayant de chanter.
Il refusamême de monterquand sa femmequi tombait de sommeilvint lechercher. Alors elle partit toute seulecar elle était "dumatin"toujours levée avec le soleiltandis que sonhomme était "du soir"toujours prêt àpasser la nuit avec des amis. Il lui cria : "Tu placeras monlait de poule devant le feu"et se remit à sa partie.Quand on vit bien qu'on n'en pourrait rien tireron déclaraqu'il était temps de s'en alleret chacun gagna son lit.
---
Lelendemainun clair soleil d'hiver rendait la neige éblouissante.La diligenceattelée enfinattendait devant la portetandisqu'une armée de pigeons blancsrengorgés dans leursplumes épaissesavec un oeil rosetachéau milieud'un point noirse promenaient gravement entre les jambes des sixchevauxet cherchaient leur vie dans le crottin fumant qu'ilséparpillaient.
Le cocherenveloppé dans sa peau de moutongrillait une pipe sur lesiègeet tous les voyageurs radieux faisaient rapidementempaqueter des provisions pour le reste du voyage.
Onn'attendait plus que Boule de suif. Elle parut.
Ellesemblait un peu troubléehonteuseet elle s'avançatimidement vers ses compagnonsquitousd'un même mouvementse détournèrent comme s'ils ne l'avaient pas aperçue.Le comte prit avec dignité le bras de sa femme et l'éloignade ce contact impur.
La grossefille s'arrêtastupéfaite ; alorsramassant tout soncourageelle aborda la femme du manufacturier d'un "bonjourMadame" humblement murmuré. L'autre fit de la têteseule un petit salut impertinent qu'elle accompagna d'un regard devertu outragée. Tout le monde semblait affairéet l'onse tenait loin d'elle comme si elle eût apporté uneinfection dans ses jupes. Puis on se précipita vers la voitureoù elle arriva seulela dernièreet reprit en silencela place qu'elle avait occupée pendant la premièrepartie de la route.
Onsemblait ne pas la voirne pas la connaître ; mais MmeLoiseaula considérant de loin avec indignationdit àmi-voix à son mari : "Heureusement que je ne suis pas àcôté d'elle."
La lourdevoiture s'ébranlaet le voyage recommença.
On neparla point d'abord. Boule de suif n'osait pas lever les yeux. Ellese sentait en même temps indignée contre tous sesvoisinset humiliée d'avoir cédésouilléepar les baisers de ce Prussien entre les bras duquel on l'avaithypocritement jetée.
Mme lacomtessese tournant vers Mme Carré-Lamadonrompit bientôtce pénible silence.
"Vousconnaissezje croisMme d'Etrelles ?
-- Ouic'est une de mes amies.
-- Quellecharmante femme !
--Ravissante ! Une vraie nature d'élitefort instruited'ailleurset artiste jusqu'au bout des doigts : elle chante àravir et dessine dans la perfection !"
Lemanufacturier causait avec le comteet au milieu du fracas desvitres un mot parfois jaillissait : "Coupon -- échéance-- prime -- à terme."
Loiseauqui avait chipé le vieux jeu de cartes de l'aubergeengraissépar cinq ans de frottement sur les tables mal essuyéesattaqua un bésigue avec sa femme.
Les bonnessoeurs prirent à leur ceinture le long rosaire qui pendaitfirent ensemble le signe de la croixet tout à coup leurslèvres se mirent à remuer vivementse hâtant deplus en plusprécipitant leur vague murmure comme pour unecourse d'oremus ; et de temps en temps elles baisaient une médaillese signaient de nouveaupuis recommençaient leur marmottementrapide et continu.
Cornudetsongeaitimmobile.
Au bout detrois heures de routeLoiseau ramassa ses cartes : "Il faitfaim"dit-il.
Alors safemme atteignit un paquet ficelé d'où elle fit sortirun morceau de veau froid. Elle le découpa proprement partranches minces et fermeset tous deux se mirent à manger."Si nous en faisions autant"dit la comtesse. On yconsentit et elle déballa les provisions préparéespour les deux ménages. C'étaitdans un de ces vasesallongés dont le couvercle porte un lièvre en faïencepour indiquer qu'un lièvre en pâté gîtau-dessousune charcuterie succulenteoù de blanchesrivières de lard traversaient la chair brune du gibiermêléeà d'autres viandes hachées fin. Un beau carré degruyèreapporté dans un journalgardait imprimé: "faits divers" sur sa pâte onctueuse.
Les deuxbonnes soeurs développèrent un rond de saucisson quisentait l'ail ; et Cornudetplongeant les deux mains en mêmetemps dans les vastes poches de son paletot-sactira de l'une quatreoeufs durs et de l'autre le croûton d'un pain. Il détachala coquela jeta sous ses pieds dans la paille et se mit àmordre à même les oeufsfaisant tomber sur sa vastebarbe des parcelles de jaune clair qui semblaientlà-dedansdes étoiles.
Boule desuifdans la hâte et l'effarement de son levern'avait pusonger à rien ; et elle regardaitexaspéréesuffoquant de ragetous ces gens qui mangeaient placidement. Unecolère tumultueuse la crispa d'abordet elle ouvrit la bouchepour leur crier leur fait avec un flot d'injures qui lui montait auxlèvres ; mais elle ne pouvait pas parler tant l'exaspérationl'étranglait.
Personnene la regardaitne songeait à elle. Elle se sentait noyéedans le mépris de ces gredins honnêtes qui l'avaientsacrifiée d'abordrejetée ensuitecomme une chosemalpropre et inutile. Alors elle songea à son grand paniertout plein de bonnes choses qu'ils avaient goulûment dévoréesà ses deux poulets luisants de geléeà sespâtésà ses poiresà ses quatrebouteilles de bordeaux ; et sa fureur tombant soudaincomme unecorde trop tendue qui casseelle se sentit prête àpleurer. Elle fit des efforts terriblesse raiditavala sessanglots comme les enfants ; mais les pleurs montaientluisaient aubord de ses paupièreset bientôt deux grosses larmesse détachant des yeuxroulèrent lentement sur sesjoues. D'autres les suivirent plus rapides coulant comme les gouttesd'eau qui filtrent d'une rocheet tombant régulièrementsur la courbe rebondie de sa poitrine. Elle restait droitele regardfixela face rigide et pâleespérant qu'on ne laverrait pas.
Mais lacomtesse s'en aperçut et prévint son mari d'un signe.Il haussa les épaules comme pour dire : "Que voulez-vous? ce n'est pas ma faute." Mme Loiseau eut un rire muet detriompheet murmura : "Elle pleure sa honte."
Les deuxbonnes soeurs s'étaient remises à prieraprèsavoir roulé dans un papier le reste de leur saucisson.
AlorsCornudetqui digérait ses oeufsétendit ses longuesjambes sous la banquette d'en facese renversacroisa ses brassourit comme un homme qui vient de trouver une bonne farceet se mità siffloter la Marseillaise .
Toutes lesfigures se rembrunirent. Le chant populaireassurémentneplaisait point à ses voisins. Ils devinrent nerveuxagacéset avaient l'air prêts à hurler comme des chiens quientendent un orgue de barbarie.
Il s'enaperçutne s'arrêta plus. Parfois même ilfredonnait les paroles :
Amoursacré de la patrie
Conduissoutiensnos brasvengeurs
Libertéliberté chérie
Combats avec tes défenseurs !
On fuyaitplus vitela neige étant plus dure ; et jusqu'àDieppependant les longues heures mornes du voyageà traversles cahots du cheminpar la nuit tombantepuis dans l'obscuritéprofonde de la voitureil continuaavec une obstination féroceson sifflement vengeur et monotonecontraignant les esprits las etexaspérés à suivre le chant d'un bout àl'autreà se rappeler chaque parole qu'ils appliquaient surchaque mesure.
Et Boulede suif pleurait toujours ; et parfois un sanglotqu'elle n'avait puretenirpassaitentre deux coupletsdans les ténèbres.
LesSoirées de Médan16 avril 1880.