 home page
home page
 pagina iniziale
pagina iniziale
|

|
by
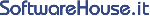
|


|
Ebook in formato Kindle (mobi) - Kindle File Ebook (mobi)
Formato per Iphone, Ipad e Ebook (epub) - Ipad, Iphone and Ebook reader format (epub)
Versione ebook di Readme.it powered by Softwarehouse.itGuy de Maupassant Contes de la bécasse
Le vieuxbaron des Ravots avait été pendant quarante ans le roides chasseurs de sa province. Maisdepuis cinq à six annéesune paralysie des jambes le clouait à son fauteuilet il nepouvait plus que tirer des pigeons de la fenêtre de son salonou du haut de son grand perron.
Le restedu temps il lisait.
C'étaitun homme de commerce aimable chez qui était restébeaucoup de l'esprit lettré du dernier siècle. Iladorait les contesles petits contes polissonset aussi leshistoires vraies arrivées dans son entourage. Dès qu'unami entrait chez luiil demandait :
"Ehbienquoi de nouveau ?"
Et ilsavait interroger à la façon d'un juge d'instruction.
Par lesjours de soleil il faisait rouler devant la porte son large fauteuilpareil à un lit. Un domestiquederrière son dostenait les fusilsles chargeait et les passait à son maître; un autre valetcaché dans un massiflâchait unpigeon de temps en tempsà des intervalles irrégulierspour que le baron ne fût pas prévenu et demeurâten éveil.
Etdumatin au soiril tirait les oiseaux rapidesse désolantquand il s'était laissé surprendreet riant aux larmesquand la bête tombait d'aplomb ou faisait quelque culbuteinattendue et drôle. Il se tournait alors vers le garçonqui chargeait les armeset il demandaiten suffoquant de gaieté:
"Yest-ilcelui-làJoseph! As-tu vu comme il est descendu ?"
Et Josephrépondait invariablement:
"Oh !monsieur le baron ne les manque pas."
Al'automneau moment des chassesil invitaitcomme àl'ancien tempsses amiset il aimait entendre au loin lesdétonations. Il les comptaitheureux quand elles seprécipitaient. Etle soiril exigeait de chacun le récitfidèle de sa journée
Et onrestait trois heures à table en racontant des coups de fusil.
C'étaientd'étranges et invraisemblables aventuresoù secomplaisait l'humeur hâbleuse des chasseurs. Quelques-unesavaient fait date et revenaient régulièrement.L'histoire d'un lapin que le petit vicomte de Bourril avait manquédans son vestibule les faisait se tordre chaque année de lamême façon. Toutes les cinq minutes un nouvel orateurprononçait :
"J'entends: "Birr ! birr !" et une compagnie magnifique me part àdix pas. J'ajuste : pif! paf! j'en vois tomber une pluieune vraiepluie. Il y en avait sept !"
Et tousétonnésmais réciproquement créduless'extasiaient.
Mais ilexistait dans la maison une vieille coutumeappelée le "contede la Bécasse".
Au momentdu passage de cette reine des gibiersla même cérémonierecommençait à chaque dîner.
Comme iladorait l'incomparable oiseauon en mangeait tous les soirs un parconvive ; mais on avait soin de laisser dans un plat toutes les têtes
Alors lebaronofficiant comme un évêquese faisait apportersur une assiette un peu de graisseoignait avec soin les têtesprécieuses en les tenant par le bout de la mince aiguille quileur sert de bec. Une chandelle allumée était poséeprès de luiet tout le monde se taisaitdans l'anxiétéde l'attente.
Puis ilsaisissait un des crânes ainsi préparéslefixait sur une épinglepiquait l'épingle sur unbouchonmaintenait le tout en équilibre au moyen de petitsbâtons croisés comme des balancierset plantaitdélicatement cet appareil sur un goulot de bouteille enmanière de tourniquet.
Tous lesconvives comptaient ensembled'une voix forte :
"Une- deux- trois."
Et lebarond'un coup de doigtfaisait vivement pivoter ce joujou.
Celui desinvités que désignaiten s'arrêtantle long becpointu devenait maître de toutes les têtesrégalexquis qui faisait loucher ses voisins.
Il lesprenait une à une et les faisait griller sur la chandelle. Lagraisse crépitaitla peau rissolée fumaitet l'éludu hasard croquait le crâne suiffé en le tenant par lenez et en poussant des exclamations de plaisir.
Et chaquefois les dîneurslevant leurs verresbuvaient à sasanté.
Puisquand il avait achevé le dernieril devait sur l'ordre dubaronconter une histoire pour indemniser les déshérités.
Voiciquelques-uns de ces récits :
CECOCHON DE MORIN
A M.Oudinot.
I
"Çamon amidis-je à Labarbetu viens encore de prononcer cesquatre mots"ce cochon de Morin". Pourquoidiablen'ai-je jamais entendu parler de Morin sans qu'on le traitât de"cochon" ? "
Labarbeaujourd'hui députéme regarda avec des yeux dechat-huant. "Commenttu ne sais pas l'histoire de Morinet tues de La Rochelle ?"
J'avouaique je ne savais pas l'histoire de Morin. Alors Labarbe se frotta lesmains et commença son récit.
"Tuas connu Morinn'est-ce paset tu te rappelles son grand magasin demercerie sur le quai de La Rochelle ?
- Ouiparfaitement.
- Eh biensache qu'en 1862 ou 63 Morin alla passer quinze jours à Parispour son plaisirou ses plaisirsmais sous prétexte derenouveler ses approvisionnements. Tu sais ce que sontpour uncommerçant de provincequinze jours de Paris.
Cela vousmet le feu dans le sang. Tous les soirsdes spectaclesdesfrôlements de femmesune continuelle excitation d'esprit. Ondevient fou. On ne voit plus que danseuses en maillotactricesdécolletéesjambes rondesépaules grassestout cela presque à portée de la mainsans qu'on oseou qu'on puisse y toucher. C'est à peine si on goûteune fois ou deuxà quelques mets inférieurs. Et l'ons'en vale coeur encore tout secouél'âme émoustilléeavec une espèce de démangeaison de baisers qui vouschatouillent les lèvres."
*
Morin setrouvait dans cet étatquand il prit son billet pour LaRochelle par l'express de 8 h 40 du soir. Et il se promenait plein deregrets et de trouble dans la grande salle commune du chemin de ferd'Orléansquand il s'arrêta net devant une jeune femmequi embrassait une vieille dame. Elle avait relevé savoiletteet Morinravimurmura : "Bigrela belle personne !"
Quand elleeut fait ses adieux à la vieilleelle entra dans la salled'attenteet Morin la suivit ; puis elle passa sur le quaiet Morinla suivit encore ; puis elle monta dans un wagon videet Morin lasuivit toujours.
Il y avaitpeu de voyageurs pour l'express. La locomotive siffla ; le trainpartit. Ils étaient seuls.
Morin ladévorait des yeux. Elle semblait avoir dix-neuf à vingtans ; elle était blondegranded'allure hardie. Elle roulaautour de ses jambes une couverture de voyageet s'étenditsur les banquettes pour dormir.
Morin sedemandait : "Qui est-ce ?" Et mille suppositionsmilleprojets lui traversaient l'esprit. Il se disait : "On racontetant d'aventures de chemin de fer. C'en est une peut-être quise présente pour moi. Qui sait ? une bonne fortune est si vitearrivée. Il me suffirait peut-être d'êtreaudacieux. N'est-ce pas Danton qui disait : "De l'audacedel'audaceet toujours de l'audace." Si ce n'est pas Dantonc'est Mirabeau. Enfinqu'importe. Ouimais je manque d'audacevoilà le hic. Oh ! Si on savaitsi on pouvait lire dans lesâmes ! Je parie qu'on passe tous les jourssans s'en douteràcôté d'occasions magnifiques. Il lui suffirait d'ungeste pourtant pour m'indiquer qu'elle ne demande pas mieux..."
Alorsilsupposa des combinaisons qui le conduisaient au triomphe. Ilimaginait une entrée en rapport chevaleresquede petitsservices qu'il lui rendaitune conversation vivegalantefinissantpar une déclaration qui finissait par... par ce que tu penses.
Mais cequi lui manquait toujoursc'était le débutleprétexte. Et il attendait une circonstance heureusele coeurravagél'esprit sens dessus dessous.
La nuitcependant s'écoulait et la belle enfant dormait toujourstandis que Morin méditait sa chute. Le jour parutet bientôtle soleil lança son premier rayonun long rayon clair venu dubout de l'horizonsur le doux visage de la dormeuse.
Elles'éveillas'assitregarda la campagneregarda Morin etsourit. Elle sourit en femme heureused'un air engageant et gai.Morin tressaillit. Pas de doutec'était pour lui cesourire-làc'était bien une invitation discrètele signal rêvé qu'il attendait. Il voulait direcesourire : "Etes-vous bêteêtes-vous niaisêtes-vous jobardd'être resté làcomme unpieusur votre siège depuis hier soir.
"Voyonsregardez-moi ; ne suis-je pas charmante ? Et vous demeurez comme çatoute une nuit en tête-à-tête avec une jolie femmesans rien osergrand sot."
Ellesouriait toujours en le regardant ; elle commençait mêmeà rire ; et il perdit la têtecherchant un mot decirconstanceun complimentquelque chose à dire enfinn'importe quoi. Mais il ne trouvait rienrien. Alorssaisi d'uneaudace de poltronil pensa : "Tant pisje risque tout" ;et brusquementsans crier "gare"il s'avançalesmains tenduesles lèvres gourmandesetla saisissant àpleins brasil l'embrassa.
D'un bondelle fut deboutcriant "Au secours"hurlant d'épouvante.Et elle ouvrit la portière ; elle agita ses bras dehorsfollede peuressayant de sautertandis que Morin éperdupersuadéqu'elle allait se précipiter sur la voiela retenait par sajupe en bégayant : "Madame... oh! madame."
Le trainralentit sa marches'arrêta. Deux employés seprécipitèrent aux signaux désespérésde la jeune femme qui tomba dans leurs bras en balbutiant : "Cethomme a voulu... a voulu... me... me..." Et elle s'évanouit.
On étaiten gare de Mauzé. Le gendarme présent arrêtaMorin.
Quand lavictime de sa brutalité eut repris connaissanceelle fit sadéclaration. L'autorité verbalisa. Et le pauvre mercierne put regagner son domicile que le soirsous le coup d'unepoursuite judiciaire pour outrage aux bonnes moeurs dans un lieupublic.
II
J'étaisalors rédacteur en chef du Fanal des Charenteset jevoyais Morinchaque soirau café du Commerce.
Dèsle lendemain de son aventureil vint me trouverne sachant quefaire. Je ne lui cachai pas mon opinion : "Tu n'es qu'un cochon.On ne se conduit pas comme ça."
Ilpleurait ; sa femme l'avait battu ; et il voyait son commerce ruinéson nom dans la bouedéshonoréses amisindignésne le saluant plus. Il finit par me faire pitiéet j'appelaimon collaborateur Rivetun petit homme goguenard et de bon conseilpour prendre ses avis.
Ilm'engagea à voir le procureur impérialqui étaitde mes amis. Je renvoyai Morin chez lui et je me rendis chez cemagistrat.
J'apprisque la femme outragée était une jeune filleMlleHenriette Bonnelqui venait de prendre à Paris ses brevetsd'institutrice et quin'ayant plus ni père ni mèrepassait ses vacances chez son oncle et sa tantebraves petitsbourgeois de Mauzé.
Ce quirendait grave la situation de Morinc'est que l'oncle avait portéplainte. Le ministère public consentait à laissertomber l'affaire si cette plainte était retirée. Voilàce qu'il fallait obtenir.
Jeretournai chez Morin. Je le trouvai dans son litmalade d'émotionet de chagrin. Sa femmeune grande gaillarde osseuse et barbuelemaltraitait sans repos. Elle m'introduisit dans la chambre en mecriant par la figure : "Vous venez voir ce cochon de Morin ?Tenezle voilàle coco !"
Et elle seplanta devant le litles poings sur les hanches. J'exposai lasituation ; et il me supplia d'aller trouver la famille. La missionétait délicate ; cependant je l'acceptai. Le pauvrediable ne cessait de répéter : "Je t'assure que jene l'ai même pas embrasséenonpas même. Je tele jure !"
Jerépondis : "C'est égaltu n'es qu'un cochon."Et je pris mille francs qu'il m'abandonna pour les employer comme jele jugerais convenable.
Mais commeje ne tenais pas à m'aventurer seul dans la maison desparentsje priai Rivet de m'accompagner. Il y consentità lacondition qu'on partirait immédiatementcar il avaitlelendemain dans l'après-midiune affaire urgente à LaRochelle.
Etdeuxheures plus tardnous sonnions à la porte d'une jolie maisonde campagne. Une belle jeune fille vint nous ouvrir. C'étaitelle assurément. Je dis tout bas à Rivet : "Sacrebleuje commence à comprendre Morin."
L'oncleM. Tonneletétait justement un abonné du Fanalun fervent coreligionnaire politique qui nous reçut àbras ouvertsnous félicitanous congratulanous serra lesmainsenthousiasmé d'avoir chez lui les deux rédacteursde son journal. Rivet me souffla dans l'oreille : "Je crois quenous pourrons arranger l'affaire de ce cochon de Morin."
La nièces'était éloignée ; et j'abordai la questiondélicate. J'agitai le spectre du scandale ; je fis valoir ladépréciation inévitable que subirait la jeunepersonne après le bruit d'une pareille affaire ; car on necroirait jamais à un simple baiser.
Lebonhomme semblait indécis ; mais il ne pouvait rien décidersans sa femme qui ne rentrerait que tard dans la soirée. Toutà coup il poussa un cri de triomphe : "Tenezj'ai uneidée excellente. Je vous tiensje vous garde. Vous allezdîner et coucher ici tous les deux ; etquand ma femme serarevenuej'espère que nous nous entendrons. "
Rivetrésistait ; mais le désir de tirer d'affaire ce cochonde Morin le décida ; et nous acceptâmes l'invitation.
L'oncle selevaradieuxappela sa nièceet nous proposa une promenadedans sa propriétéen proclamant : "A ce soir lesaffaires sérieuses."
Rivet etlui se mirent à parler politique. Quant à moije metrouvai bientôt à quelques pas en arrièreàcôté de la jeune fille. Elle était vraimentcharmantecharmante !
Avec desprécautions infiniesje commençai à lui parlerde son aventure pour tâcher de m'en faire une alliée.
Mais ellene parut pas confuse le moins du monde ; elle m'écoutait del'air d'une personne qui s'amuse beaucoup.
Je luidisais : "Songez doncmademoiselleà tous les ennuisque vous aurez. Il vous faudra comparaître devant le tribunalaffronter les regards malicieuxparler en face de tout ce monderaconter publiquement cette triste scène du wagon. Voyonsentre nousn'auriez-vous pas mieux fait de ne rien direde remettreà sa place ce polisson sans appeler les employés ; etde changer simplement de voiture ?"
Elle semit à rire. "C'est vrai ce que vous dites ! mais quevoulez-vous ? J'ai eu peur ; etquand on a peuron ne raisonneplus. Après avoir compris la situationj'ai bien regrettémes cris ; mais il était trop tard. Songez aussi que cetimbécile s'est jeté sur moi comme un furieuxsansprononcer un motavec une figure de fou. Je ne savais même pasce qu'il me voulait."
Elle meregardait en facesans être troublée ou intimidée.Je me disais : "Mais c'est une gaillardecette fille. Jecomprends que ce cochon de Morin se soit trompé."
Je reprisen badinant : "Voyonsmademoiselleavouez qu'il étaitexcusablecarenfinon ne peut pas se trouver en face d'une aussibelle personne que vous sans éprouver le désirabsolument légitime de l'embrasser."
Elle ritplus forttoutes les dents au vent. "Entre le désir etl'actionmonsieuril y a place pour le respect."
La phraseétait drôlebien que peu claire. Je demandaibrusquement : "Eh bienvoyonssi je vous embrassaismoimaintenant ; qu'est-ce que vous feriez ?"
Elles'arrêta pour me considérer du haut en baspuis elledittranquillement : "Ohvousce n'est pas la mêmechose."
Je lesavais bienparbleuque ce n'était pas la même chosepuisqu'on m'appelait dans toute la province "le beau Labarbe".J'avais trente ansalorsmais je demandai : "Pourquoi ça?"
Ellehaussa les épauleset répondit : "Tiens ! parceque vous n'êtes pas aussi bête que lui. "Puis elleajoutaen me regardant en dessous : "Ni aussi laid."
Avantqu'elle eût pu faire un mouvement pour m'éviterje luiavais planté un bon baiser sur la joue. Elle sauta de côtémais trop tard. Puis elle dit : "Eh bien ! vous n'êtes pasgêné non plusvous. Mais ne recommencez pas ce jeu-là."
Je pris unair humble et je dis à mi-voix : "Oh ! mademoisellequant à moisi j'ai un désir au coeurc'est de passerdevant un tribunal pour la même cause que Morin."
Elledemanda à son tour : "Pourquoi ça ?" Je laregardai au fond des yeux sérieusement.
"Parceque vous êtes une des plus belles créatures qui soient ;parce que ce serait pour moi un brevetun titreune gloirequed'avoir voulu vous violenter. Parce qu'on diraitaprès vousavoir vue : "TiensLabarbe n'a pas volé ce qui luiarrivemais il a de la chance tout de même."
Elle seremit à rire de tout son coeur.
"Etes-vousdrôle ?" Elle n'avait pas fini le mot drôleque je la tenais à pleins bras et je lui jetais des baisersvoraces partout où je trouvais une placedans les cheveuxsur le frontsur les yeuxsur la bouche parfoissur les jouespartoute la têtedont elle découvrait toujours malgréelle un coin pour garantir les autres.
A la finelle se dégagearouge et blessée. "Vous êtesun grossiermonsieuret vous me faites repentir de vous avoirécouté."
Je luisaisis la mainun peu confusbalbutiant : "Pardonpardonmademoiselle. Je vous ai blessée ; j'ai étébrutal ! Ne m'en voulez pas. Si vous saviez ?..." Je cherchaisvainement une excuse.
Elleprononçaau bout d'un moment : "Je n'ai rien àsavoirmonsieur."
Maisj'avais trouvé ; je m'écriai : "Mademoisellevoici un an que je vous aime !"
Elle futvraiment surprise et releva les yeux. Je repris : "Ouimademoiselleécoutez-moi. Je ne connais pas Morin et je memoque bien de lui. Peu m'importe qu'il aille en prison et devant lestribunaux. Je vous ai vue icil'an passévous étiezlà-basdevant la grille. J'ai reçu une secousse envous apercevant et votre image ne m'a plus quitté. Croyez-moiou ne me croyez paspeu m'importe. Je vous ai trouvéeadorable ; votre souvenir me possédait ; j'ai voulu vousrevoir ; j'ai saisi le prétexte de cette bête de Morin ;et me voici. Les circonstances m'ont fait passer les bornes ;pardonnez-moije vous en suppliepardonnez-moi."
Elleguettait la vérité dans mon regardprête àsourire de nouveau ; et elle murmura : "Blagueur."
Je levaila mainetd'un ton sincère (je crois même que j'étaissincère) : "Je vous jure que je ne mens pas."
Elle ditsimplement : "Allons donc."
Nousétions seulstout seulsRivet et l'oncle ayant disparu dansles allées tournantes ; et je lui fis une vraie déclarationlonguedouceen lui pressant et lui baisant les doigts. Elleécoutait cela comme une chose agréable et nouvellesans bien savoir ce qu'elle en devait croire.
Jefinissais par me sentir troublépar penser ce que je disais ;j'étais pâleoppresséfrissonnant ; etdoucementje lui pris la taille.
Je luiparlais tout bas dans les petits cheveux frisés de l'oreille.Elle semblait morte tant elle restait rêveuse.
Puis samain rencontra la mienne et la serra ; je pressai lentement sa tailled'une étreinte tremblante et toujours grandissante ; elle neremuait plus du tout ; j'effleurais sa joue de ma bouche ; et tout àcoup mes lèvressans cherchertrouvèrent les siennes.Ce fut un longlong baiser ; et il aurait encore durélongtemps ; si je n'avais entendu "humhum" àquelques pas derrière moi.
Elles'enfuit à travers un massif. Je me retournai et j'aperçusRivet qui me rejoignait.
Il secampa au milieu du cheminet sans rire : "Eh bien ! c'est commeça que tu arranges l'affaire de ce cochon de Morin !"
Jerépondis avec fatuité : "On fait ce qu'on peut moncher. Et l'oncle ? Qu'en as-tu obtenu ? Moije réponds de lanièce."
Rivetdéclara : "J'ai été moins heureux avecl'oncle."
Et je luipris le bras pour rentrer.
III
Le dîneracheva de me faire perdre la tête. J'étais à côtéd'elle et ma main sans cesse rencontrait sa main sous la nappe ; monpied pressait son pied ; nos regards se joignaientse mêlaient.
On fitensuite un tour au clair de lune et je lui murmurai dans l'âmetoutes les tendresses qui me montaient du coeur. Je la tenais serréecontre moil'embrassant à tout momentmouillant mes lèvresaux siennes. Devant nousl'oncle et Rivet discutaient. Leurs ombresles suivaient gravement sur le sable des chemins.
On rentra.Et bientôt l'employé du télégraphe apportaune dépêche de la tante annonçant qu'elle nereviendrait que le lendemain matinà sept heurespar lepremier train.
L'oncledit : "Eh bienHenrietteva montrer leurs chambres àces messieurs." On serra la main du bonhomme et on monta. Ellenous conduisit d'abord dans l'appartement de Rivetet il me souffladans l'oreille : "Pas de danger qu'elle nous ait menéschez toi d'abord." Puis elle me guida vers mon lit. Dèsqu'elle fut seule avec moije la saisis de nouveau dans mes brastachant d'affoler sa raison et de culbuter sa résistance.Maisquand elle se sentit tout près de défaillirelles'enfuit.
Je meglissai entre mes drapstrès contrariétrèsagitéet très penaudsachant bien que je ne dormiraisguèrecherchant quelle maladresse j'avais pu commettrequandon heurta doucement ma porte.
Jedemandai : "Qui est là ?"
Une voixlégère répondit : "Moi."
Je mevêtis à la hâte ; j'ouvris ; elle entra. "J'aioubliédit-ellede vous demander ce que vous prenez le matin: du chocolatdu théou du café ?"
Je l'avaisenlacée impétueusementla dévorant de caressesbégayant : "Je prends... je prends... je prends..."Mais elle me glissa entre les brassouffla ma lumièreetdisparut.
Je restaiseulfurieuxdans l'obscuritécherchant des allumettesn'en trouvant pas. J'en découvris enfin et je sortis dans lecorridorà moitié foumon bougeoir à la main.
Qu'allais-jefaire ? Je ne raisonnais plus ; je voulais la trouver ; je lavoulais. Et je fis quelques pas sans réfléchir àrien. Puisje pensai brusquement : "Mais si j'entre chezl'oncle ? que dirai-je ?..." Et je demeurai immobilele cerveauvidele coeur battant. Au bout de plusieurs secondesla réponseme vint : "Parbleu je dirai que je cherchais la chambre de Rivetpour lui parler d'une chose urgente."
Et je memis à inspecter les portes m'efforçant de découvrirla sienneà elle. Mais rien ne pouvait me guider. Au hasardje pris une clef que je tournai. J'ouvrisj'entrai... Henrietteassise dans son liteffaréeme regardait.
Alors jepoussai doucement le verrou ; etm'approchant sur la pointe despiedsje lui dis : "J'ai oubliémademoisellede vousdemander quelque chose à lire." Elle se débattait; mais j'ouvris bientôt le livre que je cherchais. Je n'endirai pas le titre. C'était vraiment le plus merveilleux desromanset le plus divin des poèmes.
Une foistournée la première pageelle me le laissa parcourir àmon gré ; et j'en feuilletai tant de chapitres que nos bougiess'usèrent jusqu'au bout.
Puisaprès l'avoir remerciéeje regagnaisà pas deloupma chambrequand une main brutale m'arrêta ; et unevoixcelle de Rivetme chuchota dans le nez : "Tu n'as doncpas fini d'arranger l'affaire de ce cochon de Morin ?"
Dèssept heures du matinelle m'apportait elle-même une tasse dechocolat. Je n'en ai jamais bu de pareil. Un chocolat à s'enfaire mourirmoelleuxveloutéparfumégrisant. Jene pouvais ôter ma bouche des bords délicieux de satasse.
A peine lajeune fille était-elle sortie que Rivet entra. Il semblait unpeu nerveuxagacé comme un homme qui n'a guère dormi ;il me dit d'un ton maussade : "Si tu continuestu saistufiniras par gâter l'affaire de ce cochon de Morin."
A huitheuresla tante arrivait. La discussion fut courte. Les braves gensretiraient leur plainteet je laisserais cinq cents francs auxpauvres du pays.
Alorsonvoulut nous retenir à passer la journée. Onorganiserait même une excursion pour aller visiter des ruines.Henriette derrière le dos de ses parents me faisait des signesde tête : "Ouirestez donc." J'acceptaismais Rivets'acharna à s'en aller.
Je le prisà part ; je le priaije le sollicitai ; je lui disais :"Voyonsmon petit Rivetfais cela pour moi." Mais ilsemblait exaspéré et me répétait dans lafigure : "J'en ai assezentends-tude l'affaire de ce cochonde Morin."
Je fusbien contraint de partir aussi. Ce fut un des moments les plus dursde ma vie. J'aurais bien arrangé cette affaire-làpendant toute mon existence.
Dans lewagonaprès les énergiques et muettes poignéesde main des adieuxje dis à Rivet : "Tu n'es qu'unebrute." Il répondit : "Mon petittu commençaisà m'agacer bougrement."
Enarrivant aux bureaux du Fanalj'aperçus une foule quinous attendait... On criadès qu'on nous vit : "Eh bienavez-vous arrangé l'affaire de ce cochon de Morin ?"
Tout LaRochelle en était troublé. Rivetdont la mauvaisehumeur s'était dissipée en routeeut grand-peine àne pas rire en déclarant : "Ouic'est faitgrâceà Labarbe."
Et nousallâmes chez Morin.
Il étaitétendu dans un fauteuilavec des sinapismes aux jambes et descompresses d'eau froide sur le crânedéfaillantd'angoisse. Et il toussait sans cessed'une petite toux d'agonisantsans qu'on sût d'où lui était venu ce rhume. Safemme le regardait avec des yeux de tigresse prête à ledévorer.
Dèsqu'il nous aperçutil eut un tremblement qui lui secouait lespoignets et les genoux. Je dis : "C'est arrangésalaudmais ne recommence pas."
Il selevasuffoquantme prit les mainsles baisa comme celles d'unprincepleurafaillit perdre connaissanceembrassa Rivetembrassamême Mme Morin qui le rejeta d'une poussée dans sonfauteuil.
Mais il nese remit jamais de ce coup-làson émotion avait ététrop brutale.
On nel'appelait plus dans toute la contrée que "ce cochon deMorin"et cette épithète le traversait comme uncoup d'épée chaque fois qu'il l'entendait.
Quand unvoyou dans la rue criait : "Cochon"il retournait la têtepar instinct. Ses amis le criblaient de plaisanteries horriblesluidemandantchaque fois qu'ils mangeaient du jambon : "Est-ce dutien ?"
Il mourutdeux ans plus tard.
Quant àmoime présentant à la députation en 1875j'allai faire une visite intéressée au nouveau notairede Tousserremaître Belloncle. Une grande femme opulente etbelle me reçut.
"Vousne me reconnaissez pas ?" dit-elle.
Jebalbutiai : "Mais... non... madame.
-Henriette Bonnel.
- Ah !"Et je me sentis devenir pâle.
Ellesemblait parfaitement à son aiseet souriait en me regardant.
Dèsqu'elle m'eut laissé seul avec son mariil me prit les mainsles serrant à les broyer : "Voici longtempschermonsieurque je veux aller vous voir. Ma femme m'a tant parléde vous. Je sais... ouije sais en quelle circonstance douloureusevous l'avez connueje sais aussi comme vous avez étéparfaitplein de délicatessede tactde dévouementdans l'affaire..." Il hésitapuis prononça plusbascomme s'il eût articulé un mot grossier : "...Dans l'affaire de ce cochon de Morin."
LAFOLLE
A Robertde Bonnières.
TenezditM. Mathieu d'Endolinles bécasses me rappellent une biensinistre anecdote de la guerre.
Vousconnaissez ma propriété dans le faubourg de Cormeil. Jel'habitais au moment de l'arrivée des Prussiens.
J'avaisalors pour voisine une espèce de folle dont l'esprit s'étaitégaré sous les coups du malheur. Jadisà l'âgede vingt-cinq anselle avait perduen un seul moisson pèreson mari et son enfant nouveau-né.
Quand lamort est entrée une fois dans une maisonelle y revientpresque toujours immédiatementcomme si elle connaissait laporte.
La pauvrejeune femmefoudroyée par le chagrinprit le litdélirapendant six semaines. Puisune sorte de lassitude calme succédantà cette crise violenteelle resta sans mouvementmangeant àpeineremuant seulement les yeux. Chaque fois qu'on voulait la faireleverelle criait comme si on l'eût tuée. On la laissadonc toujours couchéene la tirant de ses draps que pour lessoins de sa toilette et pour retourner ses matelas.
Unevieille bonne restait près d'ellela faisant boire de tempsen temps ou mâcher un peu de viande froide. Que se passait-ildans cette âme désespérée ? On ne le sutjamais ; car elle ne parla plus. Songeait-elle aux morts ?Rêvassait-elle tristementsans souvenir précis ? Oubien sa pensée anéantie restait-elle immobile comme del'eau sans courant ?
Pendantquinze annéeselle demeura ainsi fermée et inerte.
La guerrevint ; etdans les premiers jours de décembreles Prussienspénétrèrent à Cormeil.
Je merappelle cela comme d'hier. Il gelait à fendre les pierres ;et j'étais étendu moi-même dans un fauteuilimmobilisé par la gouttequand j'entendis le battement lourdet rythmé de leurs pas. De ma fenêtreje les vispasser.
Ilsdéfilaient interminablementtous pareilsavec ce mouvementde pantins qui leur est particulier. Puis les chefs distribuèrentleurs hommes aux habitants. J'en eus dix-sept. La voisinela folleen avait douzedont un commandantvrai soudardviolentbourru.
Pendantles premiers jourstout se passa normalement. On avait dit àl'officier d'à côté que la dame étaitmaladeet il ne s'en inquiéta guère. Mais bientôtcette femme qu'on ne voyait jamais l'irrita. Il s'informa de lamaladie ; on répondit que son hôtesse étaitcouchée depuis quinze ans par suite d'un violent chagrin. Iln'en crut rien sans douteet s'imagina que la pauvre insenséene quittait pas son lit par fiertépour ne pas voir lesPrussienset ne leur point parleret ne les point frôler.
Il exigeaqu'elle le reçût ; on le fit entrer dans sa chambre. Ildemanda d'un ton brusque :
"Jevous prieraimatamede fous lever et de tescentre pour qu'on fousfoie."
Elletourna vers lui ses yeux vaguesses yeux videset ne réponditpas.
Il reprit:
"Chene tolérerai bas d'insolence. Si fous ne fous levez pas deponne volontéche trouverai pien un moyen de fous fairebromener toute seule."
Elle nefit pas un gestetoujours immobile comme si elle ne l'eût pasvu.
Ilrageaitprenant ce silence pour une marque de mépris suprême.Et il ajouta :
"Sivous n'êtes pas tescentue temain..."
Puisilsortit.
Lelendemainla vieille bonneéperduela voulut habiller ;mais la folle se mit à hurler en se débattant.L'officier monta bien vite ; et la servantese jetant à sesgenouxcria :
"Ellene veut pasmonsieurelle ne veut pas. Pardonnez-lui ; elle est simalheureuse."
Le soldatrestait embarrassé n'osantmalgré sa colèrelafaire tirer du lit par ses hommes. Mais soudain il se mit àrire et donna des ordres en allemand.
Et bientôton vit sortir un détachement qui soutenait un matelas comme onporte un blessé. Dans ce lit qu'on n'avait point défaitla folle toujours silencieuserestait tranquilleindifférenteaux événementstant qu'on la laissait couchée.Un homme par-derrière portait un paquet de vêtementsféminins.
Etl'officier prononça en se frottant les mains :
"Nousferrons pien si vous poufez bas vous hapiller toute seule et faireune bétite bromenate."
Puis onvit s'éloigner le cortège dans la direction de la forêtd'Imauville.
Deuxheures plus tardles soldats revinrent tout seuls.
On nerevit plus la folle. Qu'en avaient-ils fait ? Où l'avaient-ilsportée ? On ne le sut jamais.
La neigetombait maintenant jour et nuitensevelissant la plaine et les boissous un linceul de mousse glacée. Les loups venaient hurlerjusqu'à nos portes.
La penséede cette femme perdue me hantait ; et je fis plusieurs démarchesauprès de l'autorité prussienneafin d'obtenir desrenseignements. Je faillis être fusillé.
Leprintemps revint. L'armée d'occupation s'éloigna. Lamaison de ma voisine restait fermée ; l'herbe drue poussaitdans les allées.
La vieillebonne était morte pendant l'hiver. Personne ne s'occupait plusde cette aventure ; moi seul y songeais sans cesse.
Qu'avaient-ilsfait de cette femme ? s'était-elle enfuie à travers lesbois ! L'avait-on recueillie quelque partet gardée dans unhôpital sans pouvoir obtenir d'elle aucun renseignement. Rienne venait alléger mes doutes ; maispeu à peuletemps apaisa le souci de mon coeur.
Oràl'automne suivantles bécasses passèrent en masse ;etcomme ma goutte me laissait un peu de répitje me traînaijusqu'à la forêt. J'avais déjà tuéquatre ou cinq oiseaux à long becquand j'en abattis un quidisparut dans un fossé plein de branches. Je fus obligéd'y descendre pour y ramasser ma bête. Je la trouvai tombéeauprès d'une tête de mort. Et brusquement le souvenir dela folle m'arriva dans la poitrine comme un coup de poing. Biend'autres avaient expiré dans ces bois peut-être en cetteannée sinistre ; mais je ne sais pourquoij'étais sûrsûrvous dis-jeque je rencontrais la tête de cettemisérable maniaque.
Et soudainje comprisje devinai tout. Ils l'avaient abandonnée sur cematelasdans la forêt froide et déserteetfidèleà son idée fixeelle s'était laisséemourir sous l'épais et léger duvet des neiges et sansremuer le bras ou la jambe.
Puis lesloups l'avaient dévorée.
Et lesoiseaux avaient fait leur nid avec la laine de son lit déchiré.
J'ai gardéce triste ossement. Et je fais des voeux pour que nos fils ne voientplus jamais de guerre.
PIERROT
A HenriRoujon.
MadameLefèvre était une dame de campagneune veuveune deces demi-paysannes à rubans et à chapeaux falbalasdeces personnes qui parlent avec des cuirsprennent en public des airsgrandioseset cachent une âme de brute prétentieusesous des dehors comiques et chamarréscomme elles dissimulentleurs grosses mains rouges sous des gants de soie écrue.
Elle avaitpour servante une brave campagnarde toute simplenommée Rose.
Les deuxfemmes habitaient une petite maison à volets vertsle longd'une routeen Normandieau centre du pays de Caux.
Commeelles possédaientdevant l'habitationun étroitjardinelles cultivaient quelques légumes.
Orunenuiton lui vola une douzaine d'oignons.
Dèsque Rose s'aperçut du larcinelle courut prévenirMadamequi descendit en jupe de laine. Ce fut une désolationet une terreur. On avait volévolé Mme Lefèvre! Doncon volait dans le payspuis on pouvait revenir.
Et lesdeux femmes effarées contemplaient les traces de pasbavardaientsupposaient des choses : "Tenezils ont passépar là. Ils ont mis leurs pieds sur le mur ; ils ont sautédans la plate-bande."
Et elless'épouvantaient pour l'avenir. Comment dormir tranquillesmaintenant !
Le bruitdu vol se répandit. Les voisins arrivèrentconstatèrentdiscutèrent à leur tour ; et lesdeux femmes expliquaient à chaque nouveau venu leursobservations et leurs idées.
Un fermierd'à côté leur offrit ce conseil : "Vousdevriez avoir un chien."
C'étaitvraicela ; elles devraient avoir un chienquand ce ne serait quepour donner l'éveil. Pas un gros chienSeigneur ! Queferaient-elles d'un gros chien ! Il les ruinerait en nourriture. Maisun petit chien (en Normandieon prononce quin)un petitfreluquet de quin qui jappe.
Dèsque tout le monde fut partiMme Lefèvre discuta longtempscette idée de chien. Elle faisaitaprès réflexionmille objectionsterrifiée par l'image d'une jatte pleine depâtée ; car elle était de cette raceparcimonieuse de dames campagnardes qui portent toujours des centimesdans leur poche pour faire l'aumône ostensiblement aux pauvresdes cheminset donner aux quêtes du dimanche.
Rosequiaimait les bêtesapporta ses raisons et les défenditavec astuce. Donc il fut décidé qu'on aurait un chienun tout petit chien.
On se mità sa recherchemais on n'en trouvait que des grandsdesavaleurs de soupe à faire frémir. L'épicier deRolleville en avait bien untout petitmais il exigeait qu'on lelui payât deux francspour couvrir ses frais d'élevage.Mme Lefèvre déclara qu'elle voulait bien nourrir un"quin"mais qu'elle n'en achèterait pas.
Orleboulangerqui savait les événementsapporta un matindans sa voitureun étrange petit animal tout jaunepresquesans pattesavec un corps de crocodileune tête de renard etune queue en trompetteun vrai panachegrand comme tout le reste desa personne. Un client cherchait à s'en défaire. MmeLefèvre trouva fort beau ce roquet immondequi ne coûtaitrien. Rose l'embrassapuis demanda comment on le nommait. Leboulanger répondit : "Pierrot."
Il futinstallé dans une vieille caisse à savon et on luioffrit d'abord de l'eau à boire. Il but. On lui présentaensuite un morceau de pain. Il mangea. Mme Lefèvreinquièteeut une idée : "Quand il sera bien accoutumé àla maisonon le laissera libre. Il trouvera à manger enrôdant dans le pays."
On lelaissa libreen effetce qui ne l'empêcha point d'êtreaffamé. Il ne jappait d'ailleurs que pour réclamer sapitance ; maisdans ce casil jappait avec acharnement.
Tout lemonde pouvait entrer dans le jardin. Pierrot allait caresser chaquenouveau venuet demeurait absolument muet.
MmeLefèvre cependant s'était accoutumée àcette bête. Elle en arrivait même à l'aimeret àlui donner de sa mainde temps en tempsdes bouchées de paintrempées dans la sauce de son fricot.
Mais ellen'avait nullement songé à l'impôtet quand onlui réclama huit francs - huit francsmadame ! - pour cefreluquet de quin qui ne jappait seulement pointelle faillits'évanouir de saisissement.
Il futimmédiatement décidé qu'on se débarrasseraitde Pierrot. Personne n'en voulut. Tous les habitants le refusèrentà dix lieues aux environs. Alors on se résolutfauted'autre moyenà lui faire "piquer du mas".
"Piquerdu mas"c'est "manger de la marne". On fait piquer dumas à tous les chiens dont on veut se débarrasser.
Au milieud'une vaste plaineon aperçoit une espèce de hutteouplutôt un tout petit toit de chaumeposé sur le sol.C'est l'entrée de la marnière. Un grand puits toutdroit s'enfonce jusqu'à vingt mètres sous terrepouraboutir à une série de longues galeries de mines.
On descendune fois par an dans cette carrièreà l'époqueoù l'on marne les terres. Tout le reste du tempselle sert decimetière aux chiens condamnéset souventquand onpasse auprès de l'orificedes hurlements plaintifsdesaboiements furieux ou désespérésdes appelslamentables montent jusqu'à vous.
Les chiensdes chasseurs et des bergers s'enfuient avec épouvante desabords de ce trou gémissantetquand on se penche au-dessusil sort de là une abominable odeur de pourriture.
Des dramesaffreux s'y accomplissent dans l'ombre.
Quand unebête agonise depuis dix à douze jours dans le fondnourrie par les restes immondes de ses devanciersun nouvel animalplus grosplus vigoureux certainementest précipitétout à coup. Ils sont làseulsaffaméslesyeux luisants. Ils se guettentse suiventhésitentanxieux.Mais la faim les presse : ils s'attaquentluttent longtempsacharnés ; et le plus fort mange le plus faiblele dévorevivant.
Quand ilfut décidé qu'on ferait "piquer du mas" àPierroton s'enquit d'un exécuteur. Le cantonnier qui binaitla route demanda six sous pour la course. Cela parut follementexagéré à Mme Lefèvre. Le goujat duvoisin se contentait de cinq sous ; c'était trop encore ; etRose ayant fait observer qu'il valait mieux qu'elles le portassentelles-mêmesparce qu'ainsi il ne serait pas brutaliséen route et averti de son sortil fut résolu qu'elles iraienttoutes les deux à la nuit tombante.
On luioffritce soir-làune bonne soupe avec un doigt de beurre.Il l'avala jusqu'à la dernière goutte ; etcomme ilremuait la queue de contentementRose le prit dans son tablier.
Ellesallaient à grands pascomme des maraudeusesà traversla plaine. Bientôt elles aperçurent la marnièreet l'atteignirent ; Mme Lefèvre se pencha pour écoutersi aucune bête ne gémissait. - Non - il n'y en avait pas; Pierrot serait seul. Alors Rose qui pleuraitl'embrassapuis lelança dans le trou ; et elles se penchèrent toutesdeuxl'oreille tendue.
Ellesentendirent d'abord un bruit sourd ; puis la plainte aiguëdéchiranted'une bête blesséepuis unesuccession de petits cris de douleurpuis des appels désespérésdes supplications de chien qui imploraitla tête levéevers l'ouverture
Iljappaitoh ! il jappait !
Ellesfurent saisies de remordsd'épouvanted'une peur folle etinexplicable ; et elles se sauvèrent en courant. EtcommeRose allait plus viteMme Lefèvre criait : "Attendez-moiRoseattendez-moi !"
Leur nuitfut hantée de cauchemars épouvantables.
MmeLefèvre rêva qu'elle s'asseyait à table pourmanger la soupemaisquand elle découvrait la soupièrePierrot était dedans. Il s'élançait et lamordait au nez.
Elle seréveilla et crut l'entendre japper encore. Elle écouta; elle s'était trompée.
Elles'endormit de nouveau et se trouva sur une grande routeune routeinterminablequ'elle suivait. Tout à coupau milieu ducheminelle aperçut un panierun grand panier de fermierabandonnéet ce panier lui faisait peur.
Ellefinissait cependant par l'ouvriret Pierrotblotti dedansluisaisissait la mainne la lâchait pluset elle se sauvaitéperdueportant ainsi au bout du bras le chien suspendulagueule serrée.
Au petitjourelle se levapresque folleet courut à la marnière.
Il jappait; il jappait encoreil avait jappé toute la nuit. Elle se mità sangloter et l'appela avec mille petits noms caressants. Ilrépondit avec toutes les inflexions tendres de sa voix dechien.
Alors ellevoulut le revoirse promettant de le rendre heureux jusqu'àsa mort.
Ellecourut chez le puisatier chargé de l'extraction de la marneet elle lui raconta son cas. L'homme écoutait sans rien dire.Quand elle eut finiil prononça : "Vous voulez votrequin ? Ce sera quatre francs."
Elle eutun sursaut ; toute sa douleur s'envola du coup.
"Quatrefrancs ! vous vous en feriez mourir ! quatre francs !"
Ilrépondit : "Vous croyez que j' vas apporter mes cordesmes manivelleset monter tout çaet m' n' aller là-basavec mon garçon et m' faire mordre encore par votre mauditquinpour l' plaisir de vous le r'donner ? fallait pas l'jeter."
Elle s'enallaindignée. - Quatre francs !
Aussitôtrentréeelle appela Rose et lui dit les prétentions dupuisatier. Rosetoujours résignéerépétait: "Quatre francs ! c'est de l'argentmadame."
Puiselleajouta : "Si on lui jetait à mangerà ce pauvrequinpour qu'il ne meure pas comme ça ?"
MmeLefèvre approuvatoute joyeuse ; et les voilàrepartiesavec un gros morceau de pain beurré.
Elles lecoupèrent par bouchées qu'elles lançaient l'uneaprès l'autreparlant tour à tour à Pierrot. Etsitôt que le chien avait achevé un morceauil jappaitpour réclamer le suivant
Ellesrevinrent le soirpuis le lendemaintous les jours. Mais elles nefaisaient plus qu'un voyage.
Orunmatinau moment de laisser tomber la première bouchéeelles entendirent tout à coup un aboiement formidable dans lepuits. Ils étaient deux ! On avait précipité unautre chienun gros !
Rose cria: "Pierrot !" Et Pierrot jappajappa. Alors on se mit àjeter la nourriture ; maischaque fois elles distinguaientparfaitement une bousculade terriblepuis les cris plaintifs dePierrot mordu par son compagnonqui mangeait toutétant leplus fort.
Ellesavaient beau spécifier : "C'est pour toiPierrot !"Pierrotévidemmentn'avait rien.
Les deuxfemmes interditesse regardaient ; et Mme Lefèvre prononçad'un ton aigre : "Je ne peux pourtant pas nourrir tous leschiens qu'on jettera là-dedans. Il faut y renoncer."
Etsuffoquée à l'idée de tous ces chiens vivant àses dépenselle s'en allaemportant même ce quirestait du pain qu'elle se mit à manger en marchant.
Rose lasuivit en s'essuyant les yeux du coin de son tablier bleu.
MENUET
A PaulBourget.
Les grandsmalheurs ne m'attristent guèredit Jean Bridelleun vieuxgarçon qui passait pour sceptique. J'ai vu la guerre de bienprès : j'enjambais les corps sans apitoiement. Les fortesbrutalités de la nature ou des hommes peuvent nous fairepousser des cris d'horreur ou d'indignationmais ne nous donnentpoint ce pincement au coeurce frisson qui vous passe dans le dos àla vue de certaines petites choses navrantes.
La plusviolente douleur qu'on puisse éprouvercertesest la perted'un enfant pour une mèreet la perte de la mère pourun homme. Cela est violentterriblecela bouleverse et déchire; mais on guérit de ces catastrophes comme des largesblessures saignantes. Orcertaines rencontrescertaines chosesentr'aperçuesdevinéescertains chagrins secretscertaines perfidies du sortqui remuent en nous tout un mondedouloureux de penséesqui entrouvrent devant nous brusquementla porte mystérieuse des souffrances moralescompliquéesincurablesd'autant plus profondes qu'elles semblent bénignesd'autant plus cuisantes qu'elles semblent presque insaisissablesd'autant plus tenaces qu'elles semblent facticesnous laissent àl'âme comme une traînée de tristesseun goûtd'amertumeune sensation de désenchantement dont nous sommeslongtemps à nous débarrasser.
J'aitoujours devant les yeux deux ou trois choses que d'autres n'eussentpoint remarquées assurémentet qui sont entréesen moi comme de longues et minces piqûres inguérissables.
Vous necomprendriez peut-être pas l'émotion qui m'est restéede ces rapides impressions. Je ne vous en dirai qu'une. Elle est trèsvieillemais vive comme d'hier. Il se peut que mon imagination seuleait fait les frais de mon attendrissement.
J'aicinquante ans. J'étais jeune alors et j'étudiais ledroit. Un peu tristeun peu rêveurimprégnéd'une philosophie mélancoliqueje n'aimais guère lescafés bruyantsles camarades braillardsni les fillesstupides. Je me levais tôt ; et une de mes plus chèresvoluptés était de me promener seulvers huit heures dumatindans la pépinière du Luxembourg.
Vous nel'avez pas connuevous autrescette pépinière ?C'était comme un jardin oublié de l'autre siècleun jardin joli comme un doux sourire de vieille. Des haies touffuesséparaient les allées étroites et régulièresallées calmes entre deux murs de feuillage taillés avecméthode. Les grands ciseaux du jardinier alignaient sansrelâche ces cloisons de branches ; etde place en placeonrencontrait des parterres de fleursdes plates-bandes de petitsarbres rangés comme des collégiens en promenadedessociétés de rosiers magnifiques ou des régimentsd'arbres à fruits.
Tout uncoin de ce ravissant bosquet était habité par lesabeilles. Leurs maisons de paillesavamment espacées sur desplanchesouvraient au soleil leurs portes grandes comme l'entréed'un dé à coudre ; et on rencontrait tout le long deschemins les mouches bourdonnantes et doréesvraies maîtressesde ce lieu pacifiquevraies promeneuses de ces tranquilles alléesen corridors.
Je venaislà presque tous les matins. Je m'asseyais sur un banc et jelisais. Parfois je laissais retomber le livre sur mes genoux pourrêverpour écouter autour de moi vivre Pariset jouirdu repos infini de ces charmilles à la mode ancienne.
Mais jem'aperçus bientôt que je n'étais pas seul àfréquenter ce lieu dès l'ouverture des barrièreset je rencontrais parfoisnez à nezau coin d'un massifunétrange petit vieillard.
Il portaitdes souliers à boucles d'argentune culotte à pontune redingote tabac d'Espagneune dentelle en guise de cravate et uninvraisemblable chapeau gris à grands bords et à grandspoilsqui faisait penser au déluge.
Il étaitmaigrefort maigreanguleuxgrimaçant et souriant. Ses yeuxvifs palpitaients'agitaient sous un mouvement continu des paupières; et il avait toujours à la main une superbe canne àpommeau d'or qui devait être pour lui quelque souvenirmagnifique.
Cebonhomme m'étonna d'abordpuis m'intéressa outremesure. Et je le guettais à travers les murs de feuillesjele suivais de loinm'arrêtant au détour des bosquetspour n'être point vu.
Et voilàqu'un matincomme il se croyait bien seulil se mit à fairedes mouvements singuliers : quelques petits bonds d'abordpuis unerévérence ; puis il battitde sa jambe grêleunentrechat encore alertepuis il commença à pivotergalammentsautillantse trémoussant d'une façondrôlesouriant comme devant un publicfaisant des grâcesarrondissant les brastortillant son pauvre corps de marionnetteadressant dans le vide de légers saluts attendrissants etridicules. Il dansait !
Jedemeurais pétrifié d'étonnementme demandantlequel des deux était fouluiou moi.
Mais ils'arrêta soudains'avança comme font les acteurs sur lascènepuis s'inclina en reculant avec des sourires gracieuxet des baisers de comédienne qu'il jetait de sa maintremblante aux deux rangées d'arbres taillés.
Et ilreprit avec gravité sa promenade.
A partirde ce jourje ne le perdis plus de vue ; etchaque matinilrecommençait son exercice invraisemblable.
Une enviefolle me prit de lui parler. Je me risquaietl'ayant saluéje lui dis :
"Ilfait bien bon aujourd'huimonsieur."
Ils'inclina.
"Ouimonsieurc'est un vrai temps de jadis."
Huit joursaprèsnous étions amiset je connus son histoire. Ilavait été maître de danse à l'Opéradu temps du roi Louis XV. Sa belle canne était un cadeau ducomte de Clermont. Etquand on lui parlait de danseil nes'arrêtait plus de bavarder.
Orvoilàqu'un jour il me confia :
"J'aiépousé la Castrismonsieur. Je vous présenteraisi vous voulezmais elle ne vient ici que sur le tantôt. Cejardinvoyez-vousc'est notre plaisir et notre vie. C'est tout cequi nous reste d'autrefois. Il nous semble que nous ne pourrions plusexister si nous ne l'avions point. Cela est vieux et distinguén'est-ce pas ? Je crois y respirer un air qui n'a point changédepuis ma jeunesse.
Ma femmeet moinous y passons tous nos après-midi. Maismoij'yviens dès le matincar je me lève de bonne heure."
Dèsque j'eus fini de déjeunerje retournai au Luxembourgetbientôt j'aperçus mon ami qui donnait le bras aveccérémonie à une toute vieille petite femme vêtuede noiret à qui je fus présenté. C'étaitla Castrisla grande danseuse aimée des princesaiméedu roiaimée de tout ce siècle galant qui semble avoirlaissé dans le monde une odeur d'amour.
Nous nousassîmes sur un banc de pierre. C'était au mois de mai.Un parfum de fleurs voltigeait dans les allées proprettes ; unbon soleil glissait entre les feuilles et semait sur nous de largesgouttes de lumière. La robe noire de la Castris semblait toutemouillée de clarté.
Le jardinétait vide. On entendait au loin rouler des fiacres.
"Expliquez-moidoncdis-je au vieux danseurce que c'était que le menuet ?"
Iltressaillit.
"Lemenuetmonsieurc'est la reine des danses et la danse des reinesentendez-vous ? Depuis qu'il n'y a plus de roiil n'y a plus demenuet."
Et ilcommençaen style pompeuxun long éloge dithyrambiqueauquel je ne compris rien. Je voulus me faire décrire les pastous les mouvementsles poses. Il s'embrouillaits'exaspérantde son impuissancenerveux et désolé.
Etsoudainse tournant vers son antique compagnetoujours silencieuseet grave :
"Éliseveux-tudisveux-tutu seras bien gentilleveux-tu que nousmontrions à Monsieur ce que c'était ?"
Elletourna ses yeux inquiets de tous les côtéspuis se levasans dire un mot et vint se placer en face de lui.
Alors jevis une chose inoubliable.
Ilsallaient et venaient avec des simagrées enfantinessesouriaientse balançaients'inclinaientsautillaientpareils à deux vieilles poupées qu'aurait fait danserune mécanique ancienneun peu briséeconstruite jadispar un ouvrier fort habilesuivant la manière de son temps.
Et je lesregardaisle coeur troublé de sensations extraordinairesl'âme émue d'une indicible mélancolie. Il mesemblait voir une apparition lamentable et comiquel'ombre démodéed'un siècle. J'avais envie de rire et besoin de pleurer.
Tout àcoup ils s'arrêtèrentils avaient terminé lesfigures de la danse. Pendant quelques secondes ils restèrentdebout l'un devant l'autregrimaçant d'une façonsurprenante ; puis il s'embrassèrent en sanglotant.
Jepartaistrois jours aprèspour la province. Je ne les aipoint revus. Quand je revins à Parisdeux ans plus tardonavait détruit la pépinière. Que sont-ils devenussans le cher jardin d'autrefoisavec ses chemins en labyrinthesonodeur du passé et les détours gracieux des charmilles ?
Sont-ilsmorts ? Errent-ils par les rues modernes comme des exilés sansespoir ? Dansent-ilsspectres falotsun menuet fantastique entreles cyprès d'un cimetièrele long des sentiers bordésde tombesau clair de lune ?
Leursouvenir me hantem'obsèdeme torturedemeure en moi commeune blessure. Pourquoi ? Je n'en sais rien.
Voustrouverez cela ridiculesans doute ?
LAPEUR
A J.-KHuysmans.
On remontasur le pont après dîner. Devant nousla Méditerranéen'avait pas un frisson sur toute sa surfacequ'une grande lune calmemoirait. Le vaste bateau glissaitjetant sur le cielqui semblaitensemencé d'étoilesun gros serpent de fuméenoire ; etderrière nousl'eau toute blancheagitéepar le passage rapide du lourd bâtimentbattue par l'hélicemoussaitsemblait se tordreremuait tant de clartés qu'oneût dit de la lumière de lune bouillonnant.
Nousétions làsix ou huitsilencieuxadmirantl'oeiltourné vers l'Afrique lointaine où nous allions. Lecommandantqui fumait un cigare au milieu de nousreprit soudain laconversation du dîner.
"Ouij'ai eu peur ce jour-là. Mon navire est resté sixheures avec ce rocher dans le ventrebattu par la mer. Heureusementque nous avons été recueillisvers le soirpar uncharbonnier anglais qui nous aperçut."
Alors ungrand homme à figure brûléeà l'aspectgraveun de ces hommes qu'on sent avoir traversé de longspays inconnusau milieu de dangers incessantset dont l'oeiltranquille semble garderdans sa profondeurquelque chose despaysages étranges qu'il a vus ; un de ces hommes qu'on devinetrempés dans le courageparla pour la première fois :
"Vousditescommandantque vous avez eu peur : je n'en crois rien. Vousvous trompez sur le mot et sur la sensation que vous avez éprouvée.Un homme énergique n'a jamais peur en face du danger pressant.Il est émuagitéanxieux ; mais la peurc'est autrechose."
Lecommandant reprit en riant :
"Fichtre! je vous réponds bien que j'ai eu peurmoi."
Alorsl'homme au teint bronzé prononça d'une voix lente :
*
"Permettez-moide m'expliquer ! La peur (et les hommes les plus hardis peuvent avoirpeur)c'est quelque chose d'effroyableune sensation atrocecommeune décomposition de l'âmeun spasme affreux de lapensée et du coeurdont le souvenir seul donne des frissonsd'angoisse. Mais cela n'a lieuquand on est braveni devant uneattaqueni devant la mort inévitableni devant toutes lesformes connues du péril : cela a lieu dans certainescirconstances anormalessous certaines influences mystérieusesen face de risques vagues. La vraie peurc'est quelque chose commeune réminiscence des terreurs fantastiques d'autrefois. Unhomme qui croit aux revenantset qui s'imagine apercevoir un spectredans la nuitdoit éprouver la peur en toute son épouvantablehorreur.
"Moij'ai deviné la peur en plein jouril y a dix ans environ. Jel'ai ressentiel'hiver dernierpar une nuit de décembre.
"Etpourtantj'ai traversé bien des hasardsbien des aventuresqui semblaient mortelles. Je me suis battu souvent. J'ai étélaissé pour mort par des voleurs. J'ai étécondamnécomme insurgéà être penduenAmériqueet jeté à la mer du pont d'un bâtimentsur les côtes de Chine. Chaque fois je me suis cru perduj'enai pris immédiatement mon partisans attendrissement et mêmesans regrets.
"Maisla peurce n'est pas cela.
"Jel'ai pressentie en Afrique. Et pourtant elle est fille du Nord : lesoleil la dissipe comme un brouillard. Remarquez bien cecimessieurs. Chez les Orientauxla vie ne compte pour rien : on estrésigné tout de suite : les nuits sont claires et videsde légendesles âmes aussi vides des inquiétudessombres qui hantent les cerveaux dans les pays froids. En Orientonpeut connaître la paniqueon ignore la peur.
"Ehbien ! voici ce qui m'est arrivé sur cette terre d'Afrique :
"Jetraversais les grandes dunes au sud de Ouargla. C'est là undes plus étranges pays du monde. Vous connaissez le sable unile sable droit des interminables plages de l'Océan. Eh bien !figurez-vous l'Océan lui-même devenu sable au milieud'un ouragan : imaginez une tempête silencieuse de vaguesimmobiles en poussière jaune. Elles sont hautes comme desmontagnesces vagues inégalesdifférentessoulevéestout à fait comme des flots déchaînésmais plus grandes encoreet striées comme de la moire. Surcette mer furieusemuette et sans mouvementle dévorantsoleil du sud verse sa flamme implacable et directe.
Il fautgravir ces lames de cendre d'orredescendregravir encoregravirsans cessesans repos et sans ombre. Les chevaux râlentenfoncent jusqu'aux genouxet glissent en dévalant l'autreversant des surprenantes collines.
"Nousétions deux amis suivis de huit spahis et de quatre chameauxavec leurs chameliers. Nous ne parlions plusaccablés dechaleurde fatigueet desséchés de soif comme cedésert ardent. Soudain un de ces hommes poussa une sorte decri ; tous s'arrêtèrentet nous demeurâmesimmobilessurpris par un inexplicable phénomène connudes voyageurs en ces contrées perdues.
"Quelquepartprès de nousdans une direction indéterminéeun tambour battaitle mystérieux tambour des dunes ; ilbattait distinctementtantôt plus vibranttantôtaffaibliarrêtantpuis reprenant son roulement fantastique.
"LesArabesépouvantésse regardaient ; et l'un diten salangue : "La mort est sur nous." Et voilà que tout àcoup mon compagnonmon amipresque mon frèretomba dechevalla tête en avantfoudroyé par une insolation.
"Etpendant deux heurespendant que j'essayais en vain de le sauvertoujours ce tambour insaisissable m'emplissait l'oreille de son bruitmonotoneintermittent et incompréhensible ; et je sentais seglisser dans mes os la peurla vraie peurla hideuse peuren facede ce cadavre aimédans ce trou incendié par le soleilentre quatre monts de sabletandis que l'écho inconnu nousjetaità deux cents lieues de tout village françaisle battement rapide du tambour.
"Cejour-làje compris ce que c'était que d'avoir peur ;je l'ai su mieux encore une autre fois..."
Lecommandant interrompit le conteur :
"Pardonmonsieurmais ce tambour ? Qu'était-ce ?"
Levoyageur répondit :
"Jen'en sais rien. Personne ne sait. Les officierssurpris souvent parce bruit singulierl'attribuent généralement àl'écho grossimultipliédémesurémentenflé par les vallonnements des dunesd'une grêle degrains de sable emportés dans le vent et heurtant une touffed'herbes sèches ; car on a toujours remarqué que lephénomène se produit dans le voisinage de petitesplantes brûlées par le soleilet dures comme duparchemin.
"Cetambour ne serait donc qu'une sorte de mirage du son. Voilàtout. Mais je n'appris cela que plus tard.
"J'arriveà ma seconde émotion.
"C'étaitl'hiver dernierdans une forêt du nord-est de la France. Lanuit vint deux heures plus tôttant le ciel étaitsombre. J'avais pour guide un paysan qui marchait à mon côtépar un tout petit cheminsous une voûte de sapins dont le ventdéchaîné tirait des hurlements. Entre les cimesje voyais courir des nuages en déroutedes nuages éperdusqui semblaient fuir devant une épouvante. Parfoissous uneimmense rafaletoute la forêt s'inclinait dans le mêmesens avec un gémissement de souffrance ; et le froidm'envahissait malgré mon pas rapide et mon lourd vêtement.
"Nousdevions souper et coucher chez un garde forestier dont la maisonn'était plus éloignée de nous. J'allais làpour chasser.
"Monguideparfoislevait les yeux et murmurait : "Triste temps !"Puis il me parla des gens chez qui nous arrivions. Le pèreavait tué un braconnier deux ans auparavantetdepuis cetempsil semblait sombrecomme hanté d'un souvenir. Ses deuxfilsmariésvivaient avec lui.
"Lesténèbres étaient profondes. Je ne voyais riendevant moini autour de moiet toute la branchure des arbresentrechoqués emplissait la nuit d'une rumeur incessante.Enfinj'aperçus une lumièreet bientôt moncompagnon heurtait une porte. Des cris aigus de femmes nousrépondirent. Puisune voix d'hommeune voix étrangléedemanda : "Qui va là ?" Mon guide se nomma. Nousentrâmes. Ce fut un inoubliable tableau.
"Unvieux homme à cheveux blancsà l'oeil foule fusilchargé dans la mainnous attendait debout au milieu de lacuisinetandis que deux grands gaillards armés de hachesgardaient la porte. Je distinguai dans les coins sombres deux femmesà genouxle visage caché contre le mur.
"Ons'expliqua. Le vieux remit son arme contre le mur et ordonna depréparer ma chambre ; puiscomme les femmes ne bougeaientpointil me dit brusquement :
"Voyez-vousmonsieurj'ai tué un hommevoilà deux anscettenuit. L'autre annéeil est revenu m'appeler. Je l'attendsencore ce soir."
"Puisil ajouta d'un ton qui me fit sourire :
"Aussinous ne sommes pas tranquilles."
"Jele rassurai comme je pusheureux d'être venu justement cesoir-làet d'assister au spectacle de cette terreursuperstitieuse. Je racontai des histoireset je parvins àcalmer à peu près tout le monde.
"Prèsdu foyerun vieux chienpresque aveugle et moustachuun de ceschiens qui ressemblent à des gens qu'on connaîtdormaitle nez dans ses pattes.
"Au-dehorsla tempête acharnée battait la petite maisonetpar unétroit carreauune sorte de judas placé près dela porteje voyais soudain tout un fouillis d'arbres bousculéspar le vent à la lueur de grands éclairs.
"Malgrémes effortsje sentais bien qu'une terreur profonde tenait ces genset chaque fois que je cessais de parlertoutes les oreillesécoutaient au loin. Las d'assister à ces craintesimbécilesj'allais demander à me coucherquand levieux garde tout à coup fit un bond de sa chaisesaisit denouveau son fusilen bégayant d'une voix égarée: "Le voilà le voilà ! Je l'entends !" Lesdeux femmes retombèrent à genoux dans leurs coins en secachant le visage ; et les fils reprirent leurs haches. J'allaistenter encore de les apaiserquand le chien endormi s'éveillabrusquement etlevant sa têtetendant le couregardant versle feu de son oeil presque éteintil poussa un de ceslugubres hurlements qui font tressaillir les voyageursle soirdansla campagne. Tous les yeux se portèrent sur luiil restaitmaintenant immobiledressé sur ses pattes comme hantéd'une visionet il se remit à hurler vers quelque chosed'invisibled'inconnud'affreux sans doutecar tout son poil sehérissait. Le gardelividecria : "Il le sent ! "ille sent ! il était là quand je l'ai tué."Et les femmes égarées se mirenttoutes les deuxàhurler avec le chien.
"Malgrémoiun grand frisson me courut entre les épaules. Cettevision de l'animal dans ce lieuà cette heureau milieu deces gens éperdusétait effrayante à voir.
"Alorspendant une heurele chien hurla sans bouger ; il hurla comme dansl'angoisse d'un rêve ; et la peurl'épouvantable peurentrait en moi ; la peur de quoi ? Le sais-je ? C'était lapeurvoilà tout.
"Nousrestions immobileslividesdans l'attente d'un événementaffreuxl'oreille tenduele coeur battantbouleversés aumoindre bruit. Et le chien se mit à tourner autour de lapièceen sentant les murs et gémissant toujours. Cettebête nous rendait fous ! Alorsle paysan qui m'avait amenése jeta sur elledans une sorte de paroxysme de terreur furieuseetouvrant une porte donnant sur une petite courjeta l'animaldehors.
"Ilse tut aussitôt ; et nous restâmes plongés dans unsilence plus terrifiant encore. Et soudaintous ensemblenous eûmesune sorte de sursaut : un être glissait contre le mur du dehorsvers la forêt ; puis il passa contre la portequ'il semblatâterd'une main hésitantepuis on n'entendit plusrien pendant deux minutes qui firent de nous des insensés ;puis il revintfrôlant toujours la muraille ; et il grattalégèrementcomme ferait un enfant avec son ongle ;puis soudain une tête apparut contre la vitre du judasunetête blanche avec des yeux lumineux comme ceux des fauves. Etun son sortit de sa boucheun son indistinctun murmure plaintif.
"Alorsun bruit formidable éclata dans la cuisine. Le vieux gardeavait tiré. Et aussitôt les fils se précipitèrentbouchèrent le judas en dressant la grande table qu'ilsassujettirent avec le buffet.
"Etje vous jure qu'au fracas du coup de fusil que je n'attendais pointj'eus une telle angoisse du coeurde l'âme et du corpsque jeme sentis défaillirprêt à mourir de peur.
"Nousrestâmes là jusqu'à l'auroreincapables debougerde dire un motcrispés dans un affolement indicible.
"Onn'osa débarricader la sortie qu'en apercevantpar la fented'un auventun mince rayon de jour.
"Aupied du murcontre la portele vieux chien gisaitla gueule briséed'une balle.
"Ilétait sorti de la cour en creusant un trou sous la palissade."
*
L'homme auvisage brun se tut ; puis il ajouta :
"Cettenuit-là pourtantje ne courus aucun danger ; mais j'aimeraismieux recommencer toutes les heures où j'ai affrontéles plus terribles périlsque la seule minute du coup defusil sur la tête barbue du judas."
FARCENORMANDE
A A. deJoinville.
Laprocession se déroulait dans le chemin creux ombragépar les grands arbres poussés sur les talus des fermes. Lesjeunes mariés venaient d'abordpuis les parentspuis lesinvitéspuis les pauvres du payset les gamins quitournaient autour du défilécomme des mouchespassaient entre les rangsgrimpaient aux branches pour mieux voir.
Le mariéétait un beau garsJean Patule plus riche fermier du pays.C'étaitavant toutun chasseur frénétiquequiperdait le bon sens à satisfaire cette passionet dépensaitde l'argent gros comme lui pour ses chiensses gardesses furets etses fusils.
La mariéeRosalie Rousselavait été fort courtisée partous les partis des environscar on la trouvait avenanteet on lasavait bien dotée ; mais elle avait choisi Patupeut-êtreparce qu'il lui plaisait mieux que les autresmais plutôtencoreen Normande réfléchieparce qu'il avait plusd'écus.
Lorsqu'ilstournèrent la grande barrière de la ferme maritalequarante coups de fusil éclatèrent sans qu'on vîtles tireurs cachés dans les fossés. A ce bruitunegrosse gaieté saisit les hommes qui gigotaient lourdement enleurs habits de fête ; et Patuquittant sa femmesauta sur unvalet qu'il apercevait derrière un arbreempoigna son armeet lâcha lui-même un coup de feu en gambadant comme unpoulain.
Puis on seremit en route sous les pommiers déjà lourds de fruitsà travers l'herbe hauteau milieu des veaux qui regardaientde leurs gros yeuxse levaient lentement et restaient deboutlemufle tendu vers la noce.
Les hommesredevenaient graves en approchant du repas. Les unsles richesétaient coiffés de hauts chapeaux de soie luisantsquisemblaient dépaysés en ce lieu ; les autres portaientd'anciens couvre-chefs à poils longsqu'on aurait dits enpeau de taupe ; les plus humbles étaient couronnés decasquettes.
Toutes lesfemmes avaient des châles lâchés dans le dosetdont elles tenaient les bouts sur leurs bras avec cérémonie.Ils étaient rougesbigarrésflamboyantsces châles; et leur éclat semblait étonner les poules noires surle fumierles canards au bord de la mareet les pigeons sur lestoits de chaume.
Tout levert de la campagnele vert de l'herbe et des arbressemblaitexaspéré au contact de cette pourpre ardente et lesdeux couleurs ainsi voisines devenaient aveuglantes sous le feu dusoleil de midi.
La grandeferme paraissait attendre là-basau bout de la voûtedes pommiers. Une sorte de fumée sortait de la porte et desfenêtres ouverteset une odeur épaisse de mangeailles'exhalait du vaste bâtimentde toutes ses ouverturesdesmurs eux-mêmes.
Comme unserpentla suite des invités s'allongeait à travers lacour. Les premiersatteignant la maisonbrisaient la chaînes'éparpillaienttandis que là-bas il en entraittoujours par la barrière ouverte. Les fossés maintenantétaient garnis de gamins et de pauvrescurieux ; et les coupsde fusil ne cessaient paséclatant de tous les côtésà la foismêlant à l'air une buée depoudre et cette odeur qui grise comme de l'absinthe.
Devant laporteles femmes tapaient sur leurs robes pour en faire tomber lapoussièredénouaient les oriflammes qui servaient derubans à leurs chapeauxdéfaisaient leurs châleset les posaient sur leurs braspuis entraient dans la maison pour sedébarrasser définitivement de ces ornements.
La tableétait mise dans la grande cuisinequi pouvait contenir centpersonnes.
On s'assità deux heures. A huit heures on mangeait encore. Les hommesdéboutonnésen bras de chemisela face rougieengloutissaient comme des gouffres. Le cidre jaune luisaitjoyeuxclair et dorédans les grands verresà côtédu vin colorédu vin sombrecouleur de sang.
Entrechaque plat on faisait un troule trou normandavec un verred'eau-de-vie qui jetait du feu dans le corps et de la folie dans lestêtes.
De tempsen tempsun convive plein comme une barriquesortait jusqu'auxarbres prochainsse soulageaitpuis rentrait avec une faim nouvelleaux dents.
Lesfermièresécarlatesoppresséesles corsagestendus comme des ballonscoupées en deux par le corsetgonflées du haut et du basrestaient à table parpudeur. Mais une d'ellesplus gênéeétantsortietoutes alors se levèrent à la suite. Ellesrevenaient plus joyeusesprêtes à rire. Et les lourdesplaisanteries commencèrent.
C'étaientdes bordées d'obscénités lâchées àtravers la tableet toutes sur la nuit nuptiale. L'arsenal del'esprit paysan fut vidé. Depuis cent ansles mêmesgrivoiseries servaient aux mêmes occasionsetbien que chacunles connûtelles portaient encorefaisaient partir en un rireretentissant les deux enfilées de convives.
Un vieux àcheveux gris appelait : "Les voyageurs pour Mézidon envoiture." Et c'étaient des hurlements de gaieté.
Tout aubout de la tablequatre garsdes voisinspréparaient desfarces aux mariéset ils semblaient en tenir une bonnetantils trépignaient en chuchotant.
L'und'euxsoudainprofitant d'un moment de calmecria :
"C'estles braconniers qui vont s'en donner c'te nuitavec la lune qu'y a!... Dis doncJeanc'est pas c'te lune qu' tu guetterastoi ?"
Le mariébrusquementse tourna :
"Qu'iz'y viennentles braconniers !"
Maisl'autre se mit à rire :
"Ah !i peuvent y venir ; tu quitteras pas ta besogne pour ça !"
Toute latablée fut secouée par la joie. Le sol en tremblalesverres vibrèrent.
Mais lemariéà l'idée qu'on pouvait profiter de sanoce pour braconner chez lui devint furieux :
"J'te dis qu'ça : qu'i z'y viennent !"
Alors cefut une pluie de polissonneries à double sens qui faisaient unpeu rougir la mariéetoute frémissante d'attente.
Puisquand on eut bu des barils d'eau-de-viechacun partit se coucher :et les jeunes époux entrèrent en leur chambresituéeau rez-de-chausséecomme toutes les chambres de ferme ; etcomme il y faisait un peu chaudils ouvrirent la fenêtre etfermèrent l'auvent. Une petite lampe de mauvais goûtcadeau du père de la femmebrûlait sur la commode ; etle lit était prêt à recevoir le couple nouveauqui ne mettait point à son premier embrassement tout lecérémonial des bourgeois dans les villes.
Déjàla jeune femme avait enlevé sa coiffure et sa robeet elledemeurait en jupondélaçant ses bottinestandis queJean achevait un cigare en regardant de coin sa compagne.
Il laguettait d'un oeil luisantplus sensuel que tendre ; car il ladésirait plutôt qu'il ne l'aimait ; etsoudaind'unmouvement brusquecomme un homme qui va se mettre àl'ouvrageil enleva son habit.
Elle avaitdéfait ses bottineset maintenant elle retirait ses baspuiselle lui ditle tutoyant depuis l'enfance : "Va te cacherlà-basderrière les rideauxque j' me mette au lit."
Il fitmine de refuserpuis il y alla d'un air sournoiset se dissimulasauf la tête. Elle riaitvoulait envelopper ses yeuxet ilsjouaient d'une façon amoureuse et gaiesans pudeur apprise etsans gêne.
Pour finiril céda ; alorsen une secondeelle dénoua sondernier juponqui glissa le long de ses jambestomba autour de sespieds et s'aplatit en rond par terre. Elle l'y laissal'enjambanuesous la chemise flottante et elle se glissa dans le lit dont lesressorts chantèrent sous son poids.
Aussitôtil arrivadéchaussé lui-mêmeen pantalonet ilse courbait vers sa femmecherchant ses lèvres qu'ellecachait dans l'oreillerquand un coup de feu retentit au loindansla direction du bois des Râpéeslui sembla-t-il.
Il seredressa inquietle coeur crispéetcourant à lafenêtreil décrocha l'auvent.
La pleinelune baignait la cour d'une lumière jaune. L'ombre despommiers faisait des taches sombres à leur pied ; etau loinla campagnecouverte de moissons mûresluisait.
Comme Jeans'était penché au-dehorsépiant toutes lesrumeurs de la nuitdeux bras nus vinrent se nouer sous son couetsa femmele tirant en arrièremurmura :
"Laissedoncqu'est-ce que ca faitviens-t'en."
Il seretournala saisitl'étreignitla palpant sous la toilelégère ; et l'enlevant dans ses bras robustesill'emporta vers leur couche.
Au momentoù il la posait sur le litqui plia sous le poidsunenouvelle détonationplus proche celle-làretentit.
AlorsJeansecoué d'une colère tumultueusejura : "Nomde D... ! ils croient que je ne sortirai pas à cause de toi?... Attendsattends !" Il se chaussadécrocha sonfusil toujours pendu à portée de sa mainetcomme safemme se traînait à ses genoux et le suppliaitéperdueil se dégagea vivementcourut à la fenêtre etsauta dans la cour.
Elleattendit une heuredeux heuresjusqu'au jour. Son mari ne rentrapas. Alors elle perdit la têteappelaraconta la fureur deJean et sa course après les braconniers.
Aussitôtles valetsles charretiersles gars partirent à la recherchedu maître.
On leretrouva à deux lieues de la fermeficelé des pieds àla têteà moitié mort de fureurson fusiltordusa culotte à l'enversavec trois lièvrestrépassés autour du cou et une pancarte sur la poitrine:
"Quiva à la chasseperd sa place."
Etplustardquand il racontait cette nuit d'épousaillesil ajoutait: "Oh ! pour une farce c'était une bonne farce. Ils m'ontpris dans un collet comme un lapinles salaudset ils m'ont cachéla tête dans un sac. Mais si je les tâte un jourgare àeux !"
Et voilàcomment on s'amuseles jours de noceau pays normand.
LESSABOTS
A LéonFontaine.
Le vieuxcuré bredouillait les derniers mots de son sermon au-dessusdes bonnets blancs des paysannes et des cheveux rudes ou pommadésdes paysans. Les grands paniers des fermières venues de loinpour la messe étaient posés à terre àcôté d'elles ; et la lourde chaleur d'un jour de juilletdégageait de tout le monde une odeur de bétailunfumet de troupeau. Les voix des coqs entraient par la grande porteouverteet aussi les meuglements des vaches couchées dans unchamp voisin. Parfois un souffle d'air chargé d'arômesdes champs s'engouffrait sous le portail eten soulevant sur sonpassage les longs rubans des coiffuresil allait faire vaciller surl'autel les petites flammes jaunes au bout des cierges... "Commele désire le Bon Dieu. Ainsi soit-il !" prononçaitle prêtre. Puis il se tutouvrit un livre et se mitcommechaque semaineà recommander à ses ouailles lespetites affaires intimes de la commune. C'était un vieil hommeà cheveux blancs qui administrait la paroisse depuis bientôtquarante anset le prône lui servait pour communiquerfamilièrement avec tout son monde.
Il reprit: "Je recommande à vos prières DésiréVallinqu'est bien malade et aussi la Paumelle qui ne se remet pasvite de ses couches."
Il nesavait plus ; il cherchait les bouts de papier posés dans unbréviaire. Il en retrouva deux enfinet continua : "Ilne faut pas que les garçons et les filles viennent comme çale soirdans le cimetièreou bien je préviendrai legarde champêtre. - M. Césaire Omont voudrait bientrouver une jeune fille honnête comme servante." Ilréfléchit encore quelques secondespuis ajouta :"C'est toutmes frèresc'est la grâce que je voussouhaiteau nom du Pèreet du Filset du Saint-Esprit."
Et ildescendit de la chaire pour terminer sa messe.
Quand lesMalandain furent rentrés dans leur chaumièreladernière du hameau de la Sablièresur la route deFourvillele pèreun vieux petit paysan sec et ridés'assit devant la tablependant que sa femme décrochait lamarmite et que sa fille Adélaïde prenait dans le buffetles verres et les assietteset il dit : "Ça s'raitp't-être bonc'te place chez maîtr' Omontvu que lev'là veufque sa bru l'aime pasqu'il est seul et qu'il a d'quoi. J' ferions p't-être ben d'y envoyer Adélaïde."
La femmeposa sur la table la marmite toute noireenleva le couvercleetpendant que montait au plafond une vapeur de soupe pleine d'une odeurde chouxelle réfléchit.
L'hommereprit : "Il a d' quoipour sûr. Mais qu'il faudrait êtredégourdi et qu'Adélaïde l'est pas un brin."
La femmealors articula : "J' pourrions voir tout d' même."Puisse tournant vers sa filleune gaillarde à l'air niaisaux cheveux jaunesaux grosses joues rouges comme la peau despommeselle cria : "T'entendsgrande bête. T'iras chezmaîtr' Omont t' proposer comme servanteet tu f'ras tout c'qu'il te commandera."
La fillese mit à rire sottement sans répondre. Puis tous troiscommencèrent à manger.
Au bout dedix minutesle père reprit : "Écoute un motlafilleet tâche d' n' point te mettre en défaut sur ceque j' vas te dire..."
Et il luitraça en termes lents et minutieux toute une règle deconduiteprévoyant les moindres détailsla préparantà cette conquête d'un vieux veuf mal avec sa famille.
La mèreavait cessé de manger pour écouteret elle demeuraitla fourchette à la mainles yeux sur son homme et sur safille tour à toursuivant cette instruction avec uneattention concentrée et muette.
Adélaïderestait inertele regard errant et vaguedocile et stupide.
Dèsque le repas fut terminéla mère lui fit mettre sonbonnetet elles partirent toutes deux pour aller trouver M. CésaireOmont. Il habitait une sorte de petit pavillon de brique adosséaux bâtiments d'exploitation qu'occupaient ses fermiers. Car ils'était retiré du faire-valoirpour vivre de sesrentes.
Il avaitenviron cinquante-cinq ans ; il était grosjovial et bourrucomme un homme riche. Il riait et criait à faire tomber lesmursbuvait du cidre et de l'eau-de-vie à pleins verresetpassait encore pour chaudmalgré son âge.
Il aimaità se promener dans les champsles mains derrière ledosenfonçant ses sabots de bois dans la terre grasseconsidérant la levée du blé ou la floraison descolzas d'un oeil d'amateur à son aisequi aime çamais qui ne se la foule plus.
On disaitde lui : "C'est un père Bon-Tempsqui n'est pas bienlevé tous les jours."
Il reçutles deux femmesle ventre à tableachevant son café.Etse renversantil demanda :
"Qu'est-ceque vous désirez ?"
La mèreprit la parole :
"C'estnot' fille Adélaïde que j' viens vous proposer pourservantevu c' qu'a dit çu matin monsieur le curé."
MaîtreOmont considéra la fillepuisbrusquement : "Quel âgequ'elle ac'te grande bique-là ?
- Vingt-unans à la Saint-Michelmonsieur Omont.
- C'estbien : all' aura quinze francs par mois et l' fricot. J' l'attendsd'mainpour faire ma soupe du matin."
Et ilcongédia les deux femmes.
Adélaïdeentra en fonctions le lendemain et se mit à travailler dursans dire un motcomme elle faisait chez ses parents.
Vers neufheurescomme elle nettoyait les carreaux de la cuisineM. Omont lahéla :
"Adélaïde!"
Elleaccourut. "Me v'lànot' maître."
Dèsqu'elle fut en face de luiles mains rouges et abandonnéesl'oeil troubléil déclara : "Écoute unpeuqu'il n'y ait pas d'erreur entre nous. T'es ma servantemaisrien de plus. T'entends. Nous ne mêlerons point nos sabots.
- Ouinot' maître.
- Chacunsa placema fillet'as ta cuisine ; j'ai ma salle. A part çatout sera pour té comme pour mé. C'est convenu ?
- Ouinot' maître.
- Allonsc'est bienva à ton ouvrage."
Et ellealla reprendre sa besogne.
A midielle servit le dîner du maître dans sa petite salle àpapier peintpuisquand la soupe fut sur la tableelle allaprévenir M. Omont.
"C'estservinot' maître."
Il entras'assitregarda autour de luidéplia sa serviettehésitaune secondepuisd'une voix de tonnerre :
"Adélaïde!"
Ellearrivaeffarée. Il cria comme s'il allait la massacrer. "Ehbiennom de D... et téoùsqu'est ta place ?
- Mais...not' maître..."
Il hurlait: "J'aime pas manger tout seulnom de D... : tu vas te mett' làou bien foutre le camp si tu n'veux pas. Va chercher t'n' assiette etton verre."
Épouvantéeelle apporta son couvert en balbutiant : "Me v'lànot'maître."
Et elles'assit en face de lui.
Alors ildevint jovial : il trinquaittapait sur la tableracontait deshistoires qu'elle écoutait les yeux baisséssans oserprononcer un mot.
De tempsen tempselle se levait pour aller chercher du paindu cidredesassiettes.
Enapportant le caféelle ne déposa qu'une tasse devantlui : alorsrepris de colèreil grogna :
"Ehbienet pour té ?
- J'n'enprends pointnot' maître.
- Pourquoique tu n'en prends point ?
- Parceque je l'aime point."
Alors iléclata de nouveau : "J'aime pas prend' mon cafétout seulnom de D... Si tu n' veux pas t' mett' à en prendreitoutu vas foutre le campnom de D... Va chercher une tasse etplus vite que ça."
Elle allachercher une tassese rassitgoûta la noire liqueurfit lagrimacemaissous l'oeil furieux du maîtreavala jusqu'aubout. Puis il lui fallut boire le premier verre d'eau-de-vie de larincettele second du pousse-rincetteet le troisième ducoup-de-pied-au-cul.
Et M.Omont la congédia. "Va laver ta vaisselle maintenantt'es une bonne fille."
Il en futde même au dîner. Puis elle dut faire sa partie dedominos ; puis il l'envoya se mettre au lit.
"Vate coucherje monterai tout à l'heure."
Et ellegagna sa chambreune mansarde sous le toit. Elle fit sa prièrese dévêtit et se glissa dans ses draps.
Maissoudain elle bonditeffarée. Un cri furieux faisait tremblerla maison.
"Adélaïde?"
Elleouvrit sa porte et répondit de son grenier :
"Mev'lànot' maître.
- Oùsquet'es ?
- Mais j'suis dans mon litdoncnot' maître."
Alors ilvociféra : "Veux-tu bien descendrenom de D... J'aimepas coucher tout seulnom de D...et si tu n' veux pointtu vas mefoutre le campnom de D..."
Alorselle répondit d'en hautéperduecherchant sachandelle :
"Mev'lànot' maître !"
Et ilentendit ses petits sabots découverts battre le sapin del'escalier ; etquand elle fut arrivée aux dernièresmarchesil la prit par le braset dés qu'elle eut laissédevant la porte ses étroites chaussures de bois à côtédes grosses galoches du maîtreil la poussa dans sa chambre engrognant :
"Plusvite que çadoncnom de D... !"
Et ellerépétait sans cessene sachant plus ce qu'elle disait:
"Mev'làme v'lànot' maître."
Six moisaprèscomme elle allait voir ses parentsun dimanchesonpère l'examina curieusementpuis demanda :
"T'es-tipoint grosse ?"
Ellerestait stupide regardant son ventrerépétant : "Maisnonje n' crois point."
Alorsill'interrogeavoulant tout savoir :
"Dis-mési vous n'avez pointquéque soirmêlé vossabots ?
- Ouijeles ons mêlés l' premier soir et puis l's autres.
- Maisalors t'es pleinegrande futaille."
Elle semit à sangloterbalbutiant : "J' savais timé ?J' savais timé ?"
Le pèreMalandain la guettaitl'oeil éveilléla minesatisfaite. Il demanda :
"Quéquetu ne savais point ?"
Elleprononçaà travers ses pleurs : "J' savais timéque ça se faisait comme çad's' éfants!"
Sa mèrerentrait. L'homme articulasans colère : "La v'làgrosseà c't' heure."
Mais lafemme se fâcharévoltée d'instinctinjuriant àpleine gueule sa fille en larmesla traitant de "manante"et de "traînée".
Alors levieux la fit taire. Et comme il prenait sa casquette pour allercauser de leurs affaires avec maît' Césaire Omontildéclara :
"All'est tout d' même encore pu sotte que j'aurais cru. All' n'savait point c' qu'all' faisaitc'te niente."
Au prônedu dimanche suivantle vieux curé publiait les bans de M.Onufre-Césaire Omont avec Céleste-AdélaïdeMalandain.
LAREMPAILLEUSE
A LéonHennique.
C'étaità la fin du dîner d'ouverture de chasse chez le marquisde Bertrans. Onze chasseurshuit jeunes femmes et le médecindu pays étaient assis autour de la grande table illuminéecouverte de fruits et de fleurs.
On vint àparler d'amouret une grande discussion s'éleval'éternellediscussionpour savoir si on pouvait aimer vraiment une fois ouplusieurs fois. On cita des exemples de gens n'ayant jamais eu qu'unamour sérieux ; on cita aussi d'autres exemples de gens ayantaimé souventavec violence. Les hommesen généralprétendaient que la passioncomme les maladiespeut frapperplusieurs fois le même êtreet le frapper à letuer si quelque obstacle se dresse devant lui. Bien que cette manièrede voir ne fût pas contestableles femmes dont l'opinions'appuyait sur la poésie bien plus que sur l'observationaffirmaient que l'amourl'amour vraile grand amourne pouvaittomber qu'une fois sur un mortelqu'il était semblable àla foudrecet amouret qu'un coeur touché par lui demeuraitensuite tellement vidéravagéincendiéqu'aucun autre sentiment puissantmême aucun rêven'ypouvait germer de nouveau.
Le marquisayant aimé beaucoupcombattait vivement cette croyance :
"Jevous dismoiqu'on peut aimer plusieurs fois avec toutes ses forceset toute son âme. Vous me citez des gens qui se sont tuéspar amourcomme preuve de l'impossibilité d'une secondepassion. Je vous répondrai ques'ils n'avaient pas commiscette bêtise de se suiciderce qui leur enlevait toute chancede rechuteils se seraient guéris ; et ils auraientrecommencéet toujoursjusqu'à leur mort naturelle.Il en est des amoureux comme des ivrognes. Qui a bu boira - qui aaimé aimera. C'est une affaire de tempéramentcela."
On pritpour arbitre le docteurvieux médecin parisien retiréaux champset on le pria de donner son avis.
Justementil n'en avait pas :
"Commel'a dit le marquisc'est une affaire de tempérament ; quant àmoij'ai eu connaissance d'une passion qui dura cinquante-cinq anssans un jour de répitet qui ne se termina que par la mort."
Lamarquise battit des mains.
"Est-cebeau cela ! Et quel rêve d'être aimé ainsi ! Quelbonheur de vivre cinquante-cinq ans tout enveloppé de cetteaffection acharnée et pénétrante ! Comme il a dûêtre heureux et bénir la vie celui qu'on adora de lasorte !"
Le médecinsourit :
"Eneffetmadamevous ne vous trompez pas sur ce pointque l'êtreaimé fut un homme. Vous le connaissezc'est M. Chouquetlepharmacien du bourg. Quant à ellela femmevous l'avezconnue aussic'est la vieille rempailleuse de chaises qui venaittous les ans au château. Mais je vais me faire mieuxcomprendre."
L'enthousiasmedes femmes était tombé ; et leur visage dégoûtédisait : "Pouah !" comme si l'amour n'eût dûfrapper que des êtres fins et distinguésseuls dignesde l'intérêt des gens comme il faut.
Le médecinreprit :
*
"J'aiété appeléil y a trois moisauprès decette vieille femmeà son lit de mort. Elle étaitarrivéela veilledans la voiture qui lui servait de maisontraînée par la rosse que vous avez vueet accompagnéede ses deux grands chiens noirsses amis et ses gardiens. Le curéétait déjà là. Elle nous fit sesexécuteurs testamentairesetpour nous dévoiler lesens de ses volontés dernièreselle nous raconta toutesa vie. Je ne sais rien de plus singulier et de plus poignant
"Sonpère était rempailleur et sa mère rempailleuse.Elle n'a jamais eu de logis planté en terre.
"Toutepetiteelle erraithaillonneusevermineusesordide. On s'arrêtaità l'entrée des villagesle long des fossés ; ondételait la voiture ; le cheval broutait ; le chien dormaitle museau sur ses pattes ; et la petite se roulait dans l'herbependant que le père et la mère rafistolaientàl'ombre des ormes du chemintous les vieux sièges de lacommune. On ne parlait guèredans cette demeure ambulante.Après les quelques mots nécessaires pour déciderqui ferait le tour des maisons en poussant le cri bien connu :"Remmmpailleur de chaises !" on se mettait àtortiller la pailleface à face ou côte à côte.Quand l'enfant allait trop loin ou tentait d'entrer en relation avecquelque galopin du villagela voix colère du père larappelait : "Veux-tu bien revenir icicrapule !"
C'étaientles seuls mots de tendresse qu'elle entendait.
"Quandelle devint plus grandeon l'envoya faire la récolte desfonds de sièges avariés. Alors elle ébauchaquelques connaissances de place en place avec les gamins ; maisc'étaient alors les parents de ses nouveaux amis quirappelaient brutalement leurs enfants : "Veux-tu bien venir icipolisson ! Que je te voie causer avec les va-nu-pieds !..."
"Souventles petits gars lui jetaient des pierres.
"Desdames lui ayant donné quelques souselle les gardasoigneusement.
"Unjour - elle avait alors onze ans - comme elle passait par ce payselle rencontra derrière le cimetière le petit Chouquetqui pleurait parce qu'un camarade lui avait volé deux liards.Ces larmes d'un petit bourgeoisd'un de ces petits qu'elles'imaginaitdans sa frêle caboche de déshéritéeêtre toujours contents et joyeuxla bouleversèrent.Elle s'approchaetquand elle connut la raison de sa peineelleversa entre ses mains toutes ses économiessept sousqu'ilprit naturellementen essuyant ses larmes. Alorsfolle de joieelle eut l'audace de l'embrasser. Comme il considéraitattentivement sa monnaieil se laissa faire. Ne se voyant nirepousséeni battueelle recommença ; elle l'embrassaà pleins brasà plein coeur. Puis elle se sauva.
"Quese passa-t-il dans cette misérable tête ? S'est-elleattachée à ce mioche parce qu'elle lui avait sacrifiésa fortune de vagabondeou parce qu'elle lui avait donné sonpremier baiser tendre ? Le mystère est le même pour lespetits que pour les grands.
"Pendantdes moiselle rêva de ce coin de cimetière et de cegamin. Dans l'espérance de le revoir elle vola ses parentsgrappillant un sou par-ciun sou par-làsur un rempaillageou sur les provisions qu'elle allait acheter.
"Quandelle revintelle avait deux francs dans sa pochemais elle ne putqu'apercevoir le petit pharmacienbien proprederrière lescarreaux de la boutique paternelleentre un bocal rouge et un ténia.
"Ellene l'en aima que davantageséduiteémueextasiéepar cette gloire de l'eau coloréecette apothéose descristaux luisants.
"Ellegarda en elle son souvenir ineffaçableetquand elle lerencontral'an suivantderrière l'écolejouant auxbilles avec ses camaradeselle se jeta sur luile saisit dans sesbraset le baisa avec tant de violence qu'il se mit à hurlerde peur. Alorspour l'apaiserelle lui donna son argent : troisfrancs vingtun vrai trésorqu'il regardait avec des yeuxagrandis.
"Ille prit et se laissa caresser tant qu'elle voulut.
"Pendantquatre ans encoreelle versa entre ses mains toutes ses réservesqu'il empochait avec conscience en échange de baisersconsentis. Ce fut une fois trente sousune fois deux francsunefois douze sous (elle en pleura de peine et d'humiliationmaisl'année avait été mauvaise) et la dernièrefoiscinq francsune grosse pièce rondequi le fit rired'un rire content.
Elle nepensait plus qu'à lui ; et il attendait son retour avec unecertaine impatiencecourait au-devant d'elle en la voyantce quifaisait bondir le coeur de la fillette.
"Puisil disparut. On l'avait mis au collège. Elle le sut eninterrogeant habilement. Alors elle usa d'une diplomatie infinie pourchanger l'itinéraire de ses parents et les faire passer parici au moment des vacances. Elle y réussitmais aprèsun an de ruses. Elle était donc restée deux ans sans lerevoir ; et elle le reconnut à peinetant il étaitchangégrandiembelliimposant dans sa tunique àboutons d'or. Il feignit de ne pas la voir et passa fièrementprès d'elle.
"Elleen pleura pendant deux jours ; et depuis lors elle souffrit sans fin.
"Tousles anselle revenait ; passait devant lui sans oser le saluer etsans qu'il daignât même tourner les yeux vers elle. Ellel'aimait éperdument. Elle me dit : "C'est le seul hommeque "j'aie vu sur la terremonsieur le médecin ; je ne"sais pas si les autres existaient seulement."
"Sesparents moururent. Elle continua leur métiermais elle pritdeux chiens au lieu d'undeux terribles chiens qu'on n'aurait pasosé braver.
"Unjouren rentrant dans ce village où son coeur étaitrestéelle aperçut une jeune femme qui sortait de laboutique Chouquet au bras de son bien-aimé. C'était safemme. Il était marié.
"Lesoir mêmeelle se jeta dans la mare qui est sur la place de laMairie. Un ivrogne attardé la repêchaet la porta àla pharmacie. Le fils Chouquet descendit en robe de chambrepour lasoigneretsans paraître la reconnaîtrela déshabillala frictionnapuis il lui dit d'une voix dure : "Mais "vousêtes folle ! Il ne faut pas être bête comme "ça!"
"Celasuffit pour la guérir. Il lui avait parlé ! Elle étaitheureuse pour longtemps.
"Ilne voulut rien recevoir en rémunération de ses soinsbien qu'elle insistât vivement pour le payer.
"Ettoute sa vie s'écoula ainsi. Elle rempaillait en songeant àChouquet. Tous les anselle l'apercevait derrière sesvitraux. Elle prit l'habitude d'acheter chez lui des provisions demenus médicaments. De la sorteelle le voyait de prèset lui parlaitet lui donnait encore de l'argent.
"Commeje vous l'ai dit en commençantelle est morte ce printemps.Après m'avoir raconté toute cette triste histoireelleme pria de remettre à celui qu'elle avait si patiemment aimétoutes les économies de son existencecar elle n'avaittravaillé que pour luidisait-ellejeûnant mêmepour mettre de côtéet être sûre qu'ilpenserait à elleau moins une foisquand elle serait morte.
"Elleme donna donc deux mille trois cent vingt-sept francs. Je laissai àM. le curé les vingt-sept francs pour l'enterrementetj'emportai le reste quand elle eut rendu le dernier soupir.
"Lelendemainje me rendis chez les Chouquet. Ils achevaient dedéjeuneren face l'un de l'autregros et rougesfleurantles produits pharmaceutiquesimportants et satisfaits.
"Onme fit asseoiron m'offrit un kirschque j'acceptai ; et jecommençai mon discours d'une voix émuepersuadéqu'ils allaient pleurer.
"Dèsqu'il eut compris qu'il avait été aimé de cettevagabondede cette rempailleusede cette rouleuseChouquet bonditd'indignationcomme si elle lui avait volé sa réputationl'estime des honnêtes gensson honneur intimequelque chosede délicat qui lui était plus cher que la vie.
"Safemmeaussi exaspérée que luirépétait: "Cette gueuse ! cette gueuse ! cette gueuse !..." Sanspouvoir trouver autre chose.
"Ils'était levé ; il marchait à grands pas derrièrela tablele bonnet grec chaviré sur une oreille. Ilbalbutiait : "Comprend-on çadocteur ? Voilà deces choses horribles pour un homme ! Que faire ? Oh ! si je l'avaissu de son vivantje l'aurais fait arrêter par la gendarmerieet flanquer en prison. Et elle n'en serait pas sortieje vous enréponds !"
"Jedemeurais stupéfait du résultat de ma démarchepieuse. Je ne savais que dire ni que faire. Mais j'avais àcompléter ma mission. Je repris : "Elle m'a chargéde vous remettre ses économiesqui montent à deuxmille trois cents francs. Comme ce que je viens de vous apprendresemble vous être fort désagréablele mieuxserait peut-être de donner cet argent aux pauvres."
"Ilsme regardaientl'homme et la femmeperclus de saisissement.
"Jetirai l'argent de ma pochedu misérable argent de tous lespays et de toutes les marquesde l'or et des sous mêlés.Puis je demandai : "Que décidez-vous ?"
"MmeChouquet parla la première : "Maispuisque c'étaitsa dernière volontéà cette femme... il mesemble qu'il nous est bien difficile de refuser."
"Lemarivaguement confusreprit : "Nous pourrions toujoursacheter avec ça quelque chose pour nos enfants."
"Jedis d'un air sec : "Comme vous voudrez."
"Ilreprit : "Donnez toujourspuisqu'elle vous en a chargé ;nous trouverons bien moyen de l'employer à quelque bonneoeuvre."
"Jeremis l'argentje saluai et partis.
"Lelendemain Chouquet vint me trouver etbrusquement : "Mais ellea laissé ici sa voiturecette... cette femme. Qu'est-ce quevous en faitesde cette voiture ?
- Rienprenez-la si vous voulez.
- Parfait; cela me va ; j'en ferai une cabane pour mon potager."
"Ils'en allait. Je le rappelai. "Elle a laissé aussi sonvieux cheval et ses deux chiens. Les voulez-vous ?" Il s'arrêtasurpris : "Ah ! nonpar exemple ; que voulez-vous que j'enfasse ? Disposez-en comme vous voudrez." Et il riait. Puis il metendit sa main que je serrai. Que voulez-vous ? Il ne faut pasdansun paysque le médecin et le pharmacien soient ennemis.
"J'aigardé les chiens chez-moi. Le curéqui a une grandecoura pris le cheval. La voiture sert de cabane à Chouquet ;et il a acheté cinq obligations de chemin de fer avecl'argent.
"Voilàle seul amour profond que j'aie rencontrédans ma vie."
*
Le médecinse tut.
Alors lamarquisequi avait des larmes dans les yeuxsoupira : "Décidémentil n'y a que les femmes pour savoir aimer !"
ENMER
AHenry Céard.
On lisaitdernièrement dans les journaux les lignes suivantes :
"BOULOGNE-SUR-MER22 janvier. - On nous écrit :
"Unaffreux malheur vient de jeter la consternation parmi notrepopulation maritime déjà si éprouvéedepuis deux années. Le bateau de pêche commandépar le patron Javelentrant dans le porta été jetéà l'ouest et est venu se briser sur les roches du brise-lamesde la jetée.
"Malgréles efforts du bateau de sauvetage et des lignes envoyées aumoyen du fusil porte-amarrequatre hommes et le mousse ont péri.
"Lemauvais temps continue. On craint de nouveaux sinistres."
Quel estce patron Javel ? Est-il le frère du manchot ?
Si lepauvre homme roulé par la vagueet mort peut-être sousles débris de son bateau mis en piècesest celuiauquel je penseil avait assistévoici dix-huit ansmaintenantà un autre drameterrible et simple comme sonttoujours ces drames formidables des flots.
Javel aînéétait alors patron d'un chalutier. Le chalutier est le bateaude pêche par excellence. Solide à ne craindre aucuntempsle ventre rondroulé sans cesse par les lames comme unbouchontoujours dehorstoujours fouetté par les vents durset salés de la Mancheil travaille la merinfatigablelavoile gonfléetraînant par le flanc un grand filet quiracle le fond de l'Océanet détache et cueille toutesles bêtes endormies dans les rochesles poissons plats collésau sableles crabes lourds aux pattes crochuesles homards auxmoustaches pointues.
Quand labrise est fraîche et la vague courtele bateau se met àpêcher. Son filet est fixé tout le long d'une grandetige de bois garnie de fer qu'il laisse descendre au moyen de deuxcâbles glissant sur deux rouleaux aux deux bouts del'embarcation. Et le bateaudérivant sous le vent et lecouranttire avec lui cet appareil qui ravage et dévaste lesol de la mer.
Javelavait à son bord son frère cadetquatre hommes et unmousse. Il était sorti de Boulogne par un beau temps clairpour jeter le chalut.
Orbientôt le vent s'élevaet une bourrasque survenantforça le chalutier à fuir. Il gagna les côtesd'Angleterre ; mais la mer démontée battait lesfalaises se ruait contre la terrerendait impossible l'entréedes ports. Le petit bateau reprit le large et revint sur les côtesde France. La tempête continuait à faireinfranchissables les jetéesenveloppant d'écumedebruit et de danger tous les abords des refuges.
Lechalutier repartit encorecourant sur le dos des flotsballottésecouéruisselantsouffleté par des paquets d'eaumais gaillardmalgré toutaccoutumé à ces grostemps qui le tenaient parfois cinq ou six jours errant entre les deuxpays voisins sans pouvoir aborder l'un ou l'autre.
Puis enfinl'ouragan se calma comme il se trouvait en pleine meretbien quela vague fût encore fortele patron commanda de jeter lechalut.
Donc legrand engin de pêche fut passé par-dessus bordet deuxhommes à l'avantdeux hommes à l'arrièrecommencèrent à filer sur les rouleaux les amarres quile tenaient. Soudain il toucha le fond : mais une haute lameinclinant le bateauJavel cadetqui se trouvait à l'avant etdirigeait la descente du filetchancelaet son bras se trouva saisientre la corde un instant détendue par la secousse et le boisoù elle glissait. Il fit un effort désespérétâchant de l'autre main de soulever l'amarremais le chaluttraînait déjà et le câble roidi ne cédapoint.
L'hommecrispé par la douleur appela. Tous accoururent. Son frèrequitta la barre. Ils se jetèrent sur la cordes'efforçantde dégager le membre qu'elle broyait. Ce fut en vain. "Fautcouper"dit un matelotet il tira de sa poche un largecouteauqui pouvaiten deux coupssauver le bras de Javel cadet.
Maiscouperc'était perdre le chalutet ce chalut valait del'argentbeaucoup d'argentquinze cents francs ; et il appartenaità Javel aînéqui tenait à son avoir.
Il criale coeur torturé : "Noncoupe pasattendsje vaislofer." Et il courut au gouvernail mettant toute la barredessous.
Le bateaun'obéit qu'à peineparalysé par ce filet quiimmobilisait son impulsionet entraîné d'ailleurs parla force de la dérive et du vent.
Javelcadet s'était laissé tomber sur les genouxles dentsserréesles yeux hagards. Il ne disait rien. Son frèrerevintcraignant toujours le couteau d'un marin : "Attendsattendscoupe pasfaut mouiller l'ancre."
L'ancrefut mouilléetoute la chaîne filéepuis on semit à virer au cabestan pour détendre les amarres duchalut. Elles s'amollirentenfinet on dégagea le brasinertesous la manche de laine ensanglantée.
Javelcadet semblait idiot. On lui retira la vareuse et on vit une chosehorribleune bouillie de chairs dont le sang jaillissait àflots qu'on eût dit poussés par une pompe. Alors l'hommeregarda son bras et murmura : "Foutu."
Puiscomme l'hémorragie faisait une mare sur le pont du bateauundes matelots cria : "Il va se viderfaut nouer la veine."
Alors ilsprirent une ficelleune grosse ficelle brune et goudronnéeetenlaçant le membre au-dessus de la blessureils serrèrentde toute leur force. Les jets de sang s'arrêtaient peu àpeuet finirent par cesser tout à fait.
Javelcadet se levason bras pendait à son côté. Il leprit de l'autre mainle soulevale tournale secoua. Tout étaitrompules os cassés ; les muscles seuls retenaient ce morceaude son corps. Il le considérait d'un oeil morneréfléchissant. Puis il s'assit sur une voile pliéeet les camarades lui conseillèrent de mouiller sans cesse lablessure pour empêcher le mal noir.
On mit unseau auprès de luiet de minute en minuteil puisait dedansau moyen d'un verreet baignait l'horrible plaie en laissant coulerdessus un petit filet d'eau claire.
"Tuserais mieux en bas"lui dit son frère. Il descenditmais au bout d'une heure il remontane se sentant pas bien toutseul. Et puisil préférait le grand air. Il se rassitsur sa voile et recommença à bassiner son bras.
La pêcheétait bonne. Les larges poissons à ventre blancgisaient à côté de luisecoués par desspasmes de mort ; il les regardait sans cesser d'arroser ses chairsécrasées.
Comme onallait regagner Boulogneun nouveau coup de vent se déchaîna; et le petit bateau recommença sa course follebondissant etculbutantsecouant le triste blessé.
La nuitvint. Le temps fut gros jusqu'à l'aurore. Au soleil levant onapercevait de nouveau l'Angleterremaiscomme la mer étaitmoins dureon repartit pour la France en louvoyant.
Vers lesoirJavel cadet appela ses camarades et leur montra des tracesnoirestoute une vilaine apparence de pourriture sur la partie dumembre qui ne tenait plus à lui.
Lesmatelots regardaientdisant leur avis.
"Çapourrait bien être le Noir"pensait l'un.
"Faudraitde l'iau salée là-dessus"déclarait unautre.
On apportadonc de l'eau salée et on en versa sur le mal. Le blessédevint lividegrinça des dentsse tordit un peu ; mais il necria pas.
Puisquand la brûlure se fut calmée : "Donne-moi toncouteau"dit-il à son frère. Le frèretendit son couteau.
"Tiens-moile bras en l'airtout droittire dessus."
On fit cequ'il demandait.
Alors ilse mit à couper lui-même. Il coupait doucementavecréflexiontranchant les derniers tendons avec cette lameaiguëcomme un fil de rasoir ; et bientôt il n'eut plusqu'un moignon. Il poussa un profond soupir et déclara :"Fallait ça. J'étais foutu."
Ilsemblait soulagé et respirait avec force. Il recommençaà verser de l'eau sur le tronçon de membre qui luirestait.
La nuitfut mauvaise encore et on ne put atterrir.
Quand lejour parutJavel cadet prit son bras détaché etl'examina longuement. La putréfaction se déclarait. Lescamarades vinrent aussi l'examineret ils se le passaientde mainen mainle tâtaientle retournaientle flairaient.
Son frèredit : "Faut jeter ça à la mer à c't'heure."
Mais Javelcadet se fâcha : "Ah ! mais nonah ! mais non. J'veuxpoint. C'est à moipas vraipisque c'est mon bras."
Il lereprit et le posa entre ses jambes.
"Ilva pas moins pourrir"dit l'aîné. Alors une idéevint au blessé. Pour conserver le poisson quand on tenaitlongtemps la meron l'empilait en des barils de sel.
Il demanda: "J' pourrions t'y point l'mettre dans la saumure ?
- Çac'est vrai"déclarèrent les autres.
Alors onvida un des barilsplein déjà de la pêche desjours derniers ; ettout au fondon déposa le bras. On versadu sel dessuspuis on replaçaun à unles poissons.
Un desmatelots fit cette plaisanterie : "Pourvu que je l'vendionspoint à la criée."
Et tout lemonde rithormis les deux Javel.
Le ventsoufflait toujours. On louvoya encore en vue de Boulogne jusqu'aulendemain dix heures. Le blessé continuait sans cesse àjeter de l'eau sur sa plaie.
De tempsen tempsil se levait et marchait d'un bout à l'autre dubateau.
Son frèrequi tenait la barrele suivait de l'oeil en hochant la tête.
On finitpar rentrer au port.
Le médecinexamina la blessure et la déclara en bonne voie. Il fit unpansement complet et ordonna le repos. Mais Javel ne voulut pas secoucher sans avoir repris son braset il retourna bien vite au portpour retrouver le baril qu'il avait marqué d'une croix.
On le vidadevant lui et il ressaisit son membrebien conservé dans lasaumureridérafraîchi. Il l'enveloppa dans uneserviette emportée à cette intentionet rentra chezlui.
Sa femmeet ses enfants examinèrent longuement ce débris dupèretâtant les doigtsenlevant les brins de selrestés sous les ongles ; puis on fit venir le menuisier pourun petit cercueil.
Lelendemain l'équipage complet du chalutier suivit l'enterrementdu bras détaché. Les deux frèrescôte àcôteconduisaient le deuil. Le sacristain de la paroissetenait le cadavre sous son aisselle.
Javelcadet cessa de naviguer. Il obtint un petit emploi dans le portetquand il parlait plus tard de son accidentil confiait tout bas àson auditeur : "Si le frère avait voulu couper le chalutj'aurais encore mon braspour sûr. Mais il étaitregardant à son bien."
UNNORMAND
A PaulAlexis.
Nousvenions de sortir de Rouen et nous suivions au grand trot la route deJumièges. La légère voiture filaittraversantles prairies ; puis le cheval se mit au pas pour monter la côtede Canteleu.
C'est làun des horizons les plus magnifiques qui soient au monde. Derrièrenous Rouenla ville aux églisesaux clochers gothiquestravaillés comme des bibelots d'ivoire ; en faceSaint-Severle faubourg aux manufacturesqui dresse ses mille cheminéesfumantes sur le grand ciel vis-à-vis des mille clochetonssacrés de la vieille cité.
Ici laflèche de la cathédralele plus haut sommet desmonuments humains ; et là-basla "Pompe à feu"de la "Foudre"sa rivale presque aussi démesuréeet qui passe d'un mètre la plus géante des pyramidesd'Égypte.
Devantnous la Seine se déroulaitondulantesemée d'îlesbordée à droite de blanches falaises que couronnait uneforêtà gauche de prairies immenses qu'une autre forêtlimitaitlà-bastout là-bas.
De placeen placede grands navires à l'ancre le long des berges dularge fleuve. Trois énormes vapeurs s'en allaientà laqueue leu leuvers Le Havre : et un chapelet de bâtimentsformé d'un trois-mâtsde deux goélettes et d'unbrickremontait vers Rouentraîné par un petitremorqueur vomissant un nuage de fumée noire.
Moncompagnonné dans le paysne regardait même point cesurprenant paysage ; mais il souriait sans cesse ; il semblait rireen lui-même. Tout à coupil éclata : "Ah !vous allez voir quelque chose de drôle ; la chapelle au pèreMathieu. Çac'est du nananmon bon."
Je leregardai d'un oeil étonné. Il reprit :
"Jevais vous faire sentir un fumet de Normandie qui vous restera dans lenez. Le père Mathieu est le plus beau Normand de la provinceet sa chapelle une des merveilles du mondeni plus ni moins : jevais vous donner d'abord quelques mots d'explication."
*
Le pèreMathieuqu'on appelle aussi le père "La Boisson"est un ancien sergent-major revenu dans son pays natal. Il unit endes proportions admirables pour faire un ensemble parfait la blaguedu vieux soldat à la malice finaude du Normand. De retour aupaysil est devenugrâce à des protections multipleset à des habiletés invraisemblablesgardien d'unechapelle miraculeuseune chapelle protégée par laVierge et fréquentée principalement par les fillesenceintes. Il a baptisé sa statue merveilleuse : "Notre-Damedu Gros-Ventre"et il la traite avec une certaine familiaritégoguenarde qui n'exclut point le respect. Il a composélui-même et fait imprimer une prière spécialepour sa BONNE VIERGE. Cette prière est un chef-d'oeuvred'ironie involontaired'esprit normand où la raillerie semêle à la peur du SAINTà la peur superstitieusede l'influence secrète de quelque chose. Il ne croit pasbeaucoup à sa patronne : cependant il y croit un peuparprudenceet il la ménagepar politique.
Voici ledébut de cette étonnante oraison :
"Notrebonne madame la Vierge Mariepatronne naturelle des filles-mèresen ce pays et par toute la terreprotégez votre servante quia fauté dans un moment d'oubli."
.. .. .... .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Cettesupplique se termine ainsi :
"Nem'oubliez pas surtout auprès de votre saint Époux etintercédez auprès de Dieu le Père pour qu'ilm'accorde un bon mari semblable au vôtre."
Cetteprièreinterdite par le clergé de la contréeest vendue par lui sous le manteauet passe pour salutaire àcelles qui la récitent avec onction.
En sommeil parle de la bonne Viergecomme faisait de son maître levalet de chambre d'un prince redoutéconfident de tous lespetits secrets intimes. Il sait sur son compte une foule d'histoiresamusantesqu'il dit tout basentre amisaprès boire.
Mais vousverrez par vous-même.
Comme lesrevenus fournis par la Patronne ne lui semblaient point suffisantsil a annexé à la Vierge principale un petit commerce deSaints. II les tient tous ou presque tous. La place manquant dans lachapelleil les a emmagasinés au bûcherd'où illes sort sitôt qu'un fidèle les demande. Il a façonnélui-même ces statuettes de boisinvraisemblablement comiqueset les a peintes toutes en vert à pleine couleurune annéequ'on badigeonnait sa maison. Vous savez que les Saints guérissentles maladies ; mais chacun a sa spécialité ; et il nefaut pas commettre de confusion ni d'erreurs. Ils sont jaloux les unsdes autres comme des cabotins.
Pour nepas se tromperles vieilles bonnes femmes viennent consulterMathieu.
"Pourles maux d'oreillesqué saint qu'est l'meilleur ?
- Mais y asaint Osyme qu'est bon ; y a aussi saint Pamphile qu'est pasmauvais."
Ce n'estpas tout.
CommeMathieu a du temps de resteil boit ; mais il boit en artisteenconvaincusi bien qu'il est gris régulièrement tousles soirs. Il est grismais il le sait ; il le sait si bien qu'ilnotechaque jourle degré exact de son ivresse. C'est làsa principale occupation ; la chapelle ne vient qu'après.
Et il ainventéécoutez bien et cramponnez-vousil a inventéle saoulomètre.
L'instrumentn'existe pasmais les observations de Mathieu sont aussi précisesque celles d'un mathématicien.
Vousl'entendez dire sans cesse : "D'puis lundij'ai passéquarante-cinq."
Ou bien :"J'étais entre cinquante-deux et cinquante-huit."
Ou bien :"J'en avais bien soixante-six à soixante-dix."
Ou bien :"Cré coquinje m' croyais dans les cinquantev'làque j' m'aperçois qu' j'étais dans les soixante-quinze!"
Jamais ilne se trompe.
Il affirmen'avoir pas atteint le mètremais comme il avoue que sesobservations cessent d'être précises quand il a passéquatre-vingt-dixon ne peut se fier absolument à sonaffirmation.
QuandMathieu reconnaît avoir passé quatre-vingt-dixsoyeztranquilleil était crânement gris.
Dans cesoccasions-làsa femmeMélieune autre merveillesemet en des colères folles. Elle l'attend sur sa portequandil rentreet elle hurle : "Te voilàsalaudcochonbougre d'ivrogne !"
AlorsMathieuqui ne rit plusse campe en face d'elleetd'un tonsévère : "Tais-toiMéliec'est pas lemoment de causer. Attends à d'main."
Si ellecontinue à vociféreril s'approche etla voixtremblante : "Gueule plus ; j' suis dans les quatre-vingt-dix ;je n' mesure plus ; j' vas cognerprends garde !"
AlorsMélie bat en retraite.
Si elleveutle lendemainrevenir sur ce sujetil lui rit au nez et répond: "Allonsallons ! assez causé ; c'est passé.Tant qu' j'aurai pas atteint le mètrey a pas de mal. Maissi j' passe le mètrej' te permetsde m' corrigerma parole!"
*
Nousavions gagné le sommet de la côte. La route s'enfonçaitdans l'admirable forêt de Roumare.
L'automnel'automne merveilleuxmêlait son or et sa pourpre auxdernières verdures restées vivescomme si des gouttesde soleil fondu avaient coulé du ciel dans l'épaisseurdes bois.
Ontraversa Duclairpuisau lieu de continuer sur Jumiègesmonami tourna vers la gaucheetprenant un chemin de traverses'enfonça dans le taillis.
Etbientôtdu sommet d'une grande côtenous découvrionsde nouveau la magnifique vallée de la Seine et le fleuvetortueux s'allongeant à nos pieds.
Sur ladroiteun tout petit bâtiment couvert d'ardoises et surmontéd'un clocher haut comme une ombrelle s'adossait contre une joliemaison aux persiennes vertestoute vêtue de chèvrefeuilleset de rosiers.
Une grossevoix cria : "V'là des amis !" Et Mathieu parut surle seuil. C'était un homme de soixante ansmaigreportant labarbiche et de longues moustaches blanches.
Moncompagnon lui serra la mainme présentaet Mathieu nous fitentrer dans une fraîche cuisine qui lui servait aussi de salle.Il disait :
"Moimonsieurj'n'ai pas d'appartement distingué. J'aime bien àn' point m'éloigner du fricot. Les casserolesvoyez-vousçatient compagnie."
Puissetournant vers mon ami :
"Pourquoivenez-vous un jeudi ? Vous savez bien que c'est jour de consultationd'ma Patronne. J'peux pas sortir c't' après-midi."
Etcourant à la porteil poussa un effroyable beuglement :"Méli-e-e !" qui dut faire lever la tête auxmatelots des navires qui descendaient ou remontaient le fleuvelà-bastout au fond de la creuse vallée.
Méliene répondit point.
AlorsMathieu cligna de l'oeil avec malice.
"An'est pas contente après moivoyez-vousparce qu'hier je m'suis trouvé dans les quatre-vingt-dix."
Mon voisinse mit à rire : "Dans les quatre-vingt-dixMathieu !Comment avez-vous fait ?"
Mathieurépondit :
"J'vas vous dire. J' n'ai trouvél'an dernierqu' vingtrasières d' pommes d'abricot. Y n'y en a pu ; maispour fairedu cidre y n'y a qu' ça. Donc j'en fis une pièce qu' jemis hier en perce. Pour du nectarc'est du nectar ; vous m'en direzdes nouvelles. J'avais ici Polyte ; j' nous mettons à boire uncoupet puis encore un coupsans s' rassasier (on en boiraitjusqu'à d'main)si bien qued' coup en coupje m' sens unefraîcheur dans l'estomac. J' dis à Polyte : "Si onbuvait un verre de fine pour se réchauffer !" Y consent.Mais c'te fineça vous met l' feu dans le corpssi bienqu'il a fallu r'venir au cidre. Mais v'là que d' fraîcheuren chaleur et d' chaleur en fraîcheurj' m'aperçois quej' suis dans les quatre-vingt-dix. Polyte était pas loin dumètre."
La portes'ouvrit. Mélie parutet tout de suite avant de nous avoirdit bonjour : "... Crés cochonsvous aviez bien l' mètretous les deux."
AlorsMathieu se fâcha : "Dis pas çaMéliedispas ça ; j'ai jamais été au mètre."
On nousfit un déjeuner exquisdevant la portesous deux tilleulsàcôté de la petite chapelle de "Notre-Dame duGros-Ventre" et en face de l'immense paysage : Et Mathieu nousracontaavec raillerie mêlée de crédulitésinattenduesd'invraisemblables histoires de miracles.
Nousavions bu beaucoup de cidre adorablepiquant et sucréfraiset grisantqu'il préférait à tous les liquides; et nous fumions nos pipesà cheval sur nos chaisesquanddeux bonnes femmes se présentèrent.
Ellesétaient vieillessèchescourbées. Aprèsavoir saluéelles demandèrent saint Blanc. Mathieucligna de l'oeil vers nous et répondit :
"J'vas vous donner ça."
Et ildisparut dans son bûcher.
Il y restabien cinq minutes ; puis il revint avec une figure consternée.Il levait les bras :
"J'sais pas oùsqu'il estje l' trouve pu ; j' suis pourtant sûrque je l'avais."
Alorsfaisant de ses mains un porte-voixil mugit de nouveau : "Méli-ee!" Du fond de la cour sa femme répondit :
"Quéqu'y a ?
- Oùsqu'ilest saint Blanc ! Je l' trouve pu dans l' bûcher."
AlorsMélie jeta cette explication :
"C'est-ypas celui qu' t'as pris l'aut'e semaine pour boucher l' trou d' lacabine à lapins ?"
Mathieutressaillit : "Nom d'un tonnerreça s' peut bien !"
Alors ildit aux femmes : "Suivez-moi."
Ellessuivirent. Nous en fîmes autantmalades de rires étouffés.
En effetsaint Blancpiqué en terre comme un simple pieu maculéde boue et d'orduresservait d'angle à la cabine àlapins.
Dèsqu'elles l'aperçurentles deux bonnes femmes tombèrentà genouxse signèrent et se mirent à murmurerdes Oremus. Mais Mathieu se précipita : "Attendezvous v'là dans la crotte ; j' vas vous donner une botte depaille."
Il allachercher la paille et leur en fit un prie-Dieu. Puisconsidérantson saint fangeuxetcraignant sans doute un discrédit pourson commerceil ajouta :
"J'vas vous l' débrouiller un brin."
Il prit unseau d'eauune brosse et se mit à laver vigoureusement lebonhomme de boispendant que les deux vieilles priaient toujours.
Puisquand il eut finiil ajouta : "Maintenant il n'y a plus d'mal." Et il nous ramena boire un coup.
Comme ilportait le verre à sa boucheil s'arrêtaetd'un airun peu confus : "C'est égalquand j'ai mis saint Blancaux lapinsj' croyais bien qu'i n' f'rait pu d'argent. Y avait deuxans qu'on n' le demandait plus. Mais les Saintsvoyez-vous ca n'passe jamais."
Il but etreprit :
"Allonsbuvons encore un coup. Avec des amis y n' faut pas y aller àmoins d' cinquante ; et j' n'en sommes seulement pas àtrente-huit."
LETESTAMENT
A PaulHervieu.
Jeconnaissais ce grand garçon qui s'appelait René deBourneval. Il était de commerce aimablebien qu'un peutristesemblait revenu de toutfort sceptiqued'un scepticismeprécis et mordanthabile surtout à désarticulerd'un mot les hypocrisies mondaines. Il répétait souvent: "Il n'y a pas d'hommes honnêtes : ou du moins ils ne lesont que relativement aux crapules."
Il avaitdeux frères qu'il ne voyait pointMM. de Courcils. Je lecroyais d'un autre litvu leurs noms différents. On m'avaitdit à plusieurs reprises qu'une histoire étranges'était passée en cette famillemais sans donner aucundétail.
Cet hommeme plaisant tout à faitnous fûmes bientôt liés.Un soircomme j'avais dîné chez lui en tête-à-têteje lui demandai par hasard : "Etes-vous né du premier oudu second mariage de madame votre mère ?" Je le vis pâlirun peupuis rougir ; et il demeura quelques secondes sans parlervisiblement embarrassé. Puis il sourit d'une façonmélancolique et douce qui lui était particulièreet il dit : "Mon cher amisi cela ne vous ennuie pointje vaisvous donner sur mon origine des détails bien singuliers. Jevous sais un homme intelligentje ne crains donc pas que votreamitié en souffreet si elle en devait souffrirje netiendrais plus alors à vous avoir pour ami."
*
"MamèreMme de Courcilsétait une pauvre petite femmetimideque son mari avait épousée pour sa fortune.Toute sa vie fut un martyre. D'âme aimantecraintivedélicateelle fut rudoyée sans répit par celuiqui aurait dû être mon pèreun de ces rustresqu'on appelle des gentilshommes campagnards. Au bout d'un mois demariageil vivait avec une servante. Il eut en outre pour maîtressesles femmes et les filles de ses fermiers ; ce qui ne l'empêchapoint d'avoir deux enfants de sa femme ; on devrait compter troisenme comprenant. Ma mère ne disait rien ; elle vivait dans cettemaison toujours bruyante comme ces petites souris qui glissent sousles meubles. Effacéedisparuefrémissanteelleregardait les gens de ses yeux inquiets et clairstoujours mobilesdes yeux d'être effaré que la peur ne quitte pas. Elleétait jolie pourtantfort jolietoute blonde d'un blondgrisd'un blond timide ; comme si ses cheveuxavaient étéun peu décolorés par ses craintes incessantes.
"Parmiles amis de M. de Courcils qui venaient constamment au châteause trouvait un ancien officier de cavalerieveufhomme redoutétendre et violentcapable des résolutions les plusénergiquesM. de Bournevaldont je porte le nom. C'étaitun grand gaillard maigreavec de grosses moustaches noires. Je luiressemble beaucoup. Cet homme avait luet ne pensait nullement commeceux de sa classe. Son arrière-grand-mère avait étéune amie de J.-J. Rousseauet on eût dit qu'il avait héritéquelque chose de cette liaison d'une ancêtre. Il savait parcoeur le Contrat socialla Nouvelle Héloïseet tous ces livres philosophants qui ont préparé deloin le futur bouleversement de nos antiques usagesde nos préjugésde nos lois surannéesde notre morale imbécile.
"Ilaima ma mèreparaît-ilet en fut aimé. Cetteliaison demeura tellement secrète que personne ne la soupçonnaLa pauvre femmedélaissée et tristedut s'attacher àlui d'une façon désespéréeet prendredans son commerce toutes ses manières de penserdes théoriesde libre sentimentdes audaces d'amour indépendant ; maiscomme elle était si craintive qu'elle n'osait jamais parlerhauttout cela fut refoulécondensépressé enson coeur qui ne s'ouvrit jamais.
"Mesdeux frères étaient durs pour ellecomme leur pèrene la caressaient pointethabitués à ne la voircompter pour rien dans la maisonla traitaient un peu comme unebonne.
"Jefus le seul de ses fils qui l'aima vraiment et qu'elle aima.
"Ellemourut. J'avais alors dix-huit ans. Je dois ajouterpour que vouscompreniez ce qui va suivreque son mari était dotéd'un conseil judiciairequ'une séparation de biens avait étéprononcée au profit de ma mèrequi avait conservégrâce aux artifices de la loi et au dévouementintelligent d'un notairele droit de tester à sa guise.
"Nousfûmes donc prévenus qu'un testament existait chez cenotaireet invités à assister à la lecture.
"Jeme rappelle cela comme d'hier. Ce fut une scène grandiosedramatiqueburlesquesurprenanteamenée par la révolteposthume de cette mortepar ce cri de libertécetterevendication du fond de la tombe de cette martyre écraséepar nos moeurs durant sa vieet qui jetaitde son cercueil closunappel désespéré vers l'indépendance.
"Celuiqui se croyait mon pèreun gros homme sanguin éveillantl'idée d'un boucheret mes frèresdeux forts garçonsde vingt et de vingt-deux ansattendaient tranquilles sur leurssièges. M. de Bournevalinvité à se présenterentra et se plaça derrière moi. Il était serrédans sa redingotefort pâleet il mordillait souvent samoustacheun peu grise à présent. Il s'attendait sansdoute à ce qui allait se passer.
"Lenotaire ferma la porte à double tour et commença lalectureaprès avoir décacheté devant nousl'enveloppe scellée à la cire rouge et dont il ignoraitle contenu."
Brusquementmon ami se tutse levapuis il alla prendre dans son secrétaireun vieux papierle dépliale baisa longuementet il reprit:
"Voicile testament de ma bien-aimée mère :
"JesoussignéeAnne-Catherine-Geneviève-Mathilde deCroixluceépouse légitime deJean-Léopold-Joseph-Gontran de Courcilssaine de corps etd'espritexprime ici mes dernières volontés.
"Jedemande pardon à Dieu d'abordet ensuite à mon cherfils Renéde l'acte que je vais commettre. Je crois monenfant assez grand de coeur pour me comprendre et me pardonner. J'aisouffert toute ma vie. J'ai été épouséepar calculpuis mépriséeméconnueoppriméetrompée sans cesse par mon mari.
"Jelui pardonnemais je ne lui dois rien.
"Mesfils aînés ne m'ont point aiméene m'ont pointgâtéem'ont à peine traitée comme unemère.
"J'aiété pour euxdurant ma viece que je devais être; je ne leur dois plus rien après ma mort. Les liens du sangn'existent pas sans l'affection constantesacréede chaquejour. Un fils ingrat est moins qu'un étranger ; c'est uncoupablecar il n'a pas le droit d'être indifférentpour sa mère.
"J'aitoujours tremblé devant les hommesdevant leurs lois iniquesleurs coutumes inhumainesleurs préjugés infâmes.Devant Dieuje ne crains plus. Morteje rejette de moi la honteusehypocrisie ; j'ose dire ma penséeavouer et signer le secretde mon coeur.
"Doncje laisse en dépôt toute la partie de ma fortune dont laloi me permet de disposerà mon amant bien-aiméPierre-Germer-Simon de Bournevalpour revenir ensuite à notrecher fils René.
(Cettevolonté est formulée en outred'une façon plusprécisedans un acte notarié.)
"Etdevant le Juge suprême qui m'entend je déclare quej'aurais maudit le Ciel et l'existence si je n'avais rencontrél'affection profondedévouéetendreinébranlablede mon amantsi je n'avais compris dans ses bras que le Créateura fait les êtres pour s'aimerse soutenirse consoleretpleurer ensemble dans les heures d'amertume.
"Mesdeux fils aînés ont pour père M. de Courcils.René seul doit la vie à M. de Bourneval. Je prie leMaître des hommes et de leurs destinées de placerau-dessus des préjugés sociaux le père et lefilsde les faire s'aimer jusqu'à leur mort et m'aimer encoredans mon cercueil.
"Telssont ma dernière pensée et mon dernier désir.
"MATHILDEDE CROIXLUCE."
"M.de Courcils s'était levé ; il cria : "C'est làle testament d'une folle !" Alors M. de Bourneval fit un pas etdéclara d'une voix forted'une voix tranchante : "MoiSimon de Bournevalje déclare que cet écrit nerenferme que la stricte vérité. Je suis prêt àle soutenir devant n'importe quiet à le prouver mêmepar les lettres que j'ai."
"AlorsM. de Courcils marcha vers lui. Je crus qu'ils allaient se colleter.Ils étaient làgrands tous deuxl'un grosl'autremaigrefrémissants. Le mari de ma mère articula enbégayant : "Vous êtes un misérable !"L'autre prononça du même ton vigoureux et sec : "Nousnous retrouverons autre partmonsieur. Je vous aurais déjàsouffleté et provoqué depuis longtemps si je n'avaistenu avant tout à la tranquillitédurant sa viede lapauvre femme que vous avez tant fait souffrir."
"Puisil se tourna vers moi : "Vous êtes mon fils. Voulez-vousme suivre ? Je n'ai pas le droit de vous emmenermais je le prendssi vous voulez bien m'accompagner."
"Jelui serrai la main sans répondre. Et nous sommes sortisensemble. J'étaiscertesaux trois quarts fou.
"Deuxjours plus tard M. de Bourneval tuait en duel M. de Courcils. Mesfrèrespar crainte d'un affreux scandalese sont tus. Jeleur ai cédé et ils ont accepté la moitiéde la fortune laissée par ma mère.
"J'aipris le nom de mon père véritablerenonçant àcelui que la loi me donnait et qui n'était pas le mien.
"M.de Bourneval est mort depuis cinq ans. Je ne suis point encoreconsolé."
*
Il selevafit quelques pasetse plaçant en face de moi : "Ehbien ! je dis que le testament de ma mère est une des chosesles plus bellesles plus loyalesles plus grandes qu'une femmepuisse accomplir. N'est-ce pas votre avis ?"
Je luitendis les deux mains : "Ouicertainementmon ami."
AUXCHAMPS
AOctave Mirbeau.
Les deuxchaumières étaient côte à côteaupied d'une collineproches d'une petite ville de bains. Les deuxpaysans besognaient dur sur la terre inféconde pour élevertous leurs petits. Chaque ménage en avait quatre. Devant lesdeux portes voisinestoute la marmaille grouillait du matin au soir.Les deux aînés avaient six ans et les deux cadets quinzemois environ ; les mariagesetensuiteles naissances s'étaientproduites à peu près simultanément dans l'une etl'autre maison.
Les deuxmères distinguaient à peine leurs produits dans le tas; et les deux pères confondaient tout à fait. Les huitnoms dansaient dans leur têtese mêlaient sans cesse ;etquand il fallait en appeler unles hommes souvent en criaienttrois avant d'arriver au véritable.
Lapremière des deux demeuresen venant de la station d'eaux deRolleportétait occupée par les Tuvachequi avaienttrois filles et un garçon ; l'autre masure abritait lesVallinqui avaient une fille et trois garçons.
Tout celavivait péniblement de soupede pommes de terre et de grandair. A sept heuresle matinpuis à midipuis à sixheuresle soirles ménagères réunissaientleurs mioches pour donner la pâtéecomme des gardeursd'oies assemblent leurs bêtes. Les enfants étaientassispar rang d'âgedevant la table en boisvernie parcinquante ans d'usage. Le dernier moutard avait à peine labouche au niveau de la planche. On posait devant eux l'assiettecreuse pleine de pain molli dans l'eau où avaient cuit lespommes de terreun demi-chou et trois oignons ; et toute la lignéemangeait jusqu'à plus faim. La mère empâtaitelle-même le petit. Un peu de viande au pot-au-feuledimancheétait une fête pour tous ; et le pèrece jour-làs'attardait au repas en répétant :"Je m'y ferais bien tous les jours."
Par unaprès-midi du mois d'aoûtune légèrevoiture s'arrêta brusquement devant les deux chaumièreset une jeune femmequi conduisait elle-mêmedit au monsieurassis à côté d'elle : "Oh ! regardeHenrice tas d'enfants ! Sont-ils joliscomme caà grouiller dansla poussière."
L'homme nerépondit rienaccoutumé à ces admirations quiétaient une douleur et presque un reproche pour lui.
La jeunefemme reprit :
"Ilfaut que je les embrasse ! Oh ! comme je voudrais en avoir uncelui-làle tout petit."
Etsautant de la voitureelle courut aux enfantsprit un des deuxdernierscelui des Tuvacheetl'enlevant dans ses braselle lebaisa passionnément sur ses joues salessur ses cheveuxblonds frisés et pommadés de terresur ses menottesqu'il agitait pour se débarrasser des caresses ennuyeuses.
Puis elleremonta dans sa voiture et partit au grand trot. Mais elle revint lasemaine suivantes'assit elle-même par terreprit le moutarddans ses brasle bourra de gâteauxdonna des bonbons àtous les autres ; et joua avec eux comme une gaminetandis que sonmari attendait patiemment dans sa frêle voiture.
Ellerevint encorefit connaissance avec les parentsreparut tous lesjoursles poches pleines de friandises et de sous.
Elles'appelait Mme Henri d'Hubières.
Un matinen arrivantson mari descendit avec elle ; etsans s'arrêteraux miochesqui la connaissaient bien maintenantelle pénétradans la demeure des paysans.
Ilsétaient làen train de fendre du bois pour la soupe ;ils se redressèrent tout surprisdonnèrent des chaiseset attendirent. Alors la jeune femmed'une voix entrecoupéetremblantecommença :
"Mesbraves gensje viens vous trouver parce que je voudrais bien... jevoudrais bien emmener avec moi votre... votre petit garçon..."
Lescampagnardsstupéfaits et sans idéene répondirentpas.
Ellereprit haleine et continua.
"Nousn'avons pas d'enfants ; nous sommes seulsmon mari et moi... Nous legarderions... voulez-vous ?"
Lapaysanne commençait à comprendre. Elle demanda :
"Vousvoulez nous prend'e Charlot ? Ah ben nonpour sûr."
Alors M.d'Hubières intervint :
"Mafemme s'est mal expliquée. Nous voulons l'adoptermais ilreviendra vous voir. S'il tourne biencomme tout porte à lecroireil sera notre héritier. Si nous avionspar hasarddes enfantsil partagerait également avec eux. Mais s'il nerépondait pas à nos soinsnous lui donnerionsàsa majoritéune somme de vingt mille francsqui seraimmédiatement déposée en son nom chez unnotaire. Etcomme on a aussi pensé à vouson vousservira jusqu'à votre mort une rente de cent francs par mois.Avez-vous bien compris ?"
Lafermière s'était levéetoute furieuse.
"Vousvoulez que j' vous vendions Charlot ? Ah ! mais non ; c'est pas deschoses qu'on d'mande à une mèreça ! Ah ! maisnon ! Ce s'rait une abomination."
L'homme nedisait riengrave et réfléchi ; mais il approuvait safemme d'un mouvement continu de la tête.
Mmed'Hubièreséperduese mit à pleureretsetournant vers son mariavec une voix pleine de sanglotsune voixd'enfant dont tous les désirs ordinaires sont satisfaitsellebalbutia :
"Ilsne veulent pasHenriils ne veulent pas !"
Alors ilsfirent une dernière tentative.
"Maismes amissongez à l'avenir de votre enfantà sonbonheurà..."
Lapaysanneexaspéréelui coupa la parole :
"C'esttout vuc'est tout entenduc'est tout réfléchi...Allez-vous-enet pique j' vous revoie point par ici. C'est-ipermis d' vouloir prendre un éfant comme ça !"
AlorsMmed'Hubièresen sortants'avisa qu'ils étaient deuxtout petitset elle demanda à travers ses larmesavec uneténacité de femme volontaire et gâtéequine veut jamais attendre :
"Maisl'autre petit n'est pas à vous ?"
Le pèreTuvache répondit :
"Nonc'est aux voisins ; vous pouvez y allersi vous voulez."
Et ilrentra dans sa maisonoù retentissait la voix indignéede sa femme.
Les Vallinétaient à tableen train de manger avec lenteur destranches de pain qu'ils frottaient parcimonieusement avec un peu debeurre piqué au couteaudans une assiette entre eux deux.
M.d'Hubières recommença ses propositionsmais avec plusd'insinuationsde précautions oratoiresd'astuce.
Les deuxruraux hochaient la tête en signe de refus ; mais quand ilsapprirent qu'ils auraient cent francs par moisils se considérèrentse consultant de l'oeiltrès ébranlés.
Ilsgardèrent longtemps le silencetorturéshésitants.La femme enfin demanda :
"Quéqu' t'en disl'homme ?"
Ilprononça d'un ton sentencieux :
"J'dis qu' c'est point méprisable."
Alors Mmed'Hubièresqui tremblait d'angoisseleur parla de l'avenirdu petitde son bonheuret de tout l'argent qu'il pourrait leurdonner plus tard.
Le paysandemanda :
"C'terente de douze cents francsce s'ra promis d'vant l' notaire ?"
M.d'Hubières répondit :
"Maiscertainementdès demain."
Lafermièrequi méditaitreprit :
"Centfrancs par moisc'est point suffisant pour nous priver du p'tit ; çatravaillera dans quéqu' z'ans c't' éfant ; i nous fautcent vingt francs."
Mmed'Hubièrestrépignant d'impatienceles accorda toutde suite ; etcomme elle voulait enlever l'enfantelle donna centfrancs en cadeau pendant que son mari faisait un écrit. Lemaire et un voisinappelés aussitôtservirent detémoins complaisants.
Et lajeune femmeradieuseemporta le marmot hurlantcomme on emporte unbibelot désiré d'un magasin.
LesTuvachesur leur portele regardaient partirmuetssévèresregrettant peut-être leur refus.
Onn'entendit plus du tout parler du petit Jean Vallin. Les parentschaque moisallaient toucher leurs cent vingt francs chez le notaire; et ils étaient fâchés avec leurs voisins parceque la mère Tuvache les agonisait d'ignominiesrépétantsans cesse de porte en porte qu'il fallait être dénaturépour vendre son enfantque c'était une horreurune saletéune corromperie.
Et parfoiselle prenait en ses bras son Charlot avec ostentationlui criantcomme s'il eût compris
"J'tai pas venduméj' t'ai pas vendumon p'tiot. J' vends pasm's éfantsmé. J' sieus pas richemais vends pas m'séfants."
Etpendant des années et encore des annéesce fut ainsichaque jour ; chaque jour des allusions grossières qui étaientvociférées devant la portede façon àentrer dans la maison voisine. La mère Tuvache avait fini parse croire supérieure à toute la contrée parcequ'elle n'avait pas vendu Charlot. Et ceux qui parlaient d'elledisaient :
"J'sais ben que c'était engageantc'est égalelle s'aconduite comme une bonne mère."
On lacitait ; et Charlotqui prenait dix-huit ansélevédans cette idée qu'on lui répétait sans répitse jugeait lui-même supérieur à ses camaradesparce qu'on ne l'avait pas vendu.
Les Vallinvivotaient à leur aisegrâce à la pension. Lafureur inapaisable des Tuvacherestés misérablesvenait de là.
Leur filsaîné partit au service. Le second mourut ; Charlot restaseul à peiner avec le vieux père pour nourrir la mèreet deux autres soeurs cadettes qu'il avait.
Il prenaitvingt et un ansquandun matinune brillante voiture s'arrêtadevant les deux chaumières. Un jeune monsieuravec une chaînede montre en ordescenditdonnant la main à une vieille dameaux cheveux blancs. La vieille dame lui dit :
"C'estlàmon enfantà la seconde maison."
Et ilentra comme chez lui dans la masure des Vallin.
La vieillemère lavait ses tabliers ; le père infirmesommeillaitprès de l'âtre. Tous deux levèrent la têteet le jeune homme dit :
"Bonjourpapa ; bonjourmaman."
Ils sedressèrenteffarés. La paysanne laissa tomber d'émoison savon dans son eau et balbutia :
"C'est-itém'n éfant ? C'est-i tém'n éfant ?"
Il la pritdans ses bras et l'embrassaen répétant : "Bonjourmaman." Tandis que le vieuxtout tremblantdisaitde son toncalme qu'il ne perdait jamais : "Te v'là-t'il revenu Jean?" Comme s'il l'avait vu un mois auparavant.
Etquandils se furent reconnusles parents voulurent tout de suite sortir lefieu dans le pays pour le montrer. On le conduisit chez le mairechez l'adjointchez le curéchez l'instituteur.
Charlotdebout sur le seuil de sa chaumièrele regardait passer.
Le soirau souperil dit aux vieux :
"Faut-ilqu' vous ayez été sots pour laisser prendre le p'titaux Vallin !"
Sa mèrerépondit obstinément :
"J'voulions point vendre not' éfant !"
Le pèrene disait rien.
Le filsreprit :
"C'est-ilpas malheureux d'être sacrifié comme ça !"
Alors lepère Tuvache articula d'un ton coléreux :
"Vas-tupas nous r'procher d' t'avoir gardé ?"
Et lejeune hommebrutalement :
"Ouij' vous le r'procheque vous n'êtes que des niants. Desparents comme vous ca fait l' malheur des éfants. Qu' vousmériteriez que j' vous quitte."
La bonnefemme pleurait dans son assiette. Elle gémit tout en avalantdes cuillerées de soupe dont elle répandait la moitié:
"Tuez-vousdonc pour élever d's éfants !"
Alors legarsrudement :
"J'aimeraismieux n'être point né que d'être c' que j' suis.Quand j'ai vu l'autretantôtmon sang n'a fait qu'un tour. Jem' suis dit : - v'là c' que j' serais maintenant !"
Il seleva.
"Tenezj' sens bien que je ferai mieux de n' pas rester iciparce que j'vous le reprocherais du matin au soiret que j' vous ferais une vied' misère. Çavoyez-vousj' vous l' pardonneraijamais !"
Les deuxvieux se taisaientatterréslarmoyants !
Il reprit:
"Nonc't' idée-làce serait trop dur. J'aime mieux m'enaller chercher ma vie aut' part !"
Il ouvritla porte. Un bruit de voix entra. Les Vallin festoyaient avecl'enfant revenu.
AlorsCharlot tapa du pied etse tournant vers ses parentscria :
"Manantsva !"
Et ildisparut dans la nuit.
UNCOQ CHANTA
A RenéBillotte.
MadameBerthe d'Avancelles avait jusque-là repoussé toutes lessupplications de son admirateur désespérélebaron Joseph de Croissard. Pendant l'hiver à Parisil l'avaitardemment poursuivieet il donnait pour elle maintenant des fêteset des chasses en son château normand de Carville.
Le mariM. d'Avancellesne voyait rienne savait riencomme toujours. Ilvivaitdisait-onséparé de sa femmepour cause defaiblesse physiqueque Madame ne lui pardonnait point. C'étaitun gros petit hommechauvecourt de brasde jambesde coudenezde tout.
Mmed'Avancelles était au contraire une grande jeune femme bruneet déterminéequi riait d'un rire sonore au nez de sonmaîtrequi l'appelait publiquement "madame Popote"et regardait d'un certain air engageant et tendre les larges épauleset l'encolure robuste et les longues moustaches blondes de sonsoupirant attitréle baron Joseph de Croissard.
Ellen'avait encore rien accordé cependant. Le baron se ruinaitpour elle. C'étaient sans cesse des fêtesdes chassesdes plaisirs nouveaux auxquels il invitait la noblesse des châteauxenvironnants.
Tout lejourles chiens courants hurlaient par les bois à la suite durenard et du sanglieretchaque soird'éblouissants feuxd'artifice allaient mêler aux étoiles leurs panaches defeutandis que les fenêtres illuminées du salonjetaient sur les vastes pelouses des traînées de lumièreoù passaient des ombres.
C'étaitl'automnela saison rousse. Les feuilles voltigeaient sur les gazonscomme des volées d'oiseaux. On sentait traîner dansl'air des odeurs de terre humidede terre dévêtuecomme on sent une odeur de chair nuequand tombeaprès leballa robe d'une femme.
Un soirdans une fêteau dernier printempsMme d'Avancelles avaitrépondu à M. de Croissard qui la harcelait de sesprières : "Si je dois tombermon amice ne sera pasavant la chute des feuilles. J'ai trop de choses à faire cetété pour avoir le temps." Il s'étaitsouvenu de cette parole rieuse et hardie ; etchaque jourilinsistait davantagechaque jour il avançait ses approchesilgagnait un pas dans le coeur de la belle audacieuse qui ne résistaitplussemblait-ilque pour la forme.
Une grandechasse allait avoir lieu. Etla veilleMme Berthe avait ditenriantau baron : "Baronsi vous tuez la bêtej'auraiquelque chose pour vous."
Dèsl'auroreil fut debout pour reconnaître où le solitaires'était baugé. Il accompagna ses piqueursdisposa lesrelaisorganisa tout lui-même pour préparer sontriomphe ; etquand les cors sonnèrent le départilapparut dans un étroit vêtement de chasse rouge et orles reins serrésle buste largel'oeil radieuxfrais etfort comme s'il venait de sortir du lit.
Leschasseurs partirent. Le sanglier débusqué filasuivides chiens hurleursà travers des broussailles ; et leschevaux se mirent à galoperemportant par les étroitssentiers des bois les amazones et les cavalierstandis quesur leschemins amollisroulaient sans bruit les voitures qui accompagnaientde loin la chasse.
Mmed'Avancellespar maliceretint le baron près d'elles'attardantau pasdans une grande avenue interminablement droiteet longue et sur laquelle quatre rangs de chênes se repliaientcomme une voûte.
Frémissantd'amour et d'inquiétudeil écoutait d'une oreille lebavardage moqueur de la jeune femmeet de l'autre il suivait lechant des cors et la voix des chiens qui s'éloignaient.
"Vousne m'aimez donc plus ?" disait-elle.
Ilrépondait : "Pouvez-vous dire des choses pareilles ?"
Ellereprenait : "La chasse cependant semble vous occuper plus quemoi."
Ilgémissait : "Ne m'avez-vous point donné l'ordred'abattre moi-même l'animal ?"
Et elleajoutait gravement : "Mais j'y compte. Il faut que vous le tuiezdevant moi."
Alors ilfrémissait sur sa sellepiquait son cheval qui bondissaitetperdant patience : "Mais sacristi ! madamecela ne sepourra pas si nous restons ici."
Et ellelui jetaiten riant : "Il faut que cela soitpourtant.. oualors... tant pis pour vous."
Puis ellelui parlait tendrementposant la main sur son brasou flattantcomme par distractionla crinière de son cheval.
Puis ilstournèrent à droite dans un petit chemin couvertetsoudainpour éviter une branche qui barrait la routeelle sepencha sur luisi près qu'il sentit sur son cou lechatouillement des cheveux. Alors brutalement il l'enlaçaetappuyant sur la tempe ses grandes moustachesil la baisa d'un baiserfurieux.
Elle neremua point d'abordrestant ainsi sous cette caresse emportée; puisd'une secousseelle tourna la têteetsoit hasardsoit volontéses petites lèvres à ellerencontrèrent ses lèvres à luisous leurcascade de poils blonds.
Alorssoit confusionsoit remordselle cingla le flanc de son chevalquipartit au grand galop. Ils allèrent ainsi longtempssanséchanger même un regard.
Le tumultede la chasse se rapprochait ; les fourrés semblaient frémiret tout à coupbrisant les branchescouvert de sangsecouant les chiens qui s'attachaient à luile sanglierpassa.
Alors lebaronpoussant un rire de triomphecria : "Qui m'aime me suive!" Et il disparutdans les tailliscomme si la forêtl'eût englouti.
Quand ellearrivaquelques minutes plus tarddans une clairièreil serelevait souillé de bouela jaquette déchiréeles mains sanglantestandis que la bête étendue portaitdans l'épaule le couteau de chasse enfoncé jusqu'àla garde.
La curéese fit aux flambeaux par une nuit douce et mélancolique. Lalune jaunissait la flamme rouge des torches qui embrumaient la nuitde leur fumée résineuse. Les chiens mangeaient lesentrailles puantes du sanglieret criaientet se battaient. Et lespiqueurs et les gentilshommes chasseursen cercle autour de lacuréesonnaient du cor à plein souffle. La fanfares'en allait dans la nuit claire au-dessus des boisrépétéepar les échos perdus des vallées lointainesréveillantles cerfs inquietsles renards glapissants et troublant en leursébats les petits lapins grisau bord des clairières.
Lesoiseaux de nuit voletaienteffarésau-dessus de la meuteaffolée d'ardeur. Et des femmesattendries par toutes ceschoses douces et violentess'appuyant un peu au bras des hommess'écartaient déjà dans les alléesavantque les chiens eussent fini leur repas.
Toutalanguie par cette journée de fatigue et de tendresseMmed'Avancelles dit au baron :
"Voulez-vousfaire un tour de parcmon ami ?"
Mais luisans répondretremblantdéfaillantl'entraîna.
Ettoutde suiteils s'embrassèrent. Ils allaient au pasau petitpassous les branches presque dépouillées et quilaissaient filtrer la lune ; et leur amourleurs désirsleurbesoin d'étreinte étaient devenus si véhémentsqu'ils faillirent choir au pied d'un arbre.
Les corsne sonnaient plus. Les chiens épuisés dormaient auchenil. "Rentrons"dit la jeune femme. Ils revinrent.
Puislorsqu'ils furent devant le châteauelle murmura d une vosmourante : "Je suis si fatiguée que je vais me couchermon ami." Etcomme il ouvrait les bras pour la prendre en undernier baiserelle s'enfuitlui jetant comme adieu : "Non...je vais dormir... Qui m'aime me suive !"
Une heureplus tardalors que tout le château silencieux semblait mortle baron sortit à pas de loup de sa chambre et s'en vintgratter à la porte de son amie. Comme elle ne répondaitpasil essaya d'ouvrir. Le verrou n'était point poussé.
Ellerêvaitaccoudée à la fenêtre.
Il se jetaà ses genoux qu'il baisait éperdument à traversla robe de nuit. Elle ne disait rienenfonçant ses doigtsfinsd'une manière caressantedans les cheveux du baron.
Etsoudainse dégageant comme si elle eût pris une granderésolutionelle murmura de son air hardimais à voixbasse : "Je vais revenir. Attendez-moi." Et son doigttendu dans l'ombre montrait au fond de la chambre la tache vague etblanche du lit.
Alorsàtâtonséperdules mains tremblantesil se dévêtitbien vite et s'enfonça dans les draps frais. Il s'étenditdélicieusementoubliant presque son amietant il avaitplaisir à cette caresse du linge sur son corps las demouvement.
Elle nerevenait pointpourtant ; s'amusant sans doute à le fairelanguir. Il fermait les yeux dans un bien-être exquis ; et ilrêvait doucement dans l'attente délicieuse de la chosetant désirée. Mais peu à peu ses membress'engourdirentsa pensée s'assoupitdevint incertaineflottante. La puissante fatigue enfin le terrassa ; il s'endormit.
Il dormitdu lourd sommeilde l'invincible sommeil des chasseurs exténués.Il dormit jusqu'à l'aurore.
Tout àcoupla fenêtre étant restée entrouverteuncoqperché dans un arbre voisinchanta. Alors brusquementsurpris par ce cri sonorele baron ouvrit les yeux.
Sentantcontre lui un corps de femmese trouvant en un lit qu'il nereconnaissait passurpris et ne se souvenant plus de rienilbalbutiadans l'effarement du réveil :
"Quoi? Où suis-je ? Qu'y a-t-il ?"
Alorsellequi n'avait point dormiregardant cet homme dépeignéaux yeux rougesà la lèvre épaisseréponditdu ton hautain dont elle parlait à son mari :
"Cen'est rien. C'est un coq qui chante. Rendormez-vousmonsieurcelane vous regarde pas."
UNFILS
A RenéMaizeroy.
Ils sepromenaientles deux vieux amisdans le jardin tout fleuri oùle gai printemps remuait de la vie.
L'un étaitsénateuret l'autre de l'Académie françaisegraves tous deuxpleins de raisonnements très logiques maissolennelsgens de marque et de réputation.
Ilsparlotèrent d'abord de politiqueéchangeant despenséesnon pas sur des Idéesmais sur des hommes :les personnalitésen cette matièreprimant toujoursla Raison. Puis ils soulevèrent quelques souvenirs ; puis ilsse turentcontinuant à marcher côte à côtetout amollis par la tiédeur de l'air.
Une grandecorbeille de ravenelles exhalait des souffles sucrés etdélicats ; un tas de fleurs de toute race et de toute nuancejetaient leurs odeurs dans la brisetandis qu'un faux-ébéniervêtu de grappes jauneséparpillait au vent sa finepoussièreune fumée d'or qui sentait le miel et quiportaitpareille aux poudres caressantes des parfumeurssa semenceembaumée à travers l'espace.
Lesénateur s'arrêtahuma le nuage fécondant quiflottaitconsidéra l'arbre amoureux resplendissant comme unsoleil et dont les germes s'envolaient. Et il dit : "Quand onsonge que ces imperceptibles atomes qui sentent bonvont créerdes existences à des centaines de lieues d'icivont fairetressaillir les fibres et les sèves d'arbres femelles etproduire des êtres à racinesnaissant d'un germecommenousmortels comme nouset qui seront remplacés par d'autresêtres de même essencecomme nous toujours !"
Puisplanté devant l'ébénier radieux dont les parfumsvivifiants se détachaient à tous les frissons de l'airM. le sénateur ajouta : "Ah ! mon gaillards'il tefallait faire le compte de tes enfantstu serais bigrementembarrassé. En voilà un qui les exécutefacilement et qui les lâche sans remordset qui ne s'eninquiète guère."
L'académicienajouta : "Nous en faisons autantmon ami."
Lesénateur reprit : "Ouije ne le nie pasnous leslâchons quelquefoismais nous le savons au moinset celaconstitue notre supériorité."
Maisl'autre secoua la tête : "Nonce n'est pas là ceque je veux dire : voyez-vousmon cheril n'est guèred'homme qui ne possède des enfants ignorésces enfantsdits de père inconnuqu'il a faitscomme cet arbrereproduitpresque inconsciemment.
"S'ilfallait établir le compte des femmes que nous avons euesnousserionsn'est-ce pasaussi embarrassés que cet ébénierque vous interpelliez le serait pour numéroter sesdescendants.
"Dedix-huit à quarante ans enfinen faisant entrer en ligne lesrencontres passagèresles contacts d'une heureon peut bienadmettre que nous avons eu des... rapports intimes avec deux ou troiscents femmes.
"Ehbienmon amidans ce nombre êtes-vous sûr que vous n'enayez pas fécondé au moins une et que vous ne possédiezpoint sur le pavéou au bagneun chenapan de fils qui voleet assassine les honnêtes gensc'est-à-dire nous ; oubien une fille dans quelque mauvais lieu ; ou peut-êtresielle a eu la chance d'être abandonnée par sa mèrecuisinière en quelque famille.
"Songezen outre que presque toutes les femmes que nous appelons publiquespossèdent un ou deux enfants dont elles ignorent le pèreenfants attrapés dans le hasard de leurs étreintes àdix ou vingt francs. Dans tout métier on fait la part desprofits et pertes. Ces rejetons-là constituent les "pertes"de leur profession. Quels sont les générateurs ? -Vous- moi- nous tousles hommes dits comme il faut ! Cesont les résultats de nos joyeux dîners d'amisde nossoirs de gaietéde ces heures où notre chair contentenous pousse aux accouplements d'aventure.
"Lesvoleursles rôdeurstous les misérablesenfinsontnos enfants. Et cela vaut encore mieux pour nous que si nous étionsles leurscar ils reproduisent aussices gredins-là !
"Tenezj'aipour ma partsur la conscience une très vilainehistoire que je veux vous dire. C'est pour moi un remords incessantplus que celac'est un doute continuelune inapaisable incertitudequiparfoisme torture horriblement.
*
"Al'âge de vingt-cinq ans j'avais entrepris avec un de mes amisaujourd'hui conseiller d'Étatun voyage en Bretagneàpied.
"Aprèsquinze ou vingt jours de marche forcenéeaprès avoirvisité les Côtes-du-Nord et une partie du Finistèrenous arrivions à Douarnenez ; de làen une étapeon gagna la sauvage pointe du Raz par la baie des Trépasséset on coucha dans un village quelconque dont le nom finissait en of; maisle matin venuune fatigue étrange retint au lit moncamarade. Je dis au lit par habitudecar notre couche se composaitsimplement de deux bottes de paille.
"Impossibled'être malade en ce lieu. Je le forçai donc à seleveret nous parvînmes à Audierne vers quatre ou cinqheures du soir.
"Lelendemainil allait un peu mieux ; on repartit ; maisen routeilfut pris de malaises intolérableset c'est àgrand-peine que nous pûmes atteindre Pont-Labbé.
"Làau moinsnous avions une auberge. Mon ami se couchaet le médecinqu'on fit venir de Quimperconstata une forte fièvresans endéterminer la nature.
"Connaissez-vousPont-Labbé ? - Non. - Eh bienc'est la ville la plus bretonnede toute cette Bretagne bretonnante qui va de la pointe du Raz auMorbihande cette contrée qui contient l'essence des moeursdes légendesdes coutumes bretonnes. Encore aujourd'huicecoin de pays n'a presque pas changé. Je dis : encoreaujourd'huicar j'y retourne à présent tous lesanshélas !
"Unvieux château baigne le pied de ses tours dans un grand étangtristetristeavec des vols d'oiseaux sauvages. Une rivièresort de là que les caboteurs peuvent remonter jusqu'àla ville. Et dans les rues étroites aux maisons antiquesleshommes portent le grand chapeaule gilet brodé et les quatrevestes superposées : la premièregrande comme la maincouvrant au plus les omoplateset la dernière s'arrêtantjuste au-dessus du fond de culotte.
"Lesfillesgrandesbellesfraîchesont la poitrine écraséedans un gilet de drap qui forme cuirasseles étreintnelaissant même pas deviner leur gorge puissante et martyrisée; et elles sont coiffées d une étrange façon :sur les tempesdeux plaques brodées en couleur encadrent levisageserrent les cheveux qui tombent en nappe derrière latêtepuis remontent se tasser au sommet du crâne sous unsingulier bonnettissu souvent d'or ou d'argent.
"Laservante de notre auberge avait dix-huit ans au plusdes yeux toutbleusd'un bleu pâle que perçaient les deux petitspoints noirs de la pupille ; et ses dents courtesserréesqu'elle montrait sans cesse en riantsemblaient faites pour broyerdu granit.
"Ellene savait pas un mot de françaisne parlant que le bretoncomme la plupart de ses compatriotes.
"Ormon ami n'allait guère mieuxetbien qu'aucune maladie ne sedéclarâtle médecin lui défendait departir encoreordonnant un repos complet. Je passais donc lesjournées près de luiet sans cesse la petite bonneentraitapportantsoit mon dînersoit de la tisane.
"Jela lutinais un peuce qui semblait l'amusermais nous ne causionspasnaturellementpuisque nous ne nous comprenions point.
"Orune nuitcomme j'étais resté fort tard auprèsdu maladeje croisaien regagnant ma chambrela fillette quirentrait dans la sienne. C'était juste en face de ma porteouverte ; alors brusquementsans réfléchir à ceque je faisaisplutôt par plaisanterie qu'autrementje lasaisis à pleine tailleetavant qu'elle fût revenue desa stupeurje l'avais jetée et enfermée chez moi. Elleme regardaiteffaréeaffoléeépouvantéen'osant pas crier de peur d'un scandaled'être chasséesans doute par ses maîtres d'abordet peut-être par sonpère ensuite.
"J'avaisfait cela en riant : maisdès qu'elle fut chez moile désirde la posséder m'envahit. Ce fut une lutte longue etsilencieuseune lutte corps à corpsà la façondes athlètesavec les bras tenduscrispéstorduslarespiration essouffléela peau mouillée de sueur. Oh !elle se débattit vaillamment : et parfois nous heurtions unmeubleune cloisonune chaise : alorstoujours enlacésnous restions immobiles plusieurs secondes dans la crainte que lebruit n'eût éveillé quelqu'un ; puis nousrecommencions notre acharnée bataillemoi l'attaquantellerésistant.
"Épuiséeenfinelle tomba : et je la pris brutalementpar terresur lepavé.
"Sitôtrelevéeelle courut à la portetira les verrous ets'enfuit.
"Jela rencontrai à peine les jours suivants. Elle ne me laissaitpoint l'approcher. Puiscomme mon camarade était guériet que nous devions reprendre notre voyageje la vis entrerlaveille de mon départà minuitnu-piedsen chemisedans ma chambre où je venais de me retirer.
"Ellese jeta dans mes brasm'étreignit passionnémentpuisjusqu'au jourm'embrassame caressapleurantsanglotantmedonnant enfin toutes les assurances de tendresse et de désespoirqu'une femme nous peut donner quand elle ne sait pas un mot de notrelangue.
"Huitjours aprèsj'avais oublié cette aventure commune etfréquente quand on voyageles servantes d'auberge étantgénéralement destinées à distraire ainsiles voyageurs.
"Etje fus trente ans sans y songer et sans revenir à Pont-Labbé.
"Oren 1876j'y retournai par hasard au cours d'une excursion enBretagneentreprise pour documenter un livre et pour me bienpénétrer des paysages.
"Rienne me sembla changé. Le château mouillait toujours sesmurs grisâtres dans l'étang à l'entrée dela petite ville : et l'auberge était la même quoiqueréparéeremise à neufavec un air plusmoderne. En entrantje fus reçu par deux jeunes Bretonnes dedix-huit ansfraîches et gentillesencuirassées dansleur étroit gilet de drapcasquées d'argent avec lesgrandes plaques brodées sur les oreilles.
"Ilétait environ six heures du soir. Je me mis à tablepour dîner etcomme le patron s'empressait lui-même àme servirla fatalité sans doute me fit dire : "Avez-vousconnu les anciens maîtres de cette maison ? J'ai passéici une dizaine de jours il y a trente ans maintenant. Je vous parlede loin."
"Ilrépondit : "C'étaient mes parentsmonsieur."
"Alorsje lui racontai en quelle occasion je m'étais arrêtécomment j'avais été retenu par l'indisposition d'uncamarade. Il ne me laissa pas achever.
"- Oh! je me rappelle parfaitement. J'avais alors quinze ou seize ans.Vous couchiez dans la chambre du fond et votre ami dans celle dontj'ai fait la miennesur la rue."
"C'estalors seulement que le souvenir très vif de la petite bonne merevint. Je demandai : "Vous rappelez-vous une gentille petiteservante qu'avait alors votre pèreet qui possédaitsi ma mémoire ne me trompede jolis yeux bleus et des dentsfraîches ?"
"Ilreprit : "Ouimonsieur ; elle est morte en couches quelquetemps après."
"Ettendant la main vers la cour où un homme maigre et boiteuxremuait du fumieril ajouta : "Voilà son fils."
"Jeme mis à rire. "Il n'est pas beau et ne ressemble guèreà sa mère. Il tient du père sans doute."
"L'aubergistereprit : "Ça se peut bien ; mais on n'a jamais su àqui c'était. Elle est morte sans le dire et personne ici nelui connaissait de galant. Ç'a été un fameuxétonnement quand on a appris qu'elle était enceinte.Personne ne voulait le croire."
"J'eusune sorte de frisson désagréableun de ceseffleurements pénibles qui nous touchent le coeurcommel'approche d'un lourd chagrin. Et je regardai l'homme dans la cour.Il venait maintenant de puiser de l'eau pour les chevaux et portaitses deux seaux en boitantavec un effort douloureux de la jambe pluscourte. Il était déguenilléhideusement saleavec de longs cheveux jaunes tellement mêlés qu'ils luitombaient comme des cordes sur les joues.
"L'aubergisteajouta : "Il ne vaut pas grand-choseç'a étégardé par charité dans la maison. Peut-être qu'ilaurait mieux tourné si on l'avait élevé commetout le monde. Mais que voulez-vousmonsieur ? Pas de pèrepas de mèrepas d'argent ! Mes parents ont eu pitié del'enfantmais ce n'était pas à euxvous comprenez."
"Jene dis rien.
"Etje couchai dans mon ancienne chambre ; et toute la nuit je pensai àcet affreux valet d'écurie en me répétant : "Sic'était mon filspourtant ? Aurais-je donc pu tuer cettefille et procréer cet être ?" C'étaitpossibleenfin !
"Jerésolus de parler à cet homme et de connaîtreexactement la date de sa naissance. Une différence de deuxmois devait m'arracher mes doutes.
"Jele fis venir le lendemain. Mais il ne parlait pas le françaisnon plus. Il avait l'air de ne rien comprendred'ailleursignorantabsolument son âge qu'une des bonnes lui demanda de ma part. Etil se tenait d'un air idiot devant moiroulant son chapeau dans sespattes noueuses et dégoûtantesriant stupidementavecquelque chose du rire ancien de la mère dans le coin deslèvres et dans le coin des yeux.
"Maisle patron survenant alla chercher l'acte de naissance du misérable.Il était entré dans la vie huit mois et vingt-six joursaprès mon passage à Pont-Labbécar je merappelais parfaitement être arrivé à Lorient le15 août. L'acte portait la mention : "Pèreinconnu." La mère s'était appelée JeanneKerradec.
"Alorsmon coeur se mit à battre à coups pressés. Je nepouvais plus parler tant je me sentais suffoqué : et jeregardais cette brute dont les grands cheveux jaunes semblaient unfumier plus sordide que celui des bêtes ; et le gueuxgênépar mon regardcessait de riredétournait la têtecherchait à s'en aller.
"Toutle jour j'errai le long de la petite rivièreen réfléchissantdouloureusement Mais à quoi bon réfléchir ? Rienne pouvait me fixer. Pendant des heures et des heures je pesaistoutes les raisons bonnes ou mauvaises pour ou contre mes chances depaternitém'énervant en des suppositionsinextricablespour revenir sans cesse à la mêmehorrible incertitudepuis à la conviction plus atroce encoreque cet homme était mon fils.
"Jene pus dîner et je me retirai dans ma chambre. Je fus longtempssans parvenir à dormir ; puis le sommeil vintun sommeilhanté de visions insupportables. Je voyais ce goujat qui meriait au nezm'appelait "papa" ; puis il se changeait enchien et me mordait les molletsetj'avais beau me sauveril mesuivait toujoursetau lieu d'aboyeril parlaitm'injuriait ;puis il comparaissait devant mes collègues de l'Académieréunis pour décider si j'étais bien son père; et l'un d'eux s'écriait : "C'est indubitable ! Regardezdonc comme il lui ressemble." Et en effet je m'apercevais que cemonstre me ressemblait. Et je me réveillai avec cette idéeplantée dans le crâne et avec le désir fou derevoir l'homme pour décider sioui ou nonnous avions destraits communs.
"Jele joignis comme il allait à la messe (c'était undimanche) et je lui donnai cent sous en le dévisageantanxieusement. Il se remit à rire d'une ignoble façonprit l'argentpuisgêné de nouveau par mon oeilils'enfuit après avoir bredouillé un mot à peuprés inarticuléqui voulait dire "merci"sans doute.
"Lajournée se passa pour moi dans les mêmes angoisses quela veille. Vers le soirje fis venir l'hôtelieret avecbeaucoup de précautionsd'habiletésde finessesjelui dis que je m'intéressais à ce pauvre être siabandonné de tous et privé de toutet que je voulaisfaire quelque chose pour lui.
"Maisl'homme répliqua : "Oh ! n'y songez pasmonsieuril nevaut rienvous n'en aurez que du désagrément. Moijel'emploie à vider l'écurieet c'est tout ce qu'il peutfaire. Pour ça je le nourris et il couche avec les chevaux. Ilne lui en faut pas plus. Si vous avez une vieille culottedonnez-la-luimais elle sera en pièces dans huit jours."
"Jen'insistai pasme réservant d'aviser.
"Legueux rentra le soir horriblement ivrefaillit mettre le feu àla maisonassomma un cheval à coups de piocheeten fin decomptes'endormit dans la boue sous la pluiegrâce àmes largesses.
"Onme pria le lendemain de ne plus lui donner d'argent. L'eau-de-vie lerendait furieuxetdès qu'il avait deux sous en pocheilles buvait. L'aubergiste ajouta : "Lui donner de l'argentc'estvouloir sa mort." Cet homme n'en avait jamais euabsolumentjamaissauf quelques centimes jetés par les voyageurset ilne connaissait pas d'autre destination à ce métal quele cabaret.
"Alorsje passai des heures dans ma chambreavec un livre ouvert que jesemblais liremais ne faisant autre chose que de regarder cettebrutemon fils ! mon fils ! en tâchant de découvrirs'il avait quelque chose de moi. A force de chercher je crusreconnaître des lignes semblables dans le front et à lanaissance du nezet je fus bientôt convaincu d'uneressemblance que dissimulaient l'habillement différent et lacrinière hideuse de l'homme.
"Maisje ne pouvais demeurer plus longtemps sans devenir suspectet jepartisle coeur broyéaprès avoir laissé àl'aubergiste quelque argent pour adoucir l'existence de son valet.
"Ordepuis six ansje vis avec cette penséecette horribleincertitudece doute abominable. Etchaque annéeune forceinvincible me ramène à Pont-Labbé. Chaque annéeje me condamne à ce supplice de voir cette brute patauger dansson fumierde m'imaginer qu'il me ressemblede cherchertoujoursen vainà lui être secourable. Et chaque annéeje reviens iciplus indécisplus torturéplusanxieux.
"J'aiessayé de le faire instruire. Il est idiot sans ressource.
"J'aiessayé de lui rendre la vie moins pénible. Il estirrémédiablement ivrogne et emploie à boire toutl'argent qu'on lui donne et il sait fort bien vendre ses habits neufspour se procurer de l'eau-de-vie.
"J'aiessayé d'apitoyer sur lui son patron pour qu'il le ménageâten offrant toujours de l'argent. L'aubergisteétonné àla finm'a répondu fort sagement : "Tout ce que vousferez pour luimonsieurne servira qu'à le perdre. Il fautle tenir comme un prisonnier. Sitôt qu'il a du temps ou dubien-êtreil devient malfaisant. Si vous voulez faire du biença ne manque pasallezles enfants abandonnésmaischoisissez-en un qui réponde à votre peine."
"Quedire à cela ?
"Etsi je laissais percer un soupçon des doutes qui me torturentce crétincertesdeviendrait malin pour m'exploitermecompromettreme perdreil me crierait "papa"comme dansmon rêve.
"Etje me dis que j'ai tué la mère et perdu cet êtreatrophiélarve d'écurieéclose et pousséedans le fumiercet homme quiélevé comme d'autresaurait été pareil aux autres.
"Etvous ne vous figurez pas la sensation étrangeconfuse etintolérable que j'éprouve en face de lui en songeantque cela est sorti de moiqu'il tient à moi par ce lienintime qui lie le fils au pèrequegrâce aux terribleslois de l'héréditéil est moi par mille chosespar son sang et par sa chairet qu'il a jusqu'aux mêmes germesde maladiesaux mêmes ferments de passions.
"Etj'ai sans cesse un inapaisable et douloureux besoin de le voir ; etsa vue me fait horriblement souffrir ; et de ma fenêtrelà-basje le regarde pendant des heures remuer et charrierles ordures des bêtesen me répétant : "C'estmon fils."
"Etje sensparfoisd'intolérables envies de l'embrasser. Jen'ai même jamais touché sa main sordide."
*
L'académiciense tut. Et son compagnonl'homme politiquemurmura : "Ouivraiment nous devrions bien nous occuper un peu plus des enfants quin'ont pas de père."
Et unsouffle de vent traversant le grand arbre jaune secoua ses grappesenveloppa d'une nuée odorante et fine les deux vieillards quila respirèrent à longs traits.
Et lesénateur ajouta : "C'est bon vraiment d'avoir vingt-cinqanset même de faire des enfants comme ça."
SAINT-ANTOINE
A X.Charmes.
Onl'appelait Saint-Antoineparce qu'il se nommait Antoineet aussipeut-être parce qu'il était bon vivantjoyeuxfarceurpuissant mangeur et fort buveuret vigoureux trousseur de servantesbien qu'il eût plus de soixante ans.
C'étaitun grand paysan du pays de Cauxhaut en couleurgros de poitrine etde ventreet perché sur de longues jambes qui semblaient tropmaigres pour l'ampleur du corps.
Veufilvivait seul avec sa bonne et ses deux valets dans sa ferme qu'ildirigeait en madré compèresoigneux de ses intérêtsentendu dans les affaires et dans l'élevage du bétailet dans la culture de ses terres. Ses deux fils et ses trois fillesmariés avec avantagevivaient aux environset venaientunefois par moisdîner avec le père. Sa vigueur étaitcélèbre dans tout le pays d'alentour : on disaitenmanière de proverbe : "Il est fort comme Saint-Antoine."
Lorsquearriva l'invasion prussienneSaint-Antoineau cabaretpromettaitde manger une arméecar il était hâbleur commeun vrai Normandun peu couard et fanfaron. Il tapait du poing sur latable de boisqui sautait en faisant danser les tasses et les petitsverreset il criaitla face rouge et l'oeil sournoisdans unefausse colère de bon vivant : "Faudra que j'en mangenomde Dieu !" Il comptait bien que les Prussiens ne viendraient pasjusqu'à Tanneville ; mais lorsqu'il apprit qu'ils étaientà Rautôtil ne sortit plus de sa maisonet il guettaitsans cesse la route par la petite fenêtre de sa cuisines'attendant à tout moment à voir passer desbaïonnettes.
Un matincomme il mangeait la soupe avec ses serviteursla porte s'ouvritetle maire de la communemaître Chicotparut suivi d'un soldatcoiffé d'un casque noir à pointe de cuivre.Saint-Antoine se dressa d'un bond ; et tout son monde le regardaits'attendant à le voir écharper le Prussien ; mais il secontenta de serrer la main du maire qui lui dit : "En v'làun pour toiSaint-Antoine. Ils sont venus c'te nuit. Fais pas debêtises surtoutvu qu'ils parlent de fusiller et de brûlertout si seulement il arrive la moindre chose. Te v'là prévenu.Donne-li à mangeril a l'air d'un bon gars. Bonsoirje vaschez l's' autres. Y en a pour tout le monde." Et il sortit.
Le pèreAntoinedevenu pâleregarda son Prussien. C'était ungros garçon à la chair grasse et blancheaux yeuxbleusau poil blondbarbu jusqu'aux pommettesqui semblait idiottimide et bon enfant. Le Normand malin le pénétra toutde suiteetrassurélui fit signe de s'asseoir. Puis il luidemanda : "Voulez-vous de la soupe ?" L'étranger necomprit pas. Antoine alors eut un coup d'audaceetlui poussantsous le nez une assiette pleine : "Tiensavale çagroscochon."
Le soldatrépondit : "Ya" et se mit à manger goulûmentpendant que le fermier triomphant sentant sa réputationreconquiseclignait de l'oeil à ses serviteurs quigrimaçaient étrangementayant en même tempsgrand-peur et envie de rire.
Quand lePrussien eut englouti son assiettéeSaint-Antoine lui enservit une autre qu'il fit disparaître également ; maisil recula devant la troisièmeque le fermier voulait luifaire manger de forceen répétant : "Allonsfous-toi ça dans le ventre. T'engraisseras ou tu diraspourquoivamon cochon !"
Et lesoldatcomprenant seulement qu'on voulait le faire manger tout sonsoûlriait d'un air contenten faisant signe qu'il étaitplein.
AlorsSaint-Antoinedevenu tout à fait familierlui tapa sur leventre en criant : "Y en a-t-il dans la bedaine à moncochon !" Mais soudain il se torditrouge à tomber d'uneattaquene pouvant plus parler. Une idée lui étaitvenue qui le faisait étouffer de rire : "C'est çac'est çasaint Antoine et son cochon. V'là mon cochon!" Et les trois serviteurs éclatèrent àleur tour.
Le vieuxétait si content qu'il fit apporter l'eau-de-viela bonnelefil-en-dixet qu'il en régala tout le monde. On trinqua avecle Prussienqui claqua de la langue par flatteriepour indiquerqu'il trouvait ça fameux. Et Saint-Antoine lui criait dans lenez : "Hein ? En v'là d' la fine ! T'en bois pas comme çachez toimon cochon."
Dèslorsle père Antoine ne sortit plus sans son Prussien. Ilavait trouvé là son affairec'était savengeance à luisa vengeance de gros malin. Et tout le paysqui crevait de peurriait à se tordre derrière le dosdes vainqueurs de la farce de Saint-Antoine. Vraimentdans laplaisanterieil n'avait pas son pareil. Il n'y avait que lui pourinventer des choses comme ça. Cré coquinva !
Il s'enallait chez les voisinstous les jours après midibrasdessus bras dessous avec son Allemand qu'il présentait d'unair gai en lui tapant sur l'épaule : "Tenezv'làmon cochonr'gardez-moi s'il engraissec't' animal-là !"
Et lespaysans s'épanouissaient. "Est-il donc rigoloce bougred'Antoine !"
"J'te l' vendsCésairetrois pistoles.
- Je l'prendsAntoineet j' t'invite à manger du boudin.
- Méc' que j' veuxc'est d' ses pieds.
- Tâte-lil' ventretu verras qu'il n'a que d' la graisse."
Et tout lemonde clignait de l'oeilsans rire trop haut cependantde peur quele Prussien devinât à la fin qu'on se moquait de lui.Antoine seuls'enhardissant tous les jourslui pinçait lescuisses en criant : "Rien qu' du gras" ; lui tapait sur lederrière en hurlant : "Tout ça d' la couenne"; l'enlevait dans ses bras de vieux colosse capable de porter uneenclume en déclarant : "Il pèse six centset pasde déchet."
Et ilavait pris l'habitude de faire offrir à manger à soncochon partout où il entrait avec lui. C'était làle grand plaisirle grand divertissement de tous les jours :"Donnez-li de c' que vous voudrezil avale tout." Et onoffrait à l'homme du pain et du beurredes pommes de terredu fricot froidde l'andouille qui faisait dire : "De la vôtreet du choix."
Le soldatstupide et douxmangeait par politesseenchanté de cesattentions ; se rendait malade pour ne pas refuser ; et ilengraissait vraimentserré maintenant dans son uniformecequi ravissait Saint-Antoine et lui faisait répéter :"Tu saismon cochonfaudra te faire faire une autre cage."
Ilsétaient devenusd'ailleursles meilleurs amis du monde ; etquand le vieux allait à ses affaires dans les environslePrussien l'accompagnait de lui-même pour le seul plaisir d'êtreavec lui.
Le tempsétait rigoureux ; il gelait dur ; le terrible hiver de 1870semblait jeter ensemble tous les fléaux sur la France.
Le pèreAntoinequi préparait les choses de loin et profitait desoccasionsprévoyant qu'il manquerait de fumier pour lestravaux du printempsacheta celui d'un voisin qui se trouvait dansla gêne ; et il fut convenu qu'il irait chaque soir avec sontombereau chercher une charge d'engrais.
Chaquejour donc il se mettait en route à l'approche de la nuit et serendait à la ferme des Haulesdistante d'une demi-lieuetoujours accompagné de son cochon. Et chaque jour c'étaitune fête de nourrir l'animal. Tout le pays accourait làcomme on vale dimancheà la grand-messe.
Le soldatcependantcommençait à se méfier etquand onriait trop fort il roulait des yeux inquiets quiparfoiss'allumaient d'une flamme de colère.
Orunsoirquand il eut mangé à sa contenanceil refusad'avaler un morceau de plus ; et il essaya de se lever pour s'enaller. Mais Saint-Antoine l'arrêta d'un tour de poignetet luiposant ses deux mains puissantes sur les épaules il le rassitsi durement que la chaise s'écrasa sous l'homme.
Une gaietéde tempête éclata ; et Antoine radieuxramassant soncochonfit semblant de le panser pour le guérir ; puis ildéclara : "Puisque tu n' veux pas mangertu vas boirenom de Dieu !"
Et on allachercher de l'eau-de-vie au cabaret.
Le soldatroulait des yeux méchants ; mais il but néanmoins ; ilbut tant qu'on voulut ; et Saint-Antoine lui tenait la têteàla grande joie des assistants.
LeNormandrouge comme une tomatele regard en feuemplissait lesverrestrinquait en gueulant : "A la tienne !" Et lePrussiensans prononcer un motentonnait coup sur coup des lampéesde cognac.
C'étaitune lutteune batailleune revanche ! A qui boirait le plusnomd'un nom ! Ils n'en pouvaient plus ni l'un ni l'autre quand le litrefut séché. Mais aucun d'eux n'était vaincu. Ilss'en allaient manche à manchevoilà tout. Faudraitrecommencer le lendemain !
Ilssortirent en titubant et se mirent en routeà côtédu tombereau de fumier que traînaient lentement les deuxchevaux.
La neigecommençait à tomberet la nuit sans lune s'éclairaittristement de cette blancheur morte des plaines. Le froid saisit lesdeux hommesaugmentant leur ivresseet Saint-Antoinemécontentde n'avoir pas triomphés'amusait à pousser l'épaulede son cochon pour le faire culbuter dans le fossé. L'autreévitait les attaques par des retraites ; etchaque foisilprononçait quelques mots allemands sur un ton irritéqui faisait rire aux éclats le paysan. A la finle Prussiense fâcha ; et juste au moment où Antoine lui lançaitune nouvelle bourradeil répondit par un coup de poingterrible qui fit chanceler le colosse.
Alorsenflammé d'eau-de-viele vieux saisit l'homme àbras-le-corpsle secoua quelques secondes comme il eût faitd'un petit enfantet il le lança à toute voléede l'autre côté du chemin. Puiscontent de cetteexécutionil croisa ses bras pour rire de nouveau.
Mais lesoldat se releva vivementnu-têteson casque ayant rouléetdégainant son sabreil se précipita sur le pèreAntoine.
Quand ilvit celale paysan saisit son fouet par le milieuson grand fouetde houxdroitfort et souple comme un nerf de boeuf.
LePrussien arrivale front baissél'arme en avantsûrde tuer. Mais le vieuxattrapant à pleine main la lame dontla pointe allait lui crever le ventrel'écartaet il frappad'un coup sec sur la tempeavec la poignée du fouetsonennemi qui s'abattit à ses pieds.
Puis ilregardaeffaréstupide d'étonnementle corps d'abordsecoué de spasmespuis immobile sur le ventre. Il se penchale retournale considéra quelque temps. L'homme avait lesyeux clos ; et un filet de sang coulait d'une fente au coin du front.Malgré la nuitle père Antoine distinguait la tachebrune de ce sang sur la neige.
Il restaitlàperdant la têtetandis que son tombereau s'enallait toujoursau pas tranquille des chevaux.
Qu'allait-ilfaire ? Il serait fusillé ! On brûlerait sa fermeonruinerait le pays ! Que faire ? que faire ? Comment cacher le corpscacher la morttromper les Prussiens ? Il entendit des voix au loindans le grand silence des neiges. Alorsil s'affolaetramassantle casqueil recoiffa sa victimepuisl'empoignant par les reinsil l'enlevacourutrattrapa son attelage et lança le corpssur le fumier. Une fois chez luiil aviserait.
Il allaità petits passe creusant la cervellene trouvant rien. Il sevoyaitil se sentait perdu. Il rentra dans sa cour. Une lumièrebrillait à une lucarnesa servante ne dormait pas encore ;alors il fit vivement reculer sa voiture jusqu'au bord du trou àl'engrais. Il songeait qu'en renversant la chargele corps posédessus tomberait dessous dans la fosse : et il fit basculer letombereau.
Comme ill'avait prévul'homme fut enseveli sous le fumier. Antoineaplanit le tas avec sa fourchepuis la planta dans la terre àcôté. Il appela son valetordonna de mettre les chevauxà l'écurie ; et il rentra dans sa chambre.
Il secoucharéfléchissant toujours à ce qu'il allaitfairemais aucune idée ne l'illuminaitson épouvanteallait croissant dans l'immobilité du lit. On le fusillerait !il suait de peur ; ses dents claquaient ; il se releva grelottantnepouvant plus tenir dans ses draps.
Alors ildescendit à la cuisineprit la bouteille de fine dans lebuffetet remonta. Il but deux grands verres de suitejetant uneivresse nouvelle par-dessus l'anciennesans calmer l'angoisse de sonâme. Il avait fait là un joli coupnom de Dieud'imbécile !
Ilmarchait maintenant de long en largecherchant des rusesdesexplications et des malices ; etde temps en tempsil se rinçaitla bouche avec une gorgée de fil-en-dix pour se mettre ducoeur au ventre.
Et il netrouvait rien. Mais rien.
Versminuitson chien de gardeune sorte de demi-loup qu'il appelait"Dévorant"se mit à hurler à la mort.Le père Antoine frémit jusque dans les moelles ; etchaque fois que la bête reprenait son gémissementlugubre et longun frisson de peur courait sur la peau du vieux.
Il s'étaitabattu sur une chaiseles jambes casséeshébétén'en pouvant plusattendant avec anxiété que"Dévorant" recommençât sa plainteetsecoué par tous les sursauts dont la terreur fait vibrer nosnerfs.
L'horloged'en bas sonna cinq heures. Le chien ne se taisait pas. Le paysandevenait fou. Il se leva pour aller déchaîner la bêtepour ne plus l'entendre. Il descenditouvrit la portes'avançadans la nuit.
La neigetombait toujours. Tout était blanc. Les bâtiments de laferme faisaient de grandes taches noires. L'homme s'approcha de laniche. Le chien tirait sur sa chaîne. Il le lâcha. Alors"Dévorant" fit un bondpuis s'arrêta netlepoil hérisséles pattes tenduesles crocs au ventlenez tourné vers le fumier.
Saint-Antoinetremblant de la tête aux piedsbalbutia : "Qué qu't'as doncsale rosse ?" et il avança de quelques pasfouillant de l'oeil l'ombre indécisel'ombre terne de lacour.
Alorsilvit une formeune forme d'homme assis sur son fumier !
Ilregardait celaperclus d'horreur et haletant. Maissoudainilaperçut auprès de lui le manche de sa fourche piquéedans la terre ; il l'arracha du sol : etdans un de ces transportsde peur qui rendent téméraires les plus lâchesil se rua en avantpour voir.
C'étaitluison Prussiensorti fangeux de sa couche d'ordure qui l'avaitréchaufféranimé. Il s'était assismachinalementet il était resté làsous laneige qui le poudraitsouillé de saleté et de sangencore hébété par l'ivresseétourdi parle coupépuisé par sa blessure.
Il aperçutAntoineettrop abruti pour rien comprendreil fit un mouvementafin de se lever.
Mais levieuxdès qu'il l'eut reconnuécuma ainsi qu'une bêteenragée.
Ilbredouillait : "Ah ! cochon ! cochon ! t'es pas mort ! Tu vas medénoncerà c't' heure... Attends... attends !"
Ets'élançant sur l'Allemandil jeta en avant de toute lavigueur de ses deux bras sa fourche levée comme une lanceetil lui enfonça jusqu'au manche les quatre pointes de fer dansla poitrine. Le soldat se renversa sur le dos en poussant un longsoupir de morttandis que le vieux paysanretirant son arme desplaiesla replongeait coup sur coup dans le ventredans l'estomacdans la gorgefrappant comme un forcenétrouant de la têteaux pieds le corps palpitant dont le sang fuyait par gros bouillons.
Puis ils'arrêtaessoufflé de la violence de sa besogneaspirant l'air à grandes gorgéesapaisé par lemeurtre accompli.
Alorscomme les coqs chantaient dans les poulaillers et comme le jourallait poindreil se mit à l'oeuvre pour ensevelir l'homme.
Il creusaun trou dans le fumiertrouva la terrefouilla plus bas encoretravaillant d'une façon désordonnée dans unemportement de force avec des mouvements furieux des bras et de toutle corps.
Lorsque latranchée fut assez creuseil roula le cadavre dedansavec lafourcherejeta la terre dessusla piétina longtempsremiten place le fumieret il sourit en voyant la neige épaissequi complétait sa besogneet couvrait les traces de son voileblanc.
Puis ilrepiqua sa fourche sur le tas d'ordure et rentra chez lui. Sabouteille encore à moitié pleine d'eau-de-vie étaitrestée sur la table. Il la vida d'une haleinese jeta sur sonlitet s'endormit profondément.
Il seréveilla dégrisél'esprit calme et disposcapable de juger le cas et de prévoir l'événement.
Au boutd'une heure il courait le pays en demandant partout des nouvelles deson soldat. Il alla trouver les officierspour savoirdisait-ilpourquoi on lui avait repris son homme.
Comme onconnaissait leur liaisonon ne le soupçonna pas ; et ildirigea même les recherches en affirmant que le Prussien allaitchaque soir courir le cotillon.
Un vieuxgendarme en retraitequi tenait une auberge dans le village voisinet qui avait une jolie fillefut arrêté et fusillé.
L'AVENTUREDE WALTER SCHNAFFS
ARobert Pinchon.
Depuis sonentrée en France avec l'armée d'invasionWalterSchnaffs se jugeait le plus malheureux des hommes. Il étaitgrosmarchait avec peinesoufflait beaucoup et souffraitaffreusement des pieds qu'il avait fort plats et fort gras. Il étaiten outre pacifique et bienveillantnullement magnanime ousanguinairepère de quatre enfants qu'il adorait et mariéavec une jeune femme blondedont il regrettait désespérémentchaque soir les tendressesles petits soins et les baisers. Ilaimait se lever tard et se coucher tôtmanger lentement debonnes choses et boire de la bière dans les brasseries. Ilsongeait en outre que tout ce qui est doux dans l'existence disparaîtavec la vie ; et il gardait au coeur une haine épouvantableinstinctive et raisonnée en même tempspour les canonsles fusilsles revolvers et les sabresmais surtout pour lesbaïonnettesse sentant incapable de manoeuvrer assez vivementcette arme rapide pour défendre son gros ventre.
Etquandil se couchait sur la terrela nuit venueroulé dans sonmanteau à côté des camarades qui ronflaientilpensait longuement aux siens laissés là-bas et auxdangers semés sur sa route : "S'il était tuéque deviendraient les petits ? Qui donc les nourrirait et lesélèverait ? A l'heure mêmeils n'étaientpas richesmalgré les dettes qu'il avait contractéesen partant pour leur laisser quelque argent." Et Walter Schnaffspleurait quelquefois.
Aucommencement des batailles il se sentait dans les jambes de tellesfaiblesses qu'il se serait laissé tombers'il n'avait songéque toute l'armée lui passerait sur le corps. Le sifflementdes balles hérissait le poil sur sa peau.
Depuis desmois il vivait ainsi dans la terreur et dans l'angoisse.
Son corpsd'armée s'avançait vers la Normandie ; et il fut unjour envoyé en reconnaissance avec un faible détachementqui devait simplement explorer une partie du pays et se replierensuite. Tout semblait calme dans la campagne ; rien n'indiquait unerésistance préparée.
OrlesPrussiens descendaient avec tranquillité dans une petitevallée que coupaient des ravins profondsquand une fusilladeviolente les arrêta netjetant bas une vingtaine des leurs :et une troupe de francs-tireurssortant brusquement d'un petit boisgrand comme la mains'élança en avantla baïonnetteau fusil.
WalterSchnaffs demeura d'abord immobiletellement surpris et éperduqu'il ne pensait même pas à fuir. Puis un désirfou de détaler le saisit ; mais il songea aussitôt qu'ilcourait comme une tortue en comparaison des maigres Françaisqui arrivaient en bondissant comme un troupeau de chèvres.Alorsapercevant à six pas devant lui un large fosséplein de broussailles couvertes de feuilles sèchesil y sautaà pieds jointssans songer même à la profondeurcomme on saute d'un pont dans une rivière.
Il passaà la façon d'une flècheà travers unecouche épaisse de lianes et de ronces aiguës qui luidéchirèrent la face et les mainset il tombalourdement assis sur un lit de pierres.
Levantaussitôt les yeuxil vit le ciel par le trou qu'il avait fait.Ce trou révélateur le pouvait dénonceret il setraîna avec précautionà quatre pattesau fondde cette ornièresous le toit de branchages enlacésallant le plus vite possibleen s'éloignant du lieu ducombat. Puis il s'arrêta et s'assit de nouveautapi comme unlièvre au milieu des hautes herbes sèches.
Ilentendit pendant quelque temps encore des détonationsdescris et des plaintes. Puis les clameurs de la lutte s'affaiblirentcessèrent. Tout redevint muet et calme.
Soudainquelque chose remua contre lui. Il eut un sursaut épouvantable.C'était un petit oiseau quis'étant posé surune brancheagitait des feuilles mortes. Pendant près d'uneheurele coeur de Walter Schnaffs en battit à grands coupspressés.
La nuitvenaitemplissant d'ombre le ravin. Et le soldat se mit àsonger. Qu'allait-il faire ? Qu'allait-il devenir ? Rejoindre sonarmée ?... Mais comment ? Mais par où ? Et il luifaudrait recommencer l'horrible vie d'angoissesd'épouvantesde fatigues et de souffrances qu'il menait depuis le commencement dela guerre ! Non ! Il ne se sentait plus ce courage ! Il n'aurait plusl'énergie qu'il fallait pour supporter les marches etaffronter les dangers de toutes les minutes.
Mais quefaire ? Il ne pouvait rester dans ce ravin et s'y cacher jusqu'àla fin des hostilités. Noncertes. S'il n'avait pas fallumangercette perspective ne l'aurait pas trop atterré ; maisil fallait mangermanger tous les jours.
Et il setrouvait ainsi tout seulen armesen uniformesur le territoireennemiloin de ceux qui le pouvaient défendre. Des frissonslui couraient sur la peau.
Soudain ilpensa : "Si seulement j'étais prisonnier !" et soncoeur frémit de désird'un désir violentimmodéréd'être prisonnier des Français.Prisonnier ! Il serait sauvénourrilogéàl'abri des balles et des sabressans appréhension possibledans une bonne prison bien gardée. Prisonnier ! Quel rêve!
Et sarésolution fut prise immédiatement :
"Jevais me constituer prisonnier."
Il selevarésolu à exécuter ce projet sans tarderd'une minute. Mais il demeura immobileassailli soudain par desréflexions fâcheuses et par des terreurs nouvelles.
Oùallait-il se constituer prisonnier ? Comment ? De quel côté? Et des images affreusesdes images de mortse précipitèrentdans son âme.
Il allaitcourir des dangers terribles en s'aventurant seul avec son casque àpointepar la campagne.
S'ilrencontrait des paysans ? Ces paysansvoyant un Prussien perduunPrussien sans défensele tueraient comme un chien errant !Ils le massacreraient avec leurs fourchesleurs piochesleurs fauxleurs pelles ! Ils en feraient une bouillieune pâtéeavec l'acharnement des vaincus exaspérés.
S'ilrencontrait des francs-tireurs ? Ces francs-tireursdes enragéssans loi ni disciplinele fusilleraient pour s'amuserpour passerune heurehistoire de rire en voyant sa tête. Et il se croyaitdéjà appuyé contre un mur en face de douzecanons de fusilsdont les petits trous ronds et noirs semblaient leregarder.
S'ilrencontrait l'armée française elle-même ? Leshommes d'avant-garde le prendraient pour un éclaireurpourquelque hardi et malin troupier parti seul en reconnaissanceet ilslui tireraient dessus. Et il entendait déjà lesdétonations irrégulières des soldats couchésdans les broussaillestandis que luidebout au milieu d'un champs'affaissaittroué comme une écumoire par les ballesqu'il sentait entrer dans sa chair.
Il serassitdésespéré. Sa situation lui paraissaitsans issue.
La nuitétait tout à fait venuela nuit muette et noire. Il nebougeait plustressaillant à tous les bruits inconnus etlégers qui passent dans les ténèbres. Un lapintapant du cul au bord d'un terrierfaillit faire s'enfuir WalterSchnaffs. Les cris des chouettes lui déchiraient l'âmele traversant de peurs soudainesdouloureuses comme des blessures.Il écarquillait ses gros yeux pour tâcher de voir dansl'ombre : et il s'imaginait à tout moment entendre marcherprès de lui.
Aprèsd'interminables heures et des angoisses de damnéil aperçutà travers son plafond de branchagesle ciel qui devenaitclair. Alorsun soulagement immense le pénétra : sesmembres se détendirentreposés soudain : son coeurs'apaisa ; ses yeux se fermèrent. Il s'endormit.
Quand ilse réveillale soleil lui parut arrivé à peuprès au milieu du ciel : il devait être midi. Aucunbruit ne troublait la paix morne des champs ; et Walter Schnaffss'aperçut qu'il était atteint d'une faim aiguë.
Ilbâillaitla bouche humide à la pensée dusaucissondu bon saucisson des soldats ; et son estomac lui faisaitmal.
Il selevafit quelques passentit que ses jambes étaient faibleset se rassit pour réfléchir. Pendant deux ou troisheures encoreil établit le pour et le contrechangeant àtout moment de résolutioncombattumalheureuxtiraillépar les raisons les plus contraires.
Une idéelui parut enfin logique et pratiquec'était de guetter lepassage d'un villageois seulsans armeset sans outils de travaildangereuxde courir au-devant de lui et de se remettre en ses mainsen lui faisant bien comprendre qu'il se rendait.
Alors ilôta son casquedont la pointe le pouvait trahiret il sortitsa tête au bord de son trouavec des précautionsinfinies.
Aucun êtreisolé ne se montrait à l'horizon. Là-basàdroiteun petit village envoyait au ciel la fumée de sestoitsla fumée des cuisines ! Là-bas à gaucheil apercevaitau bout des arbres d'une avenueun grand châteauflanqué de tourelles.
Ilattendit ainsi jusqu'au soirsouffrant affreusementne voyant rienque des vols de corbeauxn'entendant rien que les plaintes sourdesde ses entrailles.
Et la nuitencore tomba sur lui.
Ils'allongea au fond de sa retraite et il s'endormit d'un sommeilfiévreuxhanté de cauchemarsd'un sommeil d'hommeaffamé.
L'aurorese leva de nouveau sur sa tête. Il se remit en observation.Mais la campagne restait vide comme la veille ; et une peur nouvelleentrait dans l'esprit de Walter Schnaffsla peur de mourir de faim !Il se voyait étendu au fond de son trousur le dosles yeuxfermés. Puis des bêtesdes petites bêtes de toutesorte s'approchaient de son cadavre et se mettaient à lemangerl'attaquant partout à la foisse glissant sous sesvêtements pour mordre sa peau froide. Et un grand corbeau luipiquait les yeux de son bec effilé.
Alorsildevint fous'imaginant qu'il allait s'évanouir de faiblesseet ne plus pouvoir marcher. Et déjàil s'apprêtaità s'élancer vers le villagerésolu àtout oserà tout braverquand il aperçut troispaysans qui s'en allaient aux champs avec leurs fourches surl'épauleet il replongea dans sa cachette.
Maisdèsque le soir obscurcit la plaineil sortit lentement du fosséet se mit en routecourbécraintifle coeur battantversle château lointainpréférant entrer là-dedansplutôt qu'au village qui lui semblait redoutable comme unetanière pleine de tigres.
Lesfenêtres d'en bas brillaient. Une d'elles était mêmeouverte ; et une forte odeur de viande cuite s'en échappaitune odeur qui pénétra brusquement dans le nez etjusqu'au fond du ventre de Walter Schnaffs ; qui le crispale fithaleterl'attirant irrésistiblementlui jetant au coeur uneaudace désespérée.
Etbrusquementsans réfléchiril apparutcasquédans le cadre de la fenêtre.
Huitdomestiques dînaient autour d'une grande table. Mais soudainune bonne demeura béantelaissant tomber son verreles yeuxfixes. Tous les regards suivirent le sien !
On aperçutl'ennemi !
Seigneur !les Prussiens attaquaient le château !...
Ce futd'abord un criun seul crifait de huit cris poussés surhuit tons différentsun cri d'épouvante horriblepuisune levée tumultueuseune bousculadeune mêléeune fuite éperdue vers la porte du fond. Les chaisestombaientles hommes renversaient les femmes et passaient dessus. Endeux secondesla pièce fut videabandonnéeavec latable couverte de mangeaille en face de Walter Schnaffs stupéfaittoujours debout dans sa fenêtre.
Aprèsquelques instants d'hésitationil enjamba le mur d'appui ets'avança vers les assiettes. Sa faim exaspéréele faisait trembler comme un fiévreux : mais une terreur leretenaitle paralysait encore. Il écouta. Toute la maisonsemblait frémir ; des portes se fermaientdes pas rapidescouraient sur le plancher du dessus. Le Prussien inquiet tendaitl'oreille à ces confuses rumeurs ; puis il entendit des bruitssourds comme si des corps fussent tombés dans la terre molleau pied des mursdes corps humains sautant du premier étage.
Puis toutmouvementtoute agitation cessèrentet le grand châteaudevint silencieux comme un tombeau.
WalterSchnaffs s'assit devant une assiette restée intacteet il semit à manger. Il mangeait par grandes bouchées commes'il eût craint d'être interrompu trop tôtde n'enpouvoir engloutir assez. Il jetait à deux mains les morceauxdans sa bouche ouverte comme une trappe ; et des paquets denourriture lui descendaient coup sur coup dans l'estomacgonflant sagorge en passant. Parfoisil s'interrompaitprêt àcrever à la façon d'un tuyau trop plein. Il prenaitalors la cruche au cidre et se déblayait l'oesophage comme onlave un conduit bouché.
Il vidatoutes les assiettestous les plats et toutes les bouteilles ; puissoûl de liquide et de mangeailleabrutirougesecouépar des hoquetsl'esprit troublé et la bouche grasseildéboutonna son uniforme pour soufflerincapable d'ailleurs defaire un pas. Ses yeux se fermaientses idéess'engourdissaient ; il posa son front pesant dans ses bras croiséssur la tableet il perdit doucement la notion des choses et desfaits.
Le derniercroissant éclairait vaguement l'horizon au-dessus des arbresdu parc. C'était l'heure froide qui précède lejour.
Des ombresglissaient dans les fourrésnombreuses et muettes ; etparfoisun rayon de lune faisait reluire dans l'ombre une pointed'acier.
Le châteautranquille dressait sa haute silhouette noire. Deux fenêtresseules brillaient encore au rez-de-chaussée.
Soudainune voix tonnante hurla :
"Enavant ! nom d'un nom ! à l'assaut ! mes enfants !"
Alorsenun instantles portesles contrevents et les vitres s'enfoncèrentsous un flot d'hommes qui s'élançabrisacreva toutenvahit la maison. En un instant cinquante soldats armésjusqu'aux cheveuxbondirent dans la cuisine où reposaitpacifiquement Walter Schnaffsetlui posant sur la poitrinecinquante fusils chargésle culbutèrent le roulèrentle saisirentle lièrent des pieds à la tête.
Ilhaletait d'ahurissementtrop abruti pour comprendrebattucrosséet fou de peur.
Et toutd'un coupun gros militaire chamarré d'or lui planta son piedsur le ventre en vociférant :
"Vousêtes mon prisonnierrendez-vous !"
LePrussien n'entendit que ce seul mot "prisonnier"et ilgémit : "Yayaya."
Il futrelevéficelé sur une chaiseet examiné avecune vive curiosité par ses vainqueurs qui soufflaient commedes baleines. Plusieurs s'assirentn'en pouvant plus d'émotionet de fatigue.
Ilsouriaitluiil souriait maintenantsûr d'être enfinprisonnier !
Un autreofficier entra et prononça :
"Moncolonelles ennemis se sont enfuis ; plusieurs semblent avoir étéblessés. Nous restons maîtres de la place."
Le grosmilitaire qui s'essuyait le front vociféra : " Victoire!"
Et ilécrivit sur un petit agenda de commerce tiré de sapoche :
"Aprèsune lutte acharnéeles Prussiens ont dû battre enretraiteemportant leurs morts et leurs blessésqu'on évalueà cinquante hommes hors de combat Plusieurs sont restésentre nos mains."
Le jeuneofficier reprit :
"Quellesdispositions dois-je prendremon colonel ?"
Le colonelrépondit :
"Nousallons nous replier pour éviter un retour offensif avec del'artillerie et des forces supérieures."
Et ildonna l'ordre de repartir.
La colonnese reforma dans l'ombresous les murs du châteauet se mit enmouvementenveloppant de partout Walter Schnaffs garrottétenu par six guerriers le revolver au poing.
Desreconnaissances furent envoyées pour éclairer la route.On avançait avec prudencefaisant halte de temps en temps.
Au jourlevanton arrivait à la sous-préfecture de LaRoche-Oyseldont la garde nationale avait accompli ce fait d'armes.
Lapopulation anxieuse et surexcitée attendait. Quand on aperçutle casque du prisonnierdes clameurs formidables éclatèrent.Les femmes levaient les bras ; des vieilles pleuraient ; un aïeullança sa béquille au Prussien et blessa le nez d'un deses gardiens.
Le colonelhurlait.
"Veillezà la sûreté du captif."
On parvintenfin à la maison de ville. La prison fut ouverteet WalterSchnaffs jeté dedanslibre de liens.
Deux centshommes en armes montèrent la garde autour du bâtiment.
Alorsmalgré des symptômes d'indigestion qui le tourmentaientdepuis quelque tempsle Prussienfou de joiese mit àdanserà danser éperdumenten levant les bras et lesjambesà danser en poussant des cris frénétiquesjusqu'au moment où il tombaépuiséau piedd'un mur
Il étaitprisonnier ! Sauvé !
C'estainsi que le château de Champignet fut repris à l'ennemiaprès six heures seulement d'occupation.
Le colonelRatiermarchand de drapqui enleva cette affaire à la têtedes gardes nationaux de La Roche-Oyselfut décoré.