 home page
home page
 pagina iniziale
pagina iniziale
|

|
by
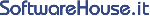
|


|
Ebook in formato Kindle (mobi) - Kindle File Ebook (mobi)
Formato per Iphone, Ipad e Ebook (epub) - Ipad, Iphone and Ebook reader format (epub)
Versione ebook di Readme.it powered by Softwarehouse.itAlphonse DaudetSouvenirs d'un Homme de Lettres
EMILEOLLIVIER
Entre tousles salons parisiens où fréquenta mon premier habitlesalon Ortolanà l'Ecole de droitm'a laissé unsouvenir aimable. Le père Ortolanméridional àtête finejurisconsulte de renométait aussi poèteà ses heures. Il avait publié les Enfantines ettout en jurant ne jamais écrire que pour le jeune âgeil ne dédaignait pas à l'endroit de ses versl'approbation des grandes personnes. Aussi ses soiréestrèssuivies par les indigènes des quartiers savantsoffraient-elles un agréable et original mélange dejolies femmesde professeurs et d'avocatsde gens doctes et depoètes. C'est comme poète qu'on m'invitait.
Parmi lesjeunes et antiques célébrités que je vis passerlà dans le brouillard d'or des premiers éblouissementsvint un soir Emile Ollivier. Il était avec sa femmelapremièreet le grand musicien Lisztson beau-père. Dela femmeje me rappelle des cheveux blonds sur un corsage de velours; de Lisztdu Liszt de ce temps-làmoins encore. Je n'avaisd'yeuxde curiosité que pour Ollivier. Agé d'environtrente-trois ans (on était en 1858)coryphée du partitrès populaire parmi la jeunesse républicaine qui étaitfière d'avoir un chef de son âgeil marchait alors dansla gloire. On se disait la légende de sa famille : le vieuxpère longtemps proscritle frère tombé dans unduellui-même proconsul à vingt ans et gouvernantMarseille par l'éloquence. Tout cela lui donnait de loindansles espritsune certaine tournure de tribun romain ou grecet mêmequelque ressemblance avec les jeunes hommes tragiques de la grandeRévolution : les Saint-Justles Desmoulinles Danton. Pourmoique la politique touchait peule voyant ainsipoétiquemalgré ses lunetteséloquentlamartinientoujoursprêt à parler et à s'émouvoirje nepouvais m'empêcher de le comparer à un arbre de son pays-- non à celui dont il porte le nom et qui est symbole desagesse -- mais à un de ces pins harmonieux qui couronnent lescollines blanches et se reflètent dans les flots bleus descôtes provençalespins stériles mais gardant eneux comme un écho de la lyre antiqueet frémissanttoujoursrésonnant toujours de leurs innombrables petitesaiguilles entrechoquées au plus léger souffle detempêteau moindre vent qui vient d'Italie.
EmileOllivier était alors un des Cinqun des cinq députésquiseulsosaient braver l'Empireet il siégeait au milieud'euxtout en haut des bancs de l'assembléeisolédans son opposition comme sur un inexpugnable Aventin. En facerenversé dans le fauteuil présidentiell'air endormiet lasMornyde son oeil froid de connaisseur d'hommesguettaitcelui-ci : il l'avait jugé moins Romain que Grecplus emportépar la légèreté athénienne que lestéde prudence et de froide raison latine. Il connaissait l'endroitvulnérable ; il savait que sous cette toge de tribun secachait la vanité native et sans défense des virtuoseset des poèteset c'est par là qu'un jour ou l'autre ilespérait en venir à bout.
Des annéesplus tardquand pour la seconde fois et dans les circonstances queje vais direje me rencontrai avec Emile Ollivieril étaitconquis à l'Empire. Morny avant de mourir avait mis comme unecoquetterie à vaincreà force d'avances narquoises etde hautaines câlineriesles résistancespour la formeet la galeriede cette mélodieuse vanité. On avaitcrié dans les rues : « la grande trahison d'EmileOllivier »et pour celaEmile Ollivier se croyait le comte deMirabeau. Mirabeau avait voulu faire marcher d'accord la Révolutionet la Monarchie ; Ollivierplein d'ailleurs des intentions lesmeilleurestentait après vingt ans d'unir la Liberté àl'Empireet ses efforts rappelaient Phrosine mariant l'Adriatiqueavec le Grand Turc. En attendant le Grand Turccomme il se trouvaitveuf depuis longtempsil s'était remarié lui-mêmeavec une toute jeune filleprovençale comme luiquil'admirait. On le disait radieuxtriomphantune même lune demiel dorait de ses plus doux rayons et ses amours et sa politique. Unhomme heureux !
Cependantun coup de pistolet retentit du côté d'Auteuil. PierreBonaparte venait de tuer Victor Noir ; et cette balle corseàtravers la poitrine d'un jeune hommefrappait en plein coeur lafiction de l'Empire libéral. Paris soudain s'émeut ;les cafés parlent à voix hauteune foule gesticule surles trottoirs. De minute en minute les nouvelles arriventles bruitscirculent ; on se raconte l'intérieur étrange du princePierrecette maison d'Auteuil fermée en plein Pariscommeune tour de seigneur génois ou florentinsentant la poudre etla ferrailleet tout le jour retentissante du bruit des pistolets detir et du cliquetis des épées froissées. On ditce qu'était Victor Noirsa grande douceursa jeunessesonmariage tout prochain. Et voilà que les femmes s'en mêlent: elles plaignent la mèrela fiancée ;l'attendrissement d'un roman d'amour s'ajoute aux colèrespolitiques. La Marseillaiseencadrée de noirpublieson appel aux armes ; des gens disent que ce soir Rochefortdistribuera quatre mille revolvers dans ses bureaux. Deux cent millehommesenfants ou femmesles quartiers bourgeoistous lesfaubourgs se préparent pour la grande manifestation dulendemain ; il souffle un vent de barricadesetdans la tristessedu jour tombanton entend ces bruits indistinctsprécurseursdes révolutionsqui semblent les craquements sourds des aisd'un trône.
A cemomentje rencontrai un ami sur le boulevard. « Ça vamallui dis-je. - Très malet le plus bêtec'estqu'en hautils ne se doutent pas de la gravité de lachose. » Puispassant son bras sous mon bras : « EmileOllivier te connaîtviens avec moi place Vendôme. »
Depuisqu'Emile Ollivier y était entréle ministère dela justice avait perdu tout caractère de pompe et de morgueadministrative. Prenant au sincère son rêve d'Empiredémocratique et libéralvrai ministre àl'américaineOllivier n'avait pas voulu habiter ces vastesappartementsces hauts salonsbrodés d'abeillestimbréset chargés selon lui de trop autocratiques dorures. Iloccupait toujoursrue Saint-Guillaumeson modeste logementd'avocat-députéet arrivait chaque matin placeVendômeune grande serviette bourrée de papiers sous lebrasavec sa redingote et ses lunettescomme un homme d'affairesqui va au Palaiscomme un brave employé qui se rendpédestrement à son bureau. Cela le faisait mépriserun peu par les garçons et les huissiers. Porte grande ouverteescalier désert ! Huissiers et garçons nous laissèrentpasserne daignant pas même nous demander où nousallionsni qui nous cherchionstémoignant seulement par unair dédaigneusement résigné et une certaineinsolence correcte d'attitude combien ils trouvaient ces moeursfamilières et nouvelles contraires aux belles traditions etéloignées de l'idéal administratif.
Dans ungrand cabinet haut de plafondlarge ouvert sur deux vastesportes-fenêtresun de ces cabinets d'aspect triste et froid oùtout est vertmais de ce vert bureaucratique des cartons verts etdes fauteuils de cuir vert qui est à la belle verdure desforêts ce qu'un papier timbré est à un sonnet survélince que le cidre est au champagne-- le ministre étaitseuladossé contre la cheminéeà son postedans une attitude d'orateur. La nuit venait. Des garçonsapportèrent de grandes lampes tout allumées.
Mon amiavait dit vraion ne se doutait de rien en haut ; les bruitsde la rue n'arrivent qu'indistincts sur ces cimes. Emile Ollivieravec l'infatuation naturelle doublée d'une certaine façonmyope de voirqui caractérise l'homme au pouvoirnousdéclara que tout allait pour le mieuxqu'il était aucourant des choses ; il nous montra même le billet écritpar Pierre Bonaparte à M. Contiqu'on venait de luicommuniquerbillet sauvage et féodalbien dans la traditionitalienne du seizième sièclecommençant ainsi :« Deux jeunes gens sont venus me provoquer... » et seterminant par ces mots : «... Je crois que j'en ai tuéun ».
Alors jepris la parole et je racontai ce que je croyais être la véritéparlantnon en politiquemais en hommedisant l'effervescence desespritsl'exaspération de la ruel'alternative inévitabled'une prise d'armes ou d'un courageux acte de justice. J'ajoutai queFonvielle et Noir me semblaientcomme à touscertainementincapables d'avoir voulu tuer ou frapper le prince chez lui ; que jeles connaissaisNoir surtoutet combien m'était sympathiquece grand garçon inoffensifpresque un enfant encoreétonnélui-même de ses succès parisiens et fier de sa précocerenomméecherchant à force de travail àconquérir ce qui lui manquait en fait d'instruction premièreet dont la plus grande joie était de se faire apprendre par unami quelque courte citation latineavec la manière del'introduire adroitementà propos de n'importe quoidans laconversationhistoire d'étonnerle soirpar cet étalaged'éruditionJ.-J. Weissalors au Journal de Parisqui lui enseignait l'orthographe.
EmileOllivier m'écouta attentivementl'air pensif et décidépuisquand j'eus finiaprès un silenceil prononçad'une voix fière cette phrase que je rapporte textuellement :« Eh bien ! si le prince Pierre est un assassinnousl'enverrons au bagne ! »
Au bagneun Bonaparte ! C'était bien là le mot d'un garde dessceaux de l'Empire libérald'un ministre encore empêtrédans ses illusions d'orateurd'un ministre qui porte le titre deministre sans en posséder l'espritd'un ministre enfin quihabite rue Saint-Guillaume !
Lelendemainil est vraiPierre Bonaparte était prisonniermais prisonnier comme l'est un princeau premier étage de laTour d'Argentavec vue sur la place du Châtelet et la Seineet les Parisiens en passant les ponts se montraient son cachot pourrire et les rideaux blancs de ses fenêtres à peinegrillées. Quelques semaines aprèsle prince Pierreétait solennellement acquitté par la haute Cour deBourges. De bagneEmile Ollivier n'en parlait plus ; il quittaitdécidément la rue Saint-Guillaume pour la placeVendôme. Désormaisdans les grands escalierslesvastes corridorshuissiers et garçons de bureau souriaientcérémonieusement à son passageil étaitdevenu parfait ministre et l'Empire libéral avait vécu!
En résuméun homme d'Etat médiocreplein de fougue et sans réflexionmais un honnête hommeun poète idéalistefourvoyé dans les affairesainsi peut se définir EmileOllivier. Morny d'abordpuis d'autres après Mornyenjouèrent. Républicainil essaya de consolider ladynastieen passant dessus un crépi de liberté ; plustardil voulait la paixdéclara la guerreet non pas coeurlégercomme il le dit par inspiration malheureusemaisesprit irrémédiablement légeril nous entraînaavec lui dans l'abîme d'où nous sommes sortisoùil est resté !
L'autresoiron finit toujours par se rencontrer dans Parisnous dînionsen face l'un de l'autre à une table amie : le mêmequ'autrefoismême regard de rêveur interrogeant etindécis derrière le cristal des lunettesmêmephysionomie de parleuroù tout est dans le pli des lèvresle dessin de la bouche plein d'audace et sans volonté. Fier etdroit d'ailleursmais tout blanc. Blanc par ses cheveux drusblancpar ses favoris courtsblanc comme un camp abandonné dans unedésastreuse campagnesous la neige. Avec celala voixcassantenerveusedes gens qui en ont sur le coeur plus gros qu'ilsn'en veulent laisser voir...
Et je merappelais le jeune tribunnoir comme un corbeauentr'aperçudans le salon du père Ortolan.
Gambetta
Un jouril y a des années et des annéesà ma tabled'hôte de l'Hôtel du Sénatque je vous ai déjàmontrée -- toute petite au fond d'une étroite cour aupavé froid et balayéoù des lauriers-roses etdes fusains s'étiolaient dans leurs classiques caisses vertes-- devant un somptueux festin à deux francs par têteGambetta et Rochefort se rencontrèrent. J'avais amenéRochefort. Il m'arrivait ainsi quelquefois d'inviter un ami delettres au lendemain d'un article au Figaroquand souriait lafortune ; cela variait et ravigotait notre table un peu provinciale.Malheureusement Gambetta et Rochefort n'étaient pas faits pours'entendreet je crois bien que ce soir-là ils ne separlèrent point. Je les voischacun à un boutséparéspar toute la longueur de la nappe et tels déjà qu'ilsdemeureront : l'un serrétout en dedansle rire sec et enlongle geste rarel'autre qui rit en largecriegesticuledébordant et fumeux comme une cuve de vin de Cahors. Et que dechosesque d'événements tenaientsans qu'on s'endoutât dans l'écart de ces deux convivesau milieu despots à goudron et des ronds de serviettes d'un maigre dînerd'étudiants !
LeGambetta d'alors jetait sa gourme et assourdissait de sa tonitruantefaconde les cafés du quartier Latin. Mais ne vous y trompezpointles cafés du quartierà cette époquen'étaient pas seulement l'estaminet où l'on boit et oùl'on fume. Au milieu de Paris musclésans vie publique etsans journauxces réunions de la jeunesse studieuse etgénéreusevéritables écoles d'oppositionou plutôt de résistance légaledemeuraient lesseuls endroits où pouvait encore se faire entendre une voixlibre. Chacun d'eux avait son orateur attitréune table quià de certains momentsdevenait presque une tribuneet chaqueorateurdans le quartierses admirateurs et ses partisans.
« AuVoltaireil y a Larmina qui est fort... bigre ! qu'il est fortleLarmina du Voltaire !...
-- Je nedis pasmais au ProcopePesquidoux est encore plus fort que lui. »
Et l'onallait par bandeen pèlerinageau Voltaire entendre Larminapuis au Procope entendre Pesquidoux avec la foi naïveardentedes vingt ans de cette époque-là. En somme cesdiscussions autour d'un bockdans la fumée des pipespréparaient une génération et tenaient en éveilcette France qu'on croyait définitivement chloroformisée.Plus d'un doctrinaire (1)quiaujourd'hui loti ou espérantl'êtreaffecte pour ces moeurs un dédain de bon goûtet traite volontiers de vieux étudiants les hommes nouveauxalongtemps vécu et vit encore (j'en connais) des bribesd'éloquence ou de haute raison que des prodigues bien douéslaissaient alors traîner sur les tables.
[(1) Ecriten 1878pour le Nouveau Tempsde Saint-Pétersbourg.]
Sans doutequelques-uns de nos jeunes tribuns s'attardèrentvieillirentsur placeparlèrent toujours et ne firent jamais rien. Toutcorps d'armée a ses traînards qu'en fin de compte latête abandonne ; mais Gambetta n'était pas de ceux-là.S'il s'escrimait au café sous le gazce n'étaitqu'après avoir rempli de travail réel sa journée.Comme 1'usinele soirlâche sa vapeur au ruisseauil venaitlà répandre en paroles son trop-plein de verve etd'idées. Cela ne l'empêchait point d'être étudiantsérieuxd'avoir des triomphes à la conférenceMoléde prendre ses inscriptionsde conquérir sesdiplômes et ses licences. Un soirchez Mme Ancelot-- qu'il ya longtemps de celaDieu de Dieu ! -- dans ce salon de la rueSaint-Guillaume plein de vieillards pétillants et d'oiseaux encageje me rappelle avoir entendu dire à la trèsbienveillante maîtresse du logis : « Mon gendre Lachaud aun nouveau secrétaireun jeune homme très éloquentparaît-ilavec un bien drôle de nom... attendez... ils'appelle... il s'appelle M. Gambetta. » Assurément labonne vieille dame était loin de prévoir jusqu'oùirait ce jeune secrétaire qu'on disait éloquent et quiavait un si drôle de nom. Et pourtantà partl'inévitable apaisement dont la pratique de la vie se charged'apprendre la nécessité à de moins subtilementcompréhensifs que luià part certaine connaissancepolitique des mobiles et des dessous facilement puisée dansl'exercice du pouvoir et le maniement des affairesle stagiaire dece temps-làpour l'ensemble du caractère et de laphysionomieétait bien ce qu'il est resté. Non pasgros encoremais carrément tailléle dos rondlegeste tutoyeuraimant déjà à s'appuyer tout enmarchanttout en causantau bras d'un amiil parlait beaucoupàtout proposde cette dure et forte voix méridionale quidécoupe les phrases comme au balancier et frappe les mots enmédaille ; mais il écoutait aussiinterrogeaitlisaits'assimilait toutes choseset préparait cet énormeemmagasinement de faits et d'idées si nécessaire àqui prétend diriger une époque et un pays aussicompliqués que les nôtres. Gambetta est un des rareshommes politiques qui ait des curiosités d'Art et quisoupçonne que les Lettres ne sont pas sans tenir quelque placedans la vie d'un peuple. Cette préoccupation apparaîtcouramment dans ses conversations et perce même dans sesdiscoursmais sans morguesans pédantisme et comme venant dequelqu'un qui a vu des artistes de près et pour qui les chosesdes Lettres et des Arts sont quotidiennes et familières. Dutemps de l'Hôtel du Sénatle jeune avocat dont j'étaisl'amibrûlait parfois un cours pour aller dans les Muséesadmirer les maîtresou défendreaux ouvertures deSaloncontre les endormis et les retardataires le grand peintreFrançois Millet alors méconnu. Son initiateur et songuide dans les sept cercles de l'enfer de la peintureétaitun méridional comme luiplus âgé que luipoilubourruavec de terribles yeux qu'on voyait luire sous d'énormessourcils retombantscomme un feu de brigands au fond d'une cavernevoilée de broussailles. C'était ThéophileSilvestreparleur superbe et infatigableà la voixmontagnarde et sonnant le fer ariégeoisécrivain dehaute saveurcritique d'Art incomparableépris des peintreset les pénétrant avec la subtilité compréhensived'un amoureux et d'un poète. Il aimait Gambetta inconnupressentant chez lui son grand rôleil continua àl'aimer plus tard malgré de terribles dissentimentspolitiqueset vint mourir un jour à sa tablede joie on peutle direet dans l'ivresse d'une tardive réconciliation. Cespromenades à travers le Salonà travers le Louvreaubras de Théophile Silvestre avaient fait à Gambettaauprès de certains hommes d'Etat en herbedèsl'enfance sanglés et cravatésune sorte de réputationde paresse. Ce sont ceux-là encoremais grandisqui toujourspleins d'eux-mêmes et toujours hermétiquement bouchésle traitent en petit comité d'homme frivole et de politiquepas sérieuxparce qu'il se plaît à la compagnied'un garçon d'esprit qui est comédien. Cela prouveraittout au plus qu'alors comme aujourd'hui Gambetta se connaissait enhommes et savait le grand secret pour se servir d'euxqui est des'en faire aimer. Un trait de caractère qui achèvera depeindre le Gambetta d'alors : cette voix de porte-voixce parleurterriblece grand gasconnant n'était pas gascon. Est-ceinfluence de la race ? Mais par plus d'un côté cetenragé fils de Cahors se rapprochait de la frontière etde la prudence italiennes ; le mélange du sang génoisen faisait presque un avisé Provençal. Parlant souventparlant toujoursil ne se laissait pas emporter dans le tourbillonde sa parole ; très enthousiasteil savait d'avance le pointprécis où son enthousiasme devait s'arrêteretpour tout exprimer d'un motc'est à peu près le seulgrand parleurà ma connaissancequi ne fût pas en mêmetemps un détestable prometteur.
Un matincomme cela finit toujours par arrivercette bruyante couvéede jeunesse qui nichait Hôtel du Sénatprit son volayant senti pousser ses ailes. L'un tira au nordl'autre au sud ; onse dispersa aux quatre coins du ciel. Gambetta et moi nous nousperdîmes de vue. Je ne l'oubliai pas cependantpiochant pourmon compte et vivant très à l'écart du mondepolitiqueje medemandais quelquefois : « Où est passémon ami de Cahors ? » et cela m'eût étonnéqu'il ne fût pas en train de devenir quelqu'un. Aquelques années de làme trouvant au Sénatnonplus à l'hôtel mais au palais du Sénatun soirde réception officielleje m'étais réfugiéloin de la musique et du bruit sur le coin de banquette d'une sallede billard taillée dans les appartements immenseshauts deplafond à y loger six étagesde la reine Marie deMédicis. C'était l'époque de crise et develléités d'être aimableoù l'Empirefaisait des mamours aux partisparlait de concessions mutuelles etsous couleur de réformes et d'apaisementessayait d'attirer àluien même temps que les moins engagés desRépublicainsles derniers survivants de l'anciennebourgeoisie libérale. Odilon Barrotje me rappellelevénérable Odilon Barrot jouait au billard. Toute unegalerie de vieillards ou d'hommes prématurément gravesl'entouraitmoins attentivecertesà ses carambolages qu'àsa personne. On attendait qu'une phraseun mot tombât de ceslèvres jadis éloquentespour recueillir le mot ou laphrase et l'enfermer dans le cristalpieusementdévotementcomme fit l'ange pour la larme d'Eloa. Mais Odilon Barrot s'obstinaità ne rien direil mettait du blancpoussait l'ivoiretoutcela noblement et d'un beau geste où tout un passé desolennité bourgeoise et de parlementarisme haut cravatésemblait revivre. On ne parlait guère davantage autour de lui: ces pères conscrits d'autrefoisces Epiménidesendormis depuis Louis-Philippe et 1848 ne s'entretenaient qu'àvoix très bassecomme pas bien sûrs d'êtreréveillés. On surprenait ces mots au vol : «Grand scandale... procès Baudin... scandale... Baudin. »Ne lisant guère de journaux et sorti très tard dans lajournéej'ignoraismoice qu'était ce fameux procès.Tout à coupj'entendis le nom de Gambetta : -- «Qu'est-ce que c'est donc que ce M. Gambetta ? » disait un desvieillards avec une impertinence voulue ou naïve. Tous lessouvenirs de ma vie au quartier me revinrent. J'étais bientranquille dans mon coinindépendant comme un brave homme delettres gagnant sa vie et trop dégagé de toute attacheet de toute ambition politique pour qu'un tel aréopagesivénérable fût-ilm'en imposât. Je me levai: « Ce M. Gambetta ? Mais c'est à coup sûr unhomme fort remarquable... Je l'ai connutout jeune hommeet chacunde nous lui prédisait l'avenir le plus magnifique. » Sivous aviez vu la stupéfaction générale àcette sortieles carambolages arrêtésles queues debillard suspenduestout ce monde irrité et les billeselles-mêmes sous la lampe qui me regardaient de leurs yeuxronds. D'où sortait celui-làcet inconnuqui sepermettait d'en défendre un autreet devant Odilon Barrotencore !... Un homme d'esprit (il s'en rencontre partout)M. Oscarde Valléeme sauva. Il était avocatluiprocureurgénéralque sais-jede la boutique enfinet sa toquemême laissée au vestiaire lui conférait le droitde parler n'importe où ; il parla : -- « Monsieur araisonparfaitement raisonMaître Gambetta n'est pas lepremier venu ; nous en faisons tous grand cas au Palais pour sonéloquence... » et voyant sans doute que ce motd'éloquence laissait froide la compagnieil ajouta eninsistant : «... pour son éloquence et pour sa jugeotte! »
Vint lesuprême assaut contre l'Empireles mois chargés àpoudrebourrés de menacestout Paris frémissant sousje ne sais quel souffle précurseurcomme la forêt avantl'orage ; ah ! nous allions en voirnous tous de la générationqui se plaignait de n'avoir rien vu. Gambettaà la suite desa plaidoirie au procès Baudin était en train de passergrand hommeles anciens du parti républicainles combattantsde 51les exilésles vieilles barbes avaient pour lejeune tribun des tendresses paternellesles faubourgs attendaienttout de « l'avocat borgne »la jeunesse ne jurait quepar lui. Je le rencontrais quelquefois : « il allait êtrenommé député... il revenait de faire un granddiscours à Lyon ou bien à Marseille !... »Toujours agitésentant la poudretoujours dans l'excitationd'un lendemain de batailleparlant hautserrant fort la main etrejetant en arrière ses cheveux dans un geste plein dedécision et d'énergie. Charmantd'ailleursplus quejamais familier et se laissant volontiers arrêter dans sonchemin pour causer ou rire : « Déjeuner à Meudon» répondit-il à un de ses amis qui l'invitaitvolontiers ! mais un de ces joursquand nous en aurons fini avecl'Empire. »
Voicimaintenant la grande bousculadela guerrele Quatre SeptembreGambetta membre de la Défense Nationale en même tempsque Rochefort. Ils se retrouvèrent face à face devantle tapis vert où se signent proclamations et décretscomme douze ans auparavantdevant la nappe cirée de ma tabled'hôte. L'arrivée subite au pouvoir de mes deuxcompagnons du quartier Latin ne m'étonna point. L'air étaitpleinà ce momentde bien plus surprenants prodiges. Legrand bruit de l'Empire écroulé remplissait encore lesoreillesempêchait d'entendre les bottes de l'arméeprussienne qui s'avançait. Je me rappelle une premièrepromenade à travers les rues. Je revenais de la campagne -- uncoin tranquille de la forêt de Sénart -- respirantencore l'odeur fraîche des feuilles et de la rivière. Jeme sentis comme étourdi : plus de Parisune immense foirequelque chose d'une énorme caserne en fête. Tout lemonde en képiet les petits métiers subitement renduslibres par la disparition de la policeremplissant comme auxapproches du jour de l'anla ville entière d'étalagesmulticolores et de cris. La foule grouillaitle jour tombait ; dansl'air des lambeaux de Marseillaise. Tout à coupbiendans mon oreilleune voix du faubourggoguenarde et traînantecria : « Ach'tez la femme Bonaparteses orgiesses amants...deux sous ! » et on me tendait un carré de papieruncanard frais encore de l'imprimerie. Quel rêve ! En pleinParisà deux pas de ces Tuileries où le bruit desdernières fêtes flotte encoresur ces mêmesboulevards que quelques mois auparavant j'avais vusbalayés àcoups de casse-têteschaussée et trottoirspar desescouades de policiers. L'antithèse me fit une impressionprofondeet j'eus cinq minutes durant le sentiment net et aigu decette chose effrayante et grandiose qu'on appelle une révolution.
Je visGambetta une foisdans cette première période dusiègeau ministère de l'intérieur -- oùil venait de s'installer comme chez luisans étonnementenhomme à qui arrive une fortune dès longtemps présagée-- en train de recevoir tranquillementà la papaavec sabonhomie un peu narquoiseces chefs de service quihier encoredisaient dédaigneusement « le petit Gambetta ! »etmaintenant arrondissaient l'échine pour soupirerl'airpénétré : « si monsieur le ministre daigneme le permettre ! »
Aprèsje ne revis plus Gambetta que de loin en loinpar apparitions etcomme à travers quelque subite déchirure faite dansl'obscurefroide et sinistre nuée qui planait sur le Paris dusiège. Une de ces rencontres m'a laissé un souvenirinoubliable. C'était à Montmartresur la placeSaint-Pierreau pied de cet escarpement de plâtre et d'ocreque les travaux de l'Eglise du Sacré-Coeur ont couvert depuisde gravats roulantsmais où alorsmalgré les pasnombreux des flâneurs dominicaux et les glissades des gaminsverdoyaient encorerongés et déchiquetésquelques lambeaux de gazon maigre. Au-dessous de nousdans la brumela ville avec ses mille toits et son grand murmure quide temps entempss'apaisait pour laisser entendre au lointain la voix sourde ducanon des forts. Il y avait làsur la placeune petitetenteet au milieu d'une enceinte tracée par une cordeungrand ballon jaune tirant sur son câblequi se balançait.Gambettadisait-onallait partirélectriser la provincelaruer à la délivrance de Parisexalter les âmesrehausser les couragesremotiver enfin (et peut-êtresans latrahison de Bazaine y eût-il réussi) les miracles de1792 ! D'abordje n'aperçus que Nadarl'ami Nadaravec sacasquette d'aéronaute mêlée à tous lesévénements du siègepuisau milieu d'ungroupeSpuller et Gambettatous deux emmitouflés defourrures. Spuller fort tranquillecourageux avec simplicitémais ne pouvant détacher ses yeux de cette énormemachine dans laquelle il devait prendre place en sa qualité dechef de cabinetet murmurant d'une voix de rêve : «C'est une chose vraiment bien extraordinaire ». Gambettacommetoujourscausant et roulant son dos presque réjoui del'aventure. Il me vitme serra la main : une poignée de mainqui disait bien des choses. Puis Spuller et lui entrèrent dansla nacelle : « Lâchez tout ! » clama la voix deNadar. Quelques saluts un cri de vive la Républiquele ballonqui fileet plus rien.
Le ballonde Gambetta arriva sain et saufmais combien d'autres tombèrentpercés de balles prussiennespérirenten mer dans lanuitsans compter l'invraisemblable aventure de celui qui poussévingt heures par la tempêtes'en alla échouer enNorvègeà deux pas des fiords et de l'Océanglacé. Certesquoi qu'on en ait pu direil y avait del'héroïsme dans ces départset ce n'est pas sansémotion que je me rappelle cette poignée de maindernière et cette nacelle d'osier quiplus petite et plusfragile que la barque historique de Césaremportait dans leciel d'hiver toute l'espérance de Paris.
Je neretrouvai Gambetta qu'un an plus tardau procès de Bazainedans cette salle à manger d'été du Trianon deMarie-Antoinette dont les entre-colonnements gracieux se prolongententre la verdure des deux jardinset qui élargieagrandie detentures et de cloisonstransformée en conseil de guerregardait encore avec ses trumeaux peuplés de colombes etd'amourscomme un souvenirun parfum des élégancespassées. Le duc d'Aumale présidait ; Bazaine étaità son banc d'accuséhautaintêtuinconscientdespotiquela poitrine barrée de rouge par le grand cordon.Et certes il y avait quelque chose de haut dans ce spectacle d'unsoldat quitraître à la patrieallait être jugéen pleine république par le descendant des anciens rois. Lestémoins défilaientdes uniformes et des blousesdesmaréchaux et des soldats des employés des postesd'anciens ministresdes paysansdes bonnes femmesdes forestierset des douaniers dont le pied habitué à l'humusélastique des bois ou au rugueux cailloutis des grandesroutesglissait sur les parquets et butait aux plis des tapisetquipar leur salut interloqué et craintifeussent fait riresi l'embarras naïf de tant d'humbles héros n'avait plutôttiré des larmes. Fidèle image de ce sublime drame de larésistance pour le pays où tousgrands et petitstrouvent leur devoir. On appelle Gambetta. A ce moment les hainesréactionnaires se déchaînaient contre son nometl'on parlaitlui ausside le poursuivre. Il entra en petitpardessusson chapeau à la mainet fit en passant au ducd'Aumale un léger salutoh ! mais un salut que je vois encore: ni trop raideni trop basmoins un salut qu'un signe demaçonnerie entre gens quimême divisésd'opinionssont toujours sûrs de se rencontrer et des'entendre sur certaines questions de patriotisme et d'honneur. Leduc d'Aumale n'eut point l'air fâchéet j'étaisravi dans mon coin de la correcte et digne attitude de mon anciencamarade ; mais je ne pus l'en félicitervoici pourquoi.Paris à peine débloquétout tremblant encore dela fièvre obsidionalej'avais écrit sur Gambetta et ladéfense en province un article sincère mais trèsinjusteque j'ai eu grand plaisirune fois mieux informéàretrancher de mes livres. Tout Parisien était un peu fou àce momentmoi comme les autres. On nous avait tant mentitantjoués. Nous avions lu aux murs des mairies tant d'affichesrayonnant l'espoirtant de proclamations enlevantes suivies lelendemain de si lamentables retombées à plat ; on nousavait fait faire fusil sur l'épaule et sac au dos tantd'imbéciles promenades ; on nous avait tenus si souvent àplat ventre dans la boue ensanglantéeimmobilesinutilesbêtestandis que les obus nous pleuvaient sur le dos ! Et lesespionset les dépêches ! « Occupons les hauteursde Montretoutl'ennemi recule ! » ou bien encore : « Al'engagement d'avant-hieravons pris deux casques et la bretelled'un fusil. » Cela pendant quene demandant qu'à sortiret combattrequatre cent mille gardes-nationaux battaient la semelledans Paris ! Puisles portes ouvertesç'avait étéautre chose ; et tandis qu'on disait à la province : «Paris ne s'est pas battu ! » on soufflait à Paris : «Tu as été lâchement abandonné par laprovince. » Si bien que furieuxhonteuximpuissants àrien distinguer dans ce brouillard de haine et de mensongesoupçonnant partout la trahisonla lâcheté et lasottiseon avait fini par tout mettreParis et Provincedans lemême sac. L'accord s'est fait depuis quand on a vu clair. Laprovince a appris ce quecinq mois durantParis a déployéd'héroïsme inutile ; et moiParisien du siègej'ai reconnu pour mon humble part combien furent admirables l'actionde Gambetta dans les départementset ce grand mouvement de laDéfense où nous n'avions tous vu d'abord qu'une sériede fanfaronnes tarasconnades.
Nous noussommes rencontré de nouveau avec Gambettail y a deux ans.Aucune explicationil est venu a moiles mains tendues ; c'étaità Ville-d'Avraychez l'éditeur Alphonse Lemerredansla maison de campagne qu'a si longtemps habitée Corot. Unemaison charmantefaite pour un peintre ou un poètetoutdix-huitième siècle avec ses boiseries conservéesdes trumeaux sur les porteset un petit portique pour descendre aujardin. C'est dans le jardin que nous déjeunâmesenplein airparmi les fleurs et les oiseauxsous les grands arbresvirgiliens que le vieux maître aimait à peindred'unvert si doux au frais voisinage des étangs. On restal'après-midi à se rappeler le passé et commequoi nous sommes à ParisGambettale docteur et moilesderniers survivants de notre table d'hôte. Puis vint le tour del'artde la littérature. Gambettaje le constatai avec joielisait toutvoyait toutdemeurait expert connaisseur et fin lettré.Ce furent cinq heures délicieusesces cinq heures passéesainsidans cet abri fleuri et vertplacé entre Paris etVersailleset si loin pourtant de tout bruit politique. Gambettaparaît-ilen comprit le charme : huit jours après cedéjeuner sous les arbresil s'achetaitlui aussiune maisonde campagne à Ville-d'Avray.
HISTOIREDE MES LIVRES :
NUMAROUMESTAN
Quand j'aicommencé cette histoire de mes livresoù l'on a puvoir de la fatuité d'auteurmais qui me semblait a moi lavraie façonoriginale et distinguéed'écrireles mémoires d'un homme de lettres dans la marge de sonoeuvrej'y prenais -- je l'avoue -- beaucoup de plaisir. Aujourd'huimon agrément est moindre. D'abord l'idée a perdu de sasaveurutilisée par plusieurs de mes confrèreset nondes moins illustres ; puis l'envahissement toujours montant du grandet du petit reportagele tumulte et la poussière qu'ilsoulève autour de la pièce ou du livresous forme dedétails anecdotiques qu'un écrivain qui n'est nipontifeni grognon se laisse volontiers arracher. Et voilà mabesogne autohistorique devenue plus difficile ; on m'a éculédes chaussures fines que je me réservais de ne porter que deloin en loin.
Il estbien certainpar exempleque tout ce qu'ont écrit lesjournauxil y a quelques moisà propos de la comédietirée de Numa Roumestan et jouée àl'Odéoncette curiosité et cette réclame nem'ont guère rien laissé d'intéressant àdire pour l'histoire de mon livre et m'ont mis en danger derabâchage. En tout cas cela m'a aidé à détruireune bonne fois la légendepropagée par des gens quin'y croyaient pas eux-mêmesde Gambetta caché sousRoumestan. Comme si c'était possible ; comme siayant voulufaire un Gambettapersonne eût pu s'y trompermême sousle masque de Numa !
Le vraiest que pendant des années et des annéesdans unminuscule cahier vert que j'ai là devant moiplein de notesserrées et d'inextricables raturessous ce titre génériqueLE MIDIj'ai résumé mon pays de naissanceclimatmoeurstempéramentl'accentles gestesfrénésieset ébullitions de notre soleilet cet ingénu besoin dementir qui vient d'un excès d'imaginationd'un délireexpansifbavard et bienveillantsi peu semblable au froid mensongeperverset calculé qu'on rencontre dans le Nord. Cesobservationsje les ai prises partoutsur moi d'abord qui me serstoujours à moi-même d'unité de mesuresur lesmiensdans ma famille et les souvenirs de ma petite enfanceconservés par une étrange mémoire oùchaque sensation se marquese clichesitôt éprouvée.
Tout notésur le cahier vertdepuis ces chansons de paysces proverbes etlocutions où l'instinct d'un peuple se confessejusqu'auxcris des vendeuses d'eau fraîchedes marchands de berlingotset d'azeroles de nos fêtes forainesjusqu'aux geignements denos maladies que l'imagination grossit et répercutepresquetoutes nerveusesrhumatismalescausées par ce ciel de ventet de flamme qui vous dévore la moellemet tout l'êtreen fusion comme une canne à sucre ; noté jusqu'auxcrimes du Midiexplosionde passionde violence ivreivre sansboirequi déroutentépouvantent la conscience desjugesvenus d'un autre climatéperdus au milieu de cesexagérationsde ces témoignages extravagants qu'ils nesavent pas mettre au point. C'est de ce cahier que j'ai tiréTartarin de TarasconNuma Roumestanet plus récemmentTartarin sur les Alpes. D'autres livres méridionaux ysont en projetfantaisiesromansétudes physiologiques :MirabeauMarquis de SadeRaousset-Boulbonet le MaladeImaginaire que Molière a sûrement rapporté delà-bas. Et même de la grande histoiresi j'en croiscette ligne ambitieuse dans un coin du petit cahier : NapoléonHomme du Midi. - synthétiser en lui toute la race.
Mon Dieuoui. Pour le jour où le Roman de moeurs me fatiguerait parl'étroitesse et le convenu de son cadreoùj'éprouverais le besoin de m'espacer plus loin et plus hautj'avais rêvé celadonner la dominante de cetteexistence féerique de Napoléonexpliquer l'hommeextraordinaire par ce seul mot très simpleLE MIDIauqueltoute la science de Taine n'a pas songé. Le Midipompeuxclassiquethéâtralaimant la représentationlecostume-- avec quelques taches en rigole-- dans le vent. Le Midifamilial et traditionneltenant de l'Orient la fidélitéau clanà la tribule goût des plats sucrés etcet inguérissable mépris de la femme qui ne l'empêchepas d'être passionné et voluptueux jusqu'au délire.Le Midi câlinfélinavec son éloquenceemportéelumineusemais sans couleurcar la couleur est duNord-- avec ses colères courtes et terriblespiaffantes etgrimaçantestoujours un peu simulées mêmelorsqu'elles sont sincères-- tragediante comediante --tempêtes de Méditerranéedix pieds d'écumesur une eau très calme. Le Midi superstitieux et idolâtreoubliant volontiers les dieux dans l'agitation de sa vie deSalamandre au bûchermais retrouvant ses prièresd'enfance dès que menace la maladie ou le malheur. (Napoléonà genouxpriantau soleil couchésur le pont duNorthumberlandentendant la messe deux fois par semaine dansla salle à manger de Sainte-Hélène.) Enfinetpar-dessus toutla grande caractéristique de la racel'imaginationque nul homme d'action n'eut aussi vasteaussifrénétique que lui(EgypteRussierêve de laconquête des Indes.) Tel est le Napoléon que je voudraisraconter dans les principaux actes de sa vie publique et le menudétail de sa vie intimeen lui donnant pour comparsepourBompard imitant et exagérant ses gestesses panachesunautre méridionalMuratde Cahorsle pauvre et vaillantMurat qui se fit prendre et mettre au murayant voulu lui aussitenter son petit retour de l'île d'Elbe.
Maislaissons le livre d'histoire que je n'ai pas faitque je n'auraipeut-être jamais le temps d'écrirepour ce roman deNuma déjà vieux de plusieurs années et oùtant de gens de mon pays ont prétendu se reconnaîtrebien que chaque personnage y soit de pièces et de morceaux. Unseulet comme il fallait s'y attendrele plus cocassele plusinvraisemblable de tousa été pris sur le vifstrictement copié d'après naturec'est le chimériqueet délirant Bompardméridional silencieuxcompriméqui ne va que par explosions et dont les inventions dépassenttoute mesureparce qu'il manque aux visions de cet imaginaire laprolixité de parole ou d'écriture qui est notre soupapede sûreté. Ce type de Bompard se trouve fréquemmentchez nousmais je n'ai bien étudié que le mienaimable et doux compagnon que je croise quelquefois sur le boulevardet à qui la publication de Numa n'a pas causé lamoindre humeurcar avec le tas de romans en fermentation dans sacervelleil n'a pas le temps de lire ceux des autres.
Dutambourinaire Valmajourquelques traits sont réelsparexemple le petit récit Ce m'est vénudénuit...cueilli mot par mot sur sa lèvre ingénue.J'ai dit ailleurs la burlesque et lamentable épopée dece Draguignanais que mon cher et grand Mistral m'expédiait unjour en ces termes : « Je t'adresse Buissontambourinaire ;pilote-le »et l'innombrable série de fours que nousfîmes Buisson et moià la suite de son galoubetdansles salonsthéâtres et concerts parisiens. Mais lavraie vérité que je n'avais pu dire de son vivantdepeur de lui nuireaujourd'hui que la mort a crevé sontambourinpécaïré ! et bouché de terrenoire les trois trous de son flûtetla voici. Buisson n'étaitqu'un faux tambourinaireun petit bourgeois du Midiclarinette oupiston de fanfare municipaleayant pour se distraire appris etperfectionné le maniement du galoubet et de la massettedes vieilles fêtes paysannes de Provence. Quand il arriva àParisle malheureux ne savait pas un air du terroirni aubadenifarandole. Son répertoire se composait exactement del'ouverture du Cheval de Bronzedu Carnaval de Veniseet des Pantéïns de Violettele tout brillammentexécutémais manquant un peu d'accent pour untambourinaire garanti par Mistral. Je lui appris quelques noëlsde SabolySaint José m'a ditTurelure-lure le coq chantepuis les Pêcheurs de Cassisles Filles d'Avignonet lamarche des Rois que Bizetquelques années plus tardorchestrait si merveilleusement pour notre Arlésienne.Buissonassez adroit musiciennotait les motifs à mesureles répétait jour et nuit dans son garni de la rueBergèreau grand émoi de ses voisins que cette musiquesûrette et bourdonnante exaspérait. Une fois styléje le lâchai par la villeoù son françaisbizarreson teint d'Ethiopied'épais sourcils noirsaussirejoints et drus que ses moustachesen plus son répertoireexotiquetrompèrent jusqu'aux méridionaux de Paris quile crurent un vrai tambourinairesans que cela fît rienhélas! pour son succès.
Fourni telquel par la naturele type me semblait compliquésurtout enfigure de second plan ; je le simplifiai donc pour mon livre. Quantaux autres personnages du romantousje le répètedeRoumestan à la petite Audibertesont faits de plusieursmodèles et comme dit Montaigne« un fagotage dediverses pièces ». De même pour Aps en Provencela ville natale de Numaque j'ai bâtie avec des morceauxd'Arlesde Nîmesde Saint-Rémyde Cavaillonprenantà l'une ses arènesà l'autre ses vieillesruelles italiennesétroites et cailloutées comme destorrents à secson marché du lundi sous les platanesmassifs du tour-de-villepuis un peu partout ces claires routesprovençalesbordées de grands roseauxneigéeset craquantes de poussière chaudeque je courais quandj'avais vingt ansun vieux moulinet toujours sur le dos ma grandecape de laine. La maison où je fais naître Numa estcelle de mes huit ansrue Séguieren face l'Académiede Nîmesl'école des frères terroriséepar l'illustre Boute-à-Cuire et sa férule marinéedans le vinaigrec'est l'école de mon enfanceles souvenirsde ma plus lointaine mémoire. « Oiseaux de prime »disent les Provençaux.
Voilàles dessous et praticablestrès simples comme on voitde ceNuma Roumestanqui me paraît le moins incomplet de tousmes livrescelui où je me suis le mieux donnéoùj'ai mis le plus d'inventionau sens aristocratique du mot. Je l'aiécrit dans le printemps et l'été de 1880avenuede l'Observatoireau-dessus de ces beaux marronniers du Luxembourgbouquets géants tout pommés de grappes blanches etrosestraversés de cris d'enfantsde sonnettes de marchandsde cocode bouffées de cuivres militaires. Sa confection m'alaissé sans fatiguecomme tout ce qui vient de source. Ilparut d'abord dans l'Illustrationavec des dessins d'EmileBayardlogé près de moide l'autre côtéde l'avenue.
Plusieursfois par semainele matinj'allais m'instiller dans son atelierlui racontant mon personnage à mesure que je l'écrivaisexpliquantcommentant le Midi pour ce forcené Parisien qui enétait encore au Gascon que l'on menait pendre et auxchansonnettes de Levassor sur la Canebière. N'est-ce pasBayardque je vous l'ai jouémon Midiet miméetchantéet les bruits de foule aux courses de taureauxauxluttes pour hommes et demi-hommeset les cantiques des pénitentsaux processions de la Fête-Dieu. Et c'est bien sûr vousou l'un de vos élèvesque j'ai mené boire ducarthagène et manger des barquettes rue Turbigo« auxproduits du Midi ».
Publiéchez Charpentiersous une chère dédicace qui m'atoujours porté bonheur et devrait figurer en tête detous mes livresle roman eut du succès. Zola l'honorait d'uneflatteuse et cordiale étudeme reprochant seulement commetrop invraisemblable l'amour d'Hortense Le Quesnoy pour letambourinaire ; d'autres après lui m'ont fait la mêmecritique. Et pourtantsi mon livre était àrecommencerje ne renoncerais pas à cet effet de mirage surcette petite âme trépidante et brûlantevictimeelle aussi de L'IMAGINATION. Maintenantpourquoi poitrinaire ?Pourquoi cette mort sentimentale et romancecette si facile amorce àl'attendrissement du lecteur ? Eh ! parce qu'on n'est pas maîtrede son oeuvreparce que durant sa gestationalors que l'idéenous tente et nous hantemille choses s'y mêlent draguéeset ramassées en route au hasard de l'existencecomme desherbes aux mailles d'un filet. Pendant que je portais Numaonm'avait envoyé aux eaux d'Allevard ; et làdans lessalles d'inhalationje voyais de jeunes visagestiréscreuséstravaillés au couteauj'entendais de pauvresvoix sans timbrerongéesdes toux rauquessuivies d'un mêmegeste furtif du mouchoir ou du gant guettant la tache rose au coindes lèvres. De ces pâles apparitions impersonnellesunes'est formée dans mon livrecomme malgré moiavec letrain mélancolique de la ville d'eauxson admirable cadrepastoralet tout cela y est resté.
NumaBaragnonmon compatrioteancien ministre ou presquetrompépar une similitude de prénomsfut le premier à sereconnaître dans Roumestan. Il protesta... jamais on n'avaitdételé sa voiture !... Mais une légenderetourd'Allemagnela maladroite réclame d'un éditeur deDresde eut bientôt remplacé le nom de Baragnon par celuide Gambettaje ne reviens plus sur cette niaiserie ; j'affirmeseulement que Gambetta n'y croyait pasqu'il fut le premier às'en amuser.
Dînantun soir chaise à chaisechez notre éditeuril medemandait si le « quand je ne parle pasje ne pense pas »de Roumestan était un mot fabriqué ou entendu.
« Depure inventionmon cher Gambetta.
-- Ehbienme dit-ilce matin au conseil des ministresun de mescollèguesMidi de Montpelliercelui-lànous adéclaré qu'il ne pensait qu'en parlant...Décidément le mot est bien de là-bas... »
Et pour ladernière foisj'entendis son grand beau rire.
Tous lesméridionaux ne se montrèrent pas aussi intelligentsNuma Roumestan me valut des lettres anonymes furibondespresque toutes au timbre des pays chauds. Les félibreseux-mêmes s'enflammèrent. Des vers lus en séancem'appelaient renégatmalfaiteur. « On voudrait luibattre l'aubade-- les baguettes tombent des mains... » disaitun sonnet provençal du vieux Borelly. Et moi qui comptais surmes compatriotes pour témoigner que je n'avais ni caricaturéni menti. Mais non ; interrogez-lesmême aujourd'hui que leurcolère est tombéele plus exaltéle plusextrême Midi de tous prendra un air raisonnable pour répondre:
« Oh! tout cela est bien Ezagéré!... »
LesFranc-Tireurs
Ecritpendant le siège de Paris.
On prenaitle thé l'autre soir chez le tabellion de Nanterre. J'emploieavec plaisir ce vieux mot de tabellionparce qu'il est bien dans lacouleur Pompadour du joli village où fleurissent les rosièreset de l'antique salon où nous étions assis autour d'unfeu de racines flambant dans une grande cheminée àfleurs de lis... Le maître du logis était absentmaisson image bonasse et finesuspendue dans un coinprésidait àla fête et souriait paisiblementdu fond d'un cadre ovaleauxsinguliers convives qui remplissaient son salon.
Drôlede mondeen effetpour une soirée de notaire ! Des capotesgalonnéesdes barbes de huit joursdes képisdescabansde grandes bottes ; et partoutsur le pianosur leguéridonpêle-mêleavec les coussins de guipureles boîtes de Spades corbeilles en tapisseriedes sabres etdes revolvers qui traînaient. Tout cela faisait un étrangecontraste avec ce logis patriarcal où flottait encore commeune odeur de pâtisseries de Nanterreservies par une bellenotaresse à des rosières en robe d'organdi... Hélas! il n'y a plus de rosières à Nanterre. On les aremplacées par un bataillon de francs-tireurs de Parisetc'est l'état-major du bataillon -- campé dans la maisondu notaire -- qui nous offrait le thé ce soir-là...
Jamais lecoin du feu ne m'avait paru si bon. Au dehorsle vent soufflait surla neige et nous apportaitavec le bruit des heures grelottanteslequi-vive des sentinelles etde loin en loinla détonationsourde d'un chassepot... Dans le salon on parlait peu. C'est un rudeservice que celui des avant-posteset l'on est las quand vient lesoir. Puisce parfum de bien-être intimequi monte desthéières en tourbillons de fumée blondenousavait tous envahis et comme hypnotisés dans les grandsfauteuils du tabellion.
Soudaindes pas pressésun bruit de portesetl'oeil brillantlaparole haletanted'un employé du télégraphetombe au milieu de nous :
«Aux armes ! aux armes ! Le poste de Rueil est attaqué ! »
C'est unposte avancé établi par les francs-tireurs à dixminutes de Nanterredans la gare de Rueilcomme qui dirait enPoméranie... En un clin d'oeil tout l'état-major estdeboutarméceinturonnéet dégringolédans la rue pour réunir les compagnies. Pas besoin detrompette pour cela. La première est logée chezle curé ; vite deux coups de pied dans la porte du curé.
«Aux armes !... levez-vous ! »
Et tout desuite on court chez le greffieroù sont ceux de laseconde....
Oh ! cepetit village noir avec son clocher pointu couvert de neigecesjardinets en quinconces quien s'ouvrantsonnaient comme desboutiquesces maisons inconnuesces escaliers de bois où jecourais en tâtonnant derrière le grand sabre del'adjudant-majorl'haleine chaude des chambrées oùnous jetions l'appel d'alarmeles fusils qui sonnaient dans l'ombreles hommes lourds de sommeil qui gagnaient leur poste en trébuchanttandis qu'au coin d'une rue cinq ou six paysans abrutis se disaienttout basavec des lanternes : « On attaque... on attaque... »tout cela sur le moment me faisait l'effet d'un rêvemaisl'impression que j'en ai gardée est ineffaçable etprécise...
Voici laplace de la Mairie toute noireles fenêtres du télégraphealluméesune première salle où les estafettesattendentle falot au poing ; dans un coinle chirurgien irlandaisdu bataillon préparant flegmatiquement sa trousseetsilhouette adorable au milieu de ce branle-bas d'escarmoucheunepetite cantinière -- habillée de bleu comme àl'orphelinat -- qui dort devant le feuun chassepot entre les jambes; puis enfindans le fondle bureau du télégrapheles lits de campla grande table blanche de lumièreles deuxemployés courbés sur leur machineet derrièreeux le commandant qui se penchesuivant d'un oeil anxieux leslongues banderoles qui se dévident et donnentminute parminutedes nouvelles du poste attaqué... Décidémentil paraît que ça chauffe là-bas. Dépêchessur dépêches. Le télégraphe affolésecoue ses sonnettes électriques et précipite àtout casser son tic-tac de machine a coudre.
«Arrivez vite... » dit Rueil.
«Nous arrivons... » répond Nanterre.
Et lescompagnies partent au galop...
Certesjeconviens que la guerre est ce qu'il y a de plus triste et de plusbête au monde. Je ne sais rienpar exemplede si lugubrequ'une nuit de janvier passée à grelotter comme unvieux loup dans une fosse de grand'garde ; rien de si ridicule qu'unquartier de chaudron qui vous tombe sur la tête à huitkilomètres de distance ; mais -- un soir de belle gelée-- s'en aller à la bataille le ventre plein et le coeur chaudse lancer à fond de train dans le noirdans l'aventureencompagnie de bons garçons dont on sent tout le temps lescoudesc'est un plaisir délicieuxet comme une excellenteivressemais une ivresse spéciale qui dégrise lesivrognes et fait voir clair les mauvais yeux...
Pour mapartj'y voyais très bien cette nuit-là. Il n'y avaitpourtant pas gros comme ça de luneet c'est la terre blanchede neige qui faisait lumière au ciel ; lumière dethéâtre froide et crues'étalant jusqu'au boutde la plaineet sur laquelle les moindres traits du paysageun pande murun poteauune rangée de saulesse détachaientsecs et noirscomme dépouillés de leur ombre... Dansle petit chemin qui borde la voieles francs-tireurs filaient au pasde course. On n'entendait que la vibration des fils télégraphiquescourant tout le long du talusla respiration haletante des hommesle coup de sifflet jeté aux sentinelleset de temps en tempsun obus du mont Valérien passant comme un oiseau de nuitau-dessus de nos têtesavec un formidable battement d'ailes...A mesure qu'on avançaitdevant nousau ras du soldes coupsde feu lointains étoilaient l'ombre. Puissur la gaucheaufond de la plainede grandes flammes d'incendie montèrentsilencieusement.
«Devant l'usineen tirailleurs !... » commanda notre chefd'escouade.
« Onva rien écoper !... » fit mon voisin de gauche avec unaccent de faubourg.
D'un bondl'officier arriva sur nous :
«Qui est-ce qui a parlé ?... C'est toi ?...
-- Ouimon capitaineje...
-- C'estbon... va-t'en... retourne à Nanterre.
-- Maismon capitaine...
-- Nonnon... va-t'en vite... je n'ai pas besoin de toi... Ah ! tu as peurd'écoper... filefile !
Et lemalheureux fut obligé de sortir des rangs ; maisau bout decinq minutesil avait repris furtivement sa place et ne demandaitqu'à écoper dorénavant.
Eh biennon. Il était dit que personne n'écoperait cettenuit-là. Comme nous arrivions sur la barricadel'affairevenait de finir. Les Prussiensqui espéraient surprendrenotre petit poste-- le trouvant sur ses gardes et à l'abrid'un coup de main-- s'étaient retirés prudemment ; etnous eûmes juste le temps de les voir disparaître au boutde la plainesilencieux et noirs comme des cancrelats. Toutefoisdans la crainte d'une nouvelle attaqueon nous fit rester àla gare de Rueilet nous achevâmes la nuit debout et l'arme aupiedles uns sur la chausséeles autres dans la salled'attente...
Pauvregare de Rueil que j'avais connue si joyeusesi clairegarearistocratique des canotiers de Bougivaloù les étésparisiens promenaient leurs ruches de mousseline et leurs toquets àaigrettescomment la reconnaître dans cette cave lugubredansce tombeau blindématelassésentant la poudrelepétrolela paille moisieoù nous parlions tout basserrés les uns contre les autres et n'ayant d'autre lumièreque le feu de nos pipes et le filet de jour venu du coin desofficiers ?... D'heure en heurepour nous distraireon nousenvoyait par escouades tirailler le long de la Seine ou faire unepatrouille dans Rueildont les rues vides et les maisons presqueabandonnées s'éclairaient des froides lueurs d'unincendie allumé par les Prussiens au Bois-Préau... Lanuit se passe ainsi sans encombre : puis au matin on nous renvoya...
Quand jerentrai à Nanterreil faisait encore nuit. Sur la place de laMairiela fenêtre du télégraphe brillait commeun feu de phareet dans le salon de l'état-majoren face deson foyer où s'éteignaient quelques cendres chaudesM.le tabellion souriait toujours paisiblement...
LEJARDIN DE LA RUE DES ROSIERS
Ecritle 22 Mars 1871.
Fiez-vousdonc au nom des rues et à leur physionomie doucereuse !...Lorsque après avoir enjambé barricades etmitrailleusesje suis arrivé là-haut derrièreles moulins de Montmartre et que j'ai vu cette petite rue desRosiersavec sa chaussée de caillouxses jardinssesmaisons bassesje me suis cru transporté en provincedans unde ces faubourgs paisibles où la ville s'espace et diminuepour venir mourir à la lisière des champs. Rien devantmoi qu'une envolée de pigeons et deux bonnes soeurs encornette frôlant timidement la muraille. Dans le fondla tourSolférinobastille vulgaire et lourderendez-vous desdimanches de banlieueque le siège a rendue presquepittoresque en en faisant une ruine.
A mesurequ'on avancela rue s'élargits'anime un peu. Ce sont destentes alignéesdes canonsdes fusils en faisceaux ; puissur la gaucheun grand portail devant lequel des gardes nationauxfument leurs pipes. La maison est en arrière et ne se voit pasde la rue. Après quelques pourparlers la sentinelle nouslaisse entrer... C'est une maison à deux étagesentrecour et jardinet qui n'a rien de tragique. Elle appartient auxhéritiers de M. Scribe...
Sur lecouloir qui mène de la petite cour pavée au jardins'ouvrent les pièces du rez-de-chausséeclairesaéréestapissées de papier à fleurs.C'est là que l'ancien Comité central tenait sesséances. C'est là quedans l'après-midi du 18les deux généraux furent conduits et qu'ils sentirentl'angoisse de leur dernière heurependant que la foulehurlait dans le jardin et que les déserteurs venaient collerleurs têtes hideuses aux fenêtresflairant le sang commedes loups ; là enfin qu'on rapporta les deux cadavres etqu'ils restèrent exposés pendant deux jours.
Jedescendsle coeur serréles trois marches qui mènentau jardin ; vrai jardin de faubourgoù chaque locataire a soncoin de groseilliers et de clématites séparéspar des treillages verts avec des portes qui sonnent... La colèred'une foule a passé là. Les clôtures sont àbasles bordures arrachées. Rien n'est resté deboutqu'un quinconce de tilleulsune vingtaine d'arbres fraîchementtaillésdressant en l'air leurs branches dures et grisescomme des serres de vautour. Une grille de fer court derrièreen guise de murailleet laisse voir au loin la valléeimmensemélancoliqueoù fument de longues cheminéesd'usines.
Les chosess'apaisent comme les êtres. Me voilà sur la scènedu drameet cependant j'ai peine à en ressaisir l'impression.Le temps est douxle ciel très clair. Ces soldats deMontmartre qui m'entourent ont l'air bon enfant. Ils chantentilsjouent au bouchon. Les officiers se promènent de long en largeen riant. Seulun grand mur troué par les balleset dont lacrête est tout émiettéese lève comme untémoin et me raconte le crime. C'est contre ce mur qu'on les afusillés.
Il paraîtqu'au dernier moment le général Lecomteferme etrésolu jusqu'alorssentit son courage défaillir. Ilessaya de lutterde s'enfuirfit quelques pas dans le jardin encourantpuisressaisi tout de suitesecouétraînébousculétomba sur ses genoux et parla de ses enfants :
«J'en ai cinq »disait-il en sanglotant.
Le coeurdu père avait crevé la tunique du soldat. Il y avaitdes pères aussi dans cette foule furieuse : à son appeldéchirant quelques voix émues répondirent ; maisles implacables déserteurs ne voulaient rien entendre :
« Sinous ne le fusillons pas aujourd'huiil nous fera fusiller demain. »
On lepoussa contre la muraille. Presque aussitôt un sergent de laligne s'approcha de lui.
«Générallui dit-ilvous aller nous promettre... »
Et tout àcoupchangeant d'idéeil fit deux pas en arrière etlui déchargea son chassepot en pleine poitrine. Les autresn'eurent plus qu'à l'achever.
ClémentThomasluine faiblit pas une minute. Adossé au mêmemur que Lecomteà deux pas de son cadavreil fit têteà la mortjusqu'au bout et parla très noblement. Quandles fusils s'abaissèrentil mitpar un geste instinctifsonbras gauche devant sa figureet ce vieux républicain mourutdans l'attitude de César... A la place où ils sonttombéscontre ce mur froid et nu comme la plaque d'un jardinde tirquelques branches de pêcher s'étalent encore enespalieretdans le hauts'ouvre une fleur hâtivetouteblanche que les balles ont épargnéeque la poudre n'apas noircie...
... Ensortant de la rue des Rosierspar ces routes silencieuses quis'échelonnent au flanc de la butte pleine de jardins et deterrassesje gagne l'ancien cimetière de Montmartrequ'on arouvert depuis quelques jours pour y mettre les corps des deuxgénéraux. C'est un cimetière de villagenusans arbrestout en tombeaux. Comme ces paysans rapaces qui enlabourant leurs champs font disparaître chaque jour un peu duchemin de traversela mort a tout envahimême les allées.Les tombes montent les unes sur les autres. Tout est comble. On nesait où poser les pieds.
Je neconnais rien de triste comme ces anciens cimetières. On y senttant de mondeet l'on n'y voit personne. Ceux qui sont là ontl'air d'être deux fois morts.
... «Qu'est-ce que vous cherchez ? » me demande une espèce dejardinierfossoyeuren képi de garde nationalquiraccommode un entourage.
Ma réponsel'étonne. Il hésite un momentregarde autour de luipuisbaissant la voix :
«Là-basme dit-ilà côté de la capote. »
Ce qu'ilappelle la capotec'est une guérite en tôle vernieabritant quelques verroteries fanées et de vieilles fleurs enfiligrane... A côtéune large dalle nouvellementdescellée. Pas de grillepas d'inscription. Rien que deuxbouquets de violettesenveloppés de papier blancavec unepierre posée sur leurs tiges pour que le grand vent de labutte ne les emporte pas... C'est là qu'ils dorment côteà côte. C'est dans ce tombeau de passage qu'en attendantde les rendre à leurs familleson leur a donné unbillet de logementà ces deux soldats.
UNEEVASION
Ecritpendant la Commune.
Un desderniers jours du mois de marsnous étions cinq ou sixattablés devant le café Richeà regarderdéfiler les bataillons de la Commune. On ne se battait pasencoremais on avait déjà assassiné rue desRosiersplace Vendômeà la préfecture depolice. La farce tournait au tragiqueet le boulevard ne riait plus.
Serrésautour du drapeau rougela musette de toile en sautoirlescommunaux marchaient d'un pas résolu dans toute la largeur dela chausséeet de voir ce peuple en armessi loin desquartiers du travailces cartouchières serrées autourdes blouses de laineces mains d'ouvriers crispées sur lescrosses des fusilson pensait aux ateliers videsaux usinesabandonnées... Rien que ce défilé ressemblait àune menace. Nous le comprenions touset les mêmespressentiments tristesmal définisnous serraient le coeur.
A cemomentun grand cocodès indolent et bouffibien connu deTortoni à la Madeleines'approcha de notre table. C'étaitun des plus tristes échantillons de l'élégant dudernier Empiremais un élégant de seconde main qui n'ajamais fait que ramasser sur le boulevard toutes les originalitésde la haute gandineriese décolletant comme Lutterothportant des peignoirs de femme comme Mouchydes bracelets commeNarishkinegardant pendant cinq ans sur sa cheminée une cartede Grammont-Caderousse ; avec cela maquillé comme un vieuxcabotle parler avachi du Directoire : Pa'ole d'honneu'...Bonjou' ma'ame »tout le crottin du Tattershall àses botteset juste assez de littérature pour signer son nomsur les glaces du café Anglaisce qui ne l'empêchaitpas de se donner pour très fort en théologie et depromener d'un cabaret à l'autre cet air dédaigneuxfatiguérevenu de toutqui était le suprêmechic d'alors.
Pendant lesiègemon gaillard s'était fait attacher à jene sais plus quel état-major-- histoire de mettre àl'abri ses chevaux de selle-- et l'on apercevait de temps en tempssa silhouette dégingandée paradant aux abords de laplace Vendôme avec tous les beaux messieurs de plastron doré: depuis je l'avais perdu de vue. De le retrouver là tout àcoup au milieu de l'émeutetoujours le même dans ceParis bouleversécela me fit l'effet à la fois lugubreet comique d'un vieux shapka du premier Empirefaisant en pleinboulevard moderne son pèlerinage du 5 mai. On n'en avait doncpas fini avec cette race de petits-crevés ! Il en restait doncencore !... En véritéje crois que si l'on m'eûtdonné à choisirj'aurais préféréces enragés de la Commune qui montent aux remparts un croûtonde pain au fond de leur sac de toile. Ceux-là du moins avaientquelque chose dans la têteun idéal vaguefouquiflottait au-dessus d'eux et prenait des teintes farouches aux plis dece haillon rouge pour lequel ils allaient mourir. Mais lui ce grelotvidecette cervelle en mie de pain...
Justementce jour-lànotre homme était plus fadeplus indolentplus pourri de chic que jamais. Il vous avait un petit chapeau saisonde bains à rubans bleusla moustache empeséelescheveux à la russeune jaquette trop courte qui laissait toutà l'airet pour s'achevermenait en laisse au bout d'uneganse de soie un petit havanais de catingros comme un ratperdudans son poill'air ennuyé et fatigué comme sonmaître. Ainsi faitil se planta languissamment devant notretableregarda les communeux défilerdit je ne sais quelleniaiseriepuis avec un dandinementun abandon inimitablesil nousdéclara positivement que ces gens-là commençaientà lui échauffer les oreilleset qu'il allait de ce pas« offrir son épée à l'amiral !... »C'était ditc'était lancé. Lasouche ni Pristonn'ont jamais rien trouvé de plus comique... Là-dessusil fit un demi-tour et s'éloigna tout alanguiavec son petitchien maussade.
Je ne saiss'il offriten effetson épée à l'amiralmaisen tous casM. Saisset n'en fit pas grand usagecar huitjours aprèsle drapeau de la Commune flottait sur toutes lesmairiesles ponts-levis étaient hissésla batailleengagée partoutet d'heure en heure on voyait les trottoirss'élargirles rues devenir désertes... Chacun sesauvait comme il pouvaitdans des voitures de maraîchersdansles fourgons des ambassades. Il y en avait qui se déguisaienten mariniersen chauffeursen hommes d'équipe. Les plusromanesques franchissaient le rempart la nuit avec des échellesde corde. Les plus hardis se mettaient à trente pour prendreune porte d'assaut ; d'autresplus pratiquess'en tiraient toutbonnement avec une pièce de cent sous. Beaucoup suivaient lescorbillards et s'en allaient dans la banlieueerrant àtravers prés avec des parapluies et des chapeaux de soienoirs de la tête aux pieds comme des huissiers du campagne. Unefois dehorstous ces Parisiens se regardaient en riantrespiraientgambadaientfaisaient la nique à Paris ; mais la nostalgie del'asphalte les prenait bien viteet cette émigrationquicommençait en école buissonnièredevenaitlourde et triste comme de l'exil.
Toutpréoccupé de ces idées d'évasionjesuivais un matin la rue de Rivoli sous une pluie battantequand jefus arrêté par une figure de connaissance. A cetteheure-làil n'y avait guère dans la rue que desbalayeuses qui rangeaient la boue par petits tas luisants le long destrottoirset des files de tombereaux que des boueux remplissaient aufur et à mesure... Horreur ! c'est sous la blouse crottéed'un de ces hommes que je reconnus mon cocodèset biendéguisé !... Un feutre tout déforméunfoulard en corde autour du coule large pantalon que les ouvriers deParis appellent (pardon) une salopette : tout cela mouillépasséfripénoyé sous une couche de vase quele malheureux ne trouvait pas encore assez épaissecar je lesurpris piétinant au milieu des flaques et s'en envoyantjusque dans les cheveux. C'est même cet étrange manègequi me l'avait fait remarquer.
«Bonjourvicomte» lui dis-je tout bas en passant. Le vicomtepâlit sous ses éclaboussuresregarda trèseffrayé autour de lui ; puisvoyant tout le monde occupéil reprit un peu d'assurance et ma raconta qu'il n'avait pas voulumettre son épée (toujours son épée !) auservice de la Communeet que le frère de son maîtred'hôtelentrepreneur des boues de Montreuillui avaitheureusement procuré ce moyen de sortir de Paris... Il ne putpas m'en dire plus long. Les voitures étaient pleinesleconvoi s'ébranlait. Mon homme n'eut que le temps de courir àson attelageprit la filefit claquer son fouetet dia ! hue ! levoilà parti... L'aventure m'intéressait. Pour en voirla finje suivis de loin les tombereaux jusqu'à la porte deVincennes.
Chaquehomme marchait à côté de ses chevauxle fouet enmainmenant l'attelage par une longe de cuir. Pour lui rendre labesogne plus facileon avait mis le vicomte le dernier ; et c'étaitpitié de voir le pauvre diable s'efforcer de faire comme lesautresimiter leur voixleur allurecette allure tasséevoûtéesomnolentequi se berce au roulement des rouesse règle sur le pas des bêtes très chargées.Quelquefois on s'arrêtait pour laisser passer des bataillonsqui descendaient du rempart. Alors il vous prenait un air affairéjuraitfouettaitse faisait aussi charretier que possiblepuis deloin en loin le cocodès reparaissait. Ce boueux regardait lesfemmes. Devant une cartoucherie de la rue de Charonneil s'arrêtaun moment pour voir des ouvrières qui entraient. L'aspect dugrand faubourgtout ce grouillement de peuple semblait aussil'étonner beaucoup. Cela se sentait aux regards effarésqu'il jetait de droite et de gauchecomme s'il arrivait en paysinconnu...
Etpourtantvicomteces longues rues qui mènent àVincennesvous les aviez parcourues bien souvent par les dimanchesde printemps et d'automnequand vous reveniez des coursesla carteverte au chapeaule sac de cuir en bandoulièreen faisant «hep ! » du bout du fouet... Mais alors vous étiez sihaut perché sur votre phaétonil y avait autour devous un tel fouillis de fleursde rubansde bouclesde voiles degazetoutes ces roues qui se frôlaient vous enveloppaientd'une poussière si lumineusesi aristocratiqueque vous nevoyiez pas les fenêtres sombres s'ouvrant à votreapprocheles intérieurs d'ouvriers où juste àcette heure-là on se mettait à table ; et quand vousaviez passéquand cette longue traînée de vieluxueusede soies clairesd'essieux brillantsde cheveluresvoyantesdisparaissait vers Parisemportait avec elle sonatmosphère doréevous ne saviez pas combien lefaubourg devenait plus noirle pain plus amerl'outil plus lourdni ce que vous laissiez là de haine et de colère...
... Unevolée de jurons et de coups de fouet coupa court à monsoliloque. Nous arrivions à la porte de Vincennes. On venaitde baisser le pont-leviset dans le demi-jourles flots de pluiecet encombrement de charrettes qui se pressaientde gardes nationauxvisitant les permisj'aperçus mon pauvre vicomte se débattantavec ses trois grands chevauxqu'il essayait de faire tourner. Lemalheureux avait perdu la file. Il juraitil tirait sur sa longesuait à grosse gouttes. Je vous réponds qu'il n'avaitplus l'air alangui... Déjà les communeux commençaientà le remarquer. On faisait cercleon riait : la positiondevenait mauvaise... Heureusementle maître charretier vint àson secourslui arracha la bride des mains en le bousculantpuisd'un grand coup de fouet enleva l'attelage qui franchit le pont augalopavec le vicomte derrièrecourant et barbotant. Laporte passéeil reprit sa placeet le convoi se perdit dansles terrains vagues qui longent les fortifications.
C'étaitvraiment une piteuse sortie. Je regardais cela du haut d'un talus ;ces champs de plâtras où les roues s'embourbaientcegazon fangeux et rareces hommes courbés par l'aversecettefile de tombereaux marchant pesamment comme des corbillards... Onaurait dit un enterrement honteux. Tout le Paris du bas-empire quis'en allait noyé dans sa boue.
LesPalais d'Eté.
Ecritpendant la Commune.
Aprèsla prise de Pékin et le pillage du Palais d'Eté par lestroupes françaiseslorsque le généralCousin-Montauban vint à Paris se faire baptiser comte dePalikaoil distribua dans la société parisienneenguise de dragées de baptêmeles merveilleux trésorsde jade et de laque rouge dont ses fourgons revenaient chargéset pendant toute une saison il y eut aux Tuileries et dans quelquessalons privilégiés une grande exhibition dechinoiseries.
On allaitlà comme à une vente de cocotte ou à uneconférence de l'abbé Bauer. Je vois encoredans ledemi-jour des pièces un peu abandonnées où cesrichesses étaient étaléesles petites Frou-Frouà gros chignons se pressants'agitant parmi les stores desoie bleue à fleurs d'argentles lanternes de gaze ornéesde houppes et de clochettes d'émailles paravents de cornetransparenteles grands écrans de toile couverts de sentencespeintestout cet encombrement de riens précieuxsi bienfaits pour la vie immobile des femmes aux petits pieds. On s'asseyaitsur les fauteuils de porcelaineon fouillait les coffres de laqueles tables à ouvrage à dessins d'or ; on essayait pourjouer les crêpes de soie blancheles colliers de perles deTartarie ; et c'étaient de petits cris d'étonnementdes rires étouffésune cloison de bambou qu'onrenversait avec sa traîneet puis sur toutes les lèvresce mot magique de palais d'Eté qui courait comme une brised'éventailouvrant à l'imagination je ne sais quellesféeriquesavenues d'ivoire blanc et de jaspe fleuri.
Cetteannéela société de Berlinde MunichdeStuttgarda euelle aussides exhibitions du même genre.Voilà plusieurs mois déjà que les fortes damesd'Outre-Rhin poussent des « mein Gott » d'admirationdevant les services de Sèvresles pendules Louis XVIlessalons blanc et orles dentelles de Chantillyles caissesd'orangerde myrte et d'argenterie que les innombrables Palikao del'armée du roi Guillaume ont cueillis aux environs de Parisdans le pillage de nos palais d'été.
Careuxils ne se sont pas contentés d'en piller un. Saint-CloudMeudon -- ces jardins du Céleste Empire -- ne leur ont passuffi. Nos vainqueurs sont entrés partout ; ils ont toutraflétout saccagédepuis les grands châteauxhistoriquesqui gardentdans la fraîcheur de leurs pelousesvertes et de leurs arbres de cent ansun petit coin de Francejusqu'à la plus humble de nos maisonnettes blanches ; etmaintenanttout le long de la Seined'une rive à l'autrenos palais d'été grands ouvertssans toitssansfenêtrese montrent leurs murailles nues et leurs terrassesdécouronnées.
C'estsurtout du côté de Montgeronde DraveildeVilleneuve-Saint-Georgesque la dévastation a étéeffroyable. S.A.R. le prince de Saxe travaillait par là-basavec sa bandeet il paraît que l'Altesse a bien fait leschoses. Dans l'armée allemande on ne l'appelle plus que «le voleur ». En sommele prince de Saxe me fait l'effet d'êtreun podestat sans illusionsun esprit pratique qui s'est trèsbien rendu compte qu'un jour ou l'autre l'ogre de Berlin ne feraitqu'une bouchée de tous les Petit-Poucet de l'Allemagne du Sudet il a pris ses précautions en conséquence. A présentquoi qu'il arrivemonseigneur est à l'abri du besoin. Le jouroù on le cassera aux gagesil pourraà son choixouvrir une librairie française à la foire de Leipzigse faire horloger à Nurembergfacteur de pianos àMunichou brocanteur à Francfort-sur-le-Mein. Nos palaisd'été lui ont fourni les moyens de tout celaet voilàpourquoi il a mené le pillage avec tant d'entrain.
Ce que jem'explique moinspar exemplec'est la rage que Son Altesse a mise àdépeupler nos faisanderies et nos garennesà ne paslaisser gros comme rien de plume et de poil dans nos bois...
Pauvreforêt de Sénartsi paisiblesi bien tenuesi fièrede ses petits étangs à poissons rougesde sesgardes-chasse en habit vert ! Comme ils se sentaient bien chez euxtous ces chevreuilstous ces faisans de la Couronne ! Quelle bonnevie de chanoines ! Quelle sécurité !... Quelquefoisdans le silence des après-midi d'étévousentendiez un frôlement de bruyèreet tout un bataillonde faisanneaux défilait en sautillant entre vos jambespendant quelà-basau bout d'une allée couvertedeuxou trois chevreuils se promenaient paisiblement de long en largecomme des abbés dans un jardin de séminaire. Allez donctirer des coups de fusil à des innocents pareils !
Aussi lesbraconniers eux-mêmess'en faisaient un scrupuleet le jourde l'ouverture de la chasselorsque M. Rouher ou le marquis de laValette arrivaient avec leurs invitésle garde général-- j'allais dire le metteur en scène -- désignaitd'avance quelques poules faisanes hors d'âgequelques vieuxlièvres chevronnésqui allaient attendre ces messieursau rond-point du Grand-Chêne et tombaient sous leurs coups avecgrâce en criant « Vive l'Empereur ! » C'est tout cequ'on tuait de gibier dans l'année.
Vouspensez quelle stupeurles malheureuses bêtesquand deux outrois cents rabatteurs en bérets crasseux sont venus un matinse ruer sur leur tapis de bruyères rosesdérangeantles couvéesrenversant les clôturess'appelant d'uneclairière à l'autre dans une langue barbareet qu'aufond de ces taillis mystérieux où Mme de Pompadourvenait épier le passage de Louis XVon a vu luire lessabretaches et les casques pointus de l'état-major saxon ! Envain les chevreuils essayaient de fuiren vain les lapins effaréslevaient leurs petites pattes frémissantes en criant : «Vive Son Altesse Royale le prince de Saxe» le dur Saxon nevoulait rien entendreet pendant plusieurs jours de suite lemassacre a continué. A cette heuretout est fini ; le grandet le petit Sénart sont vides. Il n'y reste plus que des geaiset des écureuilsauxquels les fidèles vassaux du roiGuillaume n'ont pas osé toucherparce que les geais sontblanc et noir aux couleurs de la Prusseet que la fourrure desécureuils est de ce miroir fauve si cher à M. deBismarck.
Je tiensces détails du père La Louévrai type duforestier de Seine-et-Oiseavec son accent traînardson airmadréses petits yeux clignotant dans un masque couleur deterre. Le bonhomme est si jaloux de ses fonctions de gardeilinvoque si souvent et à tout propos les cinq lettrescabalistiques flamboyant sur le cuivre de sa plaqueque les gens dupays l'ont surnommé le père La LoiLa Louépour parler comme en Seine-et-Oise. Lorsqu'au mois de septembre nousvînmes nous enfermer dans Parisle vieux La Louéenterra ses meublesses hardesenvoya sa famille au loinet restapour attendre les Prussiens.
« Jeconnais ma forêtdisait-il en brandissant sa carabine...qu'ils viennent m'y chercher ! »
Là-dessusnous nous séparâmes... Je n'étais pas sansinquiétude sur son compte. Souventpendant ce dur hiverjeme figurais ce pauvre homme tout seul dans la forêtobligéde se nourrir de racinesn'ayant pour se garer du froid qu'uneblouse de toile avec sa plaque par-dessus. Rien que d'y penserj'enavais la chair de poule.
Hiermatinje l'ai vu arriver chez moifraisgaillardengraisséavec une belle lévite neuveet toujours la fameuse plaquereluisant sur sa poitrine comme un bassin de barbier. Qu'a-t-il faittout ce temps-là ? Je n'ai pas osé le lui demander ;mais il n'a pas l'air d'avoir trop souffert... Brave père LaLoué ! Il savait si bien sa forêt ! Il y aura promenéle prince de Saxe.
C'estpeut-être une mauvaise pensée que j'ai là ; maisje connais mes paysanset je sais ce dont ils sont capables... Levaillant peintre Eugène Leroux -- blessé dans une denos premières sorties et soigné quelque temps chez desvignerons de la Beauce -- nous racontait l'autre jour un mot quipeint bien toute cette race. Les gens chez lesquels il logeait nes'expliquaient pas pourquoi il s'était battu sans y êtreforcé.
«Vous êtes donc un ancien militaire ? lui demandaient-ilstoujours.
-- Pas dutout. Je fais des tableauxje n'ai jamais fait que cela.
-- Eh ben! alorsquand ils vous ont fait signer le papier pour aller àla guerre... ?
-- Mais onne m'a rien fait signer...
-- Enfinquoi ! quand vous êtes allé pour vous battrec'est donc-- et ici ils se regardaient en clignant de l'oeil -- c'est donc quevous aviez bu un petit coup ! »
Voilàle paysan français... Celui des environs de Paris est pireencore. Les quelques braves gens qu'il y avait dans la banlieue sontvenus derrière les remparts manger du pain de chien avec nous: mais les autresje m'en méfie. Ils sont restés pourmontrer nos caves aux Prussienset consommer le pillage de nospauvres palais d'été.
Mon palaisà moi était si modestesi bien enfoui dans lesacaciasqu'il aura peut-être échappé au désastre; mais je n'irai m'en assurer que quand les Prussiens seront partiset bien longtemps après encore. Je veux laisser au paysage letemps de s'assainir... Quand je pense que tous nos jolis coinscespetites îles de roseaux et de saules grêles oùnous allions le soir nous allonger au ras de l'eau pour écouterchanter les rainettesles allées pleines de mousse oùla penséeen marchants'éparpillait tout le long deshaiess'accrochait à toutes les branchesces grandesclairières de gazon où l'on était si bien pourdormir au pied des chênesavec un tournoiement d'abeilles dansle hautqui nous faisaient un dôme de musiquequand je penseque cela a été à euxqu'ils se sont assispartout ; alors ce beau pays ne m'apparaît plus que fanéet triste. Cette souillure m'effraye encore plus que le pillage. J'aipeur de ne plus aimer mon nid.
Ah ! siles Parisiensau moment du siègeavaient pu rentrer en villecette adorable campagne des environs ; si nous avions pu rouler lespelousesles chemins verts tout empourprés des soleilscouchantsenlever les étangs qui luisent sous bois comme desmiroirs à mainpelotonner nos petites rivières autourd'une bobine comme des fils d'argentet enfermer le tout augarde-meuble : quelle joie ce serait pour nous maintenant de mettreles pelouses et les dessous de bois en placeet de refaire uneIle-de-France que les Prussiens n'auraient jamais vue !...
LENAUFRAGE
Champrosay25 mai 1871.
Etvoici le jardin charmant
Parfumé de myrte et de rose...
... Hélas! cette année le jardin est toujours plein de rosesmais lamaison est pleine de Prussiens. J'ai porté ma table au fond dujardinet c'est là que j'écrisdans l'ombre fine etle parfum d'un grand genêt tout bourdonnant d'abeillesquim'empêche de voir les tricots de Poméranie pendus etséchant à mes pauvres persiennes grises.
Je m'étaispourtant bien juré de ne venir ici que longtemps aprèsqu'ils seraient partis ; mais il fallait fuir l'horribleconscription Cluseret et je n'avais pas d'autre refuge... Et c'estainsiqu'à moicomme à bien d'autres Parisiensaucune des misères de ce triste temps n'aura étéépargnée : angoisses du siègeguerre civileémigrationetpour nous acheverl'occupation étrangère.On a beau être philosophese mettre au-dessusen dehors deschosesc'est une impression singulière-- après sixheures de marche sur ces belles routes de Francetoutes blanches dela poussière des bataillons prussiens -- d'arriver à saporte et d'y trouversous les grappes pendantes des ébénierset des acaciasun écriteau allemand en lettres gothiques :
5ecompagnie
Boehm
Sergent-major
Et trois hommes.
Ce M.Boehm est un grand garçon silencieux et bizarrequi garde lesvolets de sa chambre toujours fermésse couche et mange sanslumière. Avec celal'air trop à l' aisele cigare auxdents et d'une exigence !... Il faut à sa seigneurie une piècepour luiune pour son secrétaireune pour son domestique.Défense d'entrer par cette portede sortir par celle-là.Est-ce qu'il ne voulait pas nous empêcher d'aller dans lejardin ?... Enfin le maire est venule hauptmann s'en est mêléet nous voilà chez nous. Ce n'est pas gai chez nouscetteannée. Quoi qu'on en aitce voisinage vous gênevousblesse. Cette paille qu'on hache autour de vousdans votre maisonse mêle à ce que vous mangezfane les arbresbrouillela page du livrevous entre dans les yeuxvous donne envie depleurer. L'enfant lui-mêmesans qu'il s'en rende bien compteest sous le coup de cette étrange oppression. Il joue toutdoucement dans un coin du jardinretient son rirechante àmi-voixet le matinau lieu de ses réveils ébourifféset pleins de vieil se tient bien tranquille les yeux grands ouvertsderrière ses rideaux et demande tout bas de temps en temps :
«Est-ce que je peux me réveiller ? »
Encore sinous n'avions que les tristesses de l'occupation pour nous gâternotre printemps ; mais le plus durle plus cruelc'est ce roulementde canons et de mitrailleuses qui nous arrive dès que le ventsouffle de Parissecouant l'horizondéchirant sans pitiéles matins de brume rosebouleversant d'orages ces belles nuits demai si clairesces nuits de rossignols et de grillons.
Hier soirsurtoutc'était terrible. Les coups se succédaientfurieuxdésespérésavec un perpétuelbattement d'éclairs. J'avais ouvert ma fenêtre du côtéde la Seineet j'écoutais -- le coeur serré -- cesbruits sourds qui venaient jusqu'à moiportés surl'eau déserte et le silence... Par momentsil me semblaitqu'il y avait là-basdans l'horizonun grand navire endétressequi tirait son canon d'alarme avec furieet je merappelais qu'il y a dix anspar une nuit semblablej'étaissur la terrasse d'une hôtellerie de Bastiaà écouterune canonnade funèbre que la haute mer nous envoyait ainsicomme un cri perdu d'agonie et de colère. Cela dura toute lanuit ; puisau matinon trouvait sur la plagedans une mêléede mâts rompus et de voilesdes souliers à bouffettesclairesune batte d'arlequin et des tas de haillons pailletésd'orenrubannéstout ruisselants d'eau de merbarbouillésde sang et de vase. C'étaitcomme je l'appris plus tardcequi restait du naufrage de la Louisegrand paquebot venant deLivourne à Bastiaavec une troupe de mimes italiens.
Pour quisait ce qu'est la bataille de nuit avec la merla lutte àtâtons et stérile contre l'irrésistible force ;pour qui se représente bien les derniers moments d'un navirele gouffre qui montela mort lente et sans grandeurla mortmouillée ; pour qui connaît les ragesles espoirs foussuivis d'un abattement de brutel'agonie ivrele délirelesmains aveugles qui battent l'airles doigts crispéss'accrochant à l'insaisissablecette batte d'arlequinaumilieu d'épaves sanglantesavait quelque chose de burlesqueet de terrifiant. On se figurait la tempête tombant en coup defoudre pendant une représentation à bordla salle despectacle envahie par la merl'orchestre noyépupitresviolonscontre-basses roulant pêle-mêleColombinetordant ses bras nuscourant d'un bout de la scène àl'autremorte d'épouvante et toujours rose sous son fard ;Pierrotque la terreur n'a pu blêmirgrimpé sur unportantregardant le flot monteret dans ses gros yeux arrondispour la farceayant déjà l'horrible vertige de la mort; Isabelle empêtrée dans ses jupes de cérémonietout en larmes et coiffée de fleursridicule par sa grâcemêmeroulant sur le pont comme un paquetse cramponnant àtous les bancsbégayant des prières enfantines ;Scaramouche un tonnelet d'eau-de-vie entre ses jambesriant d'unrire hébété et chantant à tue-têtependant qu'Arlequinfrappé de foliecontinue à jouerla pièce gravementse dandinefait siffler sa batteet quele vieux Cassandreemporté par un coup de mers'en valà-basentre deux vaguesavec son habit de velours marron etsa bouche sans dents toutegrande ouverte...
Eh bience naufrage de saltimbanquesmascarade funèbreparade inextremistoutes ces convulsionstoutes ces grimaces ont passédevant moi hier soir à chaque secousse de la canonnade. Jesentais que la Communeprès de sombrertirait sa voléed'alarme. A chaque minute je voyais le flot monterla brèches'élargiretpendant ce temps-làles hommes del'Hôtel de villeaccrochés à leurs tréteauxcontinuant à décréterdécréterdans le fracas du vent et de la tempête ; puis un dernier coupde meret le grand navires'engloutissant avec ses drapeaux rougesses écharpes d'orses délégués en robesde jugesen habits de générauxses bataillonsd'amazones guêtréesempanachéesses soldats duCirqueaffublés de képis espagnolsde toquesgaribaldiennesses lanciers polonaisses turcos de fantaisieivresfurieuxchantant et tourbillonnant... Tout cela s'en allaitpêle-mêle à la dériveet de tant de bruitde foliesde crimesde pasquinadesmême d'héroïsmesil ne restait plus qu'une écharpe rougeun képi àhuit galons et une polonaise à brandebourgsretrouvésun matin sur la rivetout souillés de vase et de sang.
HISTOIREDE MES LIVRES
LESROIS EN EXIL
Voici biencertainement celui de tous mes livres qui m'a donné le plus demal à mettre deboutcelui que j'ai le plus longtemps portégardé dans ma têteà l'état de titre etd'obscure ébauchetel qu'il m'apparut un soir d'octobresurla place du Carrouseldans la déchirure tragique faite auciel parisien par l'écroulement des Tuileries.
Desprinces dépossédés s'exilant à Parisaprès faillitedescendus rue de Rivoliet au réveille store levé sur le balcon d'hôteldécouvrantces ruinesce fut la vision première des Rois en exil.Moins un roman qu'une étude historiquepuisque le roman estl'histoire des hommes et l'histoire le roman des rois. Non pasl'étude historique telle qu'on la pratique généralementchez nousla compilation mornepoudreusetâtillonneun deces gros bouquins chers à l'Institut qu'il couronne chaqueannée sans les ouvrir et sur lesquels on pourrait écrireusage externecomme sur les verres bleus de la pharmacopée: mais un livre d'histoire modernevivantcapiteuxd'unedocumentation terriblement brûlante et arduequ'il fallaitarracher des entrailles mêmes de la vieau lieu de le déterrerdans la poussière des archives.
A mesyeuxla difficulté de l'oeuvre était surtout làdans cette chasse aux modèlesaux renseignements vraisdansl'ennui de tout ce reportage commandé par la nouveautéd'un sujet tellement loin de moide mon milieuhors de meshabitudes d'existence et d'esprit. Jeune hommej'avais souvent frôléla perruque d'un noir inimitable du duc de Brunswick traînantles étroits corridors des restaurants de nuit dans l'haleinechaude du gazdes patchoulis et des épices ; chez Bignonsurle divan du fond m'était un soir apparu Citron-le-Taciturnemangeant une tranche de foie gras en face d'une fille de carrefouret encoreà la sortie d'un dimanche du Conservatoirelahaute et fière stature du roi de Hanovre aveugle et tâtonnantentre les colonnes du péristyleau bras de la touchanteprincesse Frédériquequi l'avertissait quand ilfallait saluer. Rien que de très vague en sommeaucune notionprécise sur l'intime de ces princes réfugiéssur la façon dont ils menaient leur disgrâcedontl'exill'air de Paris les avait impressionnésce qu'ilrestait de dorure à leurs manteaux de cour et de cérémonialen leurs logis de rencontre.
Poursavoir cela il me fallut beaucoup de temps et des courses sansnombremettre en route toutes mes relations de vieux Parisien duhaut en bas de l'échelle socialedepuis le tapissier quimeublait l'hôtel royal de la rue de Presbourgjusqu'au grandseigneur diplomate invité comme témoin àl'abdication de la reine Isabelle-- happer au vol la confidencemondainefeuilleter des notes de police et des devis de fournisseurs; puisquandj'eus touché le fond de tontes ces existencesde monarquesconstaté les fières détresseslesdévouements héroïques à côtédes maniesdes décrépitudesdes fêlures al'honneur et des consciences lézardéesje laissai decôté mon enquêteje n'en gardai que des détailstypiques empruntés çà et là des traits demoeursde mise en scèneet l'atmosphère généraleoù mon drame devait se mouvoir.
Pourtantpar une faiblesse dont j'ai fait déjà l'aveuce besoinde réalité qui m'opprime et m'oblige à toujourslaisser l'étiquette de la vie au bas de mes inventions le plussoigneusement démarquéesaprès avoir installéd'abord mon ménage royal rue de la Pompedans le petit hôteldu duc de Madrid avec qui Christian d'Illyrie avait plus d'un pointde ressemblanceje le transportai rue Herbillonà deux pasdu grand faubourg et de ses fêtes foraines où je voulaisque Méraut montrât le peuple à Frédériqueet lui apprît à ne plus le craindre. Le roi et la reinede Naples ayant longtemps habité la rue Herbillon on a ditdans le public que c'était eux que j'avais eu l'intention depeindre ; mais j'affirme qu'il n'en est rienet que j'ai promenédans un décor authentique un couple royal de pure invention.
Mérautluiest pris à la vieil est réeldu moins jusqu'àmi-corpset la façon dont je fus amené à lemettre dans mon livre mérite que je la raconte. Bien résoluà ne pas écrire un pamphletet à faire plaiderà l'un de mes personnages la cause de la légitimitéet du droit divinj'essayais de m'échauffer pour ellederanimer les convictions de ma toute jeunessepar la lecture deBonaldde Joseph de Maistrede Blanc Saint-Bonnetceux qued'Aurevilly appelle « les prophètes du passé. »Un jourdans un vieil exemplaire de la « Restaurationfrançaise »acheté sur les quaisau bas d'unelettre d'envoi de l'auteur publiée entre deux pagesjedécouvris ce post-scriptum que je copie textuellement : «Si vous avez besoin de quelque jeune homme instruit éloquentadressez vous de ma part à M. Thérion18ruede Tournonhôtel du Luxembourg. »
Tout desuite je revis ce grand garçon aux yeux noirs flambantsqueje rencontrai dès mon arrivée à Paristoujoursdes livres sous le brassortant d'un cabinet de lecture ou flairantles bouquins aux devantures de l'Odéonlong diable ébourifféassurant d'un gestele mêmerépété commeun ticses lunettes sur un nez camardouvertsensueléprisde vie. Eloquent certeset savantet bohème ! Tous lesdébits de prunes du Quartier l'ont entendu affirmer sa foimonarchiqueetavec des gestes largesune voix persuadante etchaudetenir attentif son auditoire noyé dans la fuméedes pipes. Ah ! si je l'avais eu làvivantquel ressort pourmon livre ! Il lui aurait soufflé son feusa vigueur deloyalisme ; quels renseignements sur son passage à la courd'Autricheoù il était allé élever despetits princes et dont il revint désillusionnéatteintdans son rêve ! Mais il était disparu déjàdepuis des annéesmort de misèrece Constant Thérionet malheureusement je l'avais plutôt rencontré que connu; mes yeux de ce temps-là n'étaient pas encoredébrouillésj'étais trop jeuneplus occupéde vivre que d'observer. Alorspour suppléer aux détailsqui me manquaient sur luije songeai à le faire de mon paysde Nîmesde cette « Bourgade » travailleuse d'oùvenaient tous les ouvriers de mon pèreà mettre danssa chambre ce cachet rougeFidesSpesque j'avais vu chezmes parentsdans la salle où l'on chantait « Vive HenriIV» le couplet de dessert de toutes nos fêtes defamille ; a l'entourer de ces traditions royalistes au milieudesquelles j'ai grandique j'ai gardées jusqu'à l'âgede l'esprit ouvert et de la pensée affranchie. En y mêlantmon Midimes souvenirs d'enfanceje rapprochais le livre de moi.Méraut trouvéThérion si vous aimez mieuxquipouvait l'amener dans la maison royale ? L'éducation d'unprince ? de là Zara. Et juste au même momentun malheurarrivé dans une maison amieun enfant frappé à1'oeil par la balle d'une carabine de salonme donnait l'idéedu pauvre faiseur de rois démolissant son oeuvre lui-même.
Lesvisions du sommeil s'impressionnent des réalités de lavie. Dans un temps où je rêvais beaucoupj'avais prisl'habitude d'écrire mes rêves au matinen lesaccompagnant de notes explicatives : « Fait ceci la veille...dit cela... rencontré un tel. » Eh bien ! je pourrais aubas des Rois en exil mettre des notes de ce genre. A la suitedu chapitre de la foire aux pains d'épicesoù Mérautporte sur ses épaules le petit roi qui a peurj'écrirais« Hiervisite à la rue Herbillon. -- Couru les bois deSaint-Mandé avec un de mes enfants. -- Dimanche de Pâques.-- Bruits de fête. -- Nous voilà dans la fouleremuantehouleuse. -- Le petit a peur. Je le prends sur mon dos pourquitter le champ de foire. » Ailleursà la fin duchapitre sur le bal héroïque à l'hôtel deRosenje noterais queun jourà l'exposition de 78écoutant la musique tzigane en buvant du tockailesvibrations du cymbalum m'ont rappelé un bal polonais chez lacomtesse Chodskobal de départ et d'adieudonné en1'honneur de ces jeunes gens dont beaucoup ne devaient pas revenir.Et puisquand on porte un livrequ'on ne pense qu'à luiquede bonheursde bizarres coïncidencesde rencontresmiraculeuses ! J'ai dit la petite lettre de Blanc Saint-Bonnet. Unautre jour c'était le procès intenté par le ducde Madrid contre Boëtson aide de camples bijoux engagésla Toison d'or vendue ; puis une adjudication au Tattershalllesvoitures de gala du duc de Brunswick achetées par l'Hippodrome: ensuiteà la salle Drouotla vente de deux couronnesmontées appartenant à la reine Isabelle. Et c'est lejour où j'étais allé à « l'Hôtel» pour suivre cette ventequ'un highlifeuridiot superbeavançant sa tête entre deux épaules d'Auvergnatsme criant dans la bousculade : « Où fait-on la fêtece soir ? » Un mot bête que j'ai lancé et qui a eula fortune de tous les mots bêtes. Une autre fois je voyaispasser devant la Librairie nouvelle l'enterrement du vieux roide Hanovreconduit par le prince de Galles. Belle page àécrirece convoi royal en exil. Malheureusement j'étaisgêné par les enterrements de mes livres précédents.MoraDésiréele petit roi Madou-Ghezo. Mais tout celam'assurait que je faisais un livre bien de mon tempsarrivant àson heure.
J'ai écrit« les Rois » place des Vosgesau fond d'une grande couroù des touffes d'herbe verte découpaient en carrésles pavés inégauxdans un petit pavillon envahi d'unreflet de vignes viergespan oublié de l'hôtelRichelieu. Dedansvieilles boiseries Louis XIIIdorures presqueéteintescinq mètres de plafond : dehorsbalcon enfer forgé mangé de rouille à sa base. C'étaitbien là le cadre qu'il fallait à cette histoiremélancolique. Dans ce grand cabinet de travail je retrouvaischaque matinles personnages de mon imaginationvivantscomme desêtresen groupes autour de ma table. La besogne fut acharnéetyrannique. Je n'avais d'autres sorties que le matindans le petitjour d'hiverla conduite de mon fils au lycée par les ruelleséclaboussantes de ce coin du Maraispassage Eginhardleghetto où fermentait la brocante du père Leemans et oùje croisais la descente sur Paris des petites ouvrières bienpeignéesgraine de Sephoras aux nez arquésallanteset rieuses. De temps à autre une course en villeunepoursuite de renseignementune recherche de maisonl'antre de TomLewisle couvent des Franciscainsrue des Fourneaux.
Tout àcoupau coeur du livre en pleine effervescence de ces heurescruelles qui sont les meilleures de la vieinterruption subitecraquement de la machine surmenée. Cela commençaentravaillantpar des sommes d'une minutedes assoupissementsd'oiseauun tremblement d'écritureune langueur interrompantla pagetroublanteinvincible. Il fallut s'arrêter au milieude l'étapelaisser passer la fatigue. Je comptais sur lessoins du bon docteur Potainsur le repos de la campagnepour rendrele ressort et la force à mes nerfs distendus. De faitaprèsun mois de Champrosayd'ivresse de senteurs vertes dans les bois deSénartce fut un bien-êtreune dilatationextraordinaire. Le printemps montait ; ma sève réveilléebouillonnaitfermentait comme la siennerefleurissait lesattendrissements de ma vingtième année. Inoubliablem'est restée l'allée de forêt où dans lafeuillure épaisse des noisetiers et des chênes vertsj'ai écrit la scène du balcon de mon livre. Puisbrusquementsans douleurune hémoptysie violentem'éveillaitla bouche âcre et sanglante. J'eus peurjecrus que c'était la finqu'il fallait s'en allerlaisserl'oeuvre inachevée : et dans un adieu qui me semblait l'adieusuprêmej'eus tout juste la force de dire à ma femmeau cher compagnon de toutes les heuresbonnes ou mauvaises : «Finis mon bouquin ».
L'immobilitéquelques jours de litcombien cruels avec toute cette rumeur delivre continuée dans ma têteet le danger passait. Toutsert. Tourgueneffpeu de temps avant de mourirayant eu àsupporter une opération douloureusenotait dans son esprittoutes les nuances de la douleur. Il voulaitdisait-ilnous contercela dans un de ces dîners que nous faisions alors avecGoncourt et Zola. Moi aussij'analysais mes souffranceset j'aifait servir à la mort d'Elysée Méraut lessensations de ces instants d'angoisse.
Doucementpeu à peuje repris mon travail. Je l'emportai aux eauxd'Allevard où l'on m'envoyait. Làdans une des sallesd'inhalationje fis la rencontre d'un vieux médecin trèsoriginalfort savantle docteur Robertyde Marseillequi me donnal'idée du type de Bouchereau et de l'épisode quitermine mon livre. Carsoutenu par la vaillante qui guidait ma plumeencore hésitanteje vins à bout de l'oeuvre tout demême. Maisje le sentaisquelque chose était cassédans moi ; désormais je ne pourrais plus traiter mon corpscomme une loquele priver de mouvement et d'airprolonger lesveillées jusqu'au matin pour l'amener à la fièvredes belles trouvailles littéraires.
Le romanparut dans le journal le Tempspuis à la librairieDentu. La presse et le public lui firent accueilmême lesjournaux légitimistes. Armand de Pontmartin disait dans laGazette de France : « J'ignore si Alphonse Daudet aécrit son livre sous une inspiration républicaine. Ceque je sais mieuxce qui résume mon impression de lectureest ce qu'il y a de beaud'émouvantde pathétiquederéconfortant dans les Rois en exil; ce qui en rachèteles cruautésce qui dérobe ce roman aux trivialeslaideurs du réalismec'est justement le sentiment royaliste.C'est l'énergique résistance de quelques âmeshautes et fières à cette débâcle oùle bal Mabilleles coulissesle grand Cluble grand Seize achèventd'engloutir les royautés vaincues. »
Au milieud'articles élogieuxun éreintement de Vallèsqui prend l'intérieur de Tom Lewis pour une invention àla Ponson du Terrail. Ceci m'a prouvé ce que je savais déjàque de Paris l'auteur de la « Rue » ne connaissait que laruela rue faubouriennela circulation funambulesque et le trottoir; il n'est jamais entré dans les maisons. Entre autresreprochesil m'accusait d'avoir trahidéfiguréThérion. J'ai déjà répondu que Mérautn'était pas absolument Thérion. Par surcroîtvoici quelques lignes d'une lettre que je reçus avec unportraitsitôt après la publication de mon livre :
«Vous deviez bien l'aimerce cher Elyséepour lui donner laplace d'honneur dans les Rois en exil. Tous ceux qui l'ontconnu ne l'oublieront jamais... Grâce à vousElyséeMéraut vivra aussi longtemps que les Rois en exil.Votre livre sera désormais pour moi et les miens un livred'amiun livre de famille. »
Cettelettre est du frère de Thérion.
Puis letapage s'éteignit. Paris passait à d'autres lectures ;moij'étais satisfait d'avoir écrit un livre que monpèreroyaliste ardenteût lu sans chagrind'avoirprouvé que les mots me venaient encore et que je n'étaispas tout à fait déprimécomme mes ennemis enavaient manifesté l'espoir.
Cependantplusieurs auteurs dramatiques désiraient tirer une comédiede mon oeuvre. J'hésitais à les laisser fairequand unItalien écrivit le drame sans me consulter pour un théâtrede Rome. Cette tentative me décida. A qui donner la piècepourtant ? Gondinet était tentémais la politique luifaisait peur. Coquelinà qui j'en parlaime dit qu'il avaitquelqu'un ; si je voulais lui confier la choseon m'apprendrait plustard le nom de mon collaborateur. J'aime beaucoup Coquelin. J'aiconfiance en luije le laissai faire. Il me lisait la pièceacte par acteà mesure qu'ils étaient bâtis ; jetrouvais l'oeuvre éloquented'une prose largespirituellebien dialoguée. Dès le milieu du premier actedeuxmots dans la bouche d'Elysée Mérautqui dit que Hezetal'avait « achevé d'imprimer »me mirent sur lapiste de l'auteur. -- « C'est quelqu'un de chez Lemerre. »On sait en effet que le libraire du passage Choiseul signe le nom desimprimeurs à la fin des beaux poèmes qu'il publie.C'est ainsi que je découvris mon collaborateur Paul Delairécrivain de grand talentun peu confus parfoismais avec deséclairs et de la grandeurun poète.
La pièceme convenaitseul le dernier acte me semblait dur. Il se passaitdans le garni de la rue Monsieur-le-Princeau lit de mort d'ElyséeMéraut. A la fin le roi Christian entre-bâillait laporte : « Est-ce ici mademoiselle Clémence ? »Dans mon petit salon de l'avenue de l'Observatoirequand Coquelinnous lut le travail de Delairtous eurent la même impressionque moi. Gambetta était venu ce soir-là ainsi qu'Edmondde GoncourtZolaBainvillele docteur CharcotErnest DaudetEdouard DrumontHenry Céard. D'avis unanimeil fallaitchanger le dernier actequi était trop dangereux. Delair nousécoutamodifia la finatténua ; peines perdues ! nousétions condamnés avant d'être joués. J'eneus la conviction dès la répétition générale.La pièce avait été bien montéecertes ;la meilleure troupe du Vaudeville l'interprétaitla directionn'avait pas ménagé sa peineet cependant je n'aijamais vu une salle tenduehostile comme celle de la première.On siffla le lendemainet tous les jours suivants : -- voir leGaulois de cette époque. Tous les soirs les cerclesenvoyaient des délégués pour faire du tapage.Des scènes entièrestrès bellestrèsémouvantespassaient dans le bruit sans que l'on entendîtune phrase. Des tirades comme celle où il est parléd'un Bourbon courant après l'omnibus étaient marquéesd'avance. Ah ! s'ils avaient su de qui je tenais ce détail !Et l'entrée superbe de Dieudonnél'ivresse en habitnoir pendant le choeur héroïque de la marche de Pugno !La mode vint d'aller là « bahuter » comme àla salle Taitbout. Et puissous cette indignation factice desgandinsil y avait en somme une grande indifférence de lasalle. Le public parisienbien moins monarchiste que moirestaitprofondément insensible à des misères royales ;c'était trop en dehors des conventions habituellesaussi loinde sa pitié que les incendiés de Chicago et les inondésdu Mississipi.
A partquelques feuilletons d'indépendantstels que GeffroyDurranela critique suivit le publicc'est son rôleaujourd'hui ; et la pièce eut le bénéfice d'ununiversel éreintement. Quoique seul Paul Delair parût ennom sur l'affichece fut moi surtout qui restai plusieurs semainesen butte aux calomniesaux outrages de toutes sortes. Je fais de cesinjures le cas qu'elles méritent. Par la multiplicitédes journaux et la clameur des reportagesla voix de Paris estdevenue un écho assourdissant de montagnequi décuplele bruit des causeriesrépercuté tout àl'infiniétouffeen l'élargissantle ton juste dublâme et de l'éloge. Pourtantj'ai noté une deces calomnies que je veux relever. On a prétendu que mon livreétait une flatterie au gouvernementquecommencé enfaveur de la royauté pendant le « Seize Mai »ilavait fait volte-face après la chute du maréchal ettourné à la république triomphante. Ceux qui ontdit celaqui ont cruqu'une oeuvre une fois structurée peutêtre ainsipar capricepar intérêtmenéeà droite ou à gauche ; ceux-là n'ont jamais bâtiun livredu moins auraient-ils pu réfléchirchercherdans quel but j'aurais fait ce dont ils m'accusaient. Je n'ai besoinde rien ni de personneje vis chez moije ne sollicite ni emploisni distinctionni avancement. Alors pourquoi ?
Quant aureproche d'avoir écrit un pamphlet de parti prisil n'est pasplus vrai. Le livre et la pièce restent au-dessous de lavérité. J'ai laissé à la royautéune part assez belle ; si cette part n'est pas meilleureàqui la faute ? La monarchie a posé devant moi ; comme toujoursj'ai écrit d'après nature. D'ailleurs je n'ai pas étéle premier à constater l'affaissement des âmes royalesen exil. Dans les admirables « mémoires d'outre-tombe »que j'avais eus tout le temps sur ma tableen travaillantChateaubriand raconte avec autrement de cruauté que moi laniaiseriel'aveuglement de la cour de Charles X en Angleterre.
« Deson sophaMadame voyait à travers la fenêtre ce qui sepassait au dehorselle nommait les promeneurs et les promeneuses.Arrivèrent deux petits chevaux avec deux jockeys vêtus àl'écossaise. Madame cessa de travaillerregarda beaucoup etdit : « C'est madame... (j'ai oublié le nom) qui va dansla montagne avec ses enfants. » Marie-Thérèsecurieusesachant les habitudes du voisinagela princesse des trôneset des échafauds descendue de la hauteur de sa vie « auniveau des autres femmesm'intéressait singulièrement.Je l'observais avec une sorte d'attendrissement philosophique. »
Etquelques pages plus loin :
«J'allai faire ma cour au Dauphinnotre conversation fut brève:
-- CommentMonseigneur se trouve-t-il à Butscherad ?
--Vieillotant.
-- C'estcomme tout le mondeMonseigneur.
-- Etvotre femme ?
--Monseigneurelle a mal aux dents.
-- Fluxion?
-- Non.Monseigneurtemps.
-- Vousdînez chez le roiNous nous reverrons.
Et nousnous quittâmes. »
Et quelréquisitoire que le livre de M. FourneronHistoire desémigrés pendant la Révolution française!La tenue du comte d'Artois et du comte de Provence en exilpendantque leur frère est prisonnier au Templeenvoyé àl'échafaudla rivalité des maîtressesmadame dePolastron et madame de Balbi !
Madescente de Gravosa a paru incroyablemonstrueuseinventée àplaisir. Mais lisez l'histoire de Quiberonl'aventure de cesmalheureux soldats vendéens à qui on a promis un princedu sang pour marcher à leur têteattendantespérantle comte d'Artois qui reste au largeen mersans oser descendreetqui écrit à d'Harcourt : « On ne voit que destroupes républicaines sur les côtes. » Ceux quiles lui faisaient voirle baron de Roll et ses amisimaginaientchaque jour des prétextes pour éluder le débarquement.L'héroïque Rivièreles comtes d'AutichampdeVauban et de la Béraudière insistaient vainement : «Je ne veux pas aller chouanner »répond le prince. Puisencore l'histoire de Frotté. et son ambassade tombant aumilieu des parties de whist d'Holyrood. Il vient soumettre son plande débarquement. On le reçoit en présence deCouziéde l'Evêque d'Arrasdu baron de Rolldescomtes de Vaudreuil et de Puységur et du financier de Theil.
«Permettezdit Roll avec son accent allemandje suis capitaine desgardes et par conséquent responsable vis-à-vis du roide la sûreté de Monsieur. Y a-t-il sécuritésuffisante pour hasarder Monsieur ? -- Nonassurément ! --Ainsiinterrompit le princevous-mêmeMonsieur de Frottévous reconnaissez que le projet est impraticable ? »
Frottésortil retourne près des gentilshommes de Normandieseulavec une de ces lettres à phrases pompeusesque prodiguait lecomte d'Artois. « Je charge le comte Louis de Frotté devous exprimer tous les sentiments dont mon coeur est pénétré.La Providencen'en doutez passecondera votre généreuseconstance... En attendant ce moment si désiré oùje pourrai m'exprimer avec vous de vive voixrecevezMessieurs... »
Ce livreest écrit par un royaliste qui n'a pas assez de haine contrela Convention. Est-il dans les Rois en exil une page aussidure que celle-là ?
UNELECTURE CHEZ EDMOND DE GONCOURT (1)
[(1)Ecrit en 1877 pour le Nouveau Temps de Saint-Pétersbourg.]
Edmond deGoncourt réunit ce matinà Auteuilquelques intimespour leur lireavant déjeunerson roman nouveau. Dans lecabinet de travail sentant bon le vieux livre et comme éclairéde haut en bas par l'or bruni des reliuresj'aperçois enouvrant la porte la robuste encolure d'Emile ZolaIvan Tourguéneffcolossal comme un dieu du Nordet la fine moustache noire sous descheveux en coup de vent du bon éditeur Charpentier. Flaubertmanqueil s'est cassé la jambe l'autre jour ; et à cemomentcloué sur une chaise longueil fait retentir laNormandie de formidables jurons carthaginois.
Edmond deGoncourtle maître de maisonparaît cinquante ans. Ilest Parisienmais d'origine lorraine ; Lorrain par la prestancefinesse bien parisienne. Des cheveux grisd'un gris d'ancien blondl'air aristo et bon garçonla haute taille droite avec le nezen chien de chasse du gentilhomme coureur de halliers ; et dans lafigure énergique et pâleun sourire perpétuellementattristéun regard qui parfois s'éclaireaigu commeune pointe de graveur... Que de volonté dans ce regardque dedouleur dans ce sourire ! Et tandis qu'on rit et qu'on causetandisque Goncourt ouvre ses tiroirsrange ses papierss'interrompt pourmontrer une brochure curieuseun bibelot venu de lointandis quechacun s'assied et s'installeune émotion me prend àregarder la table de travaillarge et longuela table fraternellefaite pour deuxet où la mort un jour est venue s'asseoirentroisièmeenlevant le plus jeune des frères et coupantcourtbrutalementà cette unique collaboration.
Lesurvivant conserve pour son frère mort une extraordinairetendresse. Malgré sa réserve native qu'augmente encoreune discrétion fière et voulueil trouve en parlant delui des nuances exquisespresque féminines. On sentlà-dessous une douleur sans bornes et quelque chose de plusque l'amitié. « Il était le préféréde notre mère ! » dit-il quelquefoiset cela sansregretsans amertumecomme trouvant juste et naturel qu'un telfrère fût toujours le préféré.
C'estqu'en effet jamais il ne s'est vu pareille communautéd'existence. Dans le tourbillon des moeurs modernesle frèredès avant vingt ansquitte le frère. L'un voyagel'autre se marie ; l'un est artistel'autre est soldat -- et quandde loin en loinun hasard les réunit sous la lampe familialeaprès des annéesil leur faut comme un effort pour nepas se retrouver étrangers. Même avec la vie côteà côtequels abîmes ne mettra pas entre ces deuxintelligences et ces deux coeurs la diversité des ambitions etdes rêves ! Pierre Corneille a beau habiter dans la mêmemaison que Thomas Corneillele premier fait le Cid et Cinnatandis que le second versifie péniblement le Comte d'Essexet Arianeet leur fraternité littéraire ne vaguère plus loin que se passer quelques maigres rimesd'unétage à l'autrepar un petit judas percé dansle plafond.
Avec lesdeux Goncourtil s'agit en vérité d'autre chose que derimes ou de phrases prêtées. Avant que la mort ne lesséparâtils avaient toujours pensé ensemble etvous ne trouveriez pas un bout de prose de vingt lignes qui ne porteleur double marque et ne soit signé de leurs deux nomsinséparablement unis. Une petite fortune -- douze àquinze mille livres de rentes pour deux -- leur assurait le loisir etl'indépendance. Avec celails s'étaient fait uneexistence ferméetoute de joie littéraire et delabeur. De temps en temps. Un grand voyage à la Gérardde Nervalà travers Parisà travers les livrestoujours par les petits sentierscar ils avaient une sincèrehorreurces touristes raffinéspour tout ce qui ressemble àla route battue de tousavec son monotone rubanses poteauxindiquant le butses fils télégraphiques et sa doublerangée de cailloux cassés en pyramide. On allait ainsibras dessusbras dessousfourrageant les livres et la vienotantle détail de moeursle coin ignoréla brochure rareet cueillant toute fleur nouvelle avec la même joie curieusequ'elle poussât dans les ruines de l'histoire ou entre lespavés gris du Paris des faubourgs. Puis une fois rentrésdans la petite maison d'Auteuilcomme des herborisateursdesnaturalistestout ensemble fatigués et joyeuxon versait ladouble récolte sur la grande table. Observationsimagestoutes neuvessentant la nature et le vertmétaphores vivescomme des fleurséclatantes comme des papillons exotiquesetil n'y avait repos ni cesse tant que tout ne fût rangéet classé.
Des deuxtas on n'en faisait qu'unchacun de son côté écrivaitsa page ; puis on comparait les deux pages pour les compléterl'une par l'autre et les fondre. Etpar un phénomèneunique d'assimilation dans le travail et de parallélisme depenséeil arrivait parfois cette surprise attendrissante etcharmante quesauf quelque détail oublié par l'unépinglé par l'autreécrites à part maisvécues ensembleles deux pages se ressemblaient.
Pourquoià côté de trop faciles succèsun telamour de l'artun si assidu travailavec tant de précieuxdons d'observateurs et d'écrivainsn'ont-ils valu aux frèresde Goncourt qu'une récompense tardive et comme marchandée? A ne considérer que l'apparence des chosescela paraîtraitincompréhensible. Mais quoi ! ces deux Lorrains si élégantssi épris d'aristocratieont étéen artdeparfaits révolutionnaires ; et le public françaistoujours prudhomme par quelque pointn'aime la Révolutionqu'en politique. Par la recherche passionnée du documentcontemporainpar la curiosité de l'autographe et del'estampeles frères de Goncourt ontdans l'histoireproprement diteet dans l'histoire de l'Artinauguré uneméthode nouvelle. Si encore ils s'étaient spécialisés-- en France on finit toujours par pardonner aux spécialités-- s'ils s'en étaient tenus à l'histoirepeut-êtreen dépit de leur originalitéaurait-on fini par lesadmettrepeut-être les aurions-nous vusces enragéss'asseoir sous la poudreuse coupole de l'Institut à côtédes Champagny et des Noailles. Maisnon ! appliquant au roman lemême souci d'information exactele même scrupule deréaliténe sont-ils paspuisque la mode est aux chefsd'écoleles chefs d'école de toute une jeunegénération de romanciers ?
Deshistoriens qui font des romans ! Passe encore si c'étaient desromans historiques ; mais des romans comme on n'en a jamais vudesromans qui ne sont ni du Balzac surmoulé ni du George Sandaffadidu roman tout en tableaux-- voilà bien de nosamateurs d'estampes ! -- avec une intrigue à peine indiquéeet de grands blancs entre les chapitresvrais fossé àse casser le cou pour l'imagination du bourgeois lecteur. Ajoutez àcela un style tout neuf roulant l'imprévuun style d'oùtout cliché est banniet quipar l'originalité vouluede la phrase et de l'imageinterdit toute banalité àla pensée : et puisdes hardiesses déconcertantesleperpétuel désaccouplement des mots accoutumés àmarcher ensemble comme des boeufs au labourle besoin de choisirl'horreur de tout direet étonnez-vousensuite que lesGoncourt ne se soient pas immédiatement imposés àl'admiration de la foule !
L'estimedes lettrésdes admirations qui consacrentde glorieusesamitiésvoilà ce que MM. de Goncourt avaient rencontrétout de suite. Le grand Michelet voulut connaître ces jeunesgenset l'hommage dont il les honorait comme historiensSainte-Beuveà son tourle leur rendait comme romanciers.Les sympathies se groupaient peu à peu. Un an durantle mondedes peintres ne jura que par Manette Salomoncette admirablecollection de tableaux à la plume. Germinie Lacerteuxfit plus de bruitpresque scandale. Et le Paris raffinés'étonna de cette effrayante ouverture sur les abîmesdes quartiers populaires. On admira ce bal de la « Boule-Noire» avec son irritant orchestre et ses odeurs mêléesde pommadede gazde pipe et de vin au saladier.
On futravi de ces paysages parisienstant imités depuiset alorsdans leur fleur de nouveautéles boulevards extérieursles buttes Montmartrela promenade aux fortificationset cescrayeux terrains de la banlieuepétris de tessons etd'écailles d'huîtres. Le tableau de ces moeursspécialessi près de nous et si lointaineshardimentvuescrânement peintesdonna à quiconque sait lire unevive impression d'originalité.
Tout celan'était pas encore le gros public.
Les gensde théâtre pillaient bien un peu les livres desGoncourtce qui pour un romancier est bon signe. Maiscesadaptations ingénieuses ne rendaient profit et gloire qu'àl'adaptateur. En dehors d'un cercle restreint en sommeaprèstant de beaux et bons livresle nom des Goncourt restait presqueinconnu.
Ilmanquait une occasionelle se présenta. La chance semblaitvouloir sourire. Un directeur lettréM. Edouard Thierryreçoit leur Henriette Maréchal. Trois grandsactes à la Comédie-Française ! La partie étaitsérieuse. On allait donc enfin le tenirce public distrait etindifférentplus insaisissable que Galathée ; et quandon l'aurait làsous la mainil faudrait bienbon grémal gréqu'il écoutât et qu'il jugeât. Onpeut ne pas lire un livrefût-il un chef-d'oeuvreune pièces'entend toujours.
Eh biennonle public n'entendit pascette fois encore. C'était unefatalitéil suffit d'un hasardd'un hasard bête. Lebruit courut que la pièce avait été imposéepar une princesse de la famille impériale ; la jeunesse duquartier Latin prit feuune cabale fut montéeet lapolitique comprimée de partoutet qui éclatait commeelle pouvaitéclata cette fois sur le dos de deux artistesinoffensifs. Henriette Maréchal fut jouée cinqfois sans que personne pût en saisir un traître mot.
Je merappelle encore le vacarme de la salleet surtout le foyer desartistes le premier soir. Pas un habituépas un acteur ! Toutle monde avait fuiau vent du désastre. Et dans ce désertluisant et cirésous le haut plafond solennel et le regarddes grands portraitsdeux jeunes gens tout seulsdebout prèsde la cheminéese demandant : « pourquoi ces haines?... que nous veut-on ? »dignes et fiersmais le coeur serrémalgré tout par la brutalité de l'injure. L'aînétout pâleréconfortait le plus jeuneun blondin àfigure étincelante et nerveuse que j'ai vu cette seule fois.
Leur drameétait pourtant une oeuvre hardiebelle et nouvelle. A quelquetemps de làles mêmes gens qui l'avaient siffléeapplaudissaient frénétiquement les HéloïseParanquet et le Supplice d'une femmepiècesd'action rapideallant droit au dénouement comme un trainlancéet dont Henriette Maréchal pourrait bienavoir préparé la formule. Et ce premier acte au bal del'Opéracette fouleces masques blaguant et hurlantcespoursuitesces engueuladesce parti pris de réalitéet de vieironique et réel comme un Gavarni n'était-cepasquinze ans avant que le mot « naturalisme » fûtinventéle naturalisme au théâtre ?
HenrietteMaréchal a sombréc'est bienon va se remettre àl'oeuvre. Et voilà de nouveau les deux frères installésdevant la grande table en leur ermitage d'Auteuil. C'est d'abord uneétude d'artla monographie sur l'oeuvre et la vie de Gavarniqu'ils avaient connu et aimévivante comme un romanpréciseet pleine de faits comme un catalogue de Musée. Puis le pluscompletle plus beau incontestablementmais aussi le plusdédaigneux et le plus hautainement personnel de leurs livres :Madame Gervaisais.
Aucuneintriguela simple histoire d'une âme de femmel'odysséeà travers une série de descriptions admirables d'uneintelligence vaincue par les nerfs et partie de la libre possessionde soi pour aller succomber à Romesous l'énervementdu climatà l'ombre des ruinesdans ce je ne sais quoi demystique et d'endormant qui tombe des murs des églisesparmil'odeur d'encens des pompes catholiques. C'était superbel'insuccès fut complet. Pas un article autourà peinesi trois cents exemplaires se vendirent.
Ce fut ledernier coup. Nature vibrantepresque fémininedepuisquelque temps déjà d'ailleurs atteint d'un commencementde maladie nerveuse et ne se soutenant que dans la fièvre dutravail et de l'espérancele plus jeune des frères neput supporter la commotion. Comme un verre de fin cristal posésur la tablette sonore d'un pianopour une dissonance trop brutalefrémit et se cassequelque chose se brisa en lui. Il languitquelque temps et mourut. L'artiste n'est pas un solitaire. On a beause mettre en dehors et au-dessus de la foulec'est toujoursen finde comptepour la foule qu'on écrit.
Et puis onles aimeces livresces romansfruits douloureux de vosentraillesfaits de votre sang et de votre chair ; comment sedésintéresser d'eux ? Ce qui les frappe vous frappeetl'auteur le plus cuirassé saigne à distance -- commepar un envoûtement mystérieux -- des blessures faites àses oeuvres. Nous jouons aux raffinésmais le nombre noustient ; nous dédaignons le succèset l'insuccèsnous tue.
Vousfigurez-vous le désespoir du survivantde ce frèrelaissé seulmort pour ainsi direlui aussiet frappédans la moitié de son âme ? A tout autre momentiln'eût sans doute pas résisté. Mais on étaitalors au moment de la guerre. Le siège vintpuis la Commune.
Le bruitdu canon dans cette banlieue de partout mitrailléelesifflement des obusl'effondrement de toutes chosesla guerreétrangèrela guerre civilele massacre dansl'incendiece vacarme de Niagara quisix mois durantroulapar-dessus Parisempêchant d'entendreétourdissantjusqu'à la penséelui rendit moins sensible sadouleur. Et quand ce fut finiquand le brouillard noir fut dissipéet qu'on recommença à penseril se retrouva tristedépareilléun grand vide au coeurétonnéd'être encore vivantmais habitué à vivre.
Edmond deGoncourt n'eut pas le courage de quitter la petite maisonfraternellesi pleine du souvenir de celui qu'il pleurait. Ilrestait làsolitaire et tristeet ne se rattachant àla vie que par un travail quasi instinctif trouvé dans le soinde ses collectionsdu jardin ; il s'était juré de nejamais plus écrire ; les livresla tablelui faisaienthorreur.
Un beaujoursans pouvoir dire comment cela s'était faitil seretrouva assisune plume aux doigtsà sa place accoutumée.D'abord ce fut duret plus d'une fois se retournant comme jadis pourdemander au frère une noteun motil se leva et partit toutpâle d'avoir trouvé la place vide. Mais quelque chose denouveaud'imprévu pour luile succèsle ramenait autravaille rasseyait sur cette place. Depuis Madame Gervaisaisle temps avait marché et le public aussi.
Unmouvement s'était fait en littérature dans le sens del'observation exacteexprimée en une langue curieuse etnette. Les lecteurs peu à peu s'apprivoisaient à cesnouveautés quid'abordles avaient tant effarouchéset les vrais initiateurs de ce mouvement de renaissanceles Goncourtdevenaient à la mode. Tous leurs livres se réimprimaient.« Si mon frère était là ! » disaitEdmond avec un sentiment de douloureuse joie. C'est alors qu'il sehasarda à écrire ce roman de la Fille Elisa dontil avait eu l'idée avec son frère.
Ce n'étaitpas précisément encore écrire seulc'étaitcomme un prolongement du travail à deuxune collaborationposthume. Le livre eut du succèsse vendit beaucoup. Triompheplein de douceur triste dans un renouvellement de douleuret plusque jamais l'éternel : « Ah ! s'il était là».
Maisdésormais le charme était rompule frèreinconsolé se réveillait homme de lettres ; et commel'Art tient toujours à la vie par un invisible fille premierlivre qu'il écrivait seul allait être l'histoire decette existence à deuxde cette collaboration tragiquementbriséede son désespoir de mort vivant et de sarésurrection douloureuse. Le livre s'appelle les FrèresZemganno.
Nousécoutions émusravisle coeur serréregardantau dehors par les vitres claires les lianesles arbustes rares auxfeuilles luisantes et laquées du petit jardin demeurévert malgré la saison. Le dégel commençaitétoilant le bassinmouillant les rocaillestandis qu'unsoleil de fin d'hiver mettait un sourire sur la neige. Ce sourirecesoleil montaientenvahissaient la maison. « Vrai ?... çavous va ?... vous êtes contents ?... »disait Edmond deGoncourt tout ragaillardi de notre enthousiasmeet devant la glacedans son petit ovale doréla miniature du frère mortsemblait s'éclairerelle aussid'un rayon de gloire tardive.
GENS DETHEATRE
DEJAZET
Quand j'aivu Déjazet à la scèneil y a déjàlongtempselle était plus près de soixante-dix ans quede soixante ; etmalgré tout son arttout son charmelessatins étroits plissaient sur sa silhouette frêlelapoudre sur sa tête semblait la vraie glace de l'âgeetles rubans de son costume flottaient tristement à tous sesgestes quipour paraître fringants et légersn'accusaient que mieux l'ankylose des années et du sangrefroidi. Un soirpourtantla comédienne m'est apparue toutà fait charmante. Ce n'était pas au théâtremais chez Villemessantà Seine-Port. On prenait le caféau salonles fenêtres ouvertes sur un parc magnifique et uneclaire nuit d'été. Tout à coupdans un refletde luneune petite forme blanche se dressa sur le seuilet une voixgrêle demanda : « Est-ce qu'on veut de moi ? »C'était Mlle Déjazet. Elle venait en voisinesacampagne étant tout à côtépasser lasoirée parmi nous. Accueillie avec empressementelle s'assitd'un air réservépresque timide. On lui demanda dedire quelque chose. Le chanteur Faure se mit au piano pourl'accompagnermais l'instrument la gênait. Les notes les plusdoucesmêlées à sa voixnous avaient empêchésde l'entendre. Elle chanta donc sans accompagnement ; etdebout aumilieu du salondont le vent d'été agitait les rareslumièresenveloppée dans une petite robe en mousselineblanche qui semblait la rendre à l'âge vague des trèsjeunes filles ou des aïeuleselle commença sur un petittimbre chevrotant et menumais très distinctsonnant commeun violon mystérieux dans le silence du parc et de la nuit :
Enfantsc'est moi qui suis Lisette...
C'esttoujours ainsi que je la voisquand je pense à elle.
LESUEUR
Bien deschoses avaient manqué à Lesueur pour acquérird'emblée l'autorité d'un grand comédien. Sa voixétait sourdevoiléed'un mauvais métal quis'éraillait aux efforts de sonorité. Un défautde mémoire le tourmentait aussil'amenait à toutmoment devant la boîte du souffleur. Enfingrêlefluetpresque petitil manquait de cette prestance quiaux instantspathétiquesdomine et tient toute la scène. Nonseulement Lesueur triomphait de tant de défautsmais ildonnait raison à la théorie de Régnierqui veutque l'acteur soit obligé de lutter contre certains obstaclesphysiques. Les finesses où sa voix échouait seretrouvaient dans ses yeux jaseursdans les détails de samimique ; et si des parties du rôle lui échappaientiln'avait jamais de loups dans son jeuparce qu'il étaittoujours à la situationet qu'il savait ce que tant decomédiens ignorent : l'art d'écouter. Quant à lataillecomment arriva-t-il à y suppléer ? Ce qui estsûrc'est que dans certaines piècesDon Quichottepar exempleil paraissait très grand et remplissait lethéâtre de l'ampleur de son geste. Toute proportiongardéeon retrouvait en lui du Frédérick :cette même souplesse à endosser tous les costumes de lacomédie humaineà porter la vareuse d'un rapinlapourpre burlesque d'un roi de féeriel'habit noir mondainavec une aisance parfaite et une égale distinction. Tous deuxavaient de commun aussi une fantaisie qui donnait à leurscréations quelque chose d'excessifmarquait leurs rôlesd'une empreinte ineffaçable et en rendait la reprise trèsdifficile après eux. Demandez à Gotqui est lui-mêmeun parfait artistele mal qu'il a eu à faire sien lepersonnage du père Poiriercrééil y aquarante anspar le comédien du Gymnase. Quand Lesueur jouaitdans une piècel'auteur pouvait se dire quemême encas de désastretout son effort ne serait pas perdu et qu'unrôle survivrait toujours du naufragele rôle de Lesueur.Qui se souviendrait aujourd'hui des Fous d'Edouard Plouviers'il n'y avait joué son magnifique buveur d'absinthe ? Qu'ilétait beau devant son verrela lèvre humide etgrelottantetenant haut la carafe qui tremblait dans sa main etdistillant goutte à goutte le poison vert dont on suivait leseffets sur son masque hébété et blafard. C'étaitd'abord une bouffée de chaleurune convulsion de la vie dansce squelette gelédesséché par l'alcoolun peude sang arrivait aux jouesun éclair allumait les yeux ; maisbientôt le regard redevenait vitreuxs'embuaitla bouchedétendue laissait retomber ses coins. Mime merveilleuxilsavait à fond l'outillageles fils cachés de la pauvremarionnette humaineet il les maniait avec une dextéritéune précision ! Lorsqu'il pleuraittout sanglotait en luises mainsses épaules. Rappelez-vous la façon dont ildétalaitdans le Chapeau d'un Horlogerses jambes quise précipitaientse multipliaientcomme s'il avait eu dixvingttrente paires de jambes : une vision de gyroscope. Et quelpoème que son regard quand il se réveillaitdans lapartie de piquet !... Ah ! Lesueur ! Lesueur !...
FELIX
Etrangefigure que celle de ce Félix ! En écrivant son nomilvient de m'apparaîtrefat et balourdl'oeil arrondile frontbascarrétêtutoujours plissé d'un effort decomprendrele meilleur des hommesmais d'une sottised'une vanitéde coq d'Inde ! Il faut avoir travaillé avec lui àl'avant-scène pour s'imaginer cela. D'abordsitôt aprèsla lecture au foyerFélix montait chez le directeur pourrendre le rôle que vous veniez de lui distribuer et qui ne luiconvenait pas. Tous les autres lui semblaient bons dans l'ouvrageexcepté celui-là ! Il eût été bienempêché de dire pourquoipar exemple. Nonc'étaitune manieun besoin de se faire prierd'amener les auteurs àson quatrième étage de la rue Geoffroy-Mariedans cepetit intérieur de provincepropretdouilletminutieuxqu'on aurait pu prendre pour un appartement de chanoine oud'archiprêtresans l'innombrable quantité de portraitsde médaillonsde photographies rappelant à l'artistechacune de ses créations. Il fallait s'asseoiraccepter unpetit verre de « quelque chose de doux » et tâcherde fléchir à force d'éloquencede complimentsd'enguirlandementscette exaspérante coquetterie. A cettepremière visiteFélix ne s'engageait pasnepromettait rien. Il verraitil réfléchirait.Quelquefoisquand le rôle lui faisait très envieilvous disait d'un air détachéindifférent : «Laissez-moi la pièce... je vais lire encore. » Et Dieusait ce qu'il y comprenaitle pauvre homme ! Huit joursquinzejoursil gardait le manuscritne parlait plus de rien ; dans lethéâtre on chuchotait : «... Jouera... jouerapas... ». Puislorsque las d'attendre de voir tout entravépar le caprice d'un seulvous vous disposiez à envoyer legrand comédien au diableil arrivait à la répétitiondispossouriantsachant déjà son rôle par coeuret faisant flamber les planches rien que de poser le pied dessus.Mais vous n'en aviez pas fini avec ses fantaisieset jusqu'au jourde la représentation il fallait s'attendre à deterribles secouées. Ce jour-làil est vraila verveincomparable de ce singulier artiste qui se transfigurait dans lalumière de la rampeses effets inconscientstoujours sûrstoujours comprisson action irrésistible sur le publievouspayaient bien de toutes vos misères.
MADAMEARNOULD-PLESSY
L'avez-vousvue dans Henriette Maréchal? Vous la rappelez-vousdevant son miroirjetant un long regard désespéréà ce confident muet et implacableet disantavec unintonation déchirante : « Oh ! j'ai bien mon âgeaujourd'hui. » Ceux qui ont entendu cela ne pourront jamaisl'oublier. C'était si profondsi humain ! Rien que dans cesquatre motsaccentués lentementtombant l'un aprèsl'autre comme les notes d'un glasla comédienne faisait tenirtant de choses : le regret de la jeunesse disparuel'angoisse navréede la femme qui sent que son règne est fini et que si ellen'abdique pas de bonne volontéla vieillesse va venir tout àl'heure lui signer son renoncement d'un coup de griffe en pleinefigure. Minute horrible pour la plus fortepour la plus honnête! C'est comme un exil subitun changement de climat et la surprised'une atmosphère glacée succédant à cetair embaumé et tièdeplein de murmures flatteurs etd'adulations passionnéesqui entoure la beauté de lafemme dans le midi de son âge. Pour la comédiennel'arrachement est encore plus cruel. Chez ellela coquetteries'accroît et s'exaspère d'un désir de gloire.Aussila plupart des actrices ne veulent jamais finirn'ont pas lecourage de se mettre une bonne fois devant leur glace et de se dire :« J'ai bien mon âgeaujourd'hui ».
Celles-làsont vraiment à plaindre. Elles ont beau lutters'accrocherdésespérément aux lambeaux défleuris dela couronne tombéeelles voient le public s'éloignerd'ellesl'admiration remplacée par l'indulgencepuis par lapitiéetce qui est plus navrant que toutparl'indifférence.
Grâceà son espritgrâce à sa fiertéla grandeet vaillante Arnould-Plessy n'a pas attendu cette heure désolante.Ayant encore quelques années devant elleelle a préférédisparaître en pleine gloirecomme un de ces beaux soleilsd'octobre qui plongent sous l'horizon brusquement plutôt que detraîner leur agonie lumineuse dans un vague et lent crépuscule.Sa réputation y aura gagné ; mais nous y aurons perdules belles soirées qu'elle pouvait nous donner encore. AvecelleMarivaux est partiet le charme de son art merveilleuxdecette phrase chatoyante et papillonnante qui a l'ampleur capricieused'un éventail déployé aux lumières.Toutes ces belles héroïnes qui s'appellent comme desprincesses de Shakespeareet qui ont quelque chose de leur éléganceéthéréesont rentrées dans le livre ; onles évoqueelles ne viennent plus. Finis aussi ces jolis jeuxd'esprit et de langageces causeries un peu maniéréesun peu alambiquéesmais si françaisescomme Musset ena tant écritbadinages charmants qui appuient sur le rebordd'une table à ouvrage leur coude chargé de dentellestraînantes et tous les caprices souriants de l'oisivetéamoureuse. Tout cela est mort maintenant ; on ne sait plus causermarivauder au théâtre. C'est une tradition perduedepuis qu'Arnould-Plessy n'est plus là. Et puisà côtéde l'artiste d'étude et de méthodede la fidèleinterprète des traditions de l'art françaisil y avaitdans cette excellente comédienne un talent original etchercheursoit qu'elle se prît aux grandes créationstragiques comme dans cette Agrippine qu'elle jouait d'une façonsi accentuéebien plus selon Suétone que selon Racinesoit qu'elle créât en pleine vie moderneen plein artréalistela Nany du drame de Meilhacpaysanne ignorante etmère passionnée. Je me souviens surtout d'une scèneoùpour exprimer les mille sentiments confus qui seheurtaient dans son âme ambitieuse et jalouseNanyincultebèguecherchant ses motsavait un élan de rage follecontre elle-même et râlait en meurtrissant de coups sapoitrine : « Ah ! paysanne... paysanne !... ». L'actricedisait cela à faire frissonner toute la salle. Notez que descris pareilsdes mouvements de cette véritéce n'estpas la traditionce n'est pas l'école qui les donnemais lavie longtemps étudiéeregardée et sentie. Etn'est-ce pas un beau triomphela preuve d'un admirable pouvoir decréationqu'un drame sombre comme Nanyjoué àpeine une dizaine de foisreste éternellement dans l'espritet les yeux de ceux qui l'ont vuparce que Mme Arnould-Plessy en ainterprété le principal personnage.
ADOLPHEDUPUIS
AdolpheDupuis est le fils de Rose Dupuissociétaire de laComédie-Françaiseretirée du théâtredepuis 1835 et morte il y a seulement quelques années. Malgréun talent très réel et des succès chèrementconquis à côté de Mlle Marsl'excellente femmegardait rigueur à son ancien métier ; etlorsqu'ausortir du collège Chaptaloù il avait fait d'assezmédiocres étudessur le même banc qu'AlexandreDumas filsDupuis parla d'être comédienla mères'y opposa de toutes les forces de sa tendresse. Mais on sait ce quevaut le « jamais » de la femme qui aimeet celle-làaimait passionnément son grand fils. Au Conservatoirel'élèvene réussit guère mieux qu'à Chaptal ; non certesque l'intelligence lui fît défautil en avait trop aucontrairemais de celle que l'école n'admet pascetteintelligence aiguiséepersonnellequi raisonne dans le ranget veut savoir pourquoi le commandement de « tête àdroite » quand c'est à gauche qu'il faut aller. Enpleine classel'écolier discutait les idées de sonmaîtreSamsons'insurgeait contre cette façon depréparerde ressasser le concours avec le professeurau lieude laisser un peu d'initiative à l'élève ; ildemandait pour l'examen un morceau déchiffré àlivre ouvertnon pas appris« seriné » dix moisd'avanceet réclamait enfin comme plan générald'étude une place plus large à la natureau détrimentde la tradition. Pensez si le vieux Samson devait bondir à cesthéories subversives ; malgré tout il se sentait de lasympathie pour le fils de son ancienne camaradece jeune révoltéau sang calmeau sourire bon enfantet il le fit entrer à laComédie-Françaisecomme cinquième ou sixièmeamoureux de répertoire. Dupuis n'y resta pas longtemps. Unjour Fechterqui tenait dans la maison le même emploi que luiet ne jouait pas davantagelui dit tout bas dans un coin du foyer :« Si nous filions ?... On meurt ici... -- Filons» ditDupuiset voilà nos jeunes premiers partis pour LondrespourBerlinchantant « Je suis Lindor » aux quatre coins del'Europemal payéspeu comprisapplaudis de traversmaisjouantayant des rôlesce que les débutants préfèrentà tout. Deux ans aprèsvers 1850nous retrouvonsnotre comédien au Gymnaseentre les mains de Montignyqui lepremier comprit ce qu'il y avait à tirer de ce beau garçonun peu lentun peu moul'assouplit par un travail acharnédes créations multiples et diversesle grima en vieuxenouvrieren raisonneuren père noblemit en oeuvre toutesses facilités d'observationde finessede sensibilitéde bonhomieet cet admirable accent de nature que personne n'a commelui. Après dix ans passés làau lendemain dugrand succès du Demi-monde dont il avait eu sa bellepartDupuis se laissa tenter par un engagement en Russie. Il y restalongtempstrop longtempset lorsqu'il nous revintaprèsdix-sept ans d'absenceeut quelque mal à reconquérirson public. C'est l'histoire de tous les revenants du théâtreMichel. Il faut croire que le diapason n'est pas le même àSaint-Pétersbourg que chez nous ; on doit parler plus basjouer plus discrètements'entendre à demi-mot et nerien soulignercomme dans un salonentre gens qui se connaissent etne sont pas très difficiles. A ce jeu-làqualitéset défauts s'estompents'atténuent. Nous reconnaissonsbien nos artistesmais la rampe n'a pas l'air montée ; on lesvoit confusément comme à travers une gaze. Le soir duNababpar exempleles vieux Parisiens retrouvèrentleur Dupuisavec tous ses dons d'autrefoismême quelque choseen plusune largeur d'envergureune fougue de sang marseillais dontce père tranquille ne leur paraissait pas capable. Aulendemain de cette représentationil n'a tenu qu'àJansoulet d'entrer à la Comédie-Française parl'escalier d'honneur ouvert à deux battants et non plus par laporte dérobée de ses débuts ; mais l'ancienélève de Samson a gardé ses goûtsd'indépendancesa libre humeur des premiers joursetl'administration de la rue Richelieu n'ayant pas cru devoir se plierà ses exigencesle Vaudeville a eu la bonne fortune deconserver son acteur.
LAFONTAINE
HenriThomasdit Lafontaineest né à Bordeaux aux premiersjours de l'hégire romantique. Dans le Midi françaisBordeaux tient une place à part. Ancré aux bords del'Atlantiqueson beaupré tourné vers les Indesil estle Midi créolele Midi des îlesexaspéréquià la fougue imaginativeà la vivacité deparole et d'impression des peuples d'outre-Loirejoint un immodérébesoin d'aventuresde coursesd'escampette. Ce Bordeaux-làjoue un grand rôle dans l'existence et le génie de notrecomédien. « Nous en ferons un prêtre ! »disait sa mèreune vraie maman de là-bascatholiquejusqu'au délire ; mais à peine au séminaireleBordelais saute par-dessus les murstroque sa soutane contre uneblouse et commence à travers champs le voyage du PetitChaperon-Rougetout en zigzags et en capricesjusqu'à ce quele loupun loup à baudrier jaune et chapeau de gendarmel'arrête et lui demande ses papiers. Ramené chez lui debrigade en brigadeon veut qu'il rentre au séminaire. «Çajamais. - Alorsvaurienembarque pour les îles ! »Et voilà bien une colère de parents du Midi : «Il ne veut pas être curé... Zou ! Nous allons en faireun mousse ». Trois mois de gourganes et de viandes saléesdans la mouillure et le vent de merguérirent le jeuneéchappé de ses velléités voyageusessanslui donner pourtant le goût de la tonsure. A son retour del'île Bourbonil essaya de vingt métiersfut tour àtour menuisierserrurierrevendeur d'une infinité de chosescoucha sur la durese nourrit de vache enragéeallant devantlui au gré de sa jeunesse et du fol instinct bordelaissansbutmais les yeux ouverts et déjà une mémoired'artiste. Le voici à Parisplacier chez un librairearpentant les ruesgrimpant les étagesmarchand delittérature et de sciencel'esprit meublé de titres etde prospectusfaisant l'article pour des livres qu'il n'a pas letemps de liremais qui lui laissent tout de même un peu dephosphore aux doigts ; tenaceinsinuantéloquentirrésistibleun placier comme la maison Lachâtre n'enavait jamais vu. Puisun soir il entre à laPorte-Saint-Martinvoit Frédérick et sent ce coup aucoeur que connaissent seuls les amoureux et les artistes. Il plantelà bouquins et revueset s'en va frapper chez Sevestrelegros père Sevestregouverneur général desthéâtres de la banlieue. « Que sais-tu faire ?...As-tu déjà joué ? -- Jamaispatron... maisdonnez-moi des rôleset vous allez voir. » Dans cettebelle présomption bordelaiseaux yeux vifsau geste largeàla voix forte et métalliqueSevestre devina tout de suite untempérament de théâtre. Ce tempérament estcommun au Midià sa nature verbeusegesticulantequi mettout dehorsexprime toutpense à voix hautela paroletoujours au delà de la pensée. L'homme de Tarascon etl'homme de la Porte-Saint-Martin se ressemblent.
Sur cepetit théâtre de la rue de la Gaîtéoùplus tard débutait Mounet-SullyLafontaine fit sonapprentissage ; il joua à Sceauxà Grenellerouladans l'omnibus des scènes de banlieueune brochure àla maindéclamant Bouchardy sur les routes. Il réussit.Le bruit de son succès passa les pontsvint jusqu'auboulevard etquelque temps aprèsHenry Lafontaine entrait àla Porte-Saint-Martin pour jouer dans Kean à côtéde Frédérick quitout de suitel'aima et le fittravailler. « Vienspetit »disait le maître ensortant du théâtre. Et il emmenait chez lui au boulevarddu Templel'élève exténué par cinqheures de planchesles yeux pleins de sommeilla joue brûléede gaz et de maquillage ; mais il s'agissait bien de dormir ! Lesouper était servitous les flambeaux du salon allumés.On buvaiton mangeait en hâtepuis le maître donnait unsujet de scèneune situation dramatique à rendreets'allongeant sur son fauteuilun flacon de vin près de lui :« Maintenantvas-y ! »
Le boncomédien Lafontaine m'a souvent raconté l'histoire d'unde ces scénarios improvisés. « VoilàditFrédérickvautré sur son divantu es un petitemployémarié depuis trois ans... C'est ce soir lafête de ta femmeque tu adores... En son absencetu lui aspréparé un bouquetune surpriseun bon petit soupercomme celui-ci... Et tout à coupen mettant le couverttudécouvres une lettre qui t'apprend que tu es indignementtrompé... Tâche de me faire pleurer avec ça...Marche. » Vivement Lafontaine se met à l'oeuvredresseson couvert en consciencesans tricherie-- car Frédéricqne plaisantait pas sur la question des accessoires-- pose sonbouquet au milieu de la table avec des petits riresdes regardsmouilléspuisfrémissant d'impatience et de joieouvre le tiroir où la surprise est serréetrouve unelettrela lit machinalement et pousse un cri terrible dans lequel ilessaye de mettre tout le désespoir de son bonheur foudroyé!... « Entre nousj'en étais assez content de mon crime disait le brave Lafontaine s'égayant au souvenir de samésaventureje le trouvais justeémusincèreje m'étais presque fait pleurer en le poussant... Ah ! bienoui !... Au lieu des compliments que j'attendaisun formidable coupde pied m'arrive au bas de l'échine... je ne m'en émuspas tropcar j'étais fait aux manières de mon maîtremais ce fut sa critique qui me frappa surtout... -- Comment ! animaltu aimes ta femme par-dessus tout au mondetu crois en elleaveuglémenta-veu-glé-mentet voilà qu'àla première lecturetu voistu comprendstu crois tout ceque ce papier te raconte... Est-ce que c'est possible ?...
Tiens ! vat'asseoir là-baset regarde-moi distiller mon poison. »Là-dessus lui-même recommence la scèneouvre letiroir... « Tiens ! une lettre... » Il la tournelaretournela parcourt du bout des yeux sans comprendrela repoussedans le tiroir et continue à ranger son couvert... «Tout de mêmec'est drôlecette lettre ! » Il yrevient encorela lit plus longuementpuis haussant les épaulesla jette sur la table. « Allons doncce n'est pas vraic'estimpossible... Elle va tout m'expliquer en rentrant... » Maiscomme ses mains lui tremblent en achevant de mettre son couvert ! Ettoujours les yeux sur la lettre... A la fin il n'y tient plusilfaut qu'il la lise encore... Cette fois il a comprisun sanglot luimonte à la gorgel'étouffe ; il tombe sur une chaiseen râlant... C'étaitparaît-ilun spectacleadmirable de voir les traits du grand comédien se décomposerun peu plus à chaque nouvelle lecture. On suivait les effetsdu poisonà mesure que ses yeux l'absorbaient... Puisunefois saisi par sa propre émotionFrédérick nes'arrêtait pluscontinuait la pièce. Un tressaut detout son corpsun regard sanglant vers la porte. Sa femme venaitd'entrer. Il la laissait venir jusqu'à lui sans bougeretsoudain se dressaitterrifiantsa lettre à la main : «Lis ! » Puisavant qu'elle eût répondudevinantà l'épouvante de ce visage de femme que c'étaitvraique la lettre n'avait pas mentiil tournait deux ou trois foissur lui-même comme une bête ivrecherchait un crin'entrouvait paset toujours amoureuxmême dans sa ragepourpasser sur quelque chose qui ne fût pas sa femme le besoinfurieux de massacrer dont ses mains étaient pleinesilprenait la table à poignée et l'envoyait rouler àl'autre bout du salon avec la lampela vaisselletout ce qu'elleportait...
Ce coup depied sacra Lafontaine grand acteurfut pour sa foi de comédiencomme une confirmation par en bas. Pourtants'il n'avait eu que lesleçons de Frédérickl'artiste bordelaisn'aurait jamais pu réglerendiguer son fougueux vagabondage.Son Midi le portaitmais le gênait aussi. Il en avaitl'improvisation brillantemais aussi les emportementsle manque demesuretous les heurts de soleil et d'ombre. Si bien douéilpouvait manquer sa vien'être qu'un détraquésublime comme ce pauvre Rouvière qu'affolait son doubletempérament d'acteur et de méridional. Par bonheurLafontaine entra au Gymnase et eut làpendant dix ansunprofesseur incomparable. Ceux qui ont vu le vieux Montigny dans sonfauteuilà l'avant-scènebourrule sourcil froncéfaisant recommencer dix foisvingt fois le même passagerompant les plus dursles plus rebellestoujours insatisfaits'acharnant au mieuxceux-là peuvent se vanter d'avoir connuun vrai directeur de théâtre. Avec luile talent del'artiste se disciplina. A sa verve exubéranteMontigny mitcomme une cangue le hausse-col militaire du Fils de Famillece même Fils de Famille que Lafontaine a repris il y aquelque temps à l'Odéonil lui boutonna son geste duMidi dans la redingote en drap fin du mari de Diane de Lys. LeBordelais se cabraitavalait son mors ; mais il sortit de làdomptéassoupliaccompliet aujourd'huiquand il parle deson vieux maîtreil a toujours les yeux mouillés.
NOTESSUR PARIS
LESNOUNOUS
Rien dejoli au Luxembourgaux Tuileriespar ces premiers joyeux soleilspar ces premiers frissons de verdurecomme la sortie des bébéset des nounous de une à deux heures de l'après-midi.
En cescoins abrités où elles se donnent toutes rendez-vousles nourrices se promènent par groupes aux rubans flottants ous'alignent sur des chaisesprotégeant le bébésous le large parasol de doublure rose ou bleue au reflet favorable ;et tandis que le pouponendormi dans son voile transparent et ladentelle mousseuse de ses petits bonnetsaspire de tout son êtremignon la sève du printempsNounou radieusereposéeayant aux lèvres un sourire de perpétuellesrelevaillespromène tout autour un regard vainqueurdressela têterit et jase avec les camarades.
Elles sontlà cinquanteces nourricestoutes en costume de paysmaisle costume affinétransformé et donnant à lasolennité du jardin royal une vieillotte poésie d'opéracomique. Des coiffures variées et superbes : madras éclatantdes Gasconnes et des mulâtressescoiffes conventuelles desBretonnesénorme et léger papillon noir desAlsaciennesaristocratique hennin des filles d'Arleset les hautsbonnets du pays de Cauxajourés comme des flèches decathédralesetfichées dans des chignons sauvagesles grandes épingles à boules d'or des Béarnaises.
L'air estdouxles parterres embaumentune odeur de résine et de mieltombe des bourgeons de marronniers. Là-basprès dubassinla musique militaire attaque une valse. Nounou s'agiteBébépiailletandis que le petit soldat en promenade devient rouge commeson pompon devant cette haie de payses qu'il trouve considérablementembellies.
Celac'est la nourrice de promenade et de paradecostumée etmétamorphosée par l'orgueil des parents et six mois deséjour à Paris. Mais pour voir la vraie nounoupourbien la connaîtreil faut la surprendre à l'arrivéedans un de ces établissements étranges qu'on nommebureaux de placement et où se faità l'usage des bébésparisiens affamés d'un lait quelconquele commerce desfemmes-mères. C'est du côté du Jardin desPlantesau bout d'une de ces rues paisiblesdemeuréesprovinciales en plein Parisavec des pensionsdes tables d'hôtedes maisonnettes à jardinetpeuplées de vieux savantsde petits rentiers et de poules ; sur la façade d'un antiquelogis à grand porcheune enseigne à lettres rosesétale ce simple mot : Nourrices.
Devant laportepar groupes ennuyésflânent des femmes enguenillesavec des enfants sur les bras. On entre : un pupitreunguichet grilléle dos de cuivre d'un grand-livredu mondequi attend sur des banquettesl'éternel bureaule mêmetoujourségalement correct et froidaux halles comme àla Morguequ'il s'agisse d'expédier des pruneaux oud'enregistrer des cadavres. Ici c'est de la chair vivante qu'ontrafique.
Comme onreconnaît en vous des personnes « bien »on vousépargne la banquette d'attenteet vous voici dans le salon.
Du papierà fleurs sur les mursle carreau rouge et ciré commedans un parloir de couventetde chaque côté de lacheminéeau-dessus de deux cylindres de verre recouvrant desroses en papierles portraits à l'huile et cerclésd'or de Monsieur le Directeur et de Madame la Directrice.
Monsieurest quelconque : tête d'ancien agent d'affaires ou de pédicurequi a réussi ; Madamebien en chairsourit de ses troismentons dans l'engraissement d'un métier facileavec ce je nesais quoi de dur que donne au visage et au regard le maniement d'untroupeau humain. Quelquefoisc'est une sage-femme ambitieuse ; leplus souvent une ancienne nourrice douée du génie desaffaires.
Un jouril y a longtempselle est venue dans une maison pareille àcelle-cipeut-être dans la mêmevendrepauvre fille decampagneun an de sa jeunesse avec son lait. Elle a rôdédevant la porte comme les autresaffaméeson enfant au bras; comme les autres elle a usé la bure de ses jupes sur le bancde pierre.
Aujourd'huiles temps ont changé : elle est richecélèbre.Son villagequi la vit partir en loquesne parle d'elle qu'avecrespect. Elle est une autorité là-baspresque uneprovidence.
La récoltea manquéle propriétaire presse. Le soirsous lacheminéel'homme dit en présentant la large paume desa main à la flamme : « Phrasieécoute voir...ton lait est bonl'argent se fait cher : si t'allait à Parisfaire une nourriture ? On n'en meurt pas ; et la patronne du bureauqu'est d'ici et qui nous connaît bent'aurait une bonne placetout de suite. »
Elle s'envapuis une autre. Peu à peu l'habitude se prendl'amour dulucre continuant ce qu'avait commencé la misère.Maintenantchaque fois qu'un enfant naîtson affaire estclaireet son destin réglé d'avance. Il restera aupays à teter la chèvre ; et le lait de la mèrebien venduservira à acquérir un champàarrondir un bout de pré.
Toutecélébrité nourrisseusetoute directrice debureau de placement exploite ainsi spécialement sa provinced'origine. L'une a l'Auvergnel'autre la Savoiecelle-ci les landesbretonnes ou les côtes boisées du Morvan. Chose àremarquerle marché aux nounousà Parissuit lesfluctuations de la vie rustique. Rare les années de récoltela nourrice afflue en temps de disette ; mais que l'année soitmauvaise ou bonneelle devient presque introuvable pendant lamoisson et la vendangeau moment des grands travauxdes champs.
Aujourd'huile bureau de placement semble bien fourni. Sans compter les nourricesque nous avons vues à l'entrée traînant leurssabots devant la porteen voici vingttrentesous la fenêtredans un petit jardin transformé en courlugubre à voiravec ses bordures de buis piétinéesses plates-bandeseffacéeset les couches d'enfant qui sèchent sur uneficelle tendue au travers entre un figuier malade et un lilas mort.Tout autour un alignement de logettes sans étagedont lanudité sordide fait songer à la fois aux payotesdes nègres esclaves et aux cabanons des forçats. C'estlà que logent les nourrices avec leurs enfantsen attendantd'être placées.
Ellescampent sur des lits de sangledans un aigre relent de malpropretérustiqueau milieu du perpétuel tintamarre des marmots en tasqui s'éveillent tous dès que l'un crieet se mettent àbrailler ensemblebouche tenduevers le sein défait. Aussiaiment elles mieux l'air libre du jardinetoù elles traînentd'un coin à l'autretoute la journéeavec des alluresennuyées de démentesne s'asseyant que pour coudre unpeumettre une pièce de plus à quelque jupe déjàcent fois rapiécéeloque de couleur spécialeterreuse et griseou bien affectant ces tons jaunes et éteintsbleus expirantsque la mode parisienne empruntepar raffinementàla misère campagnarde.
Mais voiciMadame qui entreavec la tenue de l'emploià la foiscoquette et sérieuseune avalanche de noeuds flamme de punchsur un corsage d'un noir jansénisteregard sévèreet parler doux.
«Vous désirez une nourrice ?... Soixante dix francs par mois?... Bien... Nous avons un assortiment dans ces prix-là... »
Elle donneun ordre : la porte s'ouvreles nourrices arrivent par fournéede huit ou dixpiétinent et s'alignentsoumisesleur enfantau brasavec un bruit d'esclotsde souliers à clousdes poussées gauches de bétail... Celles-ci neconviennent pas ? Vitedix autres... Et ce sont toujours les mêmesyeux baissésles mêmes timidités misérablesles mêmes joues séchées et tannéescouleur d'écorce et couleur de terre. Madame présenteet fait l'article.
«...Saine comme l'oeil... une vraie laitière... regardez le poupon! » Le poupon est beau en effettoujours beau. On en gardedeux ou trois dans l'établissement pour figurer à laplace de ceux qui seraient trop malingres.
« Decombien votre laitnourrice
-- Detrois moisM'sieu. »
Leur laitest toujours de trois mois. Voyez plutôt : du corsageentr'ouvert un long filet blanc a jailliriche de sèvecampagnarde. Mais ne vous y fiez pas : ceci est le sein de réserveque jamais l'enfant ne tette. C'est l'autre côté qu'ilfaudrait voircelui qui se cache honteux et flasque. Sans compterqu'avec quelques jours d'absolu repostoujours un peu de laits'emmagasine.
Et MadameétaleMadame déballe avec l'autorité de lapossession et l'impudence de l'habitude ces pauvres créatureseffarouchées.
Enfin lechoix est faitla nourrice est retenue -- il faut régler. Ladirectrice passe derrière son grillage et fait le compte.Effrayantce compte. D'abord le tant pour cent de la maisonpuisl'arrièré de la nourrice en logement et en nourriturequoi encore ? Les frais de route. Est-ce fini ? Nonil y a la «meneuse » qui va prendre l'enfant à la mère pourle reconduire au pays.
Tristevoyagecelui-là ! On attend qu'il y ait cinq ou six poupons ;et la « meneuse » les emporte ficelés dans degrands paniersla tête en dehors comme des poules. Plus d'unmeurt dans ce trimballement à travers des salles d'attenteglacialessur les dures banquettes des wagons de troisièmeclasse avec le lait du biberon et un peu d'eau sucrée au boutd'un chiffon pour nourriture. Et ce sont des recommandations pour latantepour la grand'mère. L'enfantbrutalement arrachédu seins'agite et piaille ; la mère l'embrasse une dernièrefoiselle pleure. On sait bien que ces larmes ne sont qu'àdemi sincèreset que l'argent les séchera bientôtce terrible argent qui tient si fort aux entrailles paysannes. Malgrétoutla scène est navrante et fait songer douloureusement auxséparations de familles d'esclaves.
Lanourrice a pris son paquetquelques guenilles dans un mouchoir.
«Comment ! c'est votre trousseau ?
-- Oh !mon bon M'sieuj'sommes si pauvres par chez nous... J'n'avonscensément ren que c'que j'portions sur la piau. »
Et le faitest que ce n'est guère. Avant toute choseil va falloir larenipperla vêtir. C'était prévu. La premièretraditionchez les nourricescomme chez les flibustiers allant aupillageest d'arriver les mains videssans bagages encombrants ; laseconde est de se procurer une grande mallela malle à serrerla __denraie__. Car vous aurez beau la choyer et la soignercette sauvagesse ainsi introduite chez vouset qui détonned'abord si étrangement parmi les élégances d'unintérieur parisien avec sa voix rauqueson patoisincompréhensiblesa forte odeur d'étable et d'herbe ;vous aurez beau laver son hâlelui apprendre un peu defrançaisde propreté et de toilette ; toujours chez lanounou la plus friande et la mieux dégrossieà tousles instantsen toute chosela brute bourguignonne ou morvandiautereparaîtra. Sous votre toità votre foyerelle restela paysannel'ennemietransportée ainsi de son triste paysde sa noire misèreen plein milieu de luxe et de féerie.
Tout cequi l'entoure lui fait envieelle voudrait tout emporter là-basdans son troudans son gîteoù sont les bestiaux etl'homme. Au fond elle n'est venue quepour celason idéefixe est la denraie. La denréemot surprenantquidans le vocabulaire des nourricesprend des élasticitésinattendues de gueule de serpent boa. La denréece sont lescadeaux et les gagesce qu'on vous payece qu'on vous donnece quise ramasse et se volele bric-à-brac et le péculequ'aux yeux des voisins pleins d'envie on compte déballer auretour. Pour engraisser et pour enfler cette denrée saintevotre bourse et votre bon coeur vont être mis en coupe réglée.Et vous n'avez pas affaire à la seule nourrice ; l'hommelagrand'mèrela tante sont compliceset du fond d'un hameauperdu dont vous ignorez même le nomtoute une familletouteune tribu ourdit contre vous des ruses de peau-rouge. Chaque semaineune lettre arrived'une écriture matoise et lourdeetcachetée d'un dé sur du pain bis.
Elles vousattendrissent d'abord ces lettres comiques et naïvesavec leurorthographe compliquéeles endimanchements de styledesphrases tortillées et retortillées comme le bonnet d'unpaysan qui ne veut pas avoir l'air timideet ces suscriptionsminutieuses ainsi qu'en imaginait Durandeau dans ses fantaisiesmilitaires :
Amadamemadame Phra-
sie Darnetnourrice chez Mr ***
rue desVosges 18. 3e arrondisse-
mentParisSeineFranceEuropeetc.
Patience.Ces fleurs de naïveté campagnarde ne vous attendrirontpas longtemps. Toutes visent à votre boursetoutes respirentle même parfum de carotte rurale et d'idyllique escroquerie. «C'est pour te faire savoirma chère et digne compagne --mais tu n'as pas besoin d'en parler à nos respectésmaîtres et bienfaiteurs parce qu'ils voudraient peut-êtreencore te donner de l'argent et que ce n'est jamais bien d'abuser...»
Là-dessusl'annonce circonstanciée d'un épouvantable orage quivient de tout ravager au pays. Plus de récolteles bléshachésles prairies perdues. Il pleut dans la maison comme enpleins champsvu que les grêlons ont crevé les tuiles ;et le porcune si belle bêtequ'on devait saigner pourPâquesdépérit du saisissement qu'il a eud'entendre le tonnerre.
D'autresfoisc'est la vache qui est mortel'aîné des petiotsqui s'est cassé le brasla volaille atteinte d'épilepsie.Sur le même bout de toitle même coin de champc'est uninvraisemblable amoncellement de catastrophes pareilles aux plaiesd'Egypte. Cela est grossierstupidecousu d'un fil blanc àcrever les yeux. N'importeil faut faire semblant d'être prisà ces inventionspayer encore et toujourssans quoi gare àNounou ! Elle ne se plaindra paselle ne demandera rienoh ! noncertesmais elle bouderapleurnichera dans les coinsbien sûrd'être vue. Et quand Nounou pleureBébé crieparce que le gros chagrin tourne les sangs et les sangstournés font le lait aigre. Vite un mandat de poste et queNounou rie.
Ces grandcoups hebdomadaires n'empêchent pas la nourrice de travaillerquotidiennement à sa petite denraie personnelle. Cesont des chemises pour le petitle malheureux déshéritétout seul là-bas à teter la chèvre ; un juponpour elleun paletot pour son hommeet la permission de ramasser cequi traîneles menus riens qui vont aux balayures. Lapermission d'ailleurs n'est pas toujours demandéeNounouayant rapporté de son village des idées particulièressur la propriété des bons Parisiens. La mêmefemme quichez ellene ramasserait pas la pomme du voisin par letrou d'une haiemettra paisiblementet sans que sa conscience ensoit troubléetoute votre maison au pillage. Pour le zouavedépouiller l'Arabe ou le colon n'est pas volerc'estchaparderfaire son fourbi. Différence énorme !De même pour Nounouvoler le bourgeoisc'est faire sadenraie.
Chez moiil y a quelques annéescar c'est par expérience que jepuis faire ainsi un cours de nourricesdes couverts d'argentdisparurent. Plusieurs domestiques pouvaient être soupçonnés; il fallut ordonner une perquisitionouvrir des malles. J'avaisdéjà mes convictions sur la denraieet jecommençai par la malle de Nounou. Nonjamais le trou declocher de la pie voleusejamais creux d'arbre où un corbeaucollectionneur entasse le fruit de ses rapinesn'offrit si disparateassemblage d'objets brillants et inutiles ; des bouchons de carafe etdes boutons de portedes agrafesdes fragments de glacedesbobines sans fildes clousdes chiffons de soiedes rognuresdupapier à chocolatdes coloriages de magasins de nouveautésettout au fondsous la denréeles deux couverts devenusdenrée eux-mêmes.
Jusqu'audernier momentNounou refusa d'avouer ; elle protestait de soninnocencedéclarant qu'elle avait pris les couverts sanspenser à malpour s'en servir de corne a souliers.Pourtant elle ne voulut pas remettre son départ au lendemain.Elle avait peur qu'on ne se ravisâtqu'on n'envoyât «querir les gendarmes ». Il faisait nuitil pleuvait. Nous lavîmessilencieuseloucheredevenue sauvagesse pour de bondisparaître à pas de fauve sous la voûte del'escalierne voulant pas même qu'on l'aidât et traînantà deux mains sa mallelourde de la précieuse denrée.
Vousfigurez-vous votre enfant aux soins de pareilles brutes... Aussin'est-ce pas trop d'une surveillance de tous les instants. Si vouslaissiez faire la nourriceelle ne sortirait jamais Bébépour le mener boire le soleilrespirer l'air de verdure des squares.Parisau fondl'excède ; et elle préféreraitrester près du feusans lumièrel'enfant aux genouxle nez dans les cendres comme à la campagnedormantdesquatre heures durantde son lourd sommeil de paysanne. C'est lediable encore de l'empêcher de coucher le nourrisson avec elledans son propre lit. Pourquoi faireun berceau ? Ces bourgeoisvraiment ont des idéesdes exigences ! Ne vaudrait-il pasmieux l'avoir làtout prèset lui donner le sein sansse réveiller ni avoir froidquand il crie ? Il est vrai queparfois en se retournant on l'étouffe ; mais ces sortesd'accidents sont rares.
Et puisdes traditions de campagne assurent qu'un enfant de lait çamange de toutqu'on peut impunément le bourrer de poiresacides et de prunes vertes. Arrive une inflammationon court aumédecin et l'enfant meurt. D'autres fois encore pour unechutepour un coup non avouésce sont les convulsions ou laméningite... Ah ! comme nos Parisiennes feraient mieux desuivre les conseils de Jean-Jacques et de nourrir leurs enfantselles-mêmes ! Il est vrai que ce n'est pas facile toujours nipour toutesdans cet air anémiant des grandes villes qui faittant de mères sans lait.
Mais quepenser des bourgeoises provinciales quisans nécessitépar pure habitude d'insouciance et de paresseenvoient leurs enfantsen nourrice pour deux ou trois ans chez des paysans qu'elles n'ontjamais vus ? La plupart meurent. Ceux qui survivent reviennent àl'état d'affreux monstres que leurs parents ne reconnaissentpasaux allures rustiques de petits hommes à grosse voix etparlant des patois barbares.
Je merappelle qu'un jourme trouvant en provincedans le Midides amisme proposèrent une excursion au Pont du Gard. Il s'agissaitd'un déjeuner champêtre sur les galets de la rivièreà l'ombre des ruines. Justement « le petit » étaiten nourrice de ces côtéset nous devions le voir enpassant. Grande partieon invite des voisinson loue un omnibusetfouette dans le ventle soleilla poussière aveuglante etbrûlante. Au bout d'une heureen haut d'une côtenousapercevons de loinau milieu du chemin blanc comme la neigeunetache brune. La tache granditse rapproche. C'était lanourriceprévenuequi nous guettait. L'omnibus s'arrêtaon passa par la portière le petit qui piaulait.
«Comme il est beau !... Comme il vous ressemble !... Et autrementilva biennourricevotre petit : » Tout l'omnibus l'embrasses'attendritpuis on repasse par la portière le petit paquetbraillantet nous filons au galoplaissant l'enfant et la nourriceplantés au soleil dans la cendre embrasée et craquantede cette route du Midi.
C'estainsi qu'on fait les gars solides... direz-vous.
Je croisbien ; ceux qui résistent sont à l'épreuve.
NOTESSUR PARIS
LESSALONS RIDICULES
De toutesles folies du tempsil n'y en a pas de plus gaiede plus étrangede plus fertile en surprises cocassesque cette rage de soiréesde thésde sauteries qui sévit d'octobre en avril àtous les étages de la bourgeoisie parisienne. Même dansles plus modestes ménagesaux coins les plus retirésde Batignolles ou de Levallois-Perreton veut recevoiravoir unsalonun jour. Je connais des malheureux qui s'en vont chaque lundiprendre le thé rue du Terrier-aux-Lapins.
Passeencore pour ceux qui ont un intérêt quelconque àces petites fêtes. Ainsi les médecins qui s'établissentet veulent se faire connaître dans le quartierles parentssans fortune qui cherchent a marier leurs filles ; les professeurs dedéclamationles maîtresses de piano recevant une foispar semaine les familles de leurs élèves. Cessoirées-là sentent toujours un peu la classeleconcours. Il y a des murs nusdes sièges raidesdes parquetsciréssans tapisune gaîté de convention et dessilences si attentifs quand le professeur annonce : « MonsieurEdmond va nous réciter une scène du Misanthrope» ou « Mademoiselle Elisa va jouer une Polonaisede Weber ».
Mais àcôté de celacombien de malheureux qui reçoiventsans raisonsans profitsimplement pour le plaisir de recevoirdese bien gêner une fois la semaine et de réunir chez euxune cinquantaine de personnes qui s'en iront en ricanant. Ce sont dessalons trop petitstout en longueuroù les invitésassis et causantont l'attitude gênée de gens enomnibus ; des appartements transformésbouleversésavec des couloirsdes portièresdes paravents àsurpriseset la maîtresse de maison effarée qui vouscrie : « Pas par là ! » Quelquefois une porteindiscrète s'entr'ouvre et vous laisse apercevoir là-basdans un fond de cuisineMonsieur qui rentre harassé decoursestrempé de pluieessuyant son chapeau avec unmouchoirou dévorant à la hâte un morceau deviande froide sur une table encombrée de plateaux. On dansedans des corridorsdans des chambres à coucher toutesdémeubléeseten ne voyant plus rien autour de soique des lustresdes bras de bronzedes tenturesun pianoon sedemande avec terreur : « Où coucheront-ils ce soir ? »
J'ai connudans ce genre une maison très singulièreoù leschambres en enfiladeséparées chacune par deux outrois marchesfiguraient des paliers d'étagesi bien que lesinvités du fond paraissaient grimpés sur une estradeetde làhumiliaient les derniers arrivésrapetissésenfoncés jusqu'au menton dans les bas-fondsde la première pièce. Vous pensez si c'étaitcommode pour danser. N'importe ! Une fois par moisil se donnait làune grande soirée. On faisait venir les divans d'un petit caféd'en faceet avec les divans un garçon en escarpinsencravate blanchele seul des invités qui eût une chaîneet une montre en or. Il fallait voir la maîtresse de maisonaffoléedécoifféetoute rouge de tant depréparatifscourir après cet hommele poursuivre depièce en pièce en l'appelant : « Monsieur legarçon... Monsieur le garçon !... »
Et lepublic de ces soirées-là ! Ce public toujours le mêmequ'on rencontre partoutqui se connaîtse cherches'attire.Tout un monde de vieilles dames et de jeunes filles àtoilettes ambitieuses et fanées ; le velours est en cotonlapercaline joue la soieet l'on sent que toutes ces frangesdéfraîchiesces fleurs chiffonnéesces rubanspassésont été bâtisassortis àla diable avec cette phrase audacieuse : « Bah ! le soir çane se verra pas. » On se couvre de poudre de rizde fauxbijouxde dentelles menteuses : « Bah ! le soir ça nese verra pas... » Les rideaux n'ont plus de couleurlesmeubles s'éraillentles tapis s'effrangent. « Bah ! lesoir... » Et c'est comme cela qu'on peut donner des fêteset qu'on a la gloireà trois heures du matinde voir quatrefiacresattirées par l'éclat des bougiess'arrêterdevant la porte ; ce quidu restene sert pas à grand'chosecar en général tout ce monde s'en va à piedfaisantà des heures impossiblestoute la longue traite del'omnibus absentles jeunes filles au bras des pèreslessouliers de satin enfoncés dans les socques.
Oh ! quej'en ai vu de ces salons comiques ! Dans quelles soiréesbizarres j'ai promené mon premier habitalors queprovincialnaïfne connaissant la vie que par Balzacje croyais de mondevoir d'aller dans le monde ! Il faut avoir comme moi roulédeux hivers de suite aux quatre coins du Paris bourgeois pour savoirjusqu'où peut aller cette démence des réceptionsquand même. Tout cela est un peu vague dans ma mémoire :pourtant je me souviens d'un petit appartement d'employéunsalon tout biscornu où l'on était obligépourgagner de la placede mettre le piano devant la porte de la cuisine.On posait les verres à sirop sur les cahiers de musique etquand on chantait des romances attendrissantesla bonne venaits'accouder sur le piano pour écouter.
Comme elleétait prisonnière dans la cuisinecette malheureusebonnec'est Monsieur qui se chargeait du service extérieur.Je le vois encoretout grelottant dans son habit noirremonter dela cave avec d'énormes blocs de charbon de terre enveloppésdans un journal. Le papier crèvele charbon roule sur leparquetet pendant ce temps on continue à chanter au piano :« J'aime entendre la ramele soirbattre les flots. »
Et cetteautre maisonce cinquième étage fantastique oùle carré servait de vestiairela rampe de porte manteauoùles meubles dépareillés s'entassaient tous dans unepièce uniquela seule qu'on pût éclairer etchaufferce qui ne l'empêchait pas de rester obscure et glacéemalgré toutà cause de l'abandonde la misèrequ'on sentait rôdant tout autour dans le désert despièces vides. Pauvres gens ! vers onze heuresils vousdemandaient bien naïvement : « Avez-vous chaud ?...Voulez-vous vous rafraîchir ?... » et ils ouvraient lesfenêtres toutes grandes pour laisser entrer l'air du dehors enguise de rafraîchissement. Après toutcela valait mieuxencore que les sirops à couleurs vénéneuseslespetits-fours poussiéreux conservés si soigneusementd'une semaine à l'autre. N'ai-je pas connu une maîtressede maison quichaque mardi matinmettait à sécher sursa fenêtre des petits paquets de thé mouilléqu'elle faisait resservir deux ou trois lundis de suite ? Oh ! quandles bourgeois se mêlent d'être fantaisisteson ne saitjamais où ils s'arrêteront. Nulle partmême enpleine bohèmeje n'ai rencontré de types aussibizarres que dans ces milieux-là.
Je merappelle une dame en blancque nous appelions la dame auxgringuenotes parce qu'elle se plaignait toujours en soupirantd'avoir des gringuenotes dans l'estomac !... Personne n'ajamais su ce qu'elle voulait dire.
Et cetteautreune grosse mèremariée à un répétiteurde droitqui amenait toujours avec elle pour la faire danser desélèves de son maritous étrangersun Moldaveentortillé de fourruresun Persan à grande jupe.
Et ceMonsieur qui mettait sur ses cartes « touriste du monde»pour dire qu'il avait fait le tour du monde !
Etdansun salon de parvenuscette vieille paysanne aux trois quarts sourdeet idiotetoute fagotée dans sa robe de soieà qui safille venait dire en minaudant : « MamanM. un tel va nousréciter quelque chose. » La pauvre vieille s'agitaitsans comprendre sur sa chaiseavec un sourire niaiseffaré :« Ah ! bien... bien... » C'est dans cette mêmemaison qu'on avait la spécialité des parents de grandshommes. On vous annonçait en grand mystère : «Nous aurons ce soir le frère d'Ambroise Thomas »oubien encore « un cousin de Gounod »ou « la tantede Gambetta ». Jamais Gambetta ni Gounodpar exemple. C'estencore là... mais je m'arrêtela série estinépuisable.
ENPROVINCE
UNMEMBRE DU JOCKEY-CLUB
Aprèsdînerces braves Cévenols avaient tenu à memontrer leur cercle. C'était l'éternel cercle de petitevillequatre pièces en enfilade au premier d'un vieil hôtelqui avait vue sur le mailde grandes glaces passéesducarrelage sans tapiset çà et là sur lescheminées -- où traînaient des journaux de Parisdatés de l'avant-veille -- des lampes de bronzeles seules dela ville qu'on ne soufflât pas au coup de neuf heures.
Quandj'arrivaiil y avait encore très peu de monde. Quelques vieuxronflaientle nez dans leur journalou jouaient au whistsilencieusementet sous la lumière verte des abat-jourcescrânes chauves penchés l'un vers l'autreles jetonsentassés dans leur petite corbeille en chenilleavaient lemême ton matjaunepoli du vieil ivoire. Dehorssur le mailon entendait sonner la retraiteet le pas des promeneurs quirentraientdispersés par les rues en penteles marches deniveaules rampes de cette ville montagnarde à plusieursétages... Après quelques derniers coups de marteaujetés aux portes dans le grand silencela jeunesse délivréedes repas et des promenades de famille monta bruyamment l'escalier ducercle. Je vis entrer une vingtaine de solides montagnards gantésde frais avec des gilets échancrésdes cols ouverts etdes essais de frisure à la russequi les faisaient ressemblertous à de grosses poupées fortement coloriées.C'était ce que vous pouvez imaginer de plus comique. Il mesemblait que j'assistais à une pièce trèsparisienne de Meilhac ou de Dumas filsjouée par des amateursde Tarascon et même plus loin. Toutes les lassitudesles airsennuyésdégoûtésce parler veule qui estle suprême chic du cocodès parisienje les retrouvais àdeux cents lieues de Parisexagérés encore par lamaladresse des acteurs. Il fallait voir ces gros garçonss'aborder d'une mine languissante : « Comment vamon bon ? »s'allonger sur les divans dans des poses accabléess'étirerles bras devant les glaces et dire avec l'accent du cru : «C'est infect... C'est crevant... » Chose touchante ! ilsappelaient leur cercle le clobqu'en bons méridionauxils prononçaient clab. On n'entendait que cela... Legarçon du clables règlements du clab...
J'étaisà me demander comment toutes ces démences parisiennesavaient pu venir là et s'implanter dans l'air vif et sain dela montagnequand je vis paraître la jolie tête pâlotteet toute frisée du petit duc de M***membre du Jockey-Clubdu Rowing-Clubde l'écurie Delamarre et de plusieurs autressociétés savantes. Ce jeune gentilhomme que sesextravagances ont rendu célèbre sur le boulevardvenait de croquer en quelques mois l'avant-dernier million de lasuccession paternelleet son conseil épouvanté l'avaitenvoyé se mettre au vert dans ce coin perdu des Cévennes.Je compris alors les airs alanguis de cette jeunesseses gilets encoeursa prononciation prétentieuse : j'avais maintenant sonmodèle sous mes yeux.
A peineentréle membre du Jockey Club fut entouréfêté.On répétait ses motson imitait ses gestessesattitudessi bien que cette pâle image de gandintiréemaladivemais distinguée en dépit de toutsemblaitreflétée tout autour dans de grossières glacesde campagne qui exagéraient ses traits. Ce soir-làsans doute pour me faire honneurM. le Duc parla beaucoup théâtrelittérature. Avec quel dédainquelle ignorance ! Ilfallait l'entendre appeler Emile Augier « ce M'sieu !... etDumas fils « le petit Dumas ». C'était àpropos de tout des idées très vagues flottant dans desphrases inachevées où les machinchosemachinremplaçaient les mots qu'il ne trouvait paset tenaient lieude ces petits points dont abusent les auteurs dramatiques qui nesavent pas écrire. En somme ce jeune gentilhomme ne s'étaitjamais donné la peine de penser ; seulement il avait frôlébeaucoup de monde et de chacun emporté des expressionsdesjugements gardés à fleur de tête et qui faisaientpartie de lui-même comme les boucles de frisure ombrant sonfront délicat. Ce qu'il connaissait à fondparexemplec'était la science héraldiqueles livréesles fillesles chevaux de courseset là-dessus les jeunesprovinciaux dont il faisait l'éducation étaient devenuspresque aussi savants que lui.
La soiréese traîna ainsi dans les bavardages de ce palefreniermélancolique. Vers dix heuresles vieux étant partiset les tables de whist désertéesla jeunesse àson tour s'attabla pour tailler un petit bac. C'était de règledepuis l'arrivée du duc. J'avais pris place dans l'ombre surun coin du divanet de là je voyais très bien tous lesjoueurs sous la lueur abaissée et restreinte des lampes. Lemembre du Jockey trônait au milieu de la tablesuperbeindifférenttenant ses cartes avec une grâce parfaiteet s'inquiétant peu de perdre ou de gagner. Ce décavéde la vie parisienne était encore le plus riche de la bande.Mais euxles pauvres petitsquel courage il leur fallait pourdemeurer impassibles ! A mesure que la partie s'échauffaitjesuivais curieusement l'expression des visages. « Je voyais leslèvres tremblerles yeux se remplir de larmeset les doigtsse crisper rageusement sur les cartes. Pour dissimuler leur émotionles perdants jetaient au travers de leur déveine des «je m'emballeje m'embête »mais dans ce terrible accentdu Miditoujours significatif et inexorableces exclamationsparisiennes n'avaient plus le même air d'aristocratiqueindifférence que sur les lèvres du petit duc.
Parmi tousles joueurs il y en avait un surtout qui m'intéressait.C'était un grand garstrès jeunepoussé tropviteune bonne grosse tête d'enfant à barbenaïveinculteprimitivemalgré les frisures Demidoffet oùtoutes les impressions se lisaient à visage ouvert. Cegarçon-là perdait tout le temps. Deux ou trois fois jel'avais vu se lever de la table et sortir vivement ; puisau bout dequelques minutesil revenait prendre sa placetout rougetoutsuantet je me disais : « Toitu viens de raconter quelquehistoire à ta mèreà tes soeurs pour avoir del'argent. » Le fait est que chaque foisle pauvre diablerentrait les poches pleines et se remettait au jeu avec fureur. Maisla chance s'acharnait contre lui. Il perdaitil perdait toujours. Jele sentais crispéfrémissantn'ayant plus mêmela force de faire bon visage à la mauvaise fortune. A chaquecarte qui tombaitses ongles s'enfonçaient dans la laine dutapis : c'était navrant.
Peu àpeu cependanthypnotisé par cette atmosphèreprovinciale d'ennui et de désoeuvrementtrès las ausside mon voyageje n'aperçus plus la table de jeu que comme unevision lumineuse très vaguetrès effacéeet jefinis par m'endormir à ce murmure de voix et de cartesremuées. Je fus réveillé tout à coup parun bruit de paroles irritéessonnant haut dans les sallesvides. Tout le monde était parti. Il ne restait plus que lemembre du Jockey Club et mon grand garçon de tout àl'heuretous les deux attablés et jouant. La partie étaitsérieuseun écarté à dix louis ; et rienqu'à voir le désespoir qui gonflait cette bonne grosseface de boule-dogueje compris que le montagnard perdait encore.
« Marevanche ! » criait-il de temps en temps avec colère.L'autretoujours calmelui faisait tête ; et à chaquenouveau coup il me semblait qu'un méchant sourire dédaigneuxpresque imperceptibleplissait sa lèvre aristocratique.J'entendis annoncer « la belle ! » puis un violent coupde poing sur la table ; c'était finile malheureux avait toutperdu.
Il restaun moment atterréregardant ses cartes sans rien direavecsa redingote en coeur toute remontéesa chemise froisséemouillée comme s'il venait de se battre. Puis tout àcoupvoyant le duc ramasser les pièces d'or disperséessur le tapisil se leva avec un cri terrible : « Mon argentN. de D. ! rendez-moi mon argent ! » et aussitôtcommeun enfant qu'il était encoreil se mit à sangloter : «Rendez-le-moi... rendez-le-moi ! » Ah ! je vous répondsqu'il ne zézayait plus. Sa voix naturelle lui étaitrevenuenavrante comme celle des êtres très forts chezqui les larmes arrivent par paquets et sont une vraie souffrance.Toujours froidtoujours ironiqueson partenaire le regardait sanssourciller... Alors le malheureux se mit à genouxet toutbasd'une voix tremblante : « Cet argent n'est pas àmoi... je l'ai volé... Mon père me l'avait laissépour payer une échéance. » La honte l'étranglaitil n'acheva pas...
Au premiermot d'argent volé le duc s'était levé. Un peud'animation montait à ses joues. La tête avait pris uneexpression de fierté qui lui allait très bien. Il vidases poches sur la tableetquittant lui aussi pour une minute sonmasque de gandinil dit d'une voix naturelle et bonne : «Reprends donc çaimbécile... Est-ce que tu crois quenous jouions sérieusement ? »
J'auraisvoulu l'embrasserce gentilhomme !
LESCOURSES DE GUERANDE
Etd'abordarrêtons-nous un peu dans cette charmante et rarepetite ville de Guérandesi pittoresque avec ses anciensremparts flanqués de grosses tours et ses fossésremplis d'eau verte. Entre les vieilles pierresles véroniquessauvages fleurissent en gros bouquetsdes lierres s'accrochentdesglycines serpententet des jardins en terrasse suspendent au borddes créneaux des massifs de roses et de clématitescroulantes. Dès que vous vous engouffrez sous la poterne basseet ronde où les grelots des chevaux de poste sonnentjoyeusementvous entrez dans un nouveau paysdans une époquevieille de cinq cents ans. Ce sont des portes cintréesogivalesd'antiques maisons irrégulières dont lesderniers étages surplombent les plus basavec des lignes dansla pierredes ornements frustes et rongés. Dans certainesruelles silencieuses s'élèvent de vieux manoirs auxhautes fenêtres éclairées de vitres étroites.Les portes seigneuriales sont ferméesmais entre leurs aisdisjoints on aperçoit le perron envahi de verduredes touffesd'hortensias à l'entréeet la cour pleine d'herbeoùquelque puits effritéquelque débris de chapelle metencore un amas de pierres et de vertes floraisons. Car c'est làle caractère de Guérandeune ruine coquette et toutefleurie.
Parfoisau-dessus d'un marteau usé et vénérablel'enseigne d'un bureau de postedes panonceaux d'huissier ou denotaire s'étalent bourgeoisement ; maisle plus souventcesanciennes demeures ont gardé leur cachet aristocratiqueeten cherchant bienon retrouverait quelques grands noms de Bretagneenfouis dans le silence de ce petit coinqui est à lui seultout un passé. Un silence rêveur habite làeneffet. Il rôde autour de cette église du quatorzièmesiècleoù des marchandes de fruits abritent leurséventaires et tricotent sans parler. Il plane sur cespromenades désertesces fossés d'eau dormantecesrues calmes que traverse de temps en temps une pastoure conduisant savachepieds nusle corsage serré d'une corde et la coiffe deJeanne d'Arc.
Le jourdes coursespar exemplel'aspect de la ville est tout différent.C'est un va-et-vient de voitures amenant des baigneurs et desbaigneuses du Croizicdu Pouliguen. Des charrettes chargéesde paysansde grands carrosses antiques qui ont l'air de sortir d'unconte de féesdes carrioles de louage où se juche unevieille douairière des environs entre sa chambrière encoiffe et son page en sabots.
Tout celaest arrivé le matin pour l'heure de la grand'messe. Le son descloches tombe dans les rues étroitesmêlé auxcoups de ciseaux des barbiers ; et l'église pleine fait laville déserte pour deux heures. A midiau premier coup del'Angelusles portes s'ouvrent et la foule envahit la petiteplaceaux psalmodies des mendiants groupés sous le porche etdont les voix éclatent en même temps. C'est une mélopéebizarre sur toutes sortes de chants d'église : LitaniesCredoPater Noster ; un étalage de plaiesd'infirmitésune léproserie du moyen âge. Lafoule contribue à cette illusion d'archaïsme : les femmesont des coiffes blanches terminées en pointe avec un bourreletde broderies au-dessus des bandeaux platset des barbes flottantesou de longs bavolets tuyautés pour les pêcheuses et lessaunièresdes jupes plissées à gros plisdesguimpes rondes autour du cou. Les hommes ont deux costumes biendifférents ; les métayers portent la veste courtelecol montant et un foulard de couleur posé en jabot qui lescrête en coqs de village. Les paludiers sont vêtusde l'ancien costume guérandaisla longue blouse blanchedescendant jusqu'à mi-jambeles braies blanches aussiserrées de jarretières au-dessus du genou et letricorne noir orné de chenilles de couleur et de bouclesd'acier. Ce chapeau se place sur la tête de différentesfaçons. Les gens mariés le portent « en bataille» comme les gendarmes ; les veufsles garçons entournent les pointes d'autre manière. Tout ce mondes'éparpille dans les vieilles rues et se réunit uneheure après au champ de coursesà un kilomètrede la villedans une plaine immense que domine l'horizon.
Destribunesle coup d'oeil est merveilleux. La merau fondtoutevertesemée d'écume blanche ; plus prèslesclochers du Croizicdu bourg de Batzet les salines qui brillent etmoutonnent au soleil dans les coupures luisantes des marais. La foulearrive de tous côtés à travers champs. Lesbéguins blancs apparaissent au-dessus des haies ; les garss'avancent par bandesbras dessus bras dessousen chantant de leursvoix rauques. L'allurela chansontout est naïfprimitifpresque sauvage. Sans nul souci des messieurs en chapeau quiregardentles femmes qui passent devant nousle fichu de moirecroisé sur leurs guimpesont la tenue réservéeet pas la moindre affectation coquette. On est venu pour voirdameoui ! mais non point pour se faire voir... En attendant les coursestout ce peuple se presse derrière les tribunesautour desgrandes baraques où l'on vend du vin et du cidreoùl'on frit des gaufres et des saucisses en plein soleil. Enfinlafanfare guérandaise qui arriveentourée de nouvellesbandes bruyantes et chantantesinterrompt pour un moment lesbuveries. Chacun court se placer pour le spectacle ; et dans cedébordement de gens qui s'éparpillent autour du champde coursessur le bord des fossés et des sillons moissonnésla longue blouse blanche des paludiersqui les granditles faitressembler de loin à des dominicains ou à desprémontrés. D'ailleurs tout ce côté de laBretagne vous donne un peu l'impression d'un grand couvent. Letravail lui-même y est silencieux. Pour arriver àGuérandenous avons traversé des villages muets malgréla grande activité de la moissonet partout sur notrepassageles batteusesles fléaux s'agitaient en mesuresansla moindre excitation de chants ou de paroles. Aujourd'huicependantles gaufresle cidre et les saucisses ont déliéla langue des garset tout le long de la piste il se fait un joyeuxvacarme. Les courses de Guérande sont de deux sortes : il y ad'abord la course citadineun de ces steeple-chases de provincecomme nous en avons vu cent fois. Des cartes vertes aux chapeauxquelques rares voitures rangées dans l'enceintedes effetsd'ombrelles et de robes traînantesle tout àl'imitation de Paris ; cela ne peut être intéressantpour nous ; mais les courses de mulets et de chevaux du pays nous ontsingulièrement amusé. C'est le diable de mettre enligne ces petits mulets bretons doublement entêtés. Lamusiqueles crisle bariolage des tribunes les effrayent. Il y en atoujours quelqu'un qui emporte son cavalier en sens contraireet ilfaut du temps pour le ramener. Les gars qui les montent ont desbonnets catalans de couleur écarlatela veste pareilledegrandes braies courtes et flottantesles jambes et les pieds nus ;pas de sellesseulement des brides que les mulets tirent de côtéavec un mauvais vouloir remarquable. Enfin les voilà partis.On les aperçoit dans la plainelancés au grand galop.Les casaques rouges sont terriblement secouéeset les jambesdroites et tendues s'efforcent de maintenir la monture dans la lignetracée par les cordes. Au tournant surtoutplus d'un cavaliers'en va rouler sur l'herbe de l'enceinte ; mais la course n'est pasinterrompue pour cela. Le paludierpropriétaire de l'animals'élance aussitôtlaisse son malheureux jockey serelever tout seul etdans sa grande blouse qu'il n'a pas eu le tempsde quitterenfourche lui-même sa bête. On souritdédaigneusement sur les tribunes ; mais là-baslepeuple bretonperché dans les arbresrangé dans lesfosséstrépigne de joie et pousse d'énergiquesacclamations. Chacun naturellement prend parti pour les bidets de sacommune. Les gens du bourg de Batzde Saillédu Pouliguend'Escoublacde Piriacguettent les pays au passageexcitent lescavalierssortent même des rangs pour taper sur les mules àgrands coups de chapeaux et de mouchoirs. Il n'est pas jusqu'auxcoiffes blanches qui ne se dressent tout à coupenpapillonnant au vent de merpour voir passer Jean-Marie Mahéou Jean-Marie Madecou quelque autre Jean-Marie. Après lesmuletsviennent les chevaux et les juments du paysun peu moinstêtusun peu moins sauvagesmais pleins d'ardeur tout de mêmeet se disputant vaillamment le prix de la course. Leur trotretentissant laboure la terre de la piste ; et pendant qu'ilscourenton voit au delàsur la mer secouée par unvent terribleune voile de pêcheur qui cingle péniblementvers le Croizic. Le spectacle reçoit de ce voisinage unegrandeur extraordinaire ; et les chevauxles voitures roulant auretour sur la routeles groupes disséminés àtravers la plainetout se détache sur un fond verdâtreet mouvantun horizon plein de vie et d'immensité.
Quand nousrentrons à Guérandele jour commence à baisser.On prépare des illuminationsdes lanternes de couleur dansles grands arbres des promenadesun feu d'artifice sur la place del'égliseune estrade au bas des remparts pour les joueurs debiniou. Mais voilà qu'une méchante petite pluieaiguëet fine comme du grésilvient déranger la fête.Tout le monde se réfugie dans les hôtelleriesdevantlesquellesles charrettesles voitures dételées etruisselantesstationnent les brancards en l'air. Pendant une heurela ville est silencieuse ; puis les bandes de tantôt traversentles rues noires en chantant. Les grandes coiffes et les petits châlesverts se hasardent dehors deux par deux. On a parlé de danserun branleet on le dansera malgré la pluie. Ah dame ! ouidame !... Bientôt toute cette jeunesse s'installe àdroite et à gauche dans les salles basses des cabarets. Lesuns dansent au son des biniousles autres « au son des bouches»comme ils disent par ici. Les planchers tremblentleslampions sont épaissis de poussièreet le mêmerefrain lent et mélancolique retentit partout lourdement.Pendant ce tempsles voituresles carrioles s'écoulent parles cinq portes de la ville. Les vieux manoirs se refermentet lesbroussailles fleuries qui garnissent les remparts semblent dans lanuit grandirse rejoindrese confondrecomme sous la baguette desfées les buissons enchantés qui entouraient le châteaude la Belle au bois dormant.
UNEVISITE A L'ILE DE HOUAT
Une bellelumière d'étéégale et limpideachevaitde se lever dans la baie de Quiberoncomme nous mettions le pied surle bateau-pilote destiné à nous conduire à l'îlede Houat. La brisetoujours éveillée sur quelque pointde cet horizon de merpoussait la voile droit au but et nousarrivait en rasant les vagues qu'elle fronçait d'un frissonserré.
Au loindes côtes se devinaient à quelque plage de sableàquelque maison blanche subitement frappée de soleiléclatantes entre le bleu nuancé des vagues et le bleumonotone du ciel où couraient seulement ces nuéeslégèresfouettéeseffrangéesque lesmarins appellent ici des « queues de cheval »et quiprésagent un vent frais pour le soir.
Latraversée nous a semblé courte.
Rien deplus uniforme en apparence que la mer par un beau temps ; des vaguesqui se succèdent d'un rythme égalse brisent au bateauen mousses murmurantess'enflentse creusentremuées parune lourdeur inquiète où l'orage est latent ; etpourtant rien de plus varié. Tout prend une valeur énormesur cette surface douée de mouvement et de vie. Ce sont desnavires au largele paquebot-poste de Belle-Isle qui passe au loinsa fumée en panachedes barques de pêche avec leursvoiles blanches ou trempées de tandes troupes de marsouinsroulant sur le flot que coupe leur nageoire aiguëpuis desîlots d'où s'envolent tumultueusement des tourbillons demouettes ou quelque troupe de cormorans avec leurs larges ailesd'oiseaux de proie faites pour planer et pour fuir.
Enpassantnous longeons le phare de la Teignouseperché sur unrocher ; et quoique notre vitesse soit très grandenous avonsune vision très nette du récif et des deux vieshumaines qui s'y abritent. Au moment où nous passonsl'un desgardienssa blouse toute gonflée par le ventdescend lapetite échelle de cuivre à pic sur l'îlot et quisert d'escalier extérieur. Son compagnonassis dans un creuxde rochepêche mélancoliquement ; et la vue de ces deuxsilhouettes si menues dans l'étendue environnantelamaçonnerie blanche du pharesa lanterne blafarde àcette heureles poids de la grosse cloche à vapeur qui sonnepar les nuits de brumetous ces détails entrevus suffisent ànous donner une impression frappante de cet exil en pleine mer et del'existence des gardiens enferméspendant des semainesdanscette tourelle de tôle sonore et creuse où la mer et levent répercutent leur voix avec une férocité sigrandeque les hommes en sont réduits à se crier dansl'oreille pour se faire entendre l'un de l'autre.
Une foisle phare doublél'île de Houat commence à nousapparaître peu à peuà élever au-dessusdes houles de la mer sa terre rocheuse où le soleil jette unmirage de végétationdes teintes de moissons mûresdes veloutés de prés en herbe.
A mesureque nous approchonsl'aspect changele terrain véritableapparaîtdésolébrûlé de soleil etde merhérissé de hauteurs farouches ; àdroiteun fort démanteléabandonné ; àgaucheun moulin gris qui nous donne la vitesse des brises de terreet quelques toits très bas groupés autour de leurclocher ; tout cela morneespacésilencieux. On croiraitl'endroit inhabitési des troupeaux épars sur lespentesdans les vallons rugueux de l'îlene se montraient deloinerrantscouchés ou broutant de maigres végétationssauvages.
Descriques de sable découpent de distance en distance des courbesclaires et moelleuses parmi la désolation des roches. C'estdans une de ces criques que nous débarquonsnon sans peinecar à la marée basse le bord manque de fond pour lachaloupeet l'on est obligé de nous déposer sur despierres mouillées et glissantes où le goémonaccroche ses longues chevelures vertes que l'eau déroule etdilatemais qui s'amassent pour le moment en lourds paquets gluantssur lesquels le pied manque à chaque pas. Enfinaprèsbien des effortsnous nous hissons sur les hautes falaises dominanttout l'horizon d'alentour.
Par cetemps clair qui rapproche les côtesle coup d'oeil estadmirable. Voici le clocher du Croisiccelui du Bourg-de-Batz àdix ou douze lieues de meret toute la dentelure du MorbihanSaint-Gildas-de-Rhuizles rivières de Vannes et d'AurayLocmariaquerPlouharmelCarnacle Bourg-de-Quiberon et les petitshameaux qu'il éparpille tout le long de la presqu'île.Du côté opposéla ligne sombre de Belle-Isle seprolonge vers la mer sauvageet les maisons du Palais reluisent dansune éclaircie. Mais si la perspective des alentours s'estagrandiecelle de Houat est à cette heure tout à faitperdue pour nous. Le clocherle fortle moulintout a disparu dansles plis d'un terrain houleux et tourmenté comme le flot quil'entoure. Nous nous dirigeons cependant vers le village par unsentier tortueuxgaranti entre ces traîtres petits mursbretonsconstruits en pierre platepleins d'embranchements et dedétours.
Cheminfaisantnous remarquons la flore de l'îleétonnantesur ce rocher battu des vents : les lys de Houatdoubles etodorants comme les nôtresde larges mauvesdes rosiersrampants et l'oeillet maritime dont le parfum léger et finforme une harmonie de nature avec le chant grêle des alouettesgrises dont l'île est remplie. Des champs de blé fraiscoupé et de pommes de terre s'étendent autour de nousmais dans toutes les terres en jachèrela landela tristelandesolidearméecourtescalades'attachefleurie dejaune parmi ses épines. A notre approcheles troupeaux sedétournent ; les vaches habituées à la coiffeplate et au chapeau du Morbihannous suivent longtemps de leurs grosregards immobiles. Partout nous rencontrons le bétail groupédispersélibre d'entraves et de toute surveillance.
Enfindans un pli du solabrité des ouragans et des embruns de merle village se découvre avec ses toits bas et pauvres serrésl'un contre l'autrecomme pour faire tête au vent et séparésnon pas par des ruellesdont la ligne droite livrerait passage àla tempêtemais par des carrefoursdes petites placescapricieusement ménagées quidans le mois oùnous sommesservent d'aire pour le battage de la moisson.
Deschevaux à demi sauvagesdont la race rappelle un peu celledes Camarguaisunis par deux ou par troistournent étroitementdans ces cirques inégauxfoulant le grain qui fait voltigersa poussière au soleil. Une femme les dirigeune poignéede paille à la main ; d'autresarmées de fourchesrepoussent le blé tout autour de l'aire. Rien de frappant dansle costume : de pauvres vêtements sans dessins et décolorésdes fichus jaunis abritant des figures terreuses et hâlées; mais la scène elle-même est d'un pittoresque primitif.Il monte de là des hennissementsdes froissements de pailledes voix claires où sonnent les dures syllabes gutturales duparler breton.
Tel qu'ilestce pauvre village morbihannais vous fait penser à quelquedouar africain ; c'est le même air étouffévicié par le fumier qu'on entasse sur les seuilsla mêmefamiliarité entre les bêtes et les gensle mêmeisolement d'un petit groupe d'êtres au milieu d'une immenseétendue ; de plusles portes sont bassesles fenêtresétroitesnulles même sur les murs regardant la mer. Onsent bien la misère en lutte contre les élémentsennemis.
Les femmesmoissonnent avec fatigues'occupent des bestiaux ; les hommespêchent dans le danger. En ce moment tous sont à la merà part un vieuxgrelottant de fièvreque nous voyonsassis devant sa roue de cordierpuis le meunier étranger àl'île et que la commune paye au moiset enfin M. le curéle plus haut personnage de l'île de Houat et sa véritableoriginalité. Ici le prêtre réunit tous lespouvoirsabsolument comme un capitaine à son bord. A sonautorité sacerdotale il ajoute celle de ses fonctionsadministratives. Il est maire-adjoint dans le villagesyndic desgens de mer ; il a aussi la surveillance des ouvrages militairesforts ou fortinsconstruits dans l'îleet quien temps depaixsont dépourvus de gardien. Qu'une contestation s'élèveentre marinsà propos d'un casier de homardsd'unedistribution de part de pêchevoici M. le curé passéjuge de paix. Qu'on fasse un peu trop de tapage à l'auberge ledimanche soirvite il roule une écharpe sur sa soutaneetremplit à l'occasion les fonctions de garde champêtre.
Il n'y apas longtemps mêmeil descendait à des emplois encoreplus infimes. Il avait le monopole des boissons et les faisaitdistribuer par une soeur à travers un guichet. Il avait aussila clef du four banal où chacun vient cuire son pain.C'étaient là des précautions d'exillaréglementation des vivres de mer introduite sur cette îlelivrée au hasard des flots comme un navire.
Depuistrois ou quatre ansles antiques usages se sont un peu modifiés; mais le principe en est toujours vivantet le curé actuelde l'îleun homme intelligent et vigoureuxnous paraîtde force à faire respecter son autorité multiple. Ilhabiteprès de l'égliseun modeste presbytèreque deux peupliersun figuier superbeun jardin de fleursquelquespoules errantes transportent en plein continent.
A côtéde la curel'école mixte pour les garçons et pour lesfillesdirigée par des religieuses qui se chargent aussi dedistribuer à tous ces pauvres gens des médicamentsdessoins et des conseils.
Dans lamaison des soeurs vient aboutir aussi le télégraphesous-marin qui relie Houat à Belle-Isle et au continent. C'estune soeur qui reçoit et transmet les dépêches ;vuen passantsa cornette empesée penchée derrièrela vitre sur l'aiguille électrique. Nous recevons encored'autres renseignements assez curieux touchant l'île de Houatet sa populationdans la petite salle à manger blanchie àla chaux avec toutes ses poutres apparentesoù M. le curénous introduit et nous fait asseoir. Il n'y a pas de pauvres àHouat. Un fonds communal fournit à tous le nécessaire.Le poisson abonde sur la côteles pêcheurs vont levendre au Croizic ou à Aurayet le vendent toujours fort bien; mais l'absence d'un mouillage sûr au long de cette côtebordée de rochersempêche les Houatais d'êtreparfaitement heureux. Il n'est pas raredans les gros tempsque leschaloupes soient obligées de se jeter au large pour chercherun abri au hasard des plus grands dangers. Quelquefois mêmedans le port mal protégé par une courte jetéeprimitivement construitedes accidents arrivent. Aussi la seuleambition du curé de Houat est-elle d'obtenir un mouillage pourles sept chaloupes qui composent la marine du pays. Nous l'avonsquitté sur cette espérance.
En sortantdu villagenous passons devant l'église où la merreflétée met des vitraux d'un bleu changeant : nousnous arrêtons un moment dans le petit cimetièreincultesilencieuxdont les rares croix noires semblent des mâtsau port dans l'horizon qui nous entoureet comme nous nous étonnonsdu petit nombre d'inscriptions et de tombes enfermées dans uncimetière si ancienon nous apprend que jusqu'à l'andernier-- c'est encore un effet des moeurs maritimes de l'îlede Houat-- on avait toujours creusé le sol au hasard etrendu à la terre des morts anonymesainsi que dans leslongues traversées on les livre au flot qui passe...